LE SURHOMME
 Au commencement vint le
surhomme. Comme dans le premier récit de la Genèse, la création de
l’homme devait spécifier la nature de la seconde, la femme; il en
alla ainsi de la sous-humanité. C’est de l’idée de surhumanité
que devait découler la race des sous-hommes. Cette
auto-contemplation narcissique des mâles Occidentaux s’est
élaborée tout au long du XIXe siècle avec des personnages, réels
ou fictifs, historiques ou romancés, qui contribuèrent à façonner
l’idée de ce que pouvait être l’humain poussé à ses
perfections jusqu’à la frontière du divin qu’il devait
remplacer : «On
intoxique souvent aujourd’hui les jeunes gens avec des sermons où
il est dit que dans la vie il n’y a que la lutte la plus brutale
qui compte, que si on ne veut pas succomber, il faut se méfier des
hommes, voir dans chacun un concurrent capable, à chaque instant, de
se jeter sur vous et de vous réduire à sa merci, que pour réussir
il faut être prêt à faire de même, etc. Le type d’un
“surhomme”, au-dessus de la morale sociale, est prôné comme un
idéal. Avouons qu’il y a là un germe de vérité…».1
Cette observation de Tchakhotine, dans son livre Le
viol des foules, décrit
ce qu’en était venu l’ensemble de la pensée occidentale au
sortir de la seconde Révolution industrielle et du darwinisme
social. Ce surhomme ne ressemble plus du tout à ce qu’en attendait
le Zarathoustra
de Nietzsche :
Au commencement vint le
surhomme. Comme dans le premier récit de la Genèse, la création de
l’homme devait spécifier la nature de la seconde, la femme; il en
alla ainsi de la sous-humanité. C’est de l’idée de surhumanité
que devait découler la race des sous-hommes. Cette
auto-contemplation narcissique des mâles Occidentaux s’est
élaborée tout au long du XIXe siècle avec des personnages, réels
ou fictifs, historiques ou romancés, qui contribuèrent à façonner
l’idée de ce que pouvait être l’humain poussé à ses
perfections jusqu’à la frontière du divin qu’il devait
remplacer : «On
intoxique souvent aujourd’hui les jeunes gens avec des sermons où
il est dit que dans la vie il n’y a que la lutte la plus brutale
qui compte, que si on ne veut pas succomber, il faut se méfier des
hommes, voir dans chacun un concurrent capable, à chaque instant, de
se jeter sur vous et de vous réduire à sa merci, que pour réussir
il faut être prêt à faire de même, etc. Le type d’un
“surhomme”, au-dessus de la morale sociale, est prôné comme un
idéal. Avouons qu’il y a là un germe de vérité…».1
Cette observation de Tchakhotine, dans son livre Le
viol des foules, décrit
ce qu’en était venu l’ensemble de la pensée occidentale au
sortir de la seconde Révolution industrielle et du darwinisme
social. Ce surhomme ne ressemble plus du tout à ce qu’en attendait
le Zarathoustra
de Nietzsche :«Quand vint Zarathoustra en la plus proche ville, qui se situe à la lisière des forêts, il y trouva nombreux peuple assemblé sur la place publique; car annonce était faite qu’on allait voir un funambule. Et voici le cours que tient au peuple Zarathoustra :
Cet évangile de Zarathoustra marque la naissance non seulement du surhomme comme personnage normatif, mais aussi de l’idée de surhumanité érigée directement contre ce monde satisfait dont il procède et dont il assume le déclin. Jusqu’à Nietzsche, en effet, le surhomme n’était que le héros, le grand homme vanté par l’historien Carlyle ou l’économiste libéral victorien, Walter
 Bagehot (1826-1877), qui : «estimait
encore que la disparition de ce qu’il avait baptisé du nom de
corpus de coutumes*
- une formule qui devait connaître un certain succès - ne
manquerait pas de provoquer le déclin du fanatisme, l’ouverture
aux idées nouvelles ainsi que l’apparition d’un homme nouveau
combinant énergie et contrôle de soi, vitalité et raison - en un
mot, d’une créature douée de ce qu’il appelait la
modération dynamique.
Les autres, tel Carlyle, pouvaient bien considérer cette évolution
comme un affaiblissement de l’énergie, Bagehot, lui, la
considérait comme un signe avant-coureur et bienvenu de la
disparition
des pulsions héréditaires et barbares dont le déclin ne pouvait
que préfigurer l’extinction.
Bien qu’il se montrât préoccupé de l’évolution vers la
démocratie que l’on constatait à son époque, Bagehot se voulait
confiant. Il voyait le progrès humain comme un passage du conflit à
la coopération, une victoire de la raison sur l’impulsivité. En
résumé, il estimait que, dans les sociétés civilisées,
l’agressivité pouvait et même se devait
Bagehot (1826-1877), qui : «estimait
encore que la disparition de ce qu’il avait baptisé du nom de
corpus de coutumes*
- une formule qui devait connaître un certain succès - ne
manquerait pas de provoquer le déclin du fanatisme, l’ouverture
aux idées nouvelles ainsi que l’apparition d’un homme nouveau
combinant énergie et contrôle de soi, vitalité et raison - en un
mot, d’une créature douée de ce qu’il appelait la
modération dynamique.
Les autres, tel Carlyle, pouvaient bien considérer cette évolution
comme un affaiblissement de l’énergie, Bagehot, lui, la
considérait comme un signe avant-coureur et bienvenu de la
disparition
des pulsions héréditaires et barbares dont le déclin ne pouvait
que préfigurer l’extinction.
Bien qu’il se montrât préoccupé de l’évolution vers la
démocratie que l’on constatait à son époque, Bagehot se voulait
confiant. Il voyait le progrès humain comme un passage du conflit à
la coopération, une victoire de la raison sur l’impulsivité. En
résumé, il estimait que, dans les sociétés civilisées,
l’agressivité pouvait et même se devait  d’être sublimée».3
Or, le surhomme de Nietzsche était l’antithèse de celui du
libéral Bagehot auquel il répondait probablement. D’un autre
côté, Nietzsche y affirmait la mort de Dieu et la disparition de
ceux qui restaient accrochés à ce spectre,
ce qui
visait, évidemment, l’Église catholique romaine où le pape Pie IX dénonçait le panthéisme moderne : «Il
n’existe aucun Être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa
providence, qui soit distinct de l’universalité des choses, et
Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent
assujetti aux changements; c’est Dieu, par cela même, qui est en
train de se faire dans l’homme et dans le monde, et tous les êtres
sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une
seule et même chose avec le monde, et par conséquent l’esprit
avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le
faux, le bien avec le mal, et le juste avec l’injuste!».4
D’autre part, Nietzsche se situait davantage dans la lignée des
écrits de Gobineau (1816-1882) : «De
l’œuvre de Gobineau, s’il se dégage une doctrine, c’est une
doctrine morale, un stoïcisme renouvelé, propre à défier
l’absurdité du monde et de la vie, la résignation héroïque :
“J’oserais même dire, écrit Schemann
[son biographe], que
l’héroïsme
doublé de résignation sera la vraie devise des nobles de
l’avenir…”»5
C’est effectivement dans cette veine que s’inscrivait l’évangile
de Zarathoustra.
d’être sublimée».3
Or, le surhomme de Nietzsche était l’antithèse de celui du
libéral Bagehot auquel il répondait probablement. D’un autre
côté, Nietzsche y affirmait la mort de Dieu et la disparition de
ceux qui restaient accrochés à ce spectre,
ce qui
visait, évidemment, l’Église catholique romaine où le pape Pie IX dénonçait le panthéisme moderne : «Il
n’existe aucun Être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa
providence, qui soit distinct de l’universalité des choses, et
Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent
assujetti aux changements; c’est Dieu, par cela même, qui est en
train de se faire dans l’homme et dans le monde, et tous les êtres
sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une
seule et même chose avec le monde, et par conséquent l’esprit
avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le
faux, le bien avec le mal, et le juste avec l’injuste!».4
D’autre part, Nietzsche se situait davantage dans la lignée des
écrits de Gobineau (1816-1882) : «De
l’œuvre de Gobineau, s’il se dégage une doctrine, c’est une
doctrine morale, un stoïcisme renouvelé, propre à défier
l’absurdité du monde et de la vie, la résignation héroïque :
“J’oserais même dire, écrit Schemann
[son biographe], que
l’héroïsme
doublé de résignation sera la vraie devise des nobles de
l’avenir…”»5
C’est effectivement dans cette veine que s’inscrivait l’évangile
de Zarathoustra. Nietzsche essayèrent de le reconnaître ou d’identifier les trois
étants – bête, homme, surhomme – à des réalités
psychologiques ou ontologiques. Chez Bergson, «“Tout
se passe comme si un être indécis et flou, qu’on pourra appeler,
comme on voudra,
homme ou
surhomme,
avait cherché à se réaliser, et n’y était parvenu qu’en
abandonnant en route une partie de lui-même”. La vie est un
mouvement qui monte. La matière la fait redescendre en engendrant
d’inopportunes oscillations sur place. Grâce à l’intelligence,
la vie a pu se faufiler en un point libre où l’humanité a pris
naissance, laissant à la dérive des biens vitaux qui eussent été
précieux à l’homme. Les déchets que la matière a constitués
dans l’évolution servent, finalement, à la conservation de l’élan
et la matière a un rôle de progrès autant que d’arrêt dans la
considération de l’ensemble. Du surhomme, seul cet être
intelligent, et par la borné, qu’est l’homme, a vu le jour. Ce
surhomme eût conservé pour lui toutes les qualités du flot vital :
il n’eût pas laissé tomber en désuétude un instinct précieux;
il ne se fût pas laissé démunir d’une intuition irremplaçable.
“La conscience, chez l’homme, est surtout intelligence. Elle
aurait pu, elle aurait dû, semble-t-il, être aussi intuition”.
L’homme historique, réel, n’a pas tout gardé : il s’est
retrouvé avec le sens opératoire, mais dépourvu du sens
divinatoire. De ce point de vue, l’intelligence va en sens inverse
de la vie. Dans l’humanité de fait, l’intuition est presque
inexistante. Dans l’humanité de droit, “une évolution autre eût
pu conduire à
Nietzsche essayèrent de le reconnaître ou d’identifier les trois
étants – bête, homme, surhomme – à des réalités
psychologiques ou ontologiques. Chez Bergson, «“Tout
se passe comme si un être indécis et flou, qu’on pourra appeler,
comme on voudra,
homme ou
surhomme,
avait cherché à se réaliser, et n’y était parvenu qu’en
abandonnant en route une partie de lui-même”. La vie est un
mouvement qui monte. La matière la fait redescendre en engendrant
d’inopportunes oscillations sur place. Grâce à l’intelligence,
la vie a pu se faufiler en un point libre où l’humanité a pris
naissance, laissant à la dérive des biens vitaux qui eussent été
précieux à l’homme. Les déchets que la matière a constitués
dans l’évolution servent, finalement, à la conservation de l’élan
et la matière a un rôle de progrès autant que d’arrêt dans la
considération de l’ensemble. Du surhomme, seul cet être
intelligent, et par la borné, qu’est l’homme, a vu le jour. Ce
surhomme eût conservé pour lui toutes les qualités du flot vital :
il n’eût pas laissé tomber en désuétude un instinct précieux;
il ne se fût pas laissé démunir d’une intuition irremplaçable.
“La conscience, chez l’homme, est surtout intelligence. Elle
aurait pu, elle aurait dû, semble-t-il, être aussi intuition”.
L’homme historique, réel, n’a pas tout gardé : il s’est
retrouvé avec le sens opératoire, mais dépourvu du sens
divinatoire. De ce point de vue, l’intelligence va en sens inverse
de la vie. Dans l’humanité de fait, l’intuition est presque
inexistante. Dans l’humanité de droit, “une évolution autre eût
pu conduire à  une humanité ou plus intelligente encore, ou plus
intuitive”. L’humanité est la raison d’être du mouvement
évolutif, non parce qu’elle est préformée, non parce qu’elle
en serait l’aboutissement, mais parce que la reprise du courant
spirituel passe par elle : “en ce point est l’humanité; là est
notre situation privilégiée”».6
Bien sûr, Bergson récupère le prologue de Zarathoustra et l’adapte
à sa propre philosophie de l’élan
vital. Nous
ne sommes pas dans la seconde topique de Freud, mais bien dans le
prolongement de la pensée du philosophe de Sils-Maria. L’instinct
motive comme l’inconscient chez Freud, mais il n’aspire qu’à
réagir et non à chercher à prendre conscience de lui : c’est
le soushomme
parfait,
l’avorton, celui de l’adaptation mécanique qui pourrait risquer
de mettre fin à la Terre et à la vie. L’intelligence qui se
développe, qui apporte cette conscience à laquelle s’adresse
Zarathoustra à travers la foule amassée devant le spectacle du
funambule, appartient bien à l’homme, le pont, la corde sur
laquelle le surhomme pose le pied avec l’intuition qui est la
nature propre de sa surhumanité. Il doit lui révéler qu’il ne
doit pas rester passif devant les angoisses qui le tourmentent, mais
se hisser jusqu’à la surhumanité telle que conçue davantage par
Bergson que Nietzsche qui se borne à l’expression de Terre.
D’autre
part, il est vrai que les traducteurs de Nietzsche ne font pas
toujours la différence entre «Surhumain
et pas
surhomme
(Ubermensch
vient de
Der Mensch,
l’être humain et non de
Der Mann :
l’homme
(Vir)…»,7
ce qui confirmerait l’idée d’espèce
derrière
le surhomme plutôt que l’idée d’un individu exceptionnel, le
grand
homme de
Carlyle. En définitive, Nietzsche en viendrait à parler de la
surhumanité
plus que
du surhomme lui-même.
une humanité ou plus intelligente encore, ou plus
intuitive”. L’humanité est la raison d’être du mouvement
évolutif, non parce qu’elle est préformée, non parce qu’elle
en serait l’aboutissement, mais parce que la reprise du courant
spirituel passe par elle : “en ce point est l’humanité; là est
notre situation privilégiée”».6
Bien sûr, Bergson récupère le prologue de Zarathoustra et l’adapte
à sa propre philosophie de l’élan
vital. Nous
ne sommes pas dans la seconde topique de Freud, mais bien dans le
prolongement de la pensée du philosophe de Sils-Maria. L’instinct
motive comme l’inconscient chez Freud, mais il n’aspire qu’à
réagir et non à chercher à prendre conscience de lui : c’est
le soushomme
parfait,
l’avorton, celui de l’adaptation mécanique qui pourrait risquer
de mettre fin à la Terre et à la vie. L’intelligence qui se
développe, qui apporte cette conscience à laquelle s’adresse
Zarathoustra à travers la foule amassée devant le spectacle du
funambule, appartient bien à l’homme, le pont, la corde sur
laquelle le surhomme pose le pied avec l’intuition qui est la
nature propre de sa surhumanité. Il doit lui révéler qu’il ne
doit pas rester passif devant les angoisses qui le tourmentent, mais
se hisser jusqu’à la surhumanité telle que conçue davantage par
Bergson que Nietzsche qui se borne à l’expression de Terre.
D’autre
part, il est vrai que les traducteurs de Nietzsche ne font pas
toujours la différence entre «Surhumain
et pas
surhomme
(Ubermensch
vient de
Der Mensch,
l’être humain et non de
Der Mann :
l’homme
(Vir)…»,7
ce qui confirmerait l’idée d’espèce
derrière
le surhomme plutôt que l’idée d’un individu exceptionnel, le
grand
homme de
Carlyle. En définitive, Nietzsche en viendrait à parler de la
surhumanité
plus que
du surhomme lui-même. craignent. Leur faiblesse et leur
lâcheté les poussent à biaiser à tout embarras qui vient de
l’extérieur, à tout obstacle qui leur barre la route” [G.
Lukács]».8
Tragédie, car le stoïcisme de la surhumanité n’est atteignable
que par une frange réduite d’individus divisés en tant
qu’appartenant à la destiné étrangère du surhumain et leur
appartenance indispensable à leur identité et dont ils ne peuvent
se dégager. C’est la nature anthropologique du schisme
de l’âme telle
que la percevait l’anthropologue : «Si
l’on voulait caractériser rapidement l’homme divisé de Marcel Mauss, on pourrait dire qu’il est partagé entre les deux forces
contraires et de l’amour et de l’identification, de l’Éros et
de la Mimésis. Il subit la tension entre une extrême individualité
et une extrême sociabilité, l’une cherchant à dominer l’autre.
Cette tension provient de ce qu’il s’est entièrement identifié
à une idée, à un groupe, à un personnage idéal - avec pour effet
d’en être hypnotisé, aurait dit Le Bon. La voix de la conscience
le lui rappelle constamment et lui demande de renoncer à l’instinct.
Elle le conjure de s’attacher exclusivement à son but. Une telle
voix “produit quelques grands hommes, beaucoup de psychotiques et
beaucoup de névrosés” (S. Freud et W. C. Bullitt)».9
La référence à Freud, à la toute fin, est cohérente car Freud
également saisit ce qui sépare l’homme qui parvient à équilibrer
en son Moi les contradictions qui le déchirent, alors que la masse
des humains restera toujours l’objet soit de ses pulsions intimes,
soit des interdits de leur société. L’homme aliéné, par les
deux extrémités, s’évade difficilement de ses névroses. Il
apparaît donc logique que le surhomme en tant qu’individualité
personnelle en soit venu à effacer, dissimuler, refouler la
surhumanité annoncée par Zarathoustra.
craignent. Leur faiblesse et leur
lâcheté les poussent à biaiser à tout embarras qui vient de
l’extérieur, à tout obstacle qui leur barre la route” [G.
Lukács]».8
Tragédie, car le stoïcisme de la surhumanité n’est atteignable
que par une frange réduite d’individus divisés en tant
qu’appartenant à la destiné étrangère du surhumain et leur
appartenance indispensable à leur identité et dont ils ne peuvent
se dégager. C’est la nature anthropologique du schisme
de l’âme telle
que la percevait l’anthropologue : «Si
l’on voulait caractériser rapidement l’homme divisé de Marcel Mauss, on pourrait dire qu’il est partagé entre les deux forces
contraires et de l’amour et de l’identification, de l’Éros et
de la Mimésis. Il subit la tension entre une extrême individualité
et une extrême sociabilité, l’une cherchant à dominer l’autre.
Cette tension provient de ce qu’il s’est entièrement identifié
à une idée, à un groupe, à un personnage idéal - avec pour effet
d’en être hypnotisé, aurait dit Le Bon. La voix de la conscience
le lui rappelle constamment et lui demande de renoncer à l’instinct.
Elle le conjure de s’attacher exclusivement à son but. Une telle
voix “produit quelques grands hommes, beaucoup de psychotiques et
beaucoup de névrosés” (S. Freud et W. C. Bullitt)».9
La référence à Freud, à la toute fin, est cohérente car Freud
également saisit ce qui sépare l’homme qui parvient à équilibrer
en son Moi les contradictions qui le déchirent, alors que la masse
des humains restera toujours l’objet soit de ses pulsions intimes,
soit des interdits de leur société. L’homme aliéné, par les
deux extrémités, s’évade difficilement de ses névroses. Il
apparaît donc logique que le surhomme en tant qu’individualité
personnelle en soit venu à effacer, dissimuler, refouler la
surhumanité annoncée par Zarathoustra. France, c’est ainsi que le général Boulanger, un type assez
médiocre, soulève l’enthousiasme des foules; en Angleterre, une
série d’éminents
victoriens
allait marquer les différentes générations : «Restent
les images de l’autorité impériale occidentale - fascinantes,
étrangement séduisantes, imposantes. Gordon à Khartoum, qui baisse
un terrible regard sur les derviches soudanais dans le célèbre
tableau de G. W. Joy, armé seulement d’un revolver et d’une épée
au fourreau. Le Kurtz de Conrad au centre de l’Afrique, brillant,
fou, condamné, brave, rapace, éloquent. Lawrence d’Arabie, qui, à
la tête de ses guerriers arabes, vit la romance du désert, invente
la guérilla, trinque avec des princes et des hommes d’État,
traduit Homère et entend maintenir le “dominion brun” de la
Grande-Bretagne. Cecil Rhodes, qui fait des pays, des conquêtes et
des empires financiers aussi aisément que d’autres des enfants.
Bugeaud, qui contraint à la reddition les forces d’Abd el-Kader et
rend l’Algérie française. Les concubines, danseuses et odalisques
de Gérôme, le
Sardanapale
de Delacroix, l’Afrique du Nord de Matisse,
Samson et Dalila
de Saint-Saëns. La liste est longue et ses trésors massifs».10
Le colonialisme, d’ailleurs, va rendre possible d’opposer au
surhomme
la
sous-humanité raciale, ethnique, culturelle. C’est à travers ces
France, c’est ainsi que le général Boulanger, un type assez
médiocre, soulève l’enthousiasme des foules; en Angleterre, une
série d’éminents
victoriens
allait marquer les différentes générations : «Restent
les images de l’autorité impériale occidentale - fascinantes,
étrangement séduisantes, imposantes. Gordon à Khartoum, qui baisse
un terrible regard sur les derviches soudanais dans le célèbre
tableau de G. W. Joy, armé seulement d’un revolver et d’une épée
au fourreau. Le Kurtz de Conrad au centre de l’Afrique, brillant,
fou, condamné, brave, rapace, éloquent. Lawrence d’Arabie, qui, à
la tête de ses guerriers arabes, vit la romance du désert, invente
la guérilla, trinque avec des princes et des hommes d’État,
traduit Homère et entend maintenir le “dominion brun” de la
Grande-Bretagne. Cecil Rhodes, qui fait des pays, des conquêtes et
des empires financiers aussi aisément que d’autres des enfants.
Bugeaud, qui contraint à la reddition les forces d’Abd el-Kader et
rend l’Algérie française. Les concubines, danseuses et odalisques
de Gérôme, le
Sardanapale
de Delacroix, l’Afrique du Nord de Matisse,
Samson et Dalila
de Saint-Saëns. La liste est longue et ses trésors massifs».10
Le colonialisme, d’ailleurs, va rendre possible d’opposer au
surhomme
la
sous-humanité raciale, ethnique, culturelle. C’est à travers ces
 exploits en terres étrangères, véhiculés par les illustrés ou
les romans de gare, que l’antithèse dont ne parlait nullement
Nietzsche – il parle des bêtes, des hommes et du surhomme; il n’y
a pas d’antithèse entre l’homme et le surhomme mais un
perfectionnement -, que l’idée de sous-humanité
va se
développer. Le surhomme, lui, avec un certain vague à l’âme, se
baladera de la vieille à la novelle aristocratie. Un médiocre comme
Guillaume II d’Allemagne, selon le ministre russe Sergueï Witte,
«éprouvait
un respect sacré pour les empereurs. “Il tient les empereurs pour
des surhommes”11,
conclut-il»
dès 1888, alors que Bismarck se trouvait encore en poste. Par contre
la jeune tsarine Alexandra, épouse de Nicolas II, aura une
appréciation toute autre de Guillaume : «Willy
se prend pour un surhomme mais, en vérité, ce n’est qu’un
clown».12
Zarathoustra avait raison, la surhumanité appartenait à une
noblesse nouvelle.
exploits en terres étrangères, véhiculés par les illustrés ou
les romans de gare, que l’antithèse dont ne parlait nullement
Nietzsche – il parle des bêtes, des hommes et du surhomme; il n’y
a pas d’antithèse entre l’homme et le surhomme mais un
perfectionnement -, que l’idée de sous-humanité
va se
développer. Le surhomme, lui, avec un certain vague à l’âme, se
baladera de la vieille à la novelle aristocratie. Un médiocre comme
Guillaume II d’Allemagne, selon le ministre russe Sergueï Witte,
«éprouvait
un respect sacré pour les empereurs. “Il tient les empereurs pour
des surhommes”11,
conclut-il»
dès 1888, alors que Bismarck se trouvait encore en poste. Par contre
la jeune tsarine Alexandra, épouse de Nicolas II, aura une
appréciation toute autre de Guillaume : «Willy
se prend pour un surhomme mais, en vérité, ce n’est qu’un
clown».12
Zarathoustra avait raison, la surhumanité appartenait à une
noblesse nouvelle. sauveur,
d’un grand
homme, ce
n’était pas, évidemment, l’espoir des marxistes. Ainsi, Pierre Lavrov, cet immigré russe à Paris, se fit le précurseur de
Plékhanov, qui tenta au tournant du siècle, de réhabiliter la
notion du grand
homme dans
l’accomplissement révolutionnaire : «Socialiste
populiste, Lavrov a la conviction que
ce sont les hommes, non les masses qui font l’histoire; mais les
hommes n’agissent que par la masse.
Laissée à elle-même, la masse n’est mue que par l’intérêt
immédiat. Les intellectuels sont les éléments créateurs; du moins
ceux qui inventent des idées neuves; ces idées sont d’abord
admise par un petit groupe; puis elles irradient et peu à peu
deviennent le patrimoine commun de l’humanité. D’autres idées
sont alors lancées par un autre groupe, puis se diffusent
pareillement. Ainsi chemine l’histoire.
Bien loin de s’isoler, comme le surhomme de Nietzsche, l’homme de
valeur doit au contraire devenir une force sociale».13
Par son énergie intarissable, sa volonté de puissance
révolutionnaire et finalement sa réussite, Vladimir Oulianov, dit
Lénine – qui était à couteau tiré avec Plékhanov -, finit par
incarner cette hérésie
du
marxisme-léninisme. Lui-même, qui s’était toujours montré
hostile à la guerre et se résigna à signer le traité de
Brest-Litovsk qui amputait la Russie d’une grande partie de son
territoire européen, n’était-il pas apparu comme un traître aux
yeux des nationalistes russes? En tant que praticien de la politique,
Lénine savait que le grand
homme
n’était que la face transitoire du traître et que, par
l’adulation de ses supporteurs, on lui renvoyait toujours cette
image négative : «De
même que le “traître” est d’une nature non-humaine, de même
le dirigeant communiste est un être à part - considérer certains
êtres humains comme quantités négligeables ou comme sous-hommes,
et adorer d’autres êtres
sauveur,
d’un grand
homme, ce
n’était pas, évidemment, l’espoir des marxistes. Ainsi, Pierre Lavrov, cet immigré russe à Paris, se fit le précurseur de
Plékhanov, qui tenta au tournant du siècle, de réhabiliter la
notion du grand
homme dans
l’accomplissement révolutionnaire : «Socialiste
populiste, Lavrov a la conviction que
ce sont les hommes, non les masses qui font l’histoire; mais les
hommes n’agissent que par la masse.
Laissée à elle-même, la masse n’est mue que par l’intérêt
immédiat. Les intellectuels sont les éléments créateurs; du moins
ceux qui inventent des idées neuves; ces idées sont d’abord
admise par un petit groupe; puis elles irradient et peu à peu
deviennent le patrimoine commun de l’humanité. D’autres idées
sont alors lancées par un autre groupe, puis se diffusent
pareillement. Ainsi chemine l’histoire.
Bien loin de s’isoler, comme le surhomme de Nietzsche, l’homme de
valeur doit au contraire devenir une force sociale».13
Par son énergie intarissable, sa volonté de puissance
révolutionnaire et finalement sa réussite, Vladimir Oulianov, dit
Lénine – qui était à couteau tiré avec Plékhanov -, finit par
incarner cette hérésie
du
marxisme-léninisme. Lui-même, qui s’était toujours montré
hostile à la guerre et se résigna à signer le traité de
Brest-Litovsk qui amputait la Russie d’une grande partie de son
territoire européen, n’était-il pas apparu comme un traître aux
yeux des nationalistes russes? En tant que praticien de la politique,
Lénine savait que le grand
homme
n’était que la face transitoire du traître et que, par
l’adulation de ses supporteurs, on lui renvoyait toujours cette
image négative : «De
même que le “traître” est d’une nature non-humaine, de même
le dirigeant communiste est un être à part - considérer certains
êtres humains comme quantités négligeables ou comme sous-hommes,
et adorer d’autres êtres  humains comme des dieux ou comme des
surhommes, ces deux extrêmes sont toujours allés de pair. Shub
décrit la surprise et le dégoût de Lénine devant l’adulation
que lui prodiguaient ses camarades; apparemment, il ne pouvait pas
comprendre comment l’homme qu’il avait créé était devenu
idolâtre.
[…] Le
fait de placer certaines personnes dans la catégorie des “morts”
historiquement inutiles, et le devoir de les utiliser avant de les
rejeter, devoir que la polémique léninienne a enseigné au
bolchevique, appelait en complément le culte du chef - qui pour le
membre du Parti est le prolétariat mondial et incarne sa promesse de
fraternité humaine, de rachat et de transcendance».14
C’est ainsi que bien des aventuriers, à cheval entre le surhomme
et le traître, basculeront du piédestal à la voirie : ce sera
le cas du général Boulanger sus mentionné; de Trotsky, de
Boukharine, de Kamenev, Zinoviev et des grands révolutionnaires
russes de 1917; de Wilson humilié par sa propre nation après avoir
été reçu comme un sauveur en Europe; de Mussolini abandonné par
le P.N.F,
de Pétain qui, de héros de Verdun au procès de trahison sera
condamné à l’indignité
nationale;
de Hitler finalement, pris comme un rat sous les bombardements dans
le bunker de la chancellerie allemande. Dans la foulée des massacres
du XXe siècle, la roche Tarpéienne ne chômait pas.
humains comme des dieux ou comme des
surhommes, ces deux extrêmes sont toujours allés de pair. Shub
décrit la surprise et le dégoût de Lénine devant l’adulation
que lui prodiguaient ses camarades; apparemment, il ne pouvait pas
comprendre comment l’homme qu’il avait créé était devenu
idolâtre.
[…] Le
fait de placer certaines personnes dans la catégorie des “morts”
historiquement inutiles, et le devoir de les utiliser avant de les
rejeter, devoir que la polémique léninienne a enseigné au
bolchevique, appelait en complément le culte du chef - qui pour le
membre du Parti est le prolétariat mondial et incarne sa promesse de
fraternité humaine, de rachat et de transcendance».14
C’est ainsi que bien des aventuriers, à cheval entre le surhomme
et le traître, basculeront du piédestal à la voirie : ce sera
le cas du général Boulanger sus mentionné; de Trotsky, de
Boukharine, de Kamenev, Zinoviev et des grands révolutionnaires
russes de 1917; de Wilson humilié par sa propre nation après avoir
été reçu comme un sauveur en Europe; de Mussolini abandonné par
le P.N.F,
de Pétain qui, de héros de Verdun au procès de trahison sera
condamné à l’indignité
nationale;
de Hitler finalement, pris comme un rat sous les bombardements dans
le bunker de la chancellerie allemande. Dans la foulée des massacres
du XXe siècle, la roche Tarpéienne ne chômait pas. cette
position qui sauvegardait son orgueil sans avoir à affronter la
vengeance de la populace les mauvais jours venus. Mais pour les
intoxiqués de la mégalomanie, pour les patriotes fanatiques, le
grand
homme n’avait
qu’à exiger pour être reconnu implicitement
un surhomme. On en appelait, en France, aux soldats de l’an II qui
résistèrent à la fois aux envahisseurs étrangers et aux
contre-révolutionnaires vendéens : «Si,
dans l’ancienne France, des pancartes avaient interdit l’entrée
des lieux publics aux “chiens, aux prostituées et aux soldats”,
un placard jacobin proclamait que “la profession des armes,
autrefois considérée comme indigne, est aujourd’hui honorable”».16
Avant d’être surhomme, Napoléon avait bénéficié de ce goût de
la gloire en affirmant que chaque soldat disposait d’un bâton de
maréchal dans sa giberne. Sur de telles déclarations, même vaincu,
Napoléon conserva son prestige jusqu’après sa mort au point
d’être reconnu par Hegel, comme nous l’avons dit, l’Esprit
du monde. Voilà
ce que Nietzsche voyait dans le surhomme – et la surhumanité –
que les autres ne voyaient pas dans le grand
homme. C’est
celui qui se dépossède de ses caprices trop
humains, pour
épouser un idéal supérieur, une mission suprême, un patriotisme
qui, des
Marseillais de l’an II passerait aux Poilus
de 14-18 et au feldgrau
allemand
: «L’impossible
devient possible parce que l’esprit a transcendé la simple
obligation, la simple action, le simple devoir - ce devoir qui, dans
la culture franco-anglaise, n’a qu’une fonction utilitaire et
égoïste. Dès le début de la guerre, l’expression
die
heilige Pflicht,
le devoir sacré, devient un leitmotiv. Dans le train qui l’emporte
vers le front en septembre 1914, un jeune étudiant en droit, Franz
Blumenfield, pense que la guerre est “horrible, indigne des êtres
humains, stupide, désuète et destructrice à tous les points de
vue”,
cette
position qui sauvegardait son orgueil sans avoir à affronter la
vengeance de la populace les mauvais jours venus. Mais pour les
intoxiqués de la mégalomanie, pour les patriotes fanatiques, le
grand
homme n’avait
qu’à exiger pour être reconnu implicitement
un surhomme. On en appelait, en France, aux soldats de l’an II qui
résistèrent à la fois aux envahisseurs étrangers et aux
contre-révolutionnaires vendéens : «Si,
dans l’ancienne France, des pancartes avaient interdit l’entrée
des lieux publics aux “chiens, aux prostituées et aux soldats”,
un placard jacobin proclamait que “la profession des armes,
autrefois considérée comme indigne, est aujourd’hui honorable”».16
Avant d’être surhomme, Napoléon avait bénéficié de ce goût de
la gloire en affirmant que chaque soldat disposait d’un bâton de
maréchal dans sa giberne. Sur de telles déclarations, même vaincu,
Napoléon conserva son prestige jusqu’après sa mort au point
d’être reconnu par Hegel, comme nous l’avons dit, l’Esprit
du monde. Voilà
ce que Nietzsche voyait dans le surhomme – et la surhumanité –
que les autres ne voyaient pas dans le grand
homme. C’est
celui qui se dépossède de ses caprices trop
humains, pour
épouser un idéal supérieur, une mission suprême, un patriotisme
qui, des
Marseillais de l’an II passerait aux Poilus
de 14-18 et au feldgrau
allemand
: «L’impossible
devient possible parce que l’esprit a transcendé la simple
obligation, la simple action, le simple devoir - ce devoir qui, dans
la culture franco-anglaise, n’a qu’une fonction utilitaire et
égoïste. Dès le début de la guerre, l’expression
die
heilige Pflicht,
le devoir sacré, devient un leitmotiv. Dans le train qui l’emporte
vers le front en septembre 1914, un jeune étudiant en droit, Franz
Blumenfield, pense que la guerre est “horrible, indigne des êtres
humains, stupide, désuète et destructrice à tous les points de
vue”,  mais en même temps il exulte à l’idée de se sacrifier et
de s’engager personnellement : “Car l’essentiel est sans aucun
doute d’être prêt au sacrifice et non pas l’objet du
sacrifice”. D’un côté, il condamne la guerre en tant que
réalité, produit de l’Histoire et des relations entre peuples et
États, et de l’autre, il applaudit à l’idée qu’elle
représente».17
C’est parce que la Grande Guerre fut d’abord une guerre sans
surhumanité que des millions d’individus, venus de tous les coins
de l’Europe et d’ailleurs, firent d’abord et avant tout
l’expérience de la sous-humanité
que la
radicalisation des deux figures ontologiques allaient se dresser dans
une hiérarchie où ne resteraient plus que deux barreaux fixés aux
extrémités de l’échelle. C'est par un tour
de force que
les États, par le culte du Soldat inconnu,
firent oublier après-guerre les conditions sous-humaines dans
lesquelles furent traités les soldats pendant quatre ans pour les
reconnaître moins comme des surhommes que des patriotes valeureux.
mais en même temps il exulte à l’idée de se sacrifier et
de s’engager personnellement : “Car l’essentiel est sans aucun
doute d’être prêt au sacrifice et non pas l’objet du
sacrifice”. D’un côté, il condamne la guerre en tant que
réalité, produit de l’Histoire et des relations entre peuples et
États, et de l’autre, il applaudit à l’idée qu’elle
représente».17
C’est parce que la Grande Guerre fut d’abord une guerre sans
surhumanité que des millions d’individus, venus de tous les coins
de l’Europe et d’ailleurs, firent d’abord et avant tout
l’expérience de la sous-humanité
que la
radicalisation des deux figures ontologiques allaient se dresser dans
une hiérarchie où ne resteraient plus que deux barreaux fixés aux
extrémités de l’échelle. C'est par un tour
de force que
les États, par le culte du Soldat inconnu,
firent oublier après-guerre les conditions sous-humaines dans
lesquelles furent traités les soldats pendant quatre ans pour les
reconnaître moins comme des surhommes que des patriotes valeureux. combattants, et
surtout les Frei
Korps allemands,
se montrèrent disposer à accepter la rhétorique du surhomme. Dans
leurs mémoires, leurs souvenirs de guerre, leurs correspondances,
ils avouaient qu’il fallait appartenir à la surhumanité pour
passer au travers de ce qu’ils avaient vécu : «À
la pratique du sous-homme répond la théorie du surhomme. C’est
dans l’équilibre toujours maintenu entre le vécu et le déclamé,
que chacun devra trouver la clé de son confort psychologique. Pour
aider la digestion, l’État totalitaire aura d’ailleurs toujours
la sagesse d’ajouter quelques éléments de distraction. Quelle
croyance suffirait à éponger toutes les insatisfactions?
[…] L’empire
nazi offrira plus qu’une formule en
combattants, et
surtout les Frei
Korps allemands,
se montrèrent disposer à accepter la rhétorique du surhomme. Dans
leurs mémoires, leurs souvenirs de guerre, leurs correspondances,
ils avouaient qu’il fallait appartenir à la surhumanité pour
passer au travers de ce qu’ils avaient vécu : «À
la pratique du sous-homme répond la théorie du surhomme. C’est
dans l’équilibre toujours maintenu entre le vécu et le déclamé,
que chacun devra trouver la clé de son confort psychologique. Pour
aider la digestion, l’État totalitaire aura d’ailleurs toujours
la sagesse d’ajouter quelques éléments de distraction. Quelle
croyance suffirait à éponger toutes les insatisfactions?
[…] L’empire
nazi offrira plus qu’une formule en  pâture à ces
Übermenschen
complètement soumis; il leur offrira aussi l’Untermensch
à piétiner. Un gage de plus pour qu’ils se persuadent de leur
grandeur - un élément de “pratique” à ajouter à la théorie.
La “race des seigneurs” sera aussi celle des tortionnaires. […]
C’est
sur cette position charnière extraordinaire - qui lui permet de
digérer tout en repoussant, et d’ouvrir tout en refermant - que
jouent les dialecticiens nouveaux».18
Le temps était venu d’assumer le déclin en réduisant à
l’esclavage tout ce qu’il y avait de sous-humanité dans le
monde. La volonté
de puissance
doublée de l’énergie
vitale se
détachaient de leurs systèmes conceptuels pour devenir des mots
d’ordre. Avec les horreurs qu’ils entraînèrent dans la foulée
de la Seconde Guerre mondiale, la surhumanité de la S.S. engendra
celle de la Résistance dans les différents pays occupés par le
régime hitlérien : «Résister, c’est d’abord trouver la force de dire “non”, sans avoir
toujours une idée très claire de ce à quoi on aspire.
[…] Résister
suppose toujours d’invoquer une histoire, une mémoire, une culture
par lesquelles et au nom desquelles je dis: “Non, pas ça, plus ça,
pas moi.” Si l’acte de résistance est création, ou re-création
d’un sujet qui se construit en s’opposant, il s’inscrit aussi
dans une filiation qui donne sens à son refus, lequel va s’exprimer
à travers des procédés plus ou moins radicaux de non-coopération,
voire de
pâture à ces
Übermenschen
complètement soumis; il leur offrira aussi l’Untermensch
à piétiner. Un gage de plus pour qu’ils se persuadent de leur
grandeur - un élément de “pratique” à ajouter à la théorie.
La “race des seigneurs” sera aussi celle des tortionnaires. […]
C’est
sur cette position charnière extraordinaire - qui lui permet de
digérer tout en repoussant, et d’ouvrir tout en refermant - que
jouent les dialecticiens nouveaux».18
Le temps était venu d’assumer le déclin en réduisant à
l’esclavage tout ce qu’il y avait de sous-humanité dans le
monde. La volonté
de puissance
doublée de l’énergie
vitale se
détachaient de leurs systèmes conceptuels pour devenir des mots
d’ordre. Avec les horreurs qu’ils entraînèrent dans la foulée
de la Seconde Guerre mondiale, la surhumanité de la S.S. engendra
celle de la Résistance dans les différents pays occupés par le
régime hitlérien : «Résister, c’est d’abord trouver la force de dire “non”, sans avoir
toujours une idée très claire de ce à quoi on aspire.
[…] Résister
suppose toujours d’invoquer une histoire, une mémoire, une culture
par lesquelles et au nom desquelles je dis: “Non, pas ça, plus ça,
pas moi.” Si l’acte de résistance est création, ou re-création
d’un sujet qui se construit en s’opposant, il s’inscrit aussi
dans une filiation qui donne sens à son refus, lequel va s’exprimer
à travers des procédés plus ou moins radicaux de non-coopération,
voire de  confrontation avec l’adversaire».19
L’épuisement démographique et moral de la civilisation
occidentale aux lendemains du conflit concéda que le surhomme
avait été
emporté par le souffle de la bombe lancée sur Hiroshima. Le
superman
préférerait
désormais affronter des bandits de droits commun, des psychopathes
meurtriers, des espions sans nation d'ancrage. La surhumanité
appartenait à un autre monde que celui de l’humanité. Elle était,
comme l’appelait un film de science-fiction de Christian Nyby,
co-réalisé avec Howard Hawks, La“Chose” d’un autre monde (1951) : «La
Chose, de genre neutre - comme l’ennemi échappant au genre humain
(“C’est un Martien, peut-être!…")
-, est, suivant le cri du cœur du scientifique, un “être
supérieur”, qui n’a “pas d’émotion” : “Ni souffrance,
ni plaisir, aucune sensation, sensibilité nulle, c’est notre
supérieur, notre supérieur à tout point de vue!” Il se repère à
sa radioactivité. D’ordre végétal, il se reproduit sans
sentiment. Il se multiplie. D’apparence très
confrontation avec l’adversaire».19
L’épuisement démographique et moral de la civilisation
occidentale aux lendemains du conflit concéda que le surhomme
avait été
emporté par le souffle de la bombe lancée sur Hiroshima. Le
superman
préférerait
désormais affronter des bandits de droits commun, des psychopathes
meurtriers, des espions sans nation d'ancrage. La surhumanité
appartenait à un autre monde que celui de l’humanité. Elle était,
comme l’appelait un film de science-fiction de Christian Nyby,
co-réalisé avec Howard Hawks, La“Chose” d’un autre monde (1951) : «La
Chose, de genre neutre - comme l’ennemi échappant au genre humain
(“C’est un Martien, peut-être!…")
-, est, suivant le cri du cœur du scientifique, un “être
supérieur”, qui n’a “pas d’émotion” : “Ni souffrance,
ni plaisir, aucune sensation, sensibilité nulle, c’est notre
supérieur, notre supérieur à tout point de vue!” Il se repère à
sa radioactivité. D’ordre végétal, il se reproduit sans
sentiment. Il se multiplie. D’apparence très  humaine, plante
“surhumaine” en fait (il mesure deux mètres), sorte de
Frankenstein-robot, il est là pour “conquérir la terre” en se
multipliant “de manière effrayante”. Il figure parfaitement les
foules mécanisées de l’“homme nouveau” des années trente».20
L’évangile de Zarathoustra, après tout, n’annonçait-il
que cela? L’homme était trop imparfait pour penser parvenir à ce
stade stoïque du surhomme; la surhumanité n’était qu’un pur
produit de l’esprit, à l’image de son prédécesseur, Dieu.
Autrement,
et l'Histoire allait le démontrer tragiquement, il n'était qu'une
Chose
effrayante.
humaine, plante
“surhumaine” en fait (il mesure deux mètres), sorte de
Frankenstein-robot, il est là pour “conquérir la terre” en se
multipliant “de manière effrayante”. Il figure parfaitement les
foules mécanisées de l’“homme nouveau” des années trente».20
L’évangile de Zarathoustra, après tout, n’annonçait-il
que cela? L’homme était trop imparfait pour penser parvenir à ce
stade stoïque du surhomme; la surhumanité n’était qu’un pur
produit de l’esprit, à l’image de son prédécesseur, Dieu.
Autrement,
et l'Histoire allait le démontrer tragiquement, il n'était qu'une
Chose
effrayante. intérieure que
dans celle qui visait l’Ouest. Des photographies de prisonniers
soviétiques hirsutes aux sourcils broussailleux et renfrognés
émaillèrent les pages de la presse allemande, côte à côte avec
des portraits de beaux guerriers en feldgrau à l’air pénétré».21
L’uniforme feldgrau amplifiait la virilité de celui qui le
portait, répondant ainsi aux canons de l’art grec qui, depuis
Winckelmann à la fin du XVIIIe siècle, représentait la virilité
exemplaire. En retour, le corps maladif, décharné ou obèse, ne
pouvait qu’appartenir à un Untermenschen.
Les
caractéristiques attribués au corps féminin, au corps juif, au
corps homosexuel ou slave et surtout au corps infirme, marquaient une
infériorité naturelle et ontologique incontestable. Comme le
rappelle G. L. Mosse : «Dès
l’origine, il fut en effet considéré comme un tout : corps et
âme, aspect extérieur et qualités intérieures, étaient censés
former une unité harmonieuse. La virilité est un stéréotype,
reflet d’une image mentale standardisée. L’image intériorisée
s’appuie, en retour, sur la perception de l’aspect physique, qui
doit permettre de juger de la valeur d’une personne.
intérieure que
dans celle qui visait l’Ouest. Des photographies de prisonniers
soviétiques hirsutes aux sourcils broussailleux et renfrognés
émaillèrent les pages de la presse allemande, côte à côte avec
des portraits de beaux guerriers en feldgrau à l’air pénétré».21
L’uniforme feldgrau amplifiait la virilité de celui qui le
portait, répondant ainsi aux canons de l’art grec qui, depuis
Winckelmann à la fin du XVIIIe siècle, représentait la virilité
exemplaire. En retour, le corps maladif, décharné ou obèse, ne
pouvait qu’appartenir à un Untermenschen.
Les
caractéristiques attribués au corps féminin, au corps juif, au
corps homosexuel ou slave et surtout au corps infirme, marquaient une
infériorité naturelle et ontologique incontestable. Comme le
rappelle G. L. Mosse : «Dès
l’origine, il fut en effet considéré comme un tout : corps et
âme, aspect extérieur et qualités intérieures, étaient censés
former une unité harmonieuse. La virilité est un stéréotype,
reflet d’une image mentale standardisée. L’image intériorisée
s’appuie, en retour, sur la perception de l’aspect physique, qui
doit permettre de juger de la valeur d’une personne.  Les
stéréotypes objectivent la nature humaine, la rendent immédiatement
visible et jugeable. Ils se sont formés à l’époque moderne au
moment où la société, désorientée par les bouleversements
qu’elle subissait, cherchait des symboles capables de concrétiser
des notions abstraites».22
En tant que stéréotype, l’image de l’homme viril n’avait
aucune substance. Elle n’était
qu’une forme dans laquelle étaient
investies une charge affective et une norme idéaliste entretenue par
les gymnastes et les hygiénistes. Pour la classification
ontologique, il ne restait
plus que «la
séduction d’une telle abstraction, une fois incarnée dans une
forme humaine familière, ce que cherchèrent à faire les
gouvernements et les politiques de tous bords».23
L’esthétique finit par modeler le tout, comme le remarque encore
Mosse : «L’idéal masculin de Winckelmann fut même colorisé. Il croyait, à tort, que
la statuaire grecque n’était pas peinte, mais Carl Gustav Carus,
dans sa
Symbolik der menschlichen Gestalt
“Symbolique de la forme humaine”, 1853), proclama que le blond,
couleur solaire, était la marque des races supérieures. Pour Carus,
la conformation physique des personnages grecs était supérieure à
toute autre. Sans doute existait-il en Allemagne, vers la fin du
siècle, des gens pour penser que l’irrégularité des traits
reflétait la nature intime des Allemands, leur obstination propre,
mais ces Aryens-là étaient généralement décrits comme vieux et
contrefaits; les jeunes, eux, devaient être à la hauteur des canons
grecs.
[…] il
semble que les
Les
stéréotypes objectivent la nature humaine, la rendent immédiatement
visible et jugeable. Ils se sont formés à l’époque moderne au
moment où la société, désorientée par les bouleversements
qu’elle subissait, cherchait des symboles capables de concrétiser
des notions abstraites».22
En tant que stéréotype, l’image de l’homme viril n’avait
aucune substance. Elle n’était
qu’une forme dans laquelle étaient
investies une charge affective et une norme idéaliste entretenue par
les gymnastes et les hygiénistes. Pour la classification
ontologique, il ne restait
plus que «la
séduction d’une telle abstraction, une fois incarnée dans une
forme humaine familière, ce que cherchèrent à faire les
gouvernements et les politiques de tous bords».23
L’esthétique finit par modeler le tout, comme le remarque encore
Mosse : «L’idéal masculin de Winckelmann fut même colorisé. Il croyait, à tort, que
la statuaire grecque n’était pas peinte, mais Carl Gustav Carus,
dans sa
Symbolik der menschlichen Gestalt
“Symbolique de la forme humaine”, 1853), proclama que le blond,
couleur solaire, était la marque des races supérieures. Pour Carus,
la conformation physique des personnages grecs était supérieure à
toute autre. Sans doute existait-il en Allemagne, vers la fin du
siècle, des gens pour penser que l’irrégularité des traits
reflétait la nature intime des Allemands, leur obstination propre,
mais ces Aryens-là étaient généralement décrits comme vieux et
contrefaits; les jeunes, eux, devaient être à la hauteur des canons
grecs.
[…] il
semble que les  nazis, qui poussèrent le nationalisme moderne à son
comble, aient entrevu qu’ils partageaient ce modèle masculin avec
d’autres».24
L’apparence, l’illusion superficielle en venait à prendre une dimension sérieuse que l’anthropologie du temps ne cessait de
confirmer. Ce n’est pas pour rien que les partisans de l’art
classique résistèrent si farouchement aux nouvelles formes
artistiques issues de l’Impressionnisme. Outre la série du Père
Ubu, Alfred
Jarry se fit connaître pour un roman qui était le non-dit du
surhomme :
«Le Surmâle
: le
livre de l’exploit. Ou bien : le livre des exploits. Ils sont en
effet de deux ordres : exploit dans l’ordre de la compétition
sportive, - exploit dans l’ordre de la répétition de l’acte
charnel qu’on nomme vulgairement “faire l’amour”».25
Rendue à la Nouvelle
Objectivité allemande,
durant l’entre-deux-guerres, le malin plaisir de certains peintres
à illustrer des corps difformes, tordus et pathétiques relevait
purement et simplement de la provocation. La Grande Guerre avait
officialisé, par ses fiches anthropomorphiques, les distinctions
physionomiques des partis : «Ami
et ennemi se différenciaient clairement l’un de l’autre au moyen
de critères de jugement familiers : la beauté ou la laideur
physique, la force ou la faiblesse, la maîtrise ou l’absence de
maîtrise de ses passions. Le corps d’un homme qui appartenait à
la race supérieure devait être harmonieux et cependant exprimer
force et assurance. Il est facile de voir comment le racisme pouvait
apporter un surcroît de substance au nationalisme, définir
précisément le caractère national et - à la différence des
symboles classiques du nationalisme comme le drapeau ou les hymnes
nationaux - fournir des symboles concrets et familiers, visibles et
palpables, que cela ait été le corps superbe de la race supérieure
ou celui déformé de la race inférieure».26
Les mots devenaient ainsi de plus en plus dangereux pour les Êtres.
nazis, qui poussèrent le nationalisme moderne à son
comble, aient entrevu qu’ils partageaient ce modèle masculin avec
d’autres».24
L’apparence, l’illusion superficielle en venait à prendre une dimension sérieuse que l’anthropologie du temps ne cessait de
confirmer. Ce n’est pas pour rien que les partisans de l’art
classique résistèrent si farouchement aux nouvelles formes
artistiques issues de l’Impressionnisme. Outre la série du Père
Ubu, Alfred
Jarry se fit connaître pour un roman qui était le non-dit du
surhomme :
«Le Surmâle
: le
livre de l’exploit. Ou bien : le livre des exploits. Ils sont en
effet de deux ordres : exploit dans l’ordre de la compétition
sportive, - exploit dans l’ordre de la répétition de l’acte
charnel qu’on nomme vulgairement “faire l’amour”».25
Rendue à la Nouvelle
Objectivité allemande,
durant l’entre-deux-guerres, le malin plaisir de certains peintres
à illustrer des corps difformes, tordus et pathétiques relevait
purement et simplement de la provocation. La Grande Guerre avait
officialisé, par ses fiches anthropomorphiques, les distinctions
physionomiques des partis : «Ami
et ennemi se différenciaient clairement l’un de l’autre au moyen
de critères de jugement familiers : la beauté ou la laideur
physique, la force ou la faiblesse, la maîtrise ou l’absence de
maîtrise de ses passions. Le corps d’un homme qui appartenait à
la race supérieure devait être harmonieux et cependant exprimer
force et assurance. Il est facile de voir comment le racisme pouvait
apporter un surcroît de substance au nationalisme, définir
précisément le caractère national et - à la différence des
symboles classiques du nationalisme comme le drapeau ou les hymnes
nationaux - fournir des symboles concrets et familiers, visibles et
palpables, que cela ait été le corps superbe de la race supérieure
ou celui déformé de la race inférieure».26
Les mots devenaient ainsi de plus en plus dangereux pour les Êtres. l’apparence du vêtement au corps rejoignait les valeurs
esthétiques héritées de Winckelmann : «Ainsi
le nouvel homme du fascisme ou du national-socialisme n’était-il
pas vraiment nouveau. La plupart de ses traits appartenaient déjà
au modèle masculin normatif; on les retrouve poussés à l’extrême
du côté de l’agressivité, et redéfinis sans une ombre
d’ambiguïté, car ce modèle devenait un essentiel instrument de
domination. Si un monde semble séparer l’élégant gentleman
britannique et le brave garçon américain du S.S. idéal, ils sont
au fond façonnés dans le même moule réunissant en lui les
qualités de force et de séduction esthétique, de réserve et de
violence, de dispositions à la générosité et à la compassion ou
au combat acharné et impitoyable. Le fascisme et le
national-socialisme ont démontré les effrayantes possibilités de
la virilité moderne, une fois celle-ci réduite à ses fonctions
guerrières».27
Ce qui était relativement nouveau, c’était la diffusion
démocratique du modèle. Ainsi, «alors
que le nazisme projetait sur l’Allemagne une ombre de plus en plus
menaçante, l’écrivain pacifiste de gauche
l’apparence du vêtement au corps rejoignait les valeurs
esthétiques héritées de Winckelmann : «Ainsi
le nouvel homme du fascisme ou du national-socialisme n’était-il
pas vraiment nouveau. La plupart de ses traits appartenaient déjà
au modèle masculin normatif; on les retrouve poussés à l’extrême
du côté de l’agressivité, et redéfinis sans une ombre
d’ambiguïté, car ce modèle devenait un essentiel instrument de
domination. Si un monde semble séparer l’élégant gentleman
britannique et le brave garçon américain du S.S. idéal, ils sont
au fond façonnés dans le même moule réunissant en lui les
qualités de force et de séduction esthétique, de réserve et de
violence, de dispositions à la générosité et à la compassion ou
au combat acharné et impitoyable. Le fascisme et le
national-socialisme ont démontré les effrayantes possibilités de
la virilité moderne, une fois celle-ci réduite à ses fonctions
guerrières».27
Ce qui était relativement nouveau, c’était la diffusion
démocratique du modèle. Ainsi, «alors
que le nazisme projetait sur l’Allemagne une ombre de plus en plus
menaçante, l’écrivain pacifiste de gauche  Arnold Zweig écrivit
aussi des pages enthousiastes sur le nouveau Juif, au corps accompli,
entraîné, musclé, qui, suivant l’exemple anglo-saxon,
s’intéressait autant à son développement physique
qu’intellectuel. Plus frappant, le “nouvel Allemand” dépeint
par Zweig en 1931 devenait le modèle du nouveau Juif».28
À l’extérieur de l’Allemagne, des intellectuels déjà formés
à l’esprit classique, comme Brasillach, Bardèche, Montherlant et
Drieu La Rochelle, communiaient dans le
même esthétique du corps. Évidemment, malgré un interdit pour les
désirs homosexuels, «cette
vénération pour la sublimité du corps masculin allait perdurer et
devenir constitutive du stéréotype. La continuité est frappante
quand on sait que, un siècle et demi après
[Winckelmann], Adolf
Hitler évoqua l’immortel idéal de la beauté grecque, alliant une
exceptionnelle beauté physique à un esprit radieux et une âme
noble. Hitler alla même plus loin, et établit la primauté du corps
en déclarant que rien ne pouvait embellir un corps contrefait, pas même un esprit rayonnant. L’homosexualité de Winckelmann a
certainement eu un rôle à cet égard, et, malgré ses évolutions,
le
Arnold Zweig écrivit
aussi des pages enthousiastes sur le nouveau Juif, au corps accompli,
entraîné, musclé, qui, suivant l’exemple anglo-saxon,
s’intéressait autant à son développement physique
qu’intellectuel. Plus frappant, le “nouvel Allemand” dépeint
par Zweig en 1931 devenait le modèle du nouveau Juif».28
À l’extérieur de l’Allemagne, des intellectuels déjà formés
à l’esprit classique, comme Brasillach, Bardèche, Montherlant et
Drieu La Rochelle, communiaient dans le
même esthétique du corps. Évidemment, malgré un interdit pour les
désirs homosexuels, «cette
vénération pour la sublimité du corps masculin allait perdurer et
devenir constitutive du stéréotype. La continuité est frappante
quand on sait que, un siècle et demi après
[Winckelmann], Adolf
Hitler évoqua l’immortel idéal de la beauté grecque, alliant une
exceptionnelle beauté physique à un esprit radieux et une âme
noble. Hitler alla même plus loin, et établit la primauté du corps
en déclarant que rien ne pouvait embellir un corps contrefait, pas même un esprit rayonnant. L’homosexualité de Winckelmann a
certainement eu un rôle à cet égard, et, malgré ses évolutions,
le  stéréotype masculin allait s’appuyer sur une sensibilité
“homoérotique” qui allait donner naissance à des modèles aussi
divers que l’élégant gentleman britannique ou le jeune
Américain».29
Il faudra revenir sur cet aspect primordial du Symbolique entre les
uniformes ornés des Bleus et des Gris de la Guerre de Sécession
jusqu’aux ornements morbides des uniformes S.S., mais il suffit
pour le moment de conserver en mémoire l’importance de l’action
fantasmatique manichéen entre la race des surhommes et celle des
sous-hommes pour saisir l’ontologie du premier XXe siècle qui
explique, en partie, la commission de tant d’horreurs.
stéréotype masculin allait s’appuyer sur une sensibilité
“homoérotique” qui allait donner naissance à des modèles aussi
divers que l’élégant gentleman britannique ou le jeune
Américain».29
Il faudra revenir sur cet aspect primordial du Symbolique entre les
uniformes ornés des Bleus et des Gris de la Guerre de Sécession
jusqu’aux ornements morbides des uniformes S.S., mais il suffit
pour le moment de conserver en mémoire l’importance de l’action
fantasmatique manichéen entre la race des surhommes et celle des
sous-hommes pour saisir l’ontologie du premier XXe siècle qui
explique, en partie, la commission de tant d’horreurs. droite mais aussi sur les équivoques du socialisme
humanitaire du XIXe. Pensez : Mussolini débute comme socialiste et
finit nationaliste réactionnaire : le surhomme du roman populaire
commence par être démocratique (Sue et Dumas) pour finir
nationaliste (Arsène Lupin). S’agit-il de coïncidences - sans
compter que l’on pourrait trouver des équivalents contemporains
très intéressants?».30
Les personnages des romans de Hugo : Jean Valjean, Gilliatt,
Quasimodo, l’homme qui rit sont des personnages démesurés qui
possèdent en eux-mêmes les traits caractéristiques du surhomme de
Nietzsche. Les personnages d’Alexandre Dumas également répondent
au stéréotype du surhomme : «La
différence entre Dumas et Nietzsche (s’il n’y en avait qu’une
seule) tient tout entière en ceci: Nietzsche est historiquement mûr
(il a la force spéculative) pour rompre les ponts avec les
justifications transcendantes, coûte que coûte (au risque du
bannissement); Dumas est dépourvu de
droite mais aussi sur les équivoques du socialisme
humanitaire du XIXe. Pensez : Mussolini débute comme socialiste et
finit nationaliste réactionnaire : le surhomme du roman populaire
commence par être démocratique (Sue et Dumas) pour finir
nationaliste (Arsène Lupin). S’agit-il de coïncidences - sans
compter que l’on pourrait trouver des équivalents contemporains
très intéressants?».30
Les personnages des romans de Hugo : Jean Valjean, Gilliatt,
Quasimodo, l’homme qui rit sont des personnages démesurés qui
possèdent en eux-mêmes les traits caractéristiques du surhomme de
Nietzsche. Les personnages d’Alexandre Dumas également répondent
au stéréotype du surhomme : «La
différence entre Dumas et Nietzsche (s’il n’y en avait qu’une
seule) tient tout entière en ceci: Nietzsche est historiquement mûr
(il a la force spéculative) pour rompre les ponts avec les
justifications transcendantes, coûte que coûte (au risque du
bannissement); Dumas est dépourvu de  cette force spéculative et
très soucieux de vendre son produit : d’autre part, en raison de
l’Esprit du Temps, il ne sait plus comment le situer. Alors, le
Surhomme deviendra un envoyé du Seigneur. La transformation s’opère
au chapitre 48, au cours d’un dialogue entre Monte-Cristo et Villefort, le magistrat qui le fit enfermer au château d’If. Le
comte expose sa philosophie de la supériorité, conteste le pouvoir
des lois au profit du choix individuel qui en brise les liens,
raisonne avec froideur sur sa propre image, et soudain, pour tenir
tête aux objections de Villefort, il tire de sa manche l’atout de
la Mission Divine. Il existe des “hommes que Dieu a mis au-dessus
des titulaires, des ministres et des rois, en leur donnant une
mission à poursuivre au lieu d’une place à remplir.
[…] Je
suis un de ces êtres exceptionnels, oui, monsieur, et je crois que,
jusqu’à ce jour, aucun homme ne s’est trouvé dans une position
semblable à la mienne”».31
Eugène Sue, lui,
livrait un jeune noble en stage dans le milieu de la petite pègre
urbaine : «Rodolphe,
juge et justicier, bienfaiteur et réformateur hors les lois, est un
Surhomme; issu en droite ligne du héros
cette force spéculative et
très soucieux de vendre son produit : d’autre part, en raison de
l’Esprit du Temps, il ne sait plus comment le situer. Alors, le
Surhomme deviendra un envoyé du Seigneur. La transformation s’opère
au chapitre 48, au cours d’un dialogue entre Monte-Cristo et Villefort, le magistrat qui le fit enfermer au château d’If. Le
comte expose sa philosophie de la supériorité, conteste le pouvoir
des lois au profit du choix individuel qui en brise les liens,
raisonne avec froideur sur sa propre image, et soudain, pour tenir
tête aux objections de Villefort, il tire de sa manche l’atout de
la Mission Divine. Il existe des “hommes que Dieu a mis au-dessus
des titulaires, des ministres et des rois, en leur donnant une
mission à poursuivre au lieu d’une place à remplir.
[…] Je
suis un de ces êtres exceptionnels, oui, monsieur, et je crois que,
jusqu’à ce jour, aucun homme ne s’est trouvé dans une position
semblable à la mienne”».31
Eugène Sue, lui,
livrait un jeune noble en stage dans le milieu de la petite pègre
urbaine : «Rodolphe,
juge et justicier, bienfaiteur et réformateur hors les lois, est un
Surhomme; issu en droite ligne du héros  satanique romantique, il est
sans doute le premier en date dans l’histoire du feuilleton, le
modèle pour Monte-Cristo, le contemporain de Vautrin (lequel naît
auparavant mais se développe pleinement à cette époque) et, en
tout cas, le précurseur du modèle nietzschéen. Gramsci l’avait
noté avec beaucoup de perspicacité et d’ironie : le Surhomme est
forgé par le roman-feuilleton et n’arrive à la philosophie que
bien plus tard. Le Surhomme est le ressort nécessaire au bon
fonctionnement du mécanisme de la consolation; il rend immédiats et
impensables les dénouements des drames, il console aussitôt et
console mieux».32
Malgré ce qu’on peut juger du feuilleton,
Umberto
Eco considère les
limites politiques de
ces
héros : «Le
Surhomme de feuilleton prend conscience que le riche prévarique sur
le dos du pauvre, que le pouvoir se fonde sur la fraude, mais il n’en
devient pas pour autant un prophète de la lutte des classes, à
l’image de Marx, et n’aspire donc pas à la subversion de l’ordre
social. Simplement, il superpose sa propre justice à la justice
commune, il détruit les méchants, récompense les bons et rétablit
l’harmonie perdue. En ce sens, le roman populaire démocratique
n’est pas révolutionnaire, il est caritatif, consolant ses
lecteurs par l’image d’une justice fabuleuse; toutefois, il met à
nu certains problèmes et, s’il n’offre pas de solutions
acceptables, du moins trace-t-il des analyses réalistes».33
En ce sens, le feuilleton ne fut
pas seulement un fournisseur au concept du surhomme, mais il
l’associa à une conception proprement anarchiste.
satanique romantique, il est
sans doute le premier en date dans l’histoire du feuilleton, le
modèle pour Monte-Cristo, le contemporain de Vautrin (lequel naît
auparavant mais se développe pleinement à cette époque) et, en
tout cas, le précurseur du modèle nietzschéen. Gramsci l’avait
noté avec beaucoup de perspicacité et d’ironie : le Surhomme est
forgé par le roman-feuilleton et n’arrive à la philosophie que
bien plus tard. Le Surhomme est le ressort nécessaire au bon
fonctionnement du mécanisme de la consolation; il rend immédiats et
impensables les dénouements des drames, il console aussitôt et
console mieux».32
Malgré ce qu’on peut juger du feuilleton,
Umberto
Eco considère les
limites politiques de
ces
héros : «Le
Surhomme de feuilleton prend conscience que le riche prévarique sur
le dos du pauvre, que le pouvoir se fonde sur la fraude, mais il n’en
devient pas pour autant un prophète de la lutte des classes, à
l’image de Marx, et n’aspire donc pas à la subversion de l’ordre
social. Simplement, il superpose sa propre justice à la justice
commune, il détruit les méchants, récompense les bons et rétablit
l’harmonie perdue. En ce sens, le roman populaire démocratique
n’est pas révolutionnaire, il est caritatif, consolant ses
lecteurs par l’image d’une justice fabuleuse; toutefois, il met à
nu certains problèmes et, s’il n’offre pas de solutions
acceptables, du moins trace-t-il des analyses réalistes».33
En ce sens, le feuilleton ne fut
pas seulement un fournisseur au concept du surhomme, mais il
l’associa à une conception proprement anarchiste. Maldoror
n’était pas moins convaincu que Zarathoustra de l’affirmation
subjective comme but du devenir-surhomme : «Par
les phrases les plus fortes nous est affirmé ici le pur choix de
Maldoror : “Je veux résider seul dans mon intime raisonnement…
Ma subjectivité et le Créateur, c’est trop pour un cerveau”.
Affirmation d’une clarté décisive. Et, au même instant, nous
saisissons comment ce pur désir d’être soi, le refus angoissé de
toute présence autre, par cette angoisse même, devient le mouvement
fasciné qui ouvre l’être à autrui et le change radicalement en
quelque chose d’autre».35
Et Barbey d’Aurevilly faisait de son jeune personnage de
Mesnilgrand, dans Les
Diaboliques, un
être que rien n’arrête «au-dessus
de la vie, dans la position que sa fierté lui commandait à lui-même
: “Il imposait comme tous les hommes qui ne demandent plus rien à
la vie : car qui ne demande plus rien à la vie est plus haut
qu’elle, et c’est elle alors qui fait des bassesses avec nous”».36
Mais déjà, le surhomme pouvait se détourner du bien et rechercher
le mal, par sa nature même, comme si
Dracula pourrait
Maldoror
n’était pas moins convaincu que Zarathoustra de l’affirmation
subjective comme but du devenir-surhomme : «Par
les phrases les plus fortes nous est affirmé ici le pur choix de
Maldoror : “Je veux résider seul dans mon intime raisonnement…
Ma subjectivité et le Créateur, c’est trop pour un cerveau”.
Affirmation d’une clarté décisive. Et, au même instant, nous
saisissons comment ce pur désir d’être soi, le refus angoissé de
toute présence autre, par cette angoisse même, devient le mouvement
fasciné qui ouvre l’être à autrui et le change radicalement en
quelque chose d’autre».35
Et Barbey d’Aurevilly faisait de son jeune personnage de
Mesnilgrand, dans Les
Diaboliques, un
être que rien n’arrête «au-dessus
de la vie, dans la position que sa fierté lui commandait à lui-même
: “Il imposait comme tous les hommes qui ne demandent plus rien à
la vie : car qui ne demande plus rien à la vie est plus haut
qu’elle, et c’est elle alors qui fait des bassesses avec nous”».36
Mais déjà, le surhomme pouvait se détourner du bien et rechercher
le mal, par sa nature même, comme si
Dracula pourrait  anticiper la vêture du S.S. : «…l’homme
sombre et livide, à la cape noire, au regard noir, à la force
musculaire irrésistible parce que surhumaine. Son champ symbolique
comporte la nuit, la mort, la chauve-souris, le loup, le regard
pénétrant, les canines hypertrophiées, la soif de sang, et une
évidente brutalité virile».37
L’artiste, pour
sa part,
pouvait apparaître comme un Prométhée moderne, ayant brisé le
cadre sacré de la perspective et du réalisme académique. Parlant
de Monet, Zola s’exclamait : «Voilà
un tempérament, voilà un homme dans la foule de ces eunuques!».38
Lorsque Zarathoustra
en
appelle au Créateur et à l’Inventeur, Zola souscrit entièrement
à cette vision de la tâche du surhomme : «Quant
à moi, ce n’est pas l’arbre, le visage, la scène qu’on me
présente qui me touchent; c’est l’homme que je trouve dans
l’œuvre, c’est l’individualité puissante qui a su créer, à
côté du monde de Dieu, un monde personnel que mes yeux ne pourront
plus oublier et qu’ils reconnaîtront partout»,
comme il l’exprima dans sa critique du Salon des Refusés.39
Dans une autre veine, celui
du colonialisme,
il en vint à déborder son propre humanisme : «comme
le clamait lyriquement Zola : “Leur plaisir est d’agir, de
soumettre des continents, leur récompense d’avoir augmenté la
vie. Répondant à
anticiper la vêture du S.S. : «…l’homme
sombre et livide, à la cape noire, au regard noir, à la force
musculaire irrésistible parce que surhumaine. Son champ symbolique
comporte la nuit, la mort, la chauve-souris, le loup, le regard
pénétrant, les canines hypertrophiées, la soif de sang, et une
évidente brutalité virile».37
L’artiste, pour
sa part,
pouvait apparaître comme un Prométhée moderne, ayant brisé le
cadre sacré de la perspective et du réalisme académique. Parlant
de Monet, Zola s’exclamait : «Voilà
un tempérament, voilà un homme dans la foule de ces eunuques!».38
Lorsque Zarathoustra
en
appelle au Créateur et à l’Inventeur, Zola souscrit entièrement
à cette vision de la tâche du surhomme : «Quant
à moi, ce n’est pas l’arbre, le visage, la scène qu’on me
présente qui me touchent; c’est l’homme que je trouve dans
l’œuvre, c’est l’individualité puissante qui a su créer, à
côté du monde de Dieu, un monde personnel que mes yeux ne pourront
plus oublier et qu’ils reconnaîtront partout»,
comme il l’exprima dans sa critique du Salon des Refusés.39
Dans une autre veine, celui
du colonialisme,
il en vint à déborder son propre humanisme : «comme
le clamait lyriquement Zola : “Leur plaisir est d’agir, de
soumettre des continents, leur récompense d’avoir augmenté la
vie. Répondant à  l’appel de nouveaux horizons, et marchant de
conquête en conquête, leur vitalité retrouvée se déploie dans
une existence aux frontières du surhumain” (1898)».40
Quoi qu’il en soit et quoi qu’en ait dit Zola, ces artistes de la
modernité se sentaient effectivement comme des surhommes. Par leurs
conditions souvent austères, ils sentaient qu’ils pouvaient
dépasser la mesure de l’homme commun, à l’exemple de Van Gogh
qui «ne
se plaignait pas de la vie ardente et exténuante qu’il menait. Il
pouvait s’accommoder facilement du manque de confort et de
nourriture, tant qu’il était en mesure de continuer son travail.
“Ah! mon cher frère, s’exclamait-il, quelquefois je sais
tellement bien ce que je veux. Je peux bien, dans la vie et dans la
peinture aussi, me passer de bon Dieu, mais je ne puis pas, moi
souffrant, me passer de quelque chose de plus grand que moi, qui est
ma vie : la puissance de créer”».41
De
la part d'un
ancien prédicateur des
corons,
cette déclaration n’allait
pas sans
aveux.
l’appel de nouveaux horizons, et marchant de
conquête en conquête, leur vitalité retrouvée se déploie dans
une existence aux frontières du surhumain” (1898)».40
Quoi qu’il en soit et quoi qu’en ait dit Zola, ces artistes de la
modernité se sentaient effectivement comme des surhommes. Par leurs
conditions souvent austères, ils sentaient qu’ils pouvaient
dépasser la mesure de l’homme commun, à l’exemple de Van Gogh
qui «ne
se plaignait pas de la vie ardente et exténuante qu’il menait. Il
pouvait s’accommoder facilement du manque de confort et de
nourriture, tant qu’il était en mesure de continuer son travail.
“Ah! mon cher frère, s’exclamait-il, quelquefois je sais
tellement bien ce que je veux. Je peux bien, dans la vie et dans la
peinture aussi, me passer de bon Dieu, mais je ne puis pas, moi
souffrant, me passer de quelque chose de plus grand que moi, qui est
ma vie : la puissance de créer”».41
De
la part d'un
ancien prédicateur des
corons,
cette déclaration n’allait
pas sans
aveux. mystificateur Dupin : «Du
moment que l’histoire existe, le policier est infaillible.
[…] [Car] qui
est Dupin? Au fond, Poe n’en sait rien. L’homme ne l’intéresse
pas. Il lui suffit de nous suggérer que Dupin est une prodigieuse
machine à raisonner […]
En somme,
il n’existe pas. En tant que personnage, il est presque de trop. On
ne lui demande que d’être une voix. L’homme qui ne se trompe
jamais s’exclut de la communauté humaine».42
En effet, la perfection de la surhumanité pourrait conduire là où
Nietzsche ne l’attendait pas, c’est-à-dire à un individu
totalement dénué de toute humanité, capable, comme dit le
criminologue Thorwald, de donner «une
assurance de “surhomme”; une assurance à la Sherlock Holmes»!43
Siegfried Kracauer, qui analyse de manière théologique
le roman
policier, tient les prouesses du surhomme pour une pure
mystification, ce en quoi Poe ne l’aurait pas contredit : «Cet
exercice fait du détective non seulement une caricature du moine,
mais encore le pendant du héros de la
ratio, qui
affirme en toute
mystificateur Dupin : «Du
moment que l’histoire existe, le policier est infaillible.
[…] [Car] qui
est Dupin? Au fond, Poe n’en sait rien. L’homme ne l’intéresse
pas. Il lui suffit de nous suggérer que Dupin est une prodigieuse
machine à raisonner […]
En somme,
il n’existe pas. En tant que personnage, il est presque de trop. On
ne lui demande que d’être une voix. L’homme qui ne se trompe
jamais s’exclut de la communauté humaine».42
En effet, la perfection de la surhumanité pourrait conduire là où
Nietzsche ne l’attendait pas, c’est-à-dire à un individu
totalement dénué de toute humanité, capable, comme dit le
criminologue Thorwald, de donner «une
assurance de “surhomme”; une assurance à la Sherlock Holmes»!43
Siegfried Kracauer, qui analyse de manière théologique
le roman
policier, tient les prouesses du surhomme pour une pure
mystification, ce en quoi Poe ne l’aurait pas contredit : «Cet
exercice fait du détective non seulement une caricature du moine,
mais encore le pendant du héros de la
ratio, qui
affirme en toute  circonstance la vérité certaine. Sauf, il est
vrai, qu’il figure dans ce rôle sans présenter plus que
l’apparence du héros. Car, dans le monde relatif, ce n’est pas
de haute lutte qu’il conquiert l’absolu incertain, mais c’est
lui l’absolu qui lutte en ce monde; ainsi, non soumis à la
relativité, il ne connaît pas non plus le conflit tragique qui le
condamnerait à l’échec inéluctable. Au contraire, la victoire
lui appartient
a priori
et son héroïsme n’est donc qu’un malentendu de l’héroïsme
authentique que seule la mort peut sceller en délivrant
définitivement le relatif du paradoxe. Le héros est héros s’il
peut mourir; le détective au contraire ne doit pas mourir, car la
ratio doit
sans cesse se conduire héroïquement - et au cas où il mourrait
quand même, sa mort ne serait qu’un hasard (dû par exemple à une
paralysie de l’imagination de l’auteur) et non une épreuve
ultime. Si intrépide que soit son
circonstance la vérité certaine. Sauf, il est
vrai, qu’il figure dans ce rôle sans présenter plus que
l’apparence du héros. Car, dans le monde relatif, ce n’est pas
de haute lutte qu’il conquiert l’absolu incertain, mais c’est
lui l’absolu qui lutte en ce monde; ainsi, non soumis à la
relativité, il ne connaît pas non plus le conflit tragique qui le
condamnerait à l’échec inéluctable. Au contraire, la victoire
lui appartient
a priori
et son héroïsme n’est donc qu’un malentendu de l’héroïsme
authentique que seule la mort peut sceller en délivrant
définitivement le relatif du paradoxe. Le héros est héros s’il
peut mourir; le détective au contraire ne doit pas mourir, car la
ratio doit
sans cesse se conduire héroïquement - et au cas où il mourrait
quand même, sa mort ne serait qu’un hasard (dû par exemple à une
paralysie de l’imagination de l’auteur) et non une épreuve
ultime. Si intrépide que soit son  Lupin, de façon très évidente, plusieurs théories :
Sorel (l’énergie créatrice, la polémique contre la bonasserie et
la stupidité de la bourgeoisie, la construction volontariste d’un
Mythe). Bergson (un “élan vital” interprété du point de vue du
surhomme et inspiré, justement, de Sorel), ou encore Maurras (la
condamnation de l’accumulation de l’Argent, un certain sens
mystique de la tradition française)… Lupin organise le crime,
bafoue la police, pille des fortunes, les dilapide et, en toute
innocence, se lance vers de nouvelles aventures non par soif de
justice ou appât du gain mais par désir de puissance, pour déployer
d’une manière extrêmement narcissique ses sources d’énergie :
“Il y a des moments où ma puissance me tourne la tête. Je suis
ivre de force et d’autorité…”, s’écrie-t-il dans l’Aiguille
creuse,
alors qu’il s’apprête en mégalomane, à léguer à la France
des trésors qui appartiennent à César, Charlemagne, Louis XIV,
ainsi que le secret d’une immense base militaire réputée
imprenable, que le pays a perdue (une fois que, mais Lupin n’ose le
dire, la monarchie a cédé devant la vile révolution - et là c’est
Maurras qui parle à travers lui)».45
Si
le surhomme de feuilletons aboutit à droite, c'est parce que dès le
départ – dès Edgar Poe -, il était cette machine à satisfaire
la ratio.
N'étant
qu'un automate de l'esprit, la condition humaine lui importait peu;
seule la résolution d'un problème le
Lupin, de façon très évidente, plusieurs théories :
Sorel (l’énergie créatrice, la polémique contre la bonasserie et
la stupidité de la bourgeoisie, la construction volontariste d’un
Mythe). Bergson (un “élan vital” interprété du point de vue du
surhomme et inspiré, justement, de Sorel), ou encore Maurras (la
condamnation de l’accumulation de l’Argent, un certain sens
mystique de la tradition française)… Lupin organise le crime,
bafoue la police, pille des fortunes, les dilapide et, en toute
innocence, se lance vers de nouvelles aventures non par soif de
justice ou appât du gain mais par désir de puissance, pour déployer
d’une manière extrêmement narcissique ses sources d’énergie :
“Il y a des moments où ma puissance me tourne la tête. Je suis
ivre de force et d’autorité…”, s’écrie-t-il dans l’Aiguille
creuse,
alors qu’il s’apprête en mégalomane, à léguer à la France
des trésors qui appartiennent à César, Charlemagne, Louis XIV,
ainsi que le secret d’une immense base militaire réputée
imprenable, que le pays a perdue (une fois que, mais Lupin n’ose le
dire, la monarchie a cédé devant la vile révolution - et là c’est
Maurras qui parle à travers lui)».45
Si
le surhomme de feuilletons aboutit à droite, c'est parce que dès le
départ – dès Edgar Poe -, il était cette machine à satisfaire
la ratio.
N'étant
qu'un automate de l'esprit, la condition humaine lui importait peu;
seule la résolution d'un problème le  stimulait. Il faudra attendre
le monde de Maigret avec Simenon pour trouver un détective-enquêteur
qui observe plus que le comportement des suspects. Avec
les inventions de la bande dessinée et du cinéma, ces caractères
de la surhumanité s'approprièrent
vite les
nouveaux média de masse. De nouveaux héros, adaptés aux média,
serviront des épopées encore plus fantastiques de la surhumanité,
jusqu’à en faire perdre ce goût de vraisemblance qui attirait les
lecteurs de romans policiers : «Face
aux crises, la science-fiction a pénétré ainsi l’image. Elle
exemplarise les combats dans d’incessantes guerres des mondes,
d’implacables combats du Bien contre le Mal, du Héros contre le
Traître, du Dieu contre le Diable. Tout est quête du Graal dans une
geste chevaleresque transposée. L’homme nouveau hante la bande
dessinée à travers les super-héros, tels
Buck Rogers in the 25th Century
de Dick Calkins et Phil Nowlan et
Tarzan de
Harold Foster en 1929;
Dick Tracy
de Chester Gould (1931);
Flash Gordon
d’Alex Raymond (1933);
Prince Valiant
d’Harold Foster (1937);
Superman
de Jerry Siegel et Joe Schuster (1938); Batman
de Bob Kane (1939). Tous surgissent de façon très significative aux
États-Unis à partir de la grande crise de 1929. Le preux aux
super-pouvoirs, alliant le Droit et les puissances de la science,
montre la Voie. L’éditeur Paul Winkler introduit ces séries en
France avec la création du
Journal de Mickey
le 21 octobre 1934
(Jim la Jungle, Prince Vaillant). En
1936,
Robinson
lance Guy
l’Éclair (Flash Gordon). Changeant
le rythme de l’action, les points de vue, la place du texte dans
l’image (avec les phylactères), ces “comics” américains
bouleversent la presse enfantine. Ils imposent pour longtemps le
surhomme en action dans un temps passé-présent-futur».46
La surhumanité du XXe siècle, définitivement, ne serait pas
allemande mais américaine.
stimulait. Il faudra attendre
le monde de Maigret avec Simenon pour trouver un détective-enquêteur
qui observe plus que le comportement des suspects. Avec
les inventions de la bande dessinée et du cinéma, ces caractères
de la surhumanité s'approprièrent
vite les
nouveaux média de masse. De nouveaux héros, adaptés aux média,
serviront des épopées encore plus fantastiques de la surhumanité,
jusqu’à en faire perdre ce goût de vraisemblance qui attirait les
lecteurs de romans policiers : «Face
aux crises, la science-fiction a pénétré ainsi l’image. Elle
exemplarise les combats dans d’incessantes guerres des mondes,
d’implacables combats du Bien contre le Mal, du Héros contre le
Traître, du Dieu contre le Diable. Tout est quête du Graal dans une
geste chevaleresque transposée. L’homme nouveau hante la bande
dessinée à travers les super-héros, tels
Buck Rogers in the 25th Century
de Dick Calkins et Phil Nowlan et
Tarzan de
Harold Foster en 1929;
Dick Tracy
de Chester Gould (1931);
Flash Gordon
d’Alex Raymond (1933);
Prince Valiant
d’Harold Foster (1937);
Superman
de Jerry Siegel et Joe Schuster (1938); Batman
de Bob Kane (1939). Tous surgissent de façon très significative aux
États-Unis à partir de la grande crise de 1929. Le preux aux
super-pouvoirs, alliant le Droit et les puissances de la science,
montre la Voie. L’éditeur Paul Winkler introduit ces séries en
France avec la création du
Journal de Mickey
le 21 octobre 1934
(Jim la Jungle, Prince Vaillant). En
1936,
Robinson
lance Guy
l’Éclair (Flash Gordon). Changeant
le rythme de l’action, les points de vue, la place du texte dans
l’image (avec les phylactères), ces “comics” américains
bouleversent la presse enfantine. Ils imposent pour longtemps le
surhomme en action dans un temps passé-présent-futur».46
La surhumanité du XXe siècle, définitivement, ne serait pas
allemande mais américaine. Malheureusement,
la surhumanité avait ses tares,
autant en fiction que dans les prétentions réelles. Les savants
devenaient fous, les détectives meurtriers (comme Hercule Poirot),
les superhéros devenaient, comme Batman,
aussi
psychopathes que les méchants qu’ils combattaient. Le surhomme
n’était en fin de course qu’un homme ordinaire doublé d’une
technique
qu’il
maîtrisait habilement.
Malheureusement,
la surhumanité avait ses tares,
autant en fiction que dans les prétentions réelles. Les savants
devenaient fous, les détectives meurtriers (comme Hercule Poirot),
les superhéros devenaient, comme Batman,
aussi
psychopathes que les méchants qu’ils combattaient. Le surhomme
n’était en fin de course qu’un homme ordinaire doublé d’une
technique
qu’il
maîtrisait habilement. Une fois ramené à ses proportions réelles, comme Superman lorsqu’il est Clark Kent, la magie n’opérait plus. Comme le souligne encore une fois Umberto Eco : «Souvent, la vertu du héros s’humanise, et ses pouvoirs ultra-surnaturels ne sont que la réalisation parfaitement aboutie d’un pouvoir naturel, la ruse, la rapidité, l’habileté guerrière, voire l’intelligence syllogistique et le sens de l’observation à l’état pur que l’on retrouve chez Sherlock Holmes. Mais dans une société particulièrement nivelée, où les troubles psychologiques, les frustrations, les complexes d’infériorité sont à l’ordre du jour, dans une société industrielle où l’homme devient un numéro à l’intérieur d’une organisation qui décide pour lui, où la force individuelle, quand elle ne s’exerce pas au sein d’une activité sportive, est humiliée face à la force de la
 machine qui
agit pour l’homme et va jusqu’à déterminer ses mouvements, dans
une telle société, le héros positif doit incarner, au-delà du
concevable, les exigences de puissance que le citoyen commun nourrit
sans pouvoir les satisfaire».47
Les auteurs, comme les artistes, réalisaient que leur surhumanité
ne provenaient pas de dons extraordinaires, mais bien des souffrances
et des efforts qu’ils mettaient à donner vie à leurs œuvres.
Thomas Mann, pour
exemple : «À
ses yeux, sa souffrance intolérable ne provient pas d’une erreur
individuelle, mais de la structure générale de la condition
humaine. Celle-ci ne peut être que malheureuse, et la supériorité
des natures d’élite consiste précisément à la reconnaître et à
l’accepter comme telle. Ce qui permet à l’artiste de ne pas
sombrer dans le désespoir absolu. C’est le plaisir qu’il prend
au travail de la forme et à la mise en œuvre de son expérience
tragique».48
Les héros du dramaturge Ibsen en savent également
quelque
chose : «L’artiste
vit dans son rêve, il est séparé du monde réel par la densité de
ses propres
machine qui
agit pour l’homme et va jusqu’à déterminer ses mouvements, dans
une telle société, le héros positif doit incarner, au-delà du
concevable, les exigences de puissance que le citoyen commun nourrit
sans pouvoir les satisfaire».47
Les auteurs, comme les artistes, réalisaient que leur surhumanité
ne provenaient pas de dons extraordinaires, mais bien des souffrances
et des efforts qu’ils mettaient à donner vie à leurs œuvres.
Thomas Mann, pour
exemple : «À
ses yeux, sa souffrance intolérable ne provient pas d’une erreur
individuelle, mais de la structure générale de la condition
humaine. Celle-ci ne peut être que malheureuse, et la supériorité
des natures d’élite consiste précisément à la reconnaître et à
l’accepter comme telle. Ce qui permet à l’artiste de ne pas
sombrer dans le désespoir absolu. C’est le plaisir qu’il prend
au travail de la forme et à la mise en œuvre de son expérience
tragique».48
Les héros du dramaturge Ibsen en savent également
quelque
chose : «L’artiste
vit dans son rêve, il est séparé du monde réel par la densité de
ses propres  visions. Il n’aperçoit dans son modèle (ou, quand il
s’agit du poète dramatique, dans son interlocuteur) qu’une
source d’inspiration. Il ne sait pas deviner les mouvements ou les
aspirations d’une âme qui veut s’ouvrir à lui. Il refuse
l’échange. Il prend, il ne donne pas. Il se réserve pour son
œuvre. Ses yeux ne s’ouvrent même pas sur le monde qui l’entoure,
sauf si ce monde et la société qui y vit peuvent l’aider à
construire l’édifice dont il rêve».49
Il y a un peu de son propre destin qu’Ibsen fait porter à son
personnage de Brand :
«Pour
mieux créer, l’artiste a fermé les yeux sur les dévouements
qu’on lui portait, sur l’amour qui cherchait à se déclarer. Il
est passé à côté de la vie. C’est en vain qu’il essaie de
renouer avec le passé, de réparer les erreurs, de les oublier, de
payer sa dette envers une femme à qui il doit le succès et même la
gloire».50
C’est une tragédie que le surhomme ne peut éviter, qu’il soit
artiste, écrivain ou, à plus fortes raisons, homme d’État :
«L’homme
supérieur ne peut pas marcher vers son but sans faire souffrir son
entourage, sans accepter que ses proches se sacrifient pour lui et,
par conséquent, il n’échappe jamais au sentiment de la
culpabilité. Mais ce sentiment devient encore plus poignant au moment où s’arrête l’action, où l’inspiration tarit».51
Bourgeois de petites villes norvégiennes, les héros d’Ibsen
doivent surmonter leur milieu afin de faire triompher leurs
aspirations collectives. C’est ce qu’apprendra à ses dépens
Stockman, le
visions. Il n’aperçoit dans son modèle (ou, quand il
s’agit du poète dramatique, dans son interlocuteur) qu’une
source d’inspiration. Il ne sait pas deviner les mouvements ou les
aspirations d’une âme qui veut s’ouvrir à lui. Il refuse
l’échange. Il prend, il ne donne pas. Il se réserve pour son
œuvre. Ses yeux ne s’ouvrent même pas sur le monde qui l’entoure,
sauf si ce monde et la société qui y vit peuvent l’aider à
construire l’édifice dont il rêve».49
Il y a un peu de son propre destin qu’Ibsen fait porter à son
personnage de Brand :
«Pour
mieux créer, l’artiste a fermé les yeux sur les dévouements
qu’on lui portait, sur l’amour qui cherchait à se déclarer. Il
est passé à côté de la vie. C’est en vain qu’il essaie de
renouer avec le passé, de réparer les erreurs, de les oublier, de
payer sa dette envers une femme à qui il doit le succès et même la
gloire».50
C’est une tragédie que le surhomme ne peut éviter, qu’il soit
artiste, écrivain ou, à plus fortes raisons, homme d’État :
«L’homme
supérieur ne peut pas marcher vers son but sans faire souffrir son
entourage, sans accepter que ses proches se sacrifient pour lui et,
par conséquent, il n’échappe jamais au sentiment de la
culpabilité. Mais ce sentiment devient encore plus poignant au moment où s’arrête l’action, où l’inspiration tarit».51
Bourgeois de petites villes norvégiennes, les héros d’Ibsen
doivent surmonter leur milieu afin de faire triompher leurs
aspirations collectives. C’est ce qu’apprendra à ses dépens
Stockman, le  bourgeois réformiste d’Un ennemi du peuple :
«Le fait
est, voyez-vous, qu’en ce monde l’homme le plus fort est celui
qui se trouve le plus seul».52
Bien avant que les Américains fassent monter le common
man au
Sénat, dans le film célèbre de Frank Capra, Mr
Smith goes to Washington (1939),
Ibsen plaçait ses tranquilles petits-bourgeois
saisis hors de leur confort, poussés
vers la tragédie généralement réservée aux seuls nobles. Ils se
sentaient
soudainement pris d’un appel mystique obsessionnel : «Ils
veulent réaliser toutes les virtualités de leur moi supérieur. Ils
ont perçu un appel, ils veulent y répondre. Le mot clé du théâtre
ibsénien est sans doute “vocation”».53
Indubitablement, ce sont des surhommes
motivés
par un Moi conquérant, prêt à révolutionner le monde, à
la manière de Freud.
Les défis qui se présentent à eux semblent les élire à
l'accomplissement
des tâches qui vont même à l’encontre de leur milieu dont ils se
font vite détester : «Or,
ce développement de la personnalité semble parfois absurde,
arrogant, provocant à
bourgeois réformiste d’Un ennemi du peuple :
«Le fait
est, voyez-vous, qu’en ce monde l’homme le plus fort est celui
qui se trouve le plus seul».52
Bien avant que les Américains fassent monter le common
man au
Sénat, dans le film célèbre de Frank Capra, Mr
Smith goes to Washington (1939),
Ibsen plaçait ses tranquilles petits-bourgeois
saisis hors de leur confort, poussés
vers la tragédie généralement réservée aux seuls nobles. Ils se
sentaient
soudainement pris d’un appel mystique obsessionnel : «Ils
veulent réaliser toutes les virtualités de leur moi supérieur. Ils
ont perçu un appel, ils veulent y répondre. Le mot clé du théâtre
ibsénien est sans doute “vocation”».53
Indubitablement, ce sont des surhommes
motivés
par un Moi conquérant, prêt à révolutionner le monde, à
la manière de Freud.
Les défis qui se présentent à eux semblent les élire à
l'accomplissement
des tâches qui vont même à l’encontre de leur milieu dont ils se
font vite détester : «Or,
ce développement de la personnalité semble parfois absurde,
arrogant, provocant à  l’entourage du héros, à la société
conservatrice qui l’entoure. Se réaliser soi-même, selon
l’optique d’Ibsen, ce n’est pas suivre sa pente naturelle,
c’est, le plus souvent, écarter les solutions faciles ou toutes
faites et ramer à contre-courant, savoir au besoin ne pas reculer
devant l’éclat ou le scandale».54
Et Maurice Gravier d’insister : «La
question qui donne son titre au 9e chapitre de Par-delà le bien et
le Mal, “Was ist Vornehm?”, Qu’est-ce
qui est noble?,
cette anxieuse interrogation est au cœur même de l’œuvre
ibsénienne. Et peut-être, hélas, est-ce justement cette question
dont le sens est aujourd’hui si peu compris».55
Pas moins que dans le roman policier, le surhomme d’Ibsen va
masqué : «Sans
action, les personnages d’Ibsen ne prennent pas vie. Par l’action,
les caractères inhérents aux personnages surgissent et se révèlent
pour le bien ou pour le mal. Les personnages d’Ibsen ont des
visages humains qui sont comme des masques cachant des forces
monstrueuses sous la surface, ces forces mêmes que, spectateur ou
spectatrice, nous percevons comme des traits archétypaux, une fois
que nous sommes pris par l’action».56
Comme le disait déjà le prologue du Faust de
Gœthe : Au
commencement était l’action, et
c’est là le premier commandement qui fait apparaître le surhomme
sur
la scène bourgeoise.
l’entourage du héros, à la société
conservatrice qui l’entoure. Se réaliser soi-même, selon
l’optique d’Ibsen, ce n’est pas suivre sa pente naturelle,
c’est, le plus souvent, écarter les solutions faciles ou toutes
faites et ramer à contre-courant, savoir au besoin ne pas reculer
devant l’éclat ou le scandale».54
Et Maurice Gravier d’insister : «La
question qui donne son titre au 9e chapitre de Par-delà le bien et
le Mal, “Was ist Vornehm?”, Qu’est-ce
qui est noble?,
cette anxieuse interrogation est au cœur même de l’œuvre
ibsénienne. Et peut-être, hélas, est-ce justement cette question
dont le sens est aujourd’hui si peu compris».55
Pas moins que dans le roman policier, le surhomme d’Ibsen va
masqué : «Sans
action, les personnages d’Ibsen ne prennent pas vie. Par l’action,
les caractères inhérents aux personnages surgissent et se révèlent
pour le bien ou pour le mal. Les personnages d’Ibsen ont des
visages humains qui sont comme des masques cachant des forces
monstrueuses sous la surface, ces forces mêmes que, spectateur ou
spectatrice, nous percevons comme des traits archétypaux, une fois
que nous sommes pris par l’action».56
Comme le disait déjà le prologue du Faust de
Gœthe : Au
commencement était l’action, et
c’est là le premier commandement qui fait apparaître le surhomme
sur
la scène bourgeoise. Si
des petits drames quotidiens
issu du fond d’un village norvégien pouvaient faire naître un
surhomme sous la peau d’un bourgeois, imaginons maintenant ce que
les révolutions, les guerres et le colonialisme ont pu faire sortir
de surhumanité
chez ces
conquérants victorieux. On a vu Zola dithyrambique devant les
colonisateurs français. Des feuilletons exotiques célébraient de
même les aventures coloniales, comme Émile Nolly, pseudonyme du
capitaine Détanger (1880-1914), qui devait mourir au combat au
début de la Grande Guerre après avoir publié un roman du
genre Hiên-le-Maboul :
«Hiên
est un tirailleur des troupes coloniales, par les yeux de qui nous
voyons “l’Aïeul”, c’est-à-dire le capitaine, en qui Hiên
voit “un dieu”; il admire les boutons dorés et les bottes
vernies, il idolâtre le sourire et les yeux clairs de “cet homme
galonné d’or et casqué de blanc”; aucune autre image ne
pourrait rendre plus clairement compte des rapports entre
colonisateur et colonisé, conçus idéalement par le colonisateur».57
Lorsque les Occidentaux prêtent la parole aux sous-hommes, c’est
Si
des petits drames quotidiens
issu du fond d’un village norvégien pouvaient faire naître un
surhomme sous la peau d’un bourgeois, imaginons maintenant ce que
les révolutions, les guerres et le colonialisme ont pu faire sortir
de surhumanité
chez ces
conquérants victorieux. On a vu Zola dithyrambique devant les
colonisateurs français. Des feuilletons exotiques célébraient de
même les aventures coloniales, comme Émile Nolly, pseudonyme du
capitaine Détanger (1880-1914), qui devait mourir au combat au
début de la Grande Guerre après avoir publié un roman du
genre Hiên-le-Maboul :
«Hiên
est un tirailleur des troupes coloniales, par les yeux de qui nous
voyons “l’Aïeul”, c’est-à-dire le capitaine, en qui Hiên
voit “un dieu”; il admire les boutons dorés et les bottes
vernies, il idolâtre le sourire et les yeux clairs de “cet homme
galonné d’or et casqué de blanc”; aucune autre image ne
pourrait rendre plus clairement compte des rapports entre
colonisateur et colonisé, conçus idéalement par le colonisateur».57
Lorsque les Occidentaux prêtent la parole aux sous-hommes, c’est
 toujours pour montrer à quels points ils sont subjugués par le
vernis de leur conquérant. On s’imagine mal un auteur nazi
décrivant la fascination d’un sous-homme d’Auschwitz devant
l’uniforme S.S.!
Joseph Conrad a également décrit l’Occidental, lord Jim, doué
d’une extraordinaire bravoure en ses intentions mais plutôt couard dans ses actions, mais vu
par la plume d’un compatriote : «Le
genre d’hommes qui a le plus gagné le cœur de Conrad a été
dessiné par Marlow lui-même quand il dit de Jim : “sa mine me
plaisait… il représentait toute sa race, une race d’hommes et de
femmes qui n’ont rien de fin ni de plaisant, mais dont toute
l’existence est basée sur une foi droite et sur l’instinct du
courage. Je ne parle pas du courage militaire, du courage civil ou
d’aucune espèce particulière de courage; je parle de cette
aptitude innée à regarder les tentations en face, aptitude assez
peu intellectuelle évidement, mais sans pose, capacité de
résistance médiocrement gracieuse, si vous voulez, mais
inappréciable, raideur spontanée et
toujours pour montrer à quels points ils sont subjugués par le
vernis de leur conquérant. On s’imagine mal un auteur nazi
décrivant la fascination d’un sous-homme d’Auschwitz devant
l’uniforme S.S.!
Joseph Conrad a également décrit l’Occidental, lord Jim, doué
d’une extraordinaire bravoure en ses intentions mais plutôt couard dans ses actions, mais vu
par la plume d’un compatriote : «Le
genre d’hommes qui a le plus gagné le cœur de Conrad a été
dessiné par Marlow lui-même quand il dit de Jim : “sa mine me
plaisait… il représentait toute sa race, une race d’hommes et de
femmes qui n’ont rien de fin ni de plaisant, mais dont toute
l’existence est basée sur une foi droite et sur l’instinct du
courage. Je ne parle pas du courage militaire, du courage civil ou
d’aucune espèce particulière de courage; je parle de cette
aptitude innée à regarder les tentations en face, aptitude assez
peu intellectuelle évidement, mais sans pose, capacité de
résistance médiocrement gracieuse, si vous voulez, mais
inappréciable, raideur spontanée et  bénie devant les terreurs du
dedans et du dehors, devant les forces de la nature et la séduisante
corruption des hommes, doublée d’une indéfectible foi dans la
puissance des faits, la contagion de l’exemple, la sollicitation
des idées. Au diable les idées, ce sont des rôdeuses, des
vagabondes qui viennent frapper à la porte dérobée de votre
esprit, dont chacune enlève une parcelle de votre substance et
emporte une miette de cette foi en quelques notions très simples
auxquelles il faut s’accrocher si l’on veut vivre honnêtement et
si l’on souhaite une mort facile”».58
Dans d’autres romans, Conrad nous présente Tom Lingard, un
véritable héritier des aventures de Melville, qui se fait une vie
dans les îles au large de Bornéo : «C’est
autre chose, que de vivre en dehors de la loi,
bénie devant les terreurs du
dedans et du dehors, devant les forces de la nature et la séduisante
corruption des hommes, doublée d’une indéfectible foi dans la
puissance des faits, la contagion de l’exemple, la sollicitation
des idées. Au diable les idées, ce sont des rôdeuses, des
vagabondes qui viennent frapper à la porte dérobée de votre
esprit, dont chacune enlève une parcelle de votre substance et
emporte une miette de cette foi en quelques notions très simples
auxquelles il faut s’accrocher si l’on veut vivre honnêtement et
si l’on souhaite une mort facile”».58
Dans d’autres romans, Conrad nous présente Tom Lingard, un
véritable héritier des aventures de Melville, qui se fait une vie
dans les îles au large de Bornéo : «C’est
autre chose, que de vivre en dehors de la loi,  comme faisait Lingard.
Non pas en lutte, mais en dehors. Vivre sans être soumis à rien ni
à personne; vivre après s’être créé, comme homme, des
conditions de vie qui permettent d’être toujours fidèle à soi, à
soi seul, à la loi intérieure de la conscience et de ses nobles
impulsions, voilà, oui, voilà ce qui pour Conrad a possédé un
charme réel et profond. Tel a été le plus beau de ses
rêves de puissance,
rêve qu’il ne réalisa que dans le domaine de l’art, sous la
figure de Lingard… et qui fut dans ce personnage soumis à un cruel
réveil par l’ironie de l’auteur dirigée sur soi-même et par
l’ironie du sort, inévitable dans la vision qu’il avait du
monde».59
Le monde extérieur à l’Occident – l’Afrique ou l’Indonésie
– où se déroulent les romans de Conrad permet à la surhumanité
de sortir de son milieu bourgeois où Ibsen le tenait. Lord Jim est
peut-être moins courageux, dans le fond, que Borkman, mais le milieu
est tout à fait différent. Vue d’Europe, le courage de Jim
amplifie la valeur du stéréotype. On s’imagine toujours mal à
quel point la médiocrité bourgeoise est encore plus barbare que les
milieux exotiques où l’on coupe les têtes pour les réduire ou
que l’on découpe des corps encore vivants pour châtier un
parricide.
comme faisait Lingard.
Non pas en lutte, mais en dehors. Vivre sans être soumis à rien ni
à personne; vivre après s’être créé, comme homme, des
conditions de vie qui permettent d’être toujours fidèle à soi, à
soi seul, à la loi intérieure de la conscience et de ses nobles
impulsions, voilà, oui, voilà ce qui pour Conrad a possédé un
charme réel et profond. Tel a été le plus beau de ses
rêves de puissance,
rêve qu’il ne réalisa que dans le domaine de l’art, sous la
figure de Lingard… et qui fut dans ce personnage soumis à un cruel
réveil par l’ironie de l’auteur dirigée sur soi-même et par
l’ironie du sort, inévitable dans la vision qu’il avait du
monde».59
Le monde extérieur à l’Occident – l’Afrique ou l’Indonésie
– où se déroulent les romans de Conrad permet à la surhumanité
de sortir de son milieu bourgeois où Ibsen le tenait. Lord Jim est
peut-être moins courageux, dans le fond, que Borkman, mais le milieu
est tout à fait différent. Vue d’Europe, le courage de Jim
amplifie la valeur du stéréotype. On s’imagine toujours mal à
quel point la médiocrité bourgeoise est encore plus barbare que les
milieux exotiques où l’on coupe les têtes pour les réduire ou
que l’on découpe des corps encore vivants pour châtier un
parricide. Cette
littérature que l’on retrouve chez Conrad ou encore chez Loti a
subi une grande influence de la littérature américaine où sont
apparus les premiers modèles de feuilletons de surhumanité à travers les coureurs des bois français qui résistaient aux hivers
rigoureux et aux cow-boys qui livrèrent la lutte aux indiens afin
d’acheminer les troupeaux vers les parcs à bestiaux de Chicago :
«Alors
qu’il n’est a priori qu’un vacher, le cow-boy s’est vu
affubler de la complète panoplie du surhomme»,
rappelle Olivier Razac.60
On se souvient que le jeune Adolf Hitler était friand des histoires
de cow-boys racontés par Karl May et le cinéma américain, dès sa
création, porta à l’écran l’odyssée de ces marins des
prairies. Les réalisateurs s’inspiraient d’autobiographies ou de
biographies pour raconter l’héroïsme de la conquête de l’ouest
de même que les coups de ses bandits et tueurs les plus célèbres :
«Comme
Buffalo Bill, Billy the Kid est inspiré d’une biographie relatant
des faits exacts ou remettant à neuf des récits populaires. Le
héros n’est pas forcément moral mais le peuple l’aime car il
est fort et courageux: il entre dans cette mythologie du surhomme
dont les salles populaires ont toujours eu besoin. Il y a aussi
d’autres
Cette
littérature que l’on retrouve chez Conrad ou encore chez Loti a
subi une grande influence de la littérature américaine où sont
apparus les premiers modèles de feuilletons de surhumanité à travers les coureurs des bois français qui résistaient aux hivers
rigoureux et aux cow-boys qui livrèrent la lutte aux indiens afin
d’acheminer les troupeaux vers les parcs à bestiaux de Chicago :
«Alors
qu’il n’est a priori qu’un vacher, le cow-boy s’est vu
affubler de la complète panoplie du surhomme»,
rappelle Olivier Razac.60
On se souvient que le jeune Adolf Hitler était friand des histoires
de cow-boys racontés par Karl May et le cinéma américain, dès sa
création, porta à l’écran l’odyssée de ces marins des
prairies. Les réalisateurs s’inspiraient d’autobiographies ou de
biographies pour raconter l’héroïsme de la conquête de l’ouest
de même que les coups de ses bandits et tueurs les plus célèbres :
«Comme
Buffalo Bill, Billy the Kid est inspiré d’une biographie relatant
des faits exacts ou remettant à neuf des récits populaires. Le
héros n’est pas forcément moral mais le peuple l’aime car il
est fort et courageux: il entre dans cette mythologie du surhomme
dont les salles populaires ont toujours eu besoin. Il y a aussi
d’autres  héros plus rassurants, comme les Texas Rangers, corps de
défense organisé militairement et chargé de maintenir l’ordre
contre les Indiens, les Apaches - classés encore comme des êtres
inférieurs - et les bandits de toutes sortes. Inspiré par eux, King
Vidor fait en 1936 avec Fred MacMurray Texas Rangers,
épopée où l’on voit s’affronter Indiens et Rangers».61
Le western,
en livre
comme en film, reproduisait ces romans maritimes dont le Moby
Dick de
Melville reste
le chef-d’œuvre indépassable. Il perpétuait
l’extrême-occidentalité dans sa conduite gyrovague que la
tragédie de Jack London (1876-1916) illustra au début du XXe
siècle. Ce Mark Twain malheureux, surmonta ses faiblesses physiques,
à l’image du jeune Théodore Roosevelt, et visa rien de moins qu’à
assumer la surhumanité en lui : «Marin
intrépide, correspondant de guerre téméraire, orateur
d’inspiration socialiste, mais en même
héros plus rassurants, comme les Texas Rangers, corps de
défense organisé militairement et chargé de maintenir l’ordre
contre les Indiens, les Apaches - classés encore comme des êtres
inférieurs - et les bandits de toutes sortes. Inspiré par eux, King
Vidor fait en 1936 avec Fred MacMurray Texas Rangers,
épopée où l’on voit s’affronter Indiens et Rangers».61
Le western,
en livre
comme en film, reproduisait ces romans maritimes dont le Moby
Dick de
Melville reste
le chef-d’œuvre indépassable. Il perpétuait
l’extrême-occidentalité dans sa conduite gyrovague que la
tragédie de Jack London (1876-1916) illustra au début du XXe
siècle. Ce Mark Twain malheureux, surmonta ses faiblesses physiques,
à l’image du jeune Théodore Roosevelt, et visa rien de moins qu’à
assumer la surhumanité en lui : «Marin
intrépide, correspondant de guerre téméraire, orateur
d’inspiration socialiste, mais en même  temps raciste avéré,
admirateur déclaré du surhomme blond et teuton, victime tout à la
fois de la fièvre de l’or en Alaska et de la boisson, l’homme
célébra avec passion l’ivresse des affrontements et des champs de
bataille. Pour lui, la civilisation parvenait mal à masquer les
pulsions sanguinaires qui faisaient battre le cœur de l’être
humain. Dans les situations extrêmes, que ce fût en pleine mer,
dans le Grand Nord ou en temps de guerre, hommes et chiens ne
réussissaient à accomplir leur destin qu’après avoir appris à
tuer. Jamais écrivain ne célébra les vertus de la virilité avec
une allégresse aussi masquée.
Longtemps sa réputation demeura considérable. En 1916, London
mourut usé par l’alcool, la débauche et la morphine. Ses livres,
emplis de récits chargés de l’agressivité la plus débridée,
s’étaient vendus à plusieurs millions d’exemplaires».62
Il poussa la surhumanité le plus loin qu’il pouvait, jusqu’à
imaginer une surfemme, partenaire idéale pour lui, dans son roman
Une Fille des Neiges (1902) :
«Cette
héroïne était censée représenter la femme idéale selon Jack,
sur les plans
temps raciste avéré,
admirateur déclaré du surhomme blond et teuton, victime tout à la
fois de la fièvre de l’or en Alaska et de la boisson, l’homme
célébra avec passion l’ivresse des affrontements et des champs de
bataille. Pour lui, la civilisation parvenait mal à masquer les
pulsions sanguinaires qui faisaient battre le cœur de l’être
humain. Dans les situations extrêmes, que ce fût en pleine mer,
dans le Grand Nord ou en temps de guerre, hommes et chiens ne
réussissaient à accomplir leur destin qu’après avoir appris à
tuer. Jamais écrivain ne célébra les vertus de la virilité avec
une allégresse aussi masquée.
Longtemps sa réputation demeura considérable. En 1916, London
mourut usé par l’alcool, la débauche et la morphine. Ses livres,
emplis de récits chargés de l’agressivité la plus débridée,
s’étaient vendus à plusieurs millions d’exemplaires».62
Il poussa la surhumanité le plus loin qu’il pouvait, jusqu’à
imaginer une surfemme, partenaire idéale pour lui, dans son roman
Une Fille des Neiges (1902) :
«Cette
héroïne était censée représenter la femme idéale selon Jack,
sur les plans  physique, moral et intellectuel. Elle pouvait citer
Spencer à tout propos, et suivre un traîneau de chiens pendant
trente kilomètres par moins 70°. Mais, ce qui était pire, elle
soutenait des thèses aussi indéfendables que son caractère. Elle
défendait sa foi d’Anglo-Saxonne comme un professeur en chaire, et
non pas comme une jeune fille parlant à un soupirant. “Nous sommes
une race de bâtisseurs et de guerriers, déclarait-elle. Nous
encerclons le globe, nous sommes des conquérants. Nous luttons, nous
travaillons et nous persistons dans nos efforts, quand bien même
seraient-ils désespérés.” Ceci dit, elle n’était nullement
féministe et méprisait la cause de la libération des femmes; elle
n’incarnait pas la femme émancipée mais la femelle d’une espèce
nouvelle. C’était elle la compagne et l’amante idéale que Jack
avait rêvé de rencontrer au Klondyke, mais sur le papier il l’avait
rendue aussi froide et artificielle qu’une statue d’éphèbe
auquel on aurait ajouté des seins de marbre».63
De
fait, les femmes durent
attendre longtemps avant de trouver sa place
de superwoman
dans les bandes dessinées et au cinéma américain.
physique, moral et intellectuel. Elle pouvait citer
Spencer à tout propos, et suivre un traîneau de chiens pendant
trente kilomètres par moins 70°. Mais, ce qui était pire, elle
soutenait des thèses aussi indéfendables que son caractère. Elle
défendait sa foi d’Anglo-Saxonne comme un professeur en chaire, et
non pas comme une jeune fille parlant à un soupirant. “Nous sommes
une race de bâtisseurs et de guerriers, déclarait-elle. Nous
encerclons le globe, nous sommes des conquérants. Nous luttons, nous
travaillons et nous persistons dans nos efforts, quand bien même
seraient-ils désespérés.” Ceci dit, elle n’était nullement
féministe et méprisait la cause de la libération des femmes; elle
n’incarnait pas la femme émancipée mais la femelle d’une espèce
nouvelle. C’était elle la compagne et l’amante idéale que Jack
avait rêvé de rencontrer au Klondyke, mais sur le papier il l’avait
rendue aussi froide et artificielle qu’une statue d’éphèbe
auquel on aurait ajouté des seins de marbre».63
De
fait, les femmes durent
attendre longtemps avant de trouver sa place
de superwoman
dans les bandes dessinées et au cinéma américain. London
présentait le Nord comme une suite de l’exotisme du Far-West,
où le
Klondyke remplaçait convenablement la ruée versl’or de
Californie
des années 1850. Pour les Canadiens, et en particulier les
francophones tôt initiés aux rigueurs du froid boréal, «ce
désir du Nord, le poète ne peut décider s’il s’agit d’un
énorme ennui ou d’un rêve, une utopie qui attend d’être
réalisée. Car l’espace est trop vaste, la neige fait penser à du
chloroforme, le paysage d’hiver ressemble à un sanatorium, le défi
prend place dans le silence le plus total, avec rien devant et une
trace bleue qui se perd à l’arrière».64
Pour les Européens, cette vision mélancolique du Nord n’était
pas recevable. Celle de London équivalait aux aventures africaines
de Kipling ou de Conrad, de Loti ou de Rimbaud.
Marie Bonaparte, la princesse-
London
présentait le Nord comme une suite de l’exotisme du Far-West,
où le
Klondyke remplaçait convenablement la ruée versl’or de
Californie
des années 1850. Pour les Canadiens, et en particulier les
francophones tôt initiés aux rigueurs du froid boréal, «ce
désir du Nord, le poète ne peut décider s’il s’agit d’un
énorme ennui ou d’un rêve, une utopie qui attend d’être
réalisée. Car l’espace est trop vaste, la neige fait penser à du
chloroforme, le paysage d’hiver ressemble à un sanatorium, le défi
prend place dans le silence le plus total, avec rien devant et une
trace bleue qui se perd à l’arrière».64
Pour les Européens, cette vision mélancolique du Nord n’était
pas recevable. Celle de London équivalait aux aventures africaines
de Kipling ou de Conrad, de Loti ou de Rimbaud.
Marie Bonaparte, la princesse- psychanalyste, va même jusqu’à
écrire que «l’Américain
du Nord est un sur-Anglais. Il incarne le plus fort dynamisme de la
race blanche, parfois avec une violence qui choque les Européens.
Rarement artiste, trop absorbé encore par la lutte pour la vie
contre les forces naturelles et par l’âpre compétition sociale,
il peut se délasser en regardant, au cinéma, le film qu’il a créé
et où trépide l’activité humaine, voire même s’offrir à prix
d’or le luxe d’écouter des chanteurs venus d’Europe. Mais ses
poèmes et ses symphonies sont avant tout le chemin de fer lancé à
travers la Prairie et par-dessus les gouffres des
Montagnes-
psychanalyste, va même jusqu’à
écrire que «l’Américain
du Nord est un sur-Anglais. Il incarne le plus fort dynamisme de la
race blanche, parfois avec une violence qui choque les Européens.
Rarement artiste, trop absorbé encore par la lutte pour la vie
contre les forces naturelles et par l’âpre compétition sociale,
il peut se délasser en regardant, au cinéma, le film qu’il a créé
et où trépide l’activité humaine, voire même s’offrir à prix
d’or le luxe d’écouter des chanteurs venus d’Europe. Mais ses
poèmes et ses symphonies sont avant tout le chemin de fer lancé à
travers la Prairie et par-dessus les gouffres des
Montagnes- Rocheuses; la forêt, la mine conquises et le port creusé.
Son plus grand effort, au domaine contemplatif, a enfanté le
pragmatisme, qui est la philosophie de sa propre vie et exalte
l’utilité comme la suprême valeur».65
Au contraire, la mort de François Paradis, gelé dans le blizzard,
coupait court aux fantaisies que pouvaient s’imaginer les Français
à partir du roman de Louis Hémon, Maria
Chapdelaine. L’auteur
lui-même périt, écrapouti en tentant de jumper
un wagon
de marchandise en partance vers l’ouest (8 juillet 1913). La poésie
québécoise, riche en images de l’hiver canadien, reste la
poésie du Vent
du Nord, d’Alfred DesRochers : «Bien
sûr, il est quelquefois synonyme de destruction, de violence et de
malheur. Sa “clameur” et ses “grognements d’ours polaire”
effraient les voyageurs, son “souffle immense ébranle les
étoiles”; chasseur et vandale comme l’aigle, toutes les proies
lui sont faciles. Sa colère et sa rage sèment la peur et le
désarroi chez les plus téméraires. Mais même la mort, causée par
lui, est grandiose, extatique :
Rocheuses; la forêt, la mine conquises et le port creusé.
Son plus grand effort, au domaine contemplatif, a enfanté le
pragmatisme, qui est la philosophie de sa propre vie et exalte
l’utilité comme la suprême valeur».65
Au contraire, la mort de François Paradis, gelé dans le blizzard,
coupait court aux fantaisies que pouvaient s’imaginer les Français
à partir du roman de Louis Hémon, Maria
Chapdelaine. L’auteur
lui-même périt, écrapouti en tentant de jumper
un wagon
de marchandise en partance vers l’ouest (8 juillet 1913). La poésie
québécoise, riche en images de l’hiver canadien, reste la
poésie du Vent
du Nord, d’Alfred DesRochers : «Bien
sûr, il est quelquefois synonyme de destruction, de violence et de
malheur. Sa “clameur” et ses “grognements d’ours polaire”
effraient les voyageurs, son “souffle immense ébranle les
étoiles”; chasseur et vandale comme l’aigle, toutes les proies
lui sont faciles. Sa colère et sa rage sèment la peur et le
désarroi chez les plus téméraires. Mais même la mort, causée par
lui, est grandiose, extatique :
 d’amour. Le poète lui demande de l’emporter “vers la grande
Aventure”, “par delà l’encerclement des horizons”, “parmi
les cimes blanches”, “sur un lit de frimas, de verglas et de
branches”. Ce “vent libérateur”, frère des hommes, se mêle à
leur sang et les régénère, engendrant une race de surhommes :
“[…]
tu donnas/La vigueur de ton souffle aux muscles de leurs bras!”
ainsi que “ton appel orageux”, ta “violence”, ta “haine de
l’obstacle” et ta “peur du silence”. Durant les longs mois
d’hiver, il rapproche les cœurs des amants, vibre en eux et
dispense l’amour. Son chant apporte la fraternité parmi les
hommes. Le cri du poète, à la fin de l’“Hymne au vent du Nord”,
en est un d’amour et de reconnaissance, un gage d’immortalité :
“J’oublierai que ma vie est moins qu’un grain de sable/Au
sablier des ans chus dans l’Éternité!”; et surtout : “Je clame
au monde veule, ô mon Vent, que je t’aime!”».66
Pour un lecteur habitué à la chaleur, sèche ou humide, il était
difficile de ne pas sentir plutôt la désolation et l’isolement
sibérien à rendre fou, mais aucun esprit véritablement
dostoïevskien n’émergea de cette culture nordique et s’il y eut
des Sur-Anglais pour Marie Bonaparte, nulle part, semble-t-il, elle
n’a trouvé de Sur-Français d'Amérique.
d’amour. Le poète lui demande de l’emporter “vers la grande
Aventure”, “par delà l’encerclement des horizons”, “parmi
les cimes blanches”, “sur un lit de frimas, de verglas et de
branches”. Ce “vent libérateur”, frère des hommes, se mêle à
leur sang et les régénère, engendrant une race de surhommes :
“[…]
tu donnas/La vigueur de ton souffle aux muscles de leurs bras!”
ainsi que “ton appel orageux”, ta “violence”, ta “haine de
l’obstacle” et ta “peur du silence”. Durant les longs mois
d’hiver, il rapproche les cœurs des amants, vibre en eux et
dispense l’amour. Son chant apporte la fraternité parmi les
hommes. Le cri du poète, à la fin de l’“Hymne au vent du Nord”,
en est un d’amour et de reconnaissance, un gage d’immortalité :
“J’oublierai que ma vie est moins qu’un grain de sable/Au
sablier des ans chus dans l’Éternité!”; et surtout : “Je clame
au monde veule, ô mon Vent, que je t’aime!”».66
Pour un lecteur habitué à la chaleur, sèche ou humide, il était
difficile de ne pas sentir plutôt la désolation et l’isolement
sibérien à rendre fou, mais aucun esprit véritablement
dostoïevskien n’émergea de cette culture nordique et s’il y eut
des Sur-Anglais pour Marie Bonaparte, nulle part, semble-t-il, elle
n’a trouvé de Sur-Français d'Amérique. que le dépassement dostoïevskien, avec
son coût considérable,
il semblerait que la compulsion de répétitions du complexe d’échec
les ait fixés sur cette volonté de toujours répéter la
transgression, non pour dépasser les limites de l’humanité
vertueuse et médiocre mais pour y ramener de façon jamais
totalement résignée. Différent était le mode de dépassement
dostoïevskien. Le surhomme de Dostoïevski est un être maudit par
sa nature égoïste de s’égaler à Dieu, par le fait même, il
appartient à la race des criminels. C’est ce que tendent à
démontrer tous les romans de Dostoïevski : «L’énigme
de Raskolnikov est déjà indiquée. Les hommes se répartissent en
forts, pour qui tout est permis, et en faible, pour qui la morale a
été inventée. Raskolnikov, Stavroguine, Ivan Karamazov se placent
“au-delà du bien et du mal”. C’est au bagne que Dostoïevski a
puisé ce nietzschéanisme d’avant Nietzsche».68
Raskolnikov, du roman Crime
et châtiment, est
la matière brute de la surhumanité maudite : «Raskolnikov,
qui se contraint à un meurtre pour prouver à lui-même et aux
autres qu’il est appelé à des décisions supérieures, est la
réfutation des hommes qui s’imaginent pouvoir disposer d’autrui
- un raté de la caste des seigneurs qui sombre avec une logique
implacable dans son expérience insensée».69
Dostoïevski prononce lui-même la condamnation de son héros :
«J’en
conclus, en un mot, que tous, non seulement les grands hommes, mais
ceux qui s’élèvent tant soit peu au-dessus du niveau
que le dépassement dostoïevskien, avec
son coût considérable,
il semblerait que la compulsion de répétitions du complexe d’échec
les ait fixés sur cette volonté de toujours répéter la
transgression, non pour dépasser les limites de l’humanité
vertueuse et médiocre mais pour y ramener de façon jamais
totalement résignée. Différent était le mode de dépassement
dostoïevskien. Le surhomme de Dostoïevski est un être maudit par
sa nature égoïste de s’égaler à Dieu, par le fait même, il
appartient à la race des criminels. C’est ce que tendent à
démontrer tous les romans de Dostoïevski : «L’énigme
de Raskolnikov est déjà indiquée. Les hommes se répartissent en
forts, pour qui tout est permis, et en faible, pour qui la morale a
été inventée. Raskolnikov, Stavroguine, Ivan Karamazov se placent
“au-delà du bien et du mal”. C’est au bagne que Dostoïevski a
puisé ce nietzschéanisme d’avant Nietzsche».68
Raskolnikov, du roman Crime
et châtiment, est
la matière brute de la surhumanité maudite : «Raskolnikov,
qui se contraint à un meurtre pour prouver à lui-même et aux
autres qu’il est appelé à des décisions supérieures, est la
réfutation des hommes qui s’imaginent pouvoir disposer d’autrui
- un raté de la caste des seigneurs qui sombre avec une logique
implacable dans son expérience insensée».69
Dostoïevski prononce lui-même la condamnation de son héros :
«J’en
conclus, en un mot, que tous, non seulement les grands hommes, mais
ceux qui s’élèvent tant soit peu au-dessus du niveau  moyen et
sont capables de prononcer quelques paroles neuves, sont de par leur
nature même et nécessairement des criminels, à un degré variable
naturellement. Sans cela, il leur serait difficile de sortir de
l’ornière commune. Or, ils ne peuvent se résoudre à y
demeurer…».70
Avant même d’être dans le geste monstrueux, le crime est déjà
dans la parole et l’auteur se condamne lui-même à chaque page de
chaque roman. Commettre le crime en pensée vaut de le réaliser
concrètement, même si cela vise des personnages fictifs. Repentant,
le condamné Dostoïevski répète constamment le crime par sa
volonté même de défier la loi de Dieu : «Selon
le raisonnement de Raskolnikov, il suffit d’appartenir au groupe
des gens exceptionnels ou des novateurs pour posséder le droit et le
devoir de commettre un crime - ici, le cas échéant, on ne doit rien
entendre d’autre sous le nom de “crime” que l’élimination
des résistances que les gens ordinaires éprouvent à l’égard de
la nouveauté. L’expression de crime désigne ainsi “la
destruction de l’ordre établi au profit d’un monde meilleur”.
L’autopersuasion de l’intellectuel mène au succès à l’instant
où il parvient à se considérer lui-même, avec un degré d’évidence suffisant, comme un membre de la catégorie
exceptionnelle - inutile de souligner le fait que Dostoïevski
partira de ce point pour caractériser son héros
moyen et
sont capables de prononcer quelques paroles neuves, sont de par leur
nature même et nécessairement des criminels, à un degré variable
naturellement. Sans cela, il leur serait difficile de sortir de
l’ornière commune. Or, ils ne peuvent se résoudre à y
demeurer…».70
Avant même d’être dans le geste monstrueux, le crime est déjà
dans la parole et l’auteur se condamne lui-même à chaque page de
chaque roman. Commettre le crime en pensée vaut de le réaliser
concrètement, même si cela vise des personnages fictifs. Repentant,
le condamné Dostoïevski répète constamment le crime par sa
volonté même de défier la loi de Dieu : «Selon
le raisonnement de Raskolnikov, il suffit d’appartenir au groupe
des gens exceptionnels ou des novateurs pour posséder le droit et le
devoir de commettre un crime - ici, le cas échéant, on ne doit rien
entendre d’autre sous le nom de “crime” que l’élimination
des résistances que les gens ordinaires éprouvent à l’égard de
la nouveauté. L’expression de crime désigne ainsi “la
destruction de l’ordre établi au profit d’un monde meilleur”.
L’autopersuasion de l’intellectuel mène au succès à l’instant
où il parvient à se considérer lui-même, avec un degré d’évidence suffisant, comme un membre de la catégorie
exceptionnelle - inutile de souligner le fait que Dostoïevski
partira de ce point pour caractériser son héros  comme la victime
d’un paralogisme démoniaque (on dira plus tard : narcissique). Des
hypothèses expérimentales du roman, on peut déduire que la
structure de la désinhibition moderne de l’action se trouve
généralement dans la synthèse de l’exceptionnalisme, de
l’innovationnisme et de l’évolutionnisme - un supplément de
motifs démocratico-messianiques ne nuisant pas à l’affaire. Cette
structure constitue la matrice d’innombrables crimes liés à la
modernisation sur un arrière-plan chrétien et humaniste».71
Et c’est là commettre autant de crimes
qui
confinent
à la surhumanité. Comme en conclut Motchoulski : «La
tragédie se termine par un épilogue. Le condamné est au bagne
depuis une année et demie déjà. Sonia l’a suivi en Sibérie,
mais il “la tourmente par son attitude méprisante et grossière”.
A t-il changé, lui? Non, il est toujours le même, solitaire, morne,
fier. “Il se jugeait sévèrement et sa conscience endurcie n’a
découvert aucune faute particulièrement horrible dans ce qui s’est
passé, si ce n’est une simple
erreur,
comme chacun peut en commettre…
Il ne se repentait
comme la victime
d’un paralogisme démoniaque (on dira plus tard : narcissique). Des
hypothèses expérimentales du roman, on peut déduire que la
structure de la désinhibition moderne de l’action se trouve
généralement dans la synthèse de l’exceptionnalisme, de
l’innovationnisme et de l’évolutionnisme - un supplément de
motifs démocratico-messianiques ne nuisant pas à l’affaire. Cette
structure constitue la matrice d’innombrables crimes liés à la
modernisation sur un arrière-plan chrétien et humaniste».71
Et c’est là commettre autant de crimes
qui
confinent
à la surhumanité. Comme en conclut Motchoulski : «La
tragédie se termine par un épilogue. Le condamné est au bagne
depuis une année et demie déjà. Sonia l’a suivi en Sibérie,
mais il “la tourmente par son attitude méprisante et grossière”.
A t-il changé, lui? Non, il est toujours le même, solitaire, morne,
fier. “Il se jugeait sévèrement et sa conscience endurcie n’a
découvert aucune faute particulièrement horrible dans ce qui s’est
passé, si ce n’est une simple
erreur,
comme chacun peut en commettre…
Il ne se repentait  pas de son crime.” “Mais
par quoi mon acte leur paraît-il si affreux? se demande-t-il. Parce
que c’est un forfait? Que veut dire le mot forfait?
Ma conscience est tranquille.”
Dans ces derniers mots se révèle subitement la
vérité finale
sur Raskolnikov.
Il est réellement un surhomme,
non un vaincu, mais un vainqueur; il voulait éprouver ses forces et
il constata qu’elles étaient sans limites, il voulait “passer de
l’autre côté” et il l’a fait, prouver que la loi morale n’a
pas été écrite pour lui, qu’il est au-delà du bien et du mal
et, voici,
sa conscience est tranquille.
Il s’est perdu non pas parce que “le tourmentait la rupture avec
les hommes”, oh non, il aime sa fière solitude, et non pas parce
que “les nerfs n’ont pas tenu”, la “nature a cédé”, -
tout cela n’est rien. Il aurait eu la force.
[…] Ce
n’est qu’au bagne qu’il a compris la cause de sa perte : “Il
était honteux du fait justement que lui, Raskolnikov, s’était
perdu si aveuglément, si désespérément, si obscurément et si
bêtement,
comme par le verdict d’un destin aveugle.”
Ce trait parachève sa majestueuse figure. L’homme fort n’a pas
d’adversaires dignes de lui, il n’a qu’un ennemi: le destin.
Raskolnikov a succombé comme le héros tragique en lutte avec
l’aveugle fatalité».72
Une fois le modèle établi avec Crime
et châtiment, la
suite de l’œuvre de Dostoïevski n’aura plus qu’à
perfectionner cette quête criminelle
du surhomme.
pas de son crime.” “Mais
par quoi mon acte leur paraît-il si affreux? se demande-t-il. Parce
que c’est un forfait? Que veut dire le mot forfait?
Ma conscience est tranquille.”
Dans ces derniers mots se révèle subitement la
vérité finale
sur Raskolnikov.
Il est réellement un surhomme,
non un vaincu, mais un vainqueur; il voulait éprouver ses forces et
il constata qu’elles étaient sans limites, il voulait “passer de
l’autre côté” et il l’a fait, prouver que la loi morale n’a
pas été écrite pour lui, qu’il est au-delà du bien et du mal
et, voici,
sa conscience est tranquille.
Il s’est perdu non pas parce que “le tourmentait la rupture avec
les hommes”, oh non, il aime sa fière solitude, et non pas parce
que “les nerfs n’ont pas tenu”, la “nature a cédé”, -
tout cela n’est rien. Il aurait eu la force.
[…] Ce
n’est qu’au bagne qu’il a compris la cause de sa perte : “Il
était honteux du fait justement que lui, Raskolnikov, s’était
perdu si aveuglément, si désespérément, si obscurément et si
bêtement,
comme par le verdict d’un destin aveugle.”
Ce trait parachève sa majestueuse figure. L’homme fort n’a pas
d’adversaires dignes de lui, il n’a qu’un ennemi: le destin.
Raskolnikov a succombé comme le héros tragique en lutte avec
l’aveugle fatalité».72
Une fois le modèle établi avec Crime
et châtiment, la
suite de l’œuvre de Dostoïevski n’aura plus qu’à
perfectionner cette quête criminelle
du surhomme. irrésistiblement à une catastrophe morale. Les plus faibles
s’effondrent personnellement. Mais les puissants qui sont dotés de
moyens violents et savent en user finissent par réduire leurs
semblables en esclavage, ce qui n’est pourtant qu’un effondrement
déguisé. À partir de là il n’y a qu’un pas à faire pour en
venir à la question principale proprement dite d’une vie sans
Dieu; à ce problème sont consacrés avant tout
Les Démons [Les Possédés]. Et
voici ce que donne l’expérience : toute tentative d’éliminer
Dieu de l’existence humaine conduit au crime organisé. L’homme a
comme ça besoin d’une force qui oriente, sur laquelle il puisse
s’appuyer et à laquelle il puisse se fier; et en tant que
semblable force entrent en question seulement : Dieu ou la raison personnelle. Mais la raison est une force de service, incapable de
toute action réellement indépendante, responsable. Si elle n’est
pas au service de l’étincelle divine dans l’homme, alors elle se
cherche un autre maître et celui-ci est infailliblement, selon
Dostoïevski, la volonté de puissance, que seul Dieu peut réfréner.
Pour en finir avec ses instincts obscurs, l’homme a besoin de
quelque chose qu’il reconnaisse comme plus fort, absolument
supérieur. Mais Dieu est la seule instance dont les moyens de
puissance sont par principe inaccessibles à l’homme; il peut
espérer soumettre toute autre à ses désirs».73
Commencent alors les mécanismes, conscients et
irrésistiblement à une catastrophe morale. Les plus faibles
s’effondrent personnellement. Mais les puissants qui sont dotés de
moyens violents et savent en user finissent par réduire leurs
semblables en esclavage, ce qui n’est pourtant qu’un effondrement
déguisé. À partir de là il n’y a qu’un pas à faire pour en
venir à la question principale proprement dite d’une vie sans
Dieu; à ce problème sont consacrés avant tout
Les Démons [Les Possédés]. Et
voici ce que donne l’expérience : toute tentative d’éliminer
Dieu de l’existence humaine conduit au crime organisé. L’homme a
comme ça besoin d’une force qui oriente, sur laquelle il puisse
s’appuyer et à laquelle il puisse se fier; et en tant que
semblable force entrent en question seulement : Dieu ou la raison personnelle. Mais la raison est une force de service, incapable de
toute action réellement indépendante, responsable. Si elle n’est
pas au service de l’étincelle divine dans l’homme, alors elle se
cherche un autre maître et celui-ci est infailliblement, selon
Dostoïevski, la volonté de puissance, que seul Dieu peut réfréner.
Pour en finir avec ses instincts obscurs, l’homme a besoin de
quelque chose qu’il reconnaisse comme plus fort, absolument
supérieur. Mais Dieu est la seule instance dont les moyens de
puissance sont par principe inaccessibles à l’homme; il peut
espérer soumettre toute autre à ses désirs».73
Commencent alors les mécanismes, conscients et  inconscients, de
mettre Dieu à mort. Sur ce point, chaque individu, chaque conscience
visant à la surhumanité et trahie par son besoin de Dieu, commence,
de
son vivant,
à souffrir des tourments de l’enfer. Malgré ces tourments, le
parricide absolu doit être accompli : «Mais
pourquoi l’homme essaie-t-il de lutter contre Dieu? Selon
Dostoïevski, c’est la volonté de liberté qui est le véritable
mobile de la tentative souvent faite pour triompher de Dieu : on
lutte contre Dieu pour ne plus rien se laisser interdire. Mais c’est
un sophisme, car en réalité la suppression de Dieu conduit à la
domination de la raison devenue effrénée, à un chaos moral qui
peut seulement être surmonté par un nivellement violent, en
conséquence à la perte précisément de la liberté. Mais si un
homme d’une qualité élevée, ayant un authentique sentiment de
responsabilité morale, répudie Dieu, il doit alors nécessairement
porter à l’extrême sa liberté et jusqu’à son point final -
l’anéantissement de soi. Le chef d’œuvre de Dostoïevski dans
la mise en exécution de cette suite d’idées est l’ingénieur
Kirilov des Démons,
qui croit devoir attester par un suicide sa liberté à l’égard de
Dieu. On ne peut pourtant vouloir s’en débarrasser en le tenant
pour un psychopathe à l’esprit mal fait; tout au plus est morbide
chez lui l’honnêteté avec laquelle il pense jusqu’au bout ce
que d’autres n’osent s’avouer à eux-mêmes».74
Car si la liberté justifie la mort de Dieu, elle ne signifie pas
pour autant la liberté face
à ses
propres obsessions, de sorte que le spectre du Dieu assassiné ne
cesse de ressurgir au
travers des personnages atteints par la grâce et qui dressent leur
innocence devant les surhommes coupables, comme
Aliocha Karamazov ou le prince Mychkine.
inconscients, de
mettre Dieu à mort. Sur ce point, chaque individu, chaque conscience
visant à la surhumanité et trahie par son besoin de Dieu, commence,
de
son vivant,
à souffrir des tourments de l’enfer. Malgré ces tourments, le
parricide absolu doit être accompli : «Mais
pourquoi l’homme essaie-t-il de lutter contre Dieu? Selon
Dostoïevski, c’est la volonté de liberté qui est le véritable
mobile de la tentative souvent faite pour triompher de Dieu : on
lutte contre Dieu pour ne plus rien se laisser interdire. Mais c’est
un sophisme, car en réalité la suppression de Dieu conduit à la
domination de la raison devenue effrénée, à un chaos moral qui
peut seulement être surmonté par un nivellement violent, en
conséquence à la perte précisément de la liberté. Mais si un
homme d’une qualité élevée, ayant un authentique sentiment de
responsabilité morale, répudie Dieu, il doit alors nécessairement
porter à l’extrême sa liberté et jusqu’à son point final -
l’anéantissement de soi. Le chef d’œuvre de Dostoïevski dans
la mise en exécution de cette suite d’idées est l’ingénieur
Kirilov des Démons,
qui croit devoir attester par un suicide sa liberté à l’égard de
Dieu. On ne peut pourtant vouloir s’en débarrasser en le tenant
pour un psychopathe à l’esprit mal fait; tout au plus est morbide
chez lui l’honnêteté avec laquelle il pense jusqu’au bout ce
que d’autres n’osent s’avouer à eux-mêmes».74
Car si la liberté justifie la mort de Dieu, elle ne signifie pas
pour autant la liberté face
à ses
propres obsessions, de sorte que le spectre du Dieu assassiné ne
cesse de ressurgir au
travers des personnages atteints par la grâce et qui dressent leur
innocence devant les surhommes coupables, comme
Aliocha Karamazov ou le prince Mychkine. d’avoir
voulu, un jour, se hisser à la hauteur de Dieu. Cette souffrance
n’est pas tant un châtiment de la pensée coupable que le moyen,
pour la conscience, de se
purger de
son égoïsme : «Mais
à cela fait pendant le fait singulier que Dostoïevski n’a
nullement l’intention d’affranchir l’humanité de la
souffrance; ses descriptions de la misère morale et sociale n’ont
pas pour objet de contribuer à l’écarter. Car de ses expériences
vécues et de ses observations il a tiré une argumentation qui,
malgré ses assises authentiquement russes, ne serait venue à l’idée
d’aucun de ses contemporains : le oui délibéré à la souffrance.
Selon sa conception, la souffrance dans le monde n’est pas
seulement inévitable mais nécessaire, voire même bénéfique et
salutaire. La souffrance est une nécessité pour devenir un être
humain, dans la souffrance l’homme se hausse à la plénitude de sa
grandeur, sans souffrance il n’est pas digne d’être un homme.
Cette notion en soi n’est pas nouvelle, mais à peu près jamais on
n’a renchéri de la sorte sur elle, Dostoïevski ne se contente pas
d’affirmer qu’il peut en être ainsi, mais il affirme sans
hésiter qu’il doit nécessairement en être ainsi, que c’est la
seule voie d’accès à Dieu et à la vérité qui soit ouverte à
l’homme; la souffrance est la seule manifestation de Dieu dans le
monde sur laquelle on puisse faire fond. Les
d’avoir
voulu, un jour, se hisser à la hauteur de Dieu. Cette souffrance
n’est pas tant un châtiment de la pensée coupable que le moyen,
pour la conscience, de se
purger de
son égoïsme : «Mais
à cela fait pendant le fait singulier que Dostoïevski n’a
nullement l’intention d’affranchir l’humanité de la
souffrance; ses descriptions de la misère morale et sociale n’ont
pas pour objet de contribuer à l’écarter. Car de ses expériences
vécues et de ses observations il a tiré une argumentation qui,
malgré ses assises authentiquement russes, ne serait venue à l’idée
d’aucun de ses contemporains : le oui délibéré à la souffrance.
Selon sa conception, la souffrance dans le monde n’est pas
seulement inévitable mais nécessaire, voire même bénéfique et
salutaire. La souffrance est une nécessité pour devenir un être
humain, dans la souffrance l’homme se hausse à la plénitude de sa
grandeur, sans souffrance il n’est pas digne d’être un homme.
Cette notion en soi n’est pas nouvelle, mais à peu près jamais on
n’a renchéri de la sorte sur elle, Dostoïevski ne se contente pas
d’affirmer qu’il peut en être ainsi, mais il affirme sans
hésiter qu’il doit nécessairement en être ainsi, que c’est la
seule voie d’accès à Dieu et à la vérité qui soit ouverte à
l’homme; la souffrance est la seule manifestation de Dieu dans le
monde sur laquelle on puisse faire fond. Les  hommes que décrit
Dostoïevski souffrent souvent indéciblement, d’une manière telle
que cela n’était peut-être réellement possible que dans les
conditions de la Russie d’alors. Mais fait digne de remarque :
c’est à peine si à un moment quelconque ils montrent un désir
intense d'être
délivrés de leur souffrance. Ils l’endurent consciemment et avec
une certaine fierté; on doit souvent dire : ils en jouissent. Ce à
quoi ils tiennent est la délivrance intérieure, qui précisément
est rendue impossible par l’affranchissement extérieur. La sagesse de la souffrance est plus importante que le bonheur».75
La souffrance, dans les romans de Dostoïevski, n’arrive pas
seulement par le mauvais coup du sort, comme dans Les
Misérables de
Hugo. Elle arrive par la conscience coupable qui reconnaît les vrais
motifs du déicide; mais pour tous ceux qui souffrent autour des
coupables, comment justifier ces peines? «Comment
cette apologie de la souffrance s’accorde-t-elle avec la
“restitution de la carte d’accès au bonheur”? Eh bien,
Dostoïevski peut invoquer le fait qu’il dit oui seulement à la
souffrance volontaire, consciemment vécue : il pourrait au surplus
alléguer qu’il se condamne personnellement, par la restitution de
la carte d’accès, à renoncer au bonheur, donc qu’il se condamne
à la souffrance, pour ne pas devoir mettre à profit la souffrance
d’autrui. Toutes ces interprétations ne sont pas absolument
convaincantes. La limite entre souffrance volontaire et forcée,
méritée et imméritée, n’est pas définie avec précision; il
reste le fait qu’on dit oui délibérément à l’horreur du monde
(donc aussi de Dieu); on ne peut effacer l’impression d’une
solution d’embarras».76
Nous pouvons
hommes que décrit
Dostoïevski souffrent souvent indéciblement, d’une manière telle
que cela n’était peut-être réellement possible que dans les
conditions de la Russie d’alors. Mais fait digne de remarque :
c’est à peine si à un moment quelconque ils montrent un désir
intense d'être
délivrés de leur souffrance. Ils l’endurent consciemment et avec
une certaine fierté; on doit souvent dire : ils en jouissent. Ce à
quoi ils tiennent est la délivrance intérieure, qui précisément
est rendue impossible par l’affranchissement extérieur. La sagesse de la souffrance est plus importante que le bonheur».75
La souffrance, dans les romans de Dostoïevski, n’arrive pas
seulement par le mauvais coup du sort, comme dans Les
Misérables de
Hugo. Elle arrive par la conscience coupable qui reconnaît les vrais
motifs du déicide; mais pour tous ceux qui souffrent autour des
coupables, comment justifier ces peines? «Comment
cette apologie de la souffrance s’accorde-t-elle avec la
“restitution de la carte d’accès au bonheur”? Eh bien,
Dostoïevski peut invoquer le fait qu’il dit oui seulement à la
souffrance volontaire, consciemment vécue : il pourrait au surplus
alléguer qu’il se condamne personnellement, par la restitution de
la carte d’accès, à renoncer au bonheur, donc qu’il se condamne
à la souffrance, pour ne pas devoir mettre à profit la souffrance
d’autrui. Toutes ces interprétations ne sont pas absolument
convaincantes. La limite entre souffrance volontaire et forcée,
méritée et imméritée, n’est pas définie avec précision; il
reste le fait qu’on dit oui délibérément à l’horreur du monde
(donc aussi de Dieu); on ne peut effacer l’impression d’une
solution d’embarras».76
Nous pouvons  constater, dans Les Frères Karamazov, que
«le
malheur de l’humanité souffrante, surtout des innocents qui
souffrent, n’est pas pour lui un problème social, mais l’occasion
d’une explication hardie, voire monstrueuse, avec Dieu lui-même.
Il a proclamé absolument sans équivoque par la bouche d’Ivan
Karamasov : si le bonheur de millions d’êtres doit s’édifier
sur le malheur d’un seul innocent qui souffre, je refuse ce
bonheur. Et si cela devait être la volonté de Dieu, alors je
déclare que je ne suis pas d’accord avec la volonté divine. Je ne
suis pas pour autant un athée, je ne veux absolument pas nier et
combattre Dieu; mais je me permets de lui rendre respectueusement ma
“carte d’accès au bonheur”; je m’exclus de son ordre du
monde. Cette formulation peut dans le détail être appropriée au
personnage très problématique d’Ivan Karamasov, mais il faut
pourtant admettre que l’idée fondamentale correspond pour
l’essentiel à la propre conception de Dostoïevski. La compassion
devient ainsi un problème métaphysique - peut-être l’exemple le
plus grandiose de l’aptitude inquiétante de Dostoïevski à suivre
à la trace les dernières conséquences».77
En
aucun cas, il s'agit de justifier des
situations
limites
qui relèveraient
de l’ambition même des égoïstes dont les conséquences de leur
crime rejaillit sur le monde entier, et
surtout sur les
créatures les plus innocentes.
constater, dans Les Frères Karamazov, que
«le
malheur de l’humanité souffrante, surtout des innocents qui
souffrent, n’est pas pour lui un problème social, mais l’occasion
d’une explication hardie, voire monstrueuse, avec Dieu lui-même.
Il a proclamé absolument sans équivoque par la bouche d’Ivan
Karamasov : si le bonheur de millions d’êtres doit s’édifier
sur le malheur d’un seul innocent qui souffre, je refuse ce
bonheur. Et si cela devait être la volonté de Dieu, alors je
déclare que je ne suis pas d’accord avec la volonté divine. Je ne
suis pas pour autant un athée, je ne veux absolument pas nier et
combattre Dieu; mais je me permets de lui rendre respectueusement ma
“carte d’accès au bonheur”; je m’exclus de son ordre du
monde. Cette formulation peut dans le détail être appropriée au
personnage très problématique d’Ivan Karamasov, mais il faut
pourtant admettre que l’idée fondamentale correspond pour
l’essentiel à la propre conception de Dostoïevski. La compassion
devient ainsi un problème métaphysique - peut-être l’exemple le
plus grandiose de l’aptitude inquiétante de Dostoïevski à suivre
à la trace les dernières conséquences».77
En
aucun cas, il s'agit de justifier des
situations
limites
qui relèveraient
de l’ambition même des égoïstes dont les conséquences de leur
crime rejaillit sur le monde entier, et
surtout sur les
créatures les plus innocentes. Si
Raskolnikov se
résigne à reconnaître sa culpabilité et
purger sa
peine en Sibérie, d’autres criminels de Dostoïevski n’accepteront
jamais de se repentir, ils n’en deviendront que plus monstrueux. Dans Souvenirs de la Maison des Morts,
«un autre
criminel, Orlov, incarne la majesté du mal, le principe de Lucifer.
Dostoïevski dit de cet affreux scélérat : “Je puis dire
positivement que de ma vie je n’ai rencontré un homme plus fort,
d’un caractère plus inflexible…
C’était en fait la victoire complète sur la chair. On
voyait que cet homme pouvait régner sans limite sur lui-même,
mépriser toute souffrance et tout châtiment, et qu’il ne
craignait rien au monde… Entre autres, je fus frappé par son
étrange arrogance. Je crois qu’il n’y avait pas un être au
monde qui pût agir sur cet homme par sa seule autorité… Je tentai
de parler avec lui de ses aventures, mais lorsqu’il comprit que
j’en voulais à sa conscience et que je recherchais en lui quelque
lueur de repentir, il me jeta un regard si méprisant et si hautain
qu’il me semble que j’étais subitement devenu à ses yeux un
stupide petit garçon, avec lequel on ne saurait penser comme avec un
grand. Son visage exprima même comme une sorte de commisération à
mon endroit. Une minute après, il éclata de rire, d’un rire qui
se moquait de moi en toute ingénuité, sans aucune ironie… En
réalité, il ne pouvait pas ne pas me mépriser et il devait sans
aucun doute me considérer comme une créature soumise, faible,
pitoyable et
inférieure à lui sous tous les rapports”.
Dostoïevski se heurte à une
Si
Raskolnikov se
résigne à reconnaître sa culpabilité et
purger sa
peine en Sibérie, d’autres criminels de Dostoïevski n’accepteront
jamais de se repentir, ils n’en deviendront que plus monstrueux. Dans Souvenirs de la Maison des Morts,
«un autre
criminel, Orlov, incarne la majesté du mal, le principe de Lucifer.
Dostoïevski dit de cet affreux scélérat : “Je puis dire
positivement que de ma vie je n’ai rencontré un homme plus fort,
d’un caractère plus inflexible…
C’était en fait la victoire complète sur la chair. On
voyait que cet homme pouvait régner sans limite sur lui-même,
mépriser toute souffrance et tout châtiment, et qu’il ne
craignait rien au monde… Entre autres, je fus frappé par son
étrange arrogance. Je crois qu’il n’y avait pas un être au
monde qui pût agir sur cet homme par sa seule autorité… Je tentai
de parler avec lui de ses aventures, mais lorsqu’il comprit que
j’en voulais à sa conscience et que je recherchais en lui quelque
lueur de repentir, il me jeta un regard si méprisant et si hautain
qu’il me semble que j’étais subitement devenu à ses yeux un
stupide petit garçon, avec lequel on ne saurait penser comme avec un
grand. Son visage exprima même comme une sorte de commisération à
mon endroit. Une minute après, il éclata de rire, d’un rire qui
se moquait de moi en toute ingénuité, sans aucune ironie… En
réalité, il ne pouvait pas ne pas me mépriser et il devait sans
aucun doute me considérer comme une créature soumise, faible,
pitoyable et
inférieure à lui sous tous les rapports”.
Dostoïevski se heurte à une  personnalité titanique, à un
surhomme, pour lequel la morale courante est un piteux enfantillage.
Ici, le mal n’est pas une dégradation de la volonté, une
faiblesse de caractère : au contraire, il est une puissance
effroyable, une grandeur sombre. Le mal n’est pas dans la
domination d’une nature charnelle, inférieure, sur sa nature
spirituelle, supérieure; le scélérat Orlov exprime la victoire
complète sur la chair.
Le mal est une réalité mystique et une spiritualité démoniaque».78
Mais c’est le Stravoguine des Possédés
qui
apparaît le surhomme idéal
de toute
la
faune dostoïevskienne : «Stavroguine
est une des plus belles créations de Dostoïevski. Dans la famille
les “hommes forts” (le prince Valkovski, Raskolnikov,
Svidrigatlov, Hippolyte, Kirilov, Versilov, Ivan Karamazov), c’est
lui qui est le plus fort; sa figure est d’une “force
incommensurable”. C’est l’homme d’un nouvel éon, cet
homme-Dieu auquel rêvait Kirilov et en comparaison duquel le
surhomme de Nietzsche paraît une ombre. C’est l’Antéchrist qui
vient, le prince de ce monde, la terrible annonce de la catastrophe
cosmique qui menace l’humanité. C’est dans la langue des mythes
personnalité titanique, à un
surhomme, pour lequel la morale courante est un piteux enfantillage.
Ici, le mal n’est pas une dégradation de la volonté, une
faiblesse de caractère : au contraire, il est une puissance
effroyable, une grandeur sombre. Le mal n’est pas dans la
domination d’une nature charnelle, inférieure, sur sa nature
spirituelle, supérieure; le scélérat Orlov exprime la victoire
complète sur la chair.
Le mal est une réalité mystique et une spiritualité démoniaque».78
Mais c’est le Stravoguine des Possédés
qui
apparaît le surhomme idéal
de toute
la
faune dostoïevskienne : «Stavroguine
est une des plus belles créations de Dostoïevski. Dans la famille
les “hommes forts” (le prince Valkovski, Raskolnikov,
Svidrigatlov, Hippolyte, Kirilov, Versilov, Ivan Karamazov), c’est
lui qui est le plus fort; sa figure est d’une “force
incommensurable”. C’est l’homme d’un nouvel éon, cet
homme-Dieu auquel rêvait Kirilov et en comparaison duquel le
surhomme de Nietzsche paraît une ombre. C’est l’Antéchrist qui
vient, le prince de ce monde, la terrible annonce de la catastrophe
cosmique qui menace l’humanité. C’est dans la langue des mythes
 que Dostoïevski parle des suprêmes mystères métaphysiques».79
Sa liberté est absolue,
son pouvoir correspond bien à celui qui laisse vivre
et fait mourir affligeant
la
suprême injure à la face
de la
divinité
niée; «ce
personnage énigmatique se définissait enfin dans une lettre à
Daria : “Étranger en Russie, comme partout du reste. Incapable de
rien haïr. D’une force sans limite, mais n’ayant jamais su
l’appliquer. Trouvant du plaisir à faire le bien, et autant à
faire le mal. Enviant les espoirs des négateurs, mais ne les
partageant pas, et capable seulement de négation.” On le croyait
loin, mais soudain on le découvrait aux Sansonnets, pendu dans une
mansarde».80
Le surhomme dostoïevskien n’avait
donc que peu de choses à voir avec son pendant germanique. C’était
un être dont la surhumanité, bien qu’elle s’érigeait
sur la conscience de soi, possédait
le fardeau des Juifs : celui du péché originel qui se ramenait
ici à
l’égoïsme qui use de sa liberté pour usurper une place qui n’est
pas la sienne, celle de Dieu ou du Tsar. Anarchiste par affirmation
du moi absolu autant que par idéologie politique, le
surhomme dostoïevskien
cherchait
à apaiser cette conscience douloureuse. Y compris envers
Dieu. Être
souffrant pensant posséder la carte d'accès au bonheur et qui, finalement, n’atteignait
que l’absurdité du Néant au bout de la corde du suicidé.
que Dostoïevski parle des suprêmes mystères métaphysiques».79
Sa liberté est absolue,
son pouvoir correspond bien à celui qui laisse vivre
et fait mourir affligeant
la
suprême injure à la face
de la
divinité
niée; «ce
personnage énigmatique se définissait enfin dans une lettre à
Daria : “Étranger en Russie, comme partout du reste. Incapable de
rien haïr. D’une force sans limite, mais n’ayant jamais su
l’appliquer. Trouvant du plaisir à faire le bien, et autant à
faire le mal. Enviant les espoirs des négateurs, mais ne les
partageant pas, et capable seulement de négation.” On le croyait
loin, mais soudain on le découvrait aux Sansonnets, pendu dans une
mansarde».80
Le surhomme dostoïevskien n’avait
donc que peu de choses à voir avec son pendant germanique. C’était
un être dont la surhumanité, bien qu’elle s’érigeait
sur la conscience de soi, possédait
le fardeau des Juifs : celui du péché originel qui se ramenait
ici à
l’égoïsme qui use de sa liberté pour usurper une place qui n’est
pas la sienne, celle de Dieu ou du Tsar. Anarchiste par affirmation
du moi absolu autant que par idéologie politique, le
surhomme dostoïevskien
cherchait
à apaiser cette conscience douloureuse. Y compris envers
Dieu. Être
souffrant pensant posséder la carte d'accès au bonheur et qui, finalement, n’atteignait
que l’absurdité du Néant au bout de la corde du suicidé. s’exprimait par le fait que, par sa liberté, «l’homme
est un dieu, mais il ne le sait pas. La seule tâche de l’homme
serait donc de rejoindre ce fragment d’absolu qui est au fond de
lui-même».82
Ce fut le travail de Nietzsche de le lui apprendre. On a vu, au début
de cette section, l’apparition du surhomme nietzschéen dans Ainsi
parlait Zarathoustra : «Dans
un langage rhapsodique qui abonde en allusions bibliques,
Zarathoustra prêche l’idéal du surhomme : “L’homme est
quelque chose qui doit être surpassé”. C’est une corde tendue
entre l’animal et le surhomme… une corde au-dessus d’un abîme.
L’avenir appartient aux forts, à ceux qui sont impitoyables,
vigoureux de corps et d’esprit. Débordants de santé, ce sont les
créateurs de valeurs nouvelles. Ils aiment la terre et toute idée
d’au-delà les fait rire, car ils savent que tous les dieux sont
morts. Ils obéissent sans crainte aux commandements de leur volonté
de puissance. Leur but est la grandeur et non le bonheur. Ils vivent
dangereusement et acceptent sans sourciller la terrible vérité
qu’il n’y aura jamais de libération de la roue de l’éternel
retour. Ce sont les seigneurs de la terre qui méprisent le troupeau,
les foules, les humbles, les malades et les pauvres d’esprit. Si
l’on réfléchit à la vision grandiose de Nietzsche du surhomme,
et si l’on se rappelle la vie misérable du visionnaire (il était
pauvre, malade et à demi fou de solitude et de déception), on
comprend brusquement que le surhomme est tout ce que Nietzsche
n’était pas. C’est la projection violente d’une brillante
intelligence torturée au-delà de toute endurance, une protestation
pleine de défi contre son destin. C’est Nietzsche inversé».83
L’apologétique du surhomme entraîna
ses
s’exprimait par le fait que, par sa liberté, «l’homme
est un dieu, mais il ne le sait pas. La seule tâche de l’homme
serait donc de rejoindre ce fragment d’absolu qui est au fond de
lui-même».82
Ce fut le travail de Nietzsche de le lui apprendre. On a vu, au début
de cette section, l’apparition du surhomme nietzschéen dans Ainsi
parlait Zarathoustra : «Dans
un langage rhapsodique qui abonde en allusions bibliques,
Zarathoustra prêche l’idéal du surhomme : “L’homme est
quelque chose qui doit être surpassé”. C’est une corde tendue
entre l’animal et le surhomme… une corde au-dessus d’un abîme.
L’avenir appartient aux forts, à ceux qui sont impitoyables,
vigoureux de corps et d’esprit. Débordants de santé, ce sont les
créateurs de valeurs nouvelles. Ils aiment la terre et toute idée
d’au-delà les fait rire, car ils savent que tous les dieux sont
morts. Ils obéissent sans crainte aux commandements de leur volonté
de puissance. Leur but est la grandeur et non le bonheur. Ils vivent
dangereusement et acceptent sans sourciller la terrible vérité
qu’il n’y aura jamais de libération de la roue de l’éternel
retour. Ce sont les seigneurs de la terre qui méprisent le troupeau,
les foules, les humbles, les malades et les pauvres d’esprit. Si
l’on réfléchit à la vision grandiose de Nietzsche du surhomme,
et si l’on se rappelle la vie misérable du visionnaire (il était
pauvre, malade et à demi fou de solitude et de déception), on
comprend brusquement que le surhomme est tout ce que Nietzsche
n’était pas. C’est la projection violente d’une brillante
intelligence torturée au-delà de toute endurance, une protestation
pleine de défi contre son destin. C’est Nietzsche inversé».83
L’apologétique du surhomme entraîna
ses  dévots vers la damnation, comme l’affirmait Dostoïevski, et
le philosophe de Sils-Maria n’y échappa pas. On eut beau mettre
sur la progression de sa maladie des délires mais qui contenaient peut-être l’aboutissement raisonné d’une pensée ayant vécu
dans sa conscience les tourments mêmes de la surhumanité. Comme
l’écrit encore Michel Carrouges : «Oui,
il s’agit de folie et d’hallucinations, mais conscientes et
dirigées vers les mystères vivants qui dépassent également la
raison et la folie. Pourquoi s’étonner que les poètes cherchent
par l’irréel
le chemin vers le surréel, les physiciens n’utilisent-ils pas
eux-mêmes le calcul des imaginaires? Bien plus, dans le chaos de la
“mort de Dieu”, le surhomme inspiré tient la place de Dieu, il
est logique qu’il considère le chaos de son propre esprit non
comme un dérèglement misérable de son microcosme, mais comme le
divin chaos créateur. N’est-ce pas le sens profond de cette parole
de Rimbaud : “Je finis par trouver sacré le désordre de mon
propre esprit”».84
L’idée du surhomme était en gestation dans la pensée de
Nietzsche bien avant qu’il ne soit annoncé dans l’évangile de
Zarathoustra : «L’annonce
dévots vers la damnation, comme l’affirmait Dostoïevski, et
le philosophe de Sils-Maria n’y échappa pas. On eut beau mettre
sur la progression de sa maladie des délires mais qui contenaient peut-être l’aboutissement raisonné d’une pensée ayant vécu
dans sa conscience les tourments mêmes de la surhumanité. Comme
l’écrit encore Michel Carrouges : «Oui,
il s’agit de folie et d’hallucinations, mais conscientes et
dirigées vers les mystères vivants qui dépassent également la
raison et la folie. Pourquoi s’étonner que les poètes cherchent
par l’irréel
le chemin vers le surréel, les physiciens n’utilisent-ils pas
eux-mêmes le calcul des imaginaires? Bien plus, dans le chaos de la
“mort de Dieu”, le surhomme inspiré tient la place de Dieu, il
est logique qu’il considère le chaos de son propre esprit non
comme un dérèglement misérable de son microcosme, mais comme le
divin chaos créateur. N’est-ce pas le sens profond de cette parole
de Rimbaud : “Je finis par trouver sacré le désordre de mon
propre esprit”».84
L’idée du surhomme était en gestation dans la pensée de
Nietzsche bien avant qu’il ne soit annoncé dans l’évangile de
Zarathoustra : «L’annonce
 du surhomme apparaît dans l’œuvre de Nietzsche dès la troisième
Intempestive
où il en appelle aux facultés les plus élevées pour “qu’un
jour enfin puisse naître l’homme qui se sentira parfait, infini en
savoir et en amour, en puissance de contemplation et d’action
créatrice”, et dans
Le Gai Savoir,
on le pressent encore. Mais c’est à Zarathoustra qu’il confie la
mission de révéler le message : “L’homme est une corde entre la
bête et le surhomme; une corde sur l’abîme”. Ce vecteur n’est
point évolution biologique, progrès de l’espèce, mais “flèche
de désir”: il n’est d’autre progrès que celui ardemment
soutenu par une volonté de puissance riche d’affirmations,
d’intensité vitale, émergeant d’un monde épuisé, las de
vivre, prêt à toutes les abdications pour sauvegarder un trésor
dérisoire fait de narcotiques religieux, de pacifisme, de bien-être,
en un mot de notions conjuratoires, invoquées pour assoupir sa peur
de la mort».85
Le
surhomme apparaît comme l'étape
déterminante
de la pensée de Nietzsche.
du surhomme apparaît dans l’œuvre de Nietzsche dès la troisième
Intempestive
où il en appelle aux facultés les plus élevées pour “qu’un
jour enfin puisse naître l’homme qui se sentira parfait, infini en
savoir et en amour, en puissance de contemplation et d’action
créatrice”, et dans
Le Gai Savoir,
on le pressent encore. Mais c’est à Zarathoustra qu’il confie la
mission de révéler le message : “L’homme est une corde entre la
bête et le surhomme; une corde sur l’abîme”. Ce vecteur n’est
point évolution biologique, progrès de l’espèce, mais “flèche
de désir”: il n’est d’autre progrès que celui ardemment
soutenu par une volonté de puissance riche d’affirmations,
d’intensité vitale, émergeant d’un monde épuisé, las de
vivre, prêt à toutes les abdications pour sauvegarder un trésor
dérisoire fait de narcotiques religieux, de pacifisme, de bien-être,
en un mot de notions conjuratoires, invoquées pour assoupir sa peur
de la mort».85
Le
surhomme apparaît comme l'étape
déterminante
de la pensée de Nietzsche. Ce n’est pas
une phrase tirée de la pensée völkisch :
«Nietzsche
était lui-même plein de mépris pour le patriotisme et pour les
antisémites qu’il voyait autour de lui, et il imaginait son
surhomme comme “un esprit libre, l’ennemi des chaînes, un
non-adorateur, l’habitant des forêts”. (Ainsi
parlait Zarathoustra)».86
En ce sens, l’appel de Nietzsche ressemble davantage au Weltgeist
de Hegel
qu’au cosmopolitisme français. «Il
s’avérait urgent pour Nietzsche de retrouver le “sens de la
terre”, de sauvegarder la terre comme terre, alors qu’il
percevrait par signes avant-coureurs ce moment où l’homme
s’apprêtait à en entreprendre la domination. L’homme de cette
domination, Nietzsche l’appelle le Surhomme. La forme par laquelle
elle s’accomplit. Heidegger lui donne le nom de Technique.
Cependant, il faudra donner au Surhomme un sens métaphysique qui
diffère radicalement de celui que peuvent lui prêter un bon sens
borné ou une imagination suspecte. De même, la Technique doit être
pensée dans son essence, c’est-à-dire selon le mode
d’interpellation qui la régit et donc par-delà sa représentation
instrumentale et anthropologique courante. La pensée du Surhomme est
un appel qui touche l’“âme louche” de la vieille humanité,
c’est une interpellation qui concerne l’homme traditionnel du
ressentiment pour qu’il se dépasse lui-même, car il n’a pas
encore accédé à la plénitude de son être, car il reste comme dit
Nietzsche, “la bête non encore déterminée”. “Le Sur-homme
est celui qui conduit l’essence de l’homme traditionnel dans sa
vérité,
Ce n’est pas
une phrase tirée de la pensée völkisch :
«Nietzsche
était lui-même plein de mépris pour le patriotisme et pour les
antisémites qu’il voyait autour de lui, et il imaginait son
surhomme comme “un esprit libre, l’ennemi des chaînes, un
non-adorateur, l’habitant des forêts”. (Ainsi
parlait Zarathoustra)».86
En ce sens, l’appel de Nietzsche ressemble davantage au Weltgeist
de Hegel
qu’au cosmopolitisme français. «Il
s’avérait urgent pour Nietzsche de retrouver le “sens de la
terre”, de sauvegarder la terre comme terre, alors qu’il
percevrait par signes avant-coureurs ce moment où l’homme
s’apprêtait à en entreprendre la domination. L’homme de cette
domination, Nietzsche l’appelle le Surhomme. La forme par laquelle
elle s’accomplit. Heidegger lui donne le nom de Technique.
Cependant, il faudra donner au Surhomme un sens métaphysique qui
diffère radicalement de celui que peuvent lui prêter un bon sens
borné ou une imagination suspecte. De même, la Technique doit être
pensée dans son essence, c’est-à-dire selon le mode
d’interpellation qui la régit et donc par-delà sa représentation
instrumentale et anthropologique courante. La pensée du Surhomme est
un appel qui touche l’“âme louche” de la vieille humanité,
c’est une interpellation qui concerne l’homme traditionnel du
ressentiment pour qu’il se dépasse lui-même, car il n’a pas
encore accédé à la plénitude de son être, car il reste comme dit
Nietzsche, “la bête non encore déterminée”. “Le Sur-homme
est celui qui conduit l’essence de l’homme traditionnel dans sa
vérité,  et qui se charge de celle-ci”».87
Cette domination n’est pas tant d’essence politique que
métaphysique. Celle-ci passe par la lutte contre la raison qui finit
par limiter l’humanité à son rôle de pont, sans possibilité
d’atteindre une étape supérieure de sa destinée. Il faudrait
donc un nettoyage
complet
de la pensée occidentale pour remettre sur ses rails les valeurs
authentiques de la philosophie de l’action, ce qui séduira tant
ses héritiers fascistes. Ainsi donc, «l’auteur
de Zarathoustra entreprend une lutte acharnée contre la pensée
rationnelle qu’il tient pour un appauvrissement et veut faire de la
philosophie - une philosophie qui n’est plus conscience
impersonnelle ou science mais émanation du moi - un outil de
destruction dirigé contre les pseudo-valeurs, les “pharisaïsmes”,
sur lesquels reposent à la fois l’humanisme chrétien et les
institutions sécurisantes de l’âge positiviste : le droit, la
sainteté, la justice, la charité ou la démocratie. Opposant à la
“morale du troupeau” celle du Surhomme, non plus esclave résigné
mais créateur capable de transformer son destin en une “destinée”,
le philosophe solitaire est appelé à devenir le maître à penser
de tous
et qui se charge de celle-ci”».87
Cette domination n’est pas tant d’essence politique que
métaphysique. Celle-ci passe par la lutte contre la raison qui finit
par limiter l’humanité à son rôle de pont, sans possibilité
d’atteindre une étape supérieure de sa destinée. Il faudrait
donc un nettoyage
complet
de la pensée occidentale pour remettre sur ses rails les valeurs
authentiques de la philosophie de l’action, ce qui séduira tant
ses héritiers fascistes. Ainsi donc, «l’auteur
de Zarathoustra entreprend une lutte acharnée contre la pensée
rationnelle qu’il tient pour un appauvrissement et veut faire de la
philosophie - une philosophie qui n’est plus conscience
impersonnelle ou science mais émanation du moi - un outil de
destruction dirigé contre les pseudo-valeurs, les “pharisaïsmes”,
sur lesquels reposent à la fois l’humanisme chrétien et les
institutions sécurisantes de l’âge positiviste : le droit, la
sainteté, la justice, la charité ou la démocratie. Opposant à la
“morale du troupeau” celle du Surhomme, non plus esclave résigné
mais créateur capable de transformer son destin en une “destinée”,
le philosophe solitaire est appelé à devenir le maître à penser
de tous  ceux qui trouveront dans sa vision dionysiaque une
justification de leur révolte. L’anarchisme individualiste puise
dans la pensée nietzschéenne ses racines spirituelles. Mais,
peut-être parce que beaucoup d’itinéraires aboutissant au
fascisme sont passés par la révolte libertaire ou par
l’anarcho-syndicalisme - Mussolini en est un exemple parmi beaucoup
d’autres - et aussi par une interprétation abusive des notions de
Surhumanité et de volonté de puissance, les apprentis dictateurs y
ont également puisé».88
Parallèlement, Heidegger, à leur exemple, n’hésitera pas à
rabaisser la notion de Terre de Nietzsche, de la planète au sol :
«cet
appel vers le Surhomme par-delà les ruines de la Métaphysique
effondrée, doit-il encore être perçu comme le chant de “la plus
haute espérance”? La domination de la terre préserve-t-elle la
terre comme terre, c’est-à-dire comme séjour historial de
l’homme? L’homme habite-t-il encore cette terre? Ne la hante-t-il
pas plutôt de son âme dévastatrice, par la planification technique
et planétaire de l’étant dont elle est la profondeur inépuisable,
l’abri tutélaire,
Physis? Le
Planétaire, “l’uniformité du sans-distance”, est-il identique
au Terrestre, non pas l'ici-bas
par rapport à l’au-delà
de la Métaphysique, non par la “vallée des larmes”, mais le
Terrestre
ceux qui trouveront dans sa vision dionysiaque une
justification de leur révolte. L’anarchisme individualiste puise
dans la pensée nietzschéenne ses racines spirituelles. Mais,
peut-être parce que beaucoup d’itinéraires aboutissant au
fascisme sont passés par la révolte libertaire ou par
l’anarcho-syndicalisme - Mussolini en est un exemple parmi beaucoup
d’autres - et aussi par une interprétation abusive des notions de
Surhumanité et de volonté de puissance, les apprentis dictateurs y
ont également puisé».88
Parallèlement, Heidegger, à leur exemple, n’hésitera pas à
rabaisser la notion de Terre de Nietzsche, de la planète au sol :
«cet
appel vers le Surhomme par-delà les ruines de la Métaphysique
effondrée, doit-il encore être perçu comme le chant de “la plus
haute espérance”? La domination de la terre préserve-t-elle la
terre comme terre, c’est-à-dire comme séjour historial de
l’homme? L’homme habite-t-il encore cette terre? Ne la hante-t-il
pas plutôt de son âme dévastatrice, par la planification technique
et planétaire de l’étant dont elle est la profondeur inépuisable,
l’abri tutélaire,
Physis? Le
Planétaire, “l’uniformité du sans-distance”, est-il identique
au Terrestre, non pas l'ici-bas
par rapport à l’au-delà
de la Métaphysique, non par la “vallée des larmes”, mais le
Terrestre  comme proximité au
sol, au
fondamental?
Le Surhomme n’est-il pas plutôt que le seigneur de la terre, le
maître du désert… Il n’y a pas d’“arc-en-ciel” au-dessus
du désert, il n’y a que des mirages. Pour l’homme, le mirage de
sa propre volonté, “le vide qui résulte de l’abandon loin de
l’être”. Aussi l’ombre de Zarathoustra peut-elle s’écrier :
“Malheur à qui protège le désert».89
C’est ici que s’inscrit l’une des traditions – mais non pas
la seule, ni nécessairement la plus importante – de la réaction
nietzschéenne.
Le refus d’une modernité représentée par ses accents bourgeois :
son espérance dans la démocratie, son investissement dans la
liberté, sa foi dans la raison et son abandon aux progrès
techniques. Sur ce point, Heidegger lui fait écho : «Le
Surhomme comme figure de la Métaphyqiue achevée, n’est-il pas
encore le dernier homme? “le chemin du Surhomme commence avec son
déclin” dit étrangement Heidegger dans
Was heisst Denken?».90
comme proximité au
sol, au
fondamental?
Le Surhomme n’est-il pas plutôt que le seigneur de la terre, le
maître du désert… Il n’y a pas d’“arc-en-ciel” au-dessus
du désert, il n’y a que des mirages. Pour l’homme, le mirage de
sa propre volonté, “le vide qui résulte de l’abandon loin de
l’être”. Aussi l’ombre de Zarathoustra peut-elle s’écrier :
“Malheur à qui protège le désert».89
C’est ici que s’inscrit l’une des traditions – mais non pas
la seule, ni nécessairement la plus importante – de la réaction
nietzschéenne.
Le refus d’une modernité représentée par ses accents bourgeois :
son espérance dans la démocratie, son investissement dans la
liberté, sa foi dans la raison et son abandon aux progrès
techniques. Sur ce point, Heidegger lui fait écho : «Le
Surhomme comme figure de la Métaphyqiue achevée, n’est-il pas
encore le dernier homme? “le chemin du Surhomme commence avec son
déclin” dit étrangement Heidegger dans
Was heisst Denken?».90 s’appliquer aussi bien à
l’impulsion guerrière qu’à l’impulsion pacifiste, l’une et
l’autre étant également des passions ou des sentiments ou même
des habitudes. La pitié comme la cruauté, la fureur comme la
patience, le courage comme la panique sont tous au même titre des
réactions de l’animal “humain, trop humain” auxquelles le
surhomme ne doit pas être asservi. Quant au surhomme lui-même, nul
ne saura jamais si dans l’intention de son Créateur il doit être
une brute ou un esprit éclairé, un matamore ou un yoghi. “Cet
homme souverain dont il désirait l’éclat, il l’imaginait
contradictoirement tantôt riche, et tantôt plus pauvre qu’un
ouvrier, tantôt puissant et tantôt traqué. Il exigeait de lui, la
vertu de tout supporter, comme il lui reconnut le droit de
transgresser les Normes… d’ailleurs il le distinguait en principe
de l’homme au pouvoir” (G.Bataille.
Sur Nietzsche)».91
Il s’agirait donc d’une perspective tout à fait contradictoire
avec celle retenue plus haut, qui se développa machinalement dans la
pensée unique fasciste. C’est le paradoxe de cette pensée
réactionnaire d’avoir servi à étoffer les idéologies qui lui
étaient antithétiques. Comme le remarque Hobsbawm : «Peu
de penseurs remirent aussi radicalement en cause les vérités
admises au milieu du siècle, y compris les vérités scientifiques,
que le
s’appliquer aussi bien à
l’impulsion guerrière qu’à l’impulsion pacifiste, l’une et
l’autre étant également des passions ou des sentiments ou même
des habitudes. La pitié comme la cruauté, la fureur comme la
patience, le courage comme la panique sont tous au même titre des
réactions de l’animal “humain, trop humain” auxquelles le
surhomme ne doit pas être asservi. Quant au surhomme lui-même, nul
ne saura jamais si dans l’intention de son Créateur il doit être
une brute ou un esprit éclairé, un matamore ou un yoghi. “Cet
homme souverain dont il désirait l’éclat, il l’imaginait
contradictoirement tantôt riche, et tantôt plus pauvre qu’un
ouvrier, tantôt puissant et tantôt traqué. Il exigeait de lui, la
vertu de tout supporter, comme il lui reconnut le droit de
transgresser les Normes… d’ailleurs il le distinguait en principe
de l’homme au pouvoir” (G.Bataille.
Sur Nietzsche)».91
Il s’agirait donc d’une perspective tout à fait contradictoire
avec celle retenue plus haut, qui se développa machinalement dans la
pensée unique fasciste. C’est le paradoxe de cette pensée
réactionnaire d’avoir servi à étoffer les idéologies qui lui
étaient antithétiques. Comme le remarque Hobsbawm : «Peu
de penseurs remirent aussi radicalement en cause les vérités
admises au milieu du siècle, y compris les vérités scientifiques,
que le  philosophe Nietzsche et pourtant, ses écrits; en particulier
son ouvrage le plus ambitieux, La Volonté de puissance, - peuvent
être lus comme une variante du darwinisme social, comme un discours
tenu dans le langage de la sélection naturelle, celle-ci devant en
l’occurrence engendrer une nouvelle race de “surhommes” qui
dominera les êtres humains inférieurs, comme l’homme dans la
nature domine et exploite les animaux. Les liens entre la biologie et
l’idéologie sont particulièrement évidents dans les rapports
qu’entretinrent l’“eugénisme” et la nouvelle science qui
naquit vers 1900 et que peu de temps après (1905) William Bateson
baptisa de “génétique”».92
Il était possible de restituer la pensée originale de Nietzsche,
comme le fit Louise Michel, l’institutrice anarchiste de la Commune
de Paris, lorsque le journal La
Patrie du
18 octobre 1900 publia sa
missive : «“Ce
que nous voulons, ce n’est pas l’extermination, c’est au
contraire la fin de toutes les exterminations, la fin des guerres du
Tonkin, du Transvaal, la fin des tripotages, des Panama, et des
flibustiers capitalistes, tandis que les travailleurs manquent de
tout et meurent d’épuisement ou de faim pour entretenir dans
l’abondance une légion de parasites.”
philosophe Nietzsche et pourtant, ses écrits; en particulier
son ouvrage le plus ambitieux, La Volonté de puissance, - peuvent
être lus comme une variante du darwinisme social, comme un discours
tenu dans le langage de la sélection naturelle, celle-ci devant en
l’occurrence engendrer une nouvelle race de “surhommes” qui
dominera les êtres humains inférieurs, comme l’homme dans la
nature domine et exploite les animaux. Les liens entre la biologie et
l’idéologie sont particulièrement évidents dans les rapports
qu’entretinrent l’“eugénisme” et la nouvelle science qui
naquit vers 1900 et que peu de temps après (1905) William Bateson
baptisa de “génétique”».92
Il était possible de restituer la pensée originale de Nietzsche,
comme le fit Louise Michel, l’institutrice anarchiste de la Commune
de Paris, lorsque le journal La
Patrie du
18 octobre 1900 publia sa
missive : «“Ce
que nous voulons, ce n’est pas l’extermination, c’est au
contraire la fin de toutes les exterminations, la fin des guerres du
Tonkin, du Transvaal, la fin des tripotages, des Panama, et des
flibustiers capitalistes, tandis que les travailleurs manquent de
tout et meurent d’épuisement ou de faim pour entretenir dans
l’abondance une légion de parasites.”  Elle cite Kropotkine et
Nietzsche : “Nous voulons la conquête du pain, la conquête du
logement et des habits pour tout le monde… Alors le rêve superbe
de Nietzsche, qui prophétisait l’avènement du surhomme, se
réalisera”».93
La liberté, pour Nietzsche, n’était pas celle de l’anarchisme
non plus. Il ne s’agissait
pas de devenir le
stade suprême du socialisme ou
même de la République sociale. Nietzsche ne s’adressait
pas tant
aux collectivités ni aux
partis; il s’adressait
aux individus. Ainsi, «dans
Le
Crépuscule des Idoles;
la liberté c’est vouloir être responsable devant soi-même et son
critère est fournit par “la résistance à vaincre, la peine qu’il
coûte de se maintenir à la hauteur. Ce type suprême d’hommes
libres devrait être recherché là où la plus haute résistance est
continuellement surmontée”. Ainsi n’est-ce point licence, ni
choix délibéré du désordre, mais acte d’affranchissement
continu à l’égard de ce que l’on a reçu de son enfance, de son
milieu et que l’habitude a sacralisé».94
«Car,
qu’est-ce que la liberté? C’est avoir la volonté de répondre
de soi. C’est maintenir les distances qui nous séparent. C’est
être indifférent aux chagrins, aux duretés, aux privations, à la
vie même. C’est être prêt à sacrifier les hommes à sa cause,
sans faire exception de soi-même. Liberté signifie que les
instincts virils, les
Elle cite Kropotkine et
Nietzsche : “Nous voulons la conquête du pain, la conquête du
logement et des habits pour tout le monde… Alors le rêve superbe
de Nietzsche, qui prophétisait l’avènement du surhomme, se
réalisera”».93
La liberté, pour Nietzsche, n’était pas celle de l’anarchisme
non plus. Il ne s’agissait
pas de devenir le
stade suprême du socialisme ou
même de la République sociale. Nietzsche ne s’adressait
pas tant
aux collectivités ni aux
partis; il s’adressait
aux individus. Ainsi, «dans
Le
Crépuscule des Idoles;
la liberté c’est vouloir être responsable devant soi-même et son
critère est fournit par “la résistance à vaincre, la peine qu’il
coûte de se maintenir à la hauteur. Ce type suprême d’hommes
libres devrait être recherché là où la plus haute résistance est
continuellement surmontée”. Ainsi n’est-ce point licence, ni
choix délibéré du désordre, mais acte d’affranchissement
continu à l’égard de ce que l’on a reçu de son enfance, de son
milieu et que l’habitude a sacralisé».94
«Car,
qu’est-ce que la liberté? C’est avoir la volonté de répondre
de soi. C’est maintenir les distances qui nous séparent. C’est
être indifférent aux chagrins, aux duretés, aux privations, à la
vie même. C’est être prêt à sacrifier les hommes à sa cause,
sans faire exception de soi-même. Liberté signifie que les
instincts virils, les  instincts joyeux de guerre et de victoire,
prédominent sur tous les autres instincts, par exemple sur ceux du
“bonheur”. L’homme
devenu libre,
combien plus encore l’esprit devenu libre, foule aux pieds cette
sorte de bien-être méprisable dont rêvent les épiciers, les
chrétiens, les vaches, les femmes, les Anglais et d’autres
démocrates. L’homme libre est
guerrier.
- À quoi se mesure la liberté chez les individus comme chez les
peuples? À la résistance qu’il faut surmonter, à la peine qu’il
en coûte pour arriver
en haut.
Le type le plus élevé de l’homme libre doit être cherché là,
où constamment la plus forte résistance doit être vaincue : à
cinq pas de la tyrannie, au seuil même du danger de la servitude.
Cela est vrai physiologiquement si l’on entend par “tyrannie”
des instincts terribles et impitoyables qui provoquent contre eux le
maximum d’autorité et de discipline…».95
On
le voit, Louise Michel non plus n'avait pas lu correctement son
Nietzsche.
instincts joyeux de guerre et de victoire,
prédominent sur tous les autres instincts, par exemple sur ceux du
“bonheur”. L’homme
devenu libre,
combien plus encore l’esprit devenu libre, foule aux pieds cette
sorte de bien-être méprisable dont rêvent les épiciers, les
chrétiens, les vaches, les femmes, les Anglais et d’autres
démocrates. L’homme libre est
guerrier.
- À quoi se mesure la liberté chez les individus comme chez les
peuples? À la résistance qu’il faut surmonter, à la peine qu’il
en coûte pour arriver
en haut.
Le type le plus élevé de l’homme libre doit être cherché là,
où constamment la plus forte résistance doit être vaincue : à
cinq pas de la tyrannie, au seuil même du danger de la servitude.
Cela est vrai physiologiquement si l’on entend par “tyrannie”
des instincts terribles et impitoyables qui provoquent contre eux le
maximum d’autorité et de discipline…».95
On
le voit, Louise Michel non plus n'avait pas lu correctement son
Nietzsche. que sa proclamation de la crise de la modernité et son appel en
faveur d’un coup de balai moral étaient ancrés dans le
“radicalisme aristocratique”. Après tout, son principal souci
était l’excellence et le raffinement esthétique des minorités
aristocratiques au dépens de la vile majorité. Mais cette
préoccupation ne s’étendait pas exclusivement aux aristocraties
spirituelles, créatrices et amateurs de philosophie, de littérature
et d’art, notamment de musique. Ce n’est pas un moindre paradoxe
que dans sa recherche d’une soi-disant décadence positive
Nietzsche exalte en même temps l’esthétique de la culture d’élite
et le style musclé de l’exercice du pouvoir politique par
l’aristocratie».96
Nietzsche n’a rien à voir ni avec la noblesse déjantée du Gotha
ni une éventuelle élite de barbares en uniformes. Il avertit
clairement la première dans Ainsi
parlait Zarathoustra :
que sa proclamation de la crise de la modernité et son appel en
faveur d’un coup de balai moral étaient ancrés dans le
“radicalisme aristocratique”. Après tout, son principal souci
était l’excellence et le raffinement esthétique des minorités
aristocratiques au dépens de la vile majorité. Mais cette
préoccupation ne s’étendait pas exclusivement aux aristocraties
spirituelles, créatrices et amateurs de philosophie, de littérature
et d’art, notamment de musique. Ce n’est pas un moindre paradoxe
que dans sa recherche d’une soi-disant décadence positive
Nietzsche exalte en même temps l’esthétique de la culture d’élite
et le style musclé de l’exercice du pouvoir politique par
l’aristocratie».96
Nietzsche n’a rien à voir ni avec la noblesse déjantée du Gotha
ni une éventuelle élite de barbares en uniformes. Il avertit
clairement la première dans Ainsi
parlait Zarathoustra : [Zarathoustra].
J’ai dû voler au plus haut pour retrouver la fontaine de la joie
[Ecce
homo]. Tu
veux monter vers les hauteurs et ton âme a soif d’étoiles
[Zarathoustra]».100
Hitler peut bien se réfugier dans Le
nid de l’aigle, mais
il n’est que coucou. C’est l’élan mystique qui se rapproche le
plus du philosophe de Sils-Maria : «De
ces incantations vers le miracle qu’il profère, il n’attend rien
de moins que la naissance immédiate du surhomme : la découverte
immédiate et tangible de la présence réelle de la divinité dans
l’homme. Même sans pousser trop loin la recherche des similitudes
renversées il faut bien constater que l’office qu’il célèbre
alors est celui de la mort de Dieu et de la résurrection de l’homme
devenu surhomme. Il opère alors la transsubstantiation du langage et
de l’expérience intérieure».101
Une mystique athée, sans nul doute, mais une élévation de l’homme
au-delà des limites imposées par la nature sociale : «C’est
là qu’il s’avère que la mystique du surhomme est loin de n’être
[Zarathoustra].
J’ai dû voler au plus haut pour retrouver la fontaine de la joie
[Ecce
homo]. Tu
veux monter vers les hauteurs et ton âme a soif d’étoiles
[Zarathoustra]».100
Hitler peut bien se réfugier dans Le
nid de l’aigle, mais
il n’est que coucou. C’est l’élan mystique qui se rapproche le
plus du philosophe de Sils-Maria : «De
ces incantations vers le miracle qu’il profère, il n’attend rien
de moins que la naissance immédiate du surhomme : la découverte
immédiate et tangible de la présence réelle de la divinité dans
l’homme. Même sans pousser trop loin la recherche des similitudes
renversées il faut bien constater que l’office qu’il célèbre
alors est celui de la mort de Dieu et de la résurrection de l’homme
devenu surhomme. Il opère alors la transsubstantiation du langage et
de l’expérience intérieure».101
Une mystique athée, sans nul doute, mais une élévation de l’homme
au-delà des limites imposées par la nature sociale : «C’est
là qu’il s’avère que la mystique du surhomme est loin de n’être
 qu’un jeu intellectuel. Ce n’est ni une théorie abstraite ni
même une ombre de religion comme le déisme, mais une religion qui empoigne ses croyants corps et âme, comme le christianisme et
l’islam. Loin que les perspectives eschatologiques dont elle use
pour les fasciner soient une évasion idéale qui les détourne de
cette vie, elle n’en sont que la glorification, en tant que cette
vie n’est point existence régulière physiquement, moralement et
intellectuellement, mais soulèvement de révolte, plaisir débridé,
ivresse de création et de destruction. C’est là que prennent
naissance leur épicurisme matérialiste et leur mysticisme et aussi
l’union paradoxale et pourtant presque indissoluble de ces deux
éléments».102
À ses yeux, le surhomme à venir, celui qu’il appelle de tous ses
vœux, ne vise que le ciel pour prendre possession de la Terre :
«La
question très particulière qui se pose en ce moment pour nous est
de savoir jusqu’à quel maximum de hauteur pourra s’élever la
citadelle du surhomme. Par là seulement nous pourrons apporter une
réponse concrète aux ambitions démesurées des prométhéens».103
Vers quels modèles Nietzsche pouvait-il s’inspirer pour donner
corps à son surhomme?
qu’un jeu intellectuel. Ce n’est ni une théorie abstraite ni
même une ombre de religion comme le déisme, mais une religion qui empoigne ses croyants corps et âme, comme le christianisme et
l’islam. Loin que les perspectives eschatologiques dont elle use
pour les fasciner soient une évasion idéale qui les détourne de
cette vie, elle n’en sont que la glorification, en tant que cette
vie n’est point existence régulière physiquement, moralement et
intellectuellement, mais soulèvement de révolte, plaisir débridé,
ivresse de création et de destruction. C’est là que prennent
naissance leur épicurisme matérialiste et leur mysticisme et aussi
l’union paradoxale et pourtant presque indissoluble de ces deux
éléments».102
À ses yeux, le surhomme à venir, celui qu’il appelle de tous ses
vœux, ne vise que le ciel pour prendre possession de la Terre :
«La
question très particulière qui se pose en ce moment pour nous est
de savoir jusqu’à quel maximum de hauteur pourra s’élever la
citadelle du surhomme. Par là seulement nous pourrons apporter une
réponse concrète aux ambitions démesurées des prométhéens».103
Vers quels modèles Nietzsche pouvait-il s’inspirer pour donner
corps à son surhomme? Certes,
de l’historien Burckhardt, Nietzsche avait
reconnu
le modèle du surhomme dans ces condottieri
dont
l’élan vital, la volonté de puissance n’étaient
jamais complètement assouvis
par les victoires militaires. Il leur fallait le ciel, c’est-à-dire
le monde de la pensée néo-platonicienne qu’ils couvèrent de
leurs ailes protectrices. Sans eux, la Renaissance n’aurait pu
survenir. Ils ont accompli la promesse de Zarathoustra : ils ont
créé, ils ont inventé. Ils ont même fait de l’État une
esthétique que Machiavel a mis en formes littéraires. Rien, sinon
l’Athènes de Périclès, n’avait propulsé la surhumanité
jusqu’à dépasser la condition transitoire de l’humanité. Or,
le dernier des condottieri
n’est-il
pas Napoléon Bonaparte? Qui, mieux que Bonaparte, a assuré la
permanence des acquis de la Révolution française en Europe? Et qui
mieux que Gœthe a célébré cette révolution au point d’être
honoré par le condottieri
au moment
de sa rencontre privilégiée? «En
1808, ces
Certes,
de l’historien Burckhardt, Nietzsche avait
reconnu
le modèle du surhomme dans ces condottieri
dont
l’élan vital, la volonté de puissance n’étaient
jamais complètement assouvis
par les victoires militaires. Il leur fallait le ciel, c’est-à-dire
le monde de la pensée néo-platonicienne qu’ils couvèrent de
leurs ailes protectrices. Sans eux, la Renaissance n’aurait pu
survenir. Ils ont accompli la promesse de Zarathoustra : ils ont
créé, ils ont inventé. Ils ont même fait de l’État une
esthétique que Machiavel a mis en formes littéraires. Rien, sinon
l’Athènes de Périclès, n’avait propulsé la surhumanité
jusqu’à dépasser la condition transitoire de l’humanité. Or,
le dernier des condottieri
n’est-il
pas Napoléon Bonaparte? Qui, mieux que Bonaparte, a assuré la
permanence des acquis de la Révolution française en Europe? Et qui
mieux que Gœthe a célébré cette révolution au point d’être
honoré par le condottieri
au moment
de sa rencontre privilégiée? «En
1808, ces  deux grands, réunis à Erfurt, auraient croisé leurs
regards, échangé des paroles. Nietzsche voyait en cette rencontre
une des cimes de l’histoire. Napoléon et Gœthe, pensait-il,
étaient capables de commencer, de fonder ensemble une Europe. “J’ai
refermé le gouffre, débrouillé le chaos; j’ai ennobli les
peuples”, avait dit Napoléon en une phrase admirée par Nietzsche.
Il les avait ennoblis par la discipline et la gloire. Gœthe, lui
aussi, sur un tout autre plan, avait refermé le gouffre, débrouillé
le chaos et ennobli, non les peuples, telle n’était
deux grands, réunis à Erfurt, auraient croisé leurs
regards, échangé des paroles. Nietzsche voyait en cette rencontre
une des cimes de l’histoire. Napoléon et Gœthe, pensait-il,
étaient capables de commencer, de fonder ensemble une Europe. “J’ai
refermé le gouffre, débrouillé le chaos; j’ai ennobli les
peuples”, avait dit Napoléon en une phrase admirée par Nietzsche.
Il les avait ennoblis par la discipline et la gloire. Gœthe, lui
aussi, sur un tout autre plan, avait refermé le gouffre, débrouillé
le chaos et ennobli, non les peuples, telle n’était  pas sa tâche,
mais les êtres, leurs esprits et leurs âmes, en leur offrant
l’exemple de sa vie, solidaire-
pas sa tâche,
mais les êtres, leurs esprits et leurs âmes, en leur offrant
l’exemple de sa vie, solidaire-ment et magnifiquement édifiée. Dans sa hiérarchie des êtres, Nietzsche distinguait, au-dessus du niveau moyen, trois stades de noblesse. Premier stade, le gentilhomme; deuxième stade, le grand homme; troisième stade, l’homme suprême. Napoléon, c’était le grand homme mais l’homme suprême, c’était Gœthe. Leur rencontre n’avait duré qu’un instant. Le gouffre ensuite s’était rouvert, l’Europe rendue au chaos. Telle est l’Histoire, qui n’admet sur les houles que des lueurs. Encore faut-il les saisir au passage».104 Comme tous les Allemands, des romantiques aux fascistes, la figure de Napoléon demeura un modèle d’investissement narcissique. Être Napoléon. Dépasser Napoléon! Même Hitler lui rendit hommage en faisant transporter
 le
cercueil de son fils, l’Aiglon, aux Invalides durant l’Occupation.
Il en allait de même de Nietzsche : «C’est,
pour lui, le type même de l’individu d’exception, “l’homme
supérieur et l’homme redoutable”, faisant irruption en homme de
la Renaissance en pleine éclosion du monde démo-libéral, prenant
l’histoire à contre-courant, lui imprimant sa marque par ses
œuvres, libéré de toute pitié, à commencer pour lui-même. Son
aventure sera éblouissante mais brève; le
le
cercueil de son fils, l’Aiglon, aux Invalides durant l’Occupation.
Il en allait de même de Nietzsche : «C’est,
pour lui, le type même de l’individu d’exception, “l’homme
supérieur et l’homme redoutable”, faisant irruption en homme de
la Renaissance en pleine éclosion du monde démo-libéral, prenant
l’histoire à contre-courant, lui imprimant sa marque par ses
œuvres, libéré de toute pitié, à commencer pour lui-même. Son
aventure sera éblouissante mais brève; le  ressentiment scandalisé
des médiocres obtiendra sa perte. Cependant, il est une manière
moins dramatique mais aussi terrible de venir à bout de celui qui
pouvait être un héros : le convertir à la morale des esclaves…».105
Que
manque-t-il alors à
Napoléon pour
être reconnu comme le
surhomme sinon
qu'il n'en a pas la conscience, conscience que seul Gœthe semble
posséder?
«À vrai
dire, dépassant ces antinomies, on retrouve l’unité de la pensée
de Nietzsche si l’on se souvient que Napoléon, pour lui, est le
mythe de l’aventurier supérieur qui méprise les idées reçues,
court les plus grands risques, les suscite sans relâche, fait subir
aux contemporains les plus dures épreuves et pour qui la défaite et
la mort elles-mêmes n’apportent aucun démenti, aucune
disqualification, puisqu’il avait voulu faire de sa vie non une
gestion habilement conservatrice mais un défi aux confins de
l’impossible. Comme César, comme Borgia, il est l’homme de la
démesure; il déclenche un conflit terrible, contre les valeurs
lénifiantes qui triomphaient avant lui et se répandent à nouveau
depuis sa chute».106
C’est que Nietzsche ne voit ici que l’individu. Il ne peut être
le Weltgeist
que s’il
a Gœthe devant lui, comme Hegel le vit à Iéna, lui-même, tout
en serrant
sa Phénoménologie
entre ses bras, se sentait partager
avec Napoléon un
même Weltgeist.
Napoléon
avec Gœthe valait mieux, aux yeux de Nietzsche, que Napoléon avec
Hegel.
ressentiment scandalisé
des médiocres obtiendra sa perte. Cependant, il est une manière
moins dramatique mais aussi terrible de venir à bout de celui qui
pouvait être un héros : le convertir à la morale des esclaves…».105
Que
manque-t-il alors à
Napoléon pour
être reconnu comme le
surhomme sinon
qu'il n'en a pas la conscience, conscience que seul Gœthe semble
posséder?
«À vrai
dire, dépassant ces antinomies, on retrouve l’unité de la pensée
de Nietzsche si l’on se souvient que Napoléon, pour lui, est le
mythe de l’aventurier supérieur qui méprise les idées reçues,
court les plus grands risques, les suscite sans relâche, fait subir
aux contemporains les plus dures épreuves et pour qui la défaite et
la mort elles-mêmes n’apportent aucun démenti, aucune
disqualification, puisqu’il avait voulu faire de sa vie non une
gestion habilement conservatrice mais un défi aux confins de
l’impossible. Comme César, comme Borgia, il est l’homme de la
démesure; il déclenche un conflit terrible, contre les valeurs
lénifiantes qui triomphaient avant lui et se répandent à nouveau
depuis sa chute».106
C’est que Nietzsche ne voit ici que l’individu. Il ne peut être
le Weltgeist
que s’il
a Gœthe devant lui, comme Hegel le vit à Iéna, lui-même, tout
en serrant
sa Phénoménologie
entre ses bras, se sentait partager
avec Napoléon un
même Weltgeist.
Napoléon
avec Gœthe valait mieux, aux yeux de Nietzsche, que Napoléon avec
Hegel. à la vie une
accélération vertigineuse.
Comme le célèbre Dr Moreau de Wells faisait franchir en quelques
jours à des animaux les siècles innombrables qui les séparaient du
stade de l’humanité, de même ils voudraient, eux, des hommes,
brûler les étapes qui les séparent du surhomme. C’est un désir
de pareille nature qui, à quelque degré, consume tous les grands
révolutionnaires impatients de briser les édifices étouffants du
passé et d’avancer à marches forcées vers le royaume de la
liberté; de cette liberté dont parle Engels et qui bien entendu
vaudrait sur le plan politique et social, mais aussi dans la vie tout
entière : au point de vue sexuel et même métaphysique».107
En affirmant l’éternel-retour contre le progrès, Nietzsche se
donnait une assurance contre l'absurdité
qu’est la mort; la mort de Dieu, précédant celle de l’homme, il
n’y avait plus raison d’aspirer en une vie future, l’humanité
actuelle cédant
sa place à une surhumanité affranchie et responsable,
à la vie une
accélération vertigineuse.
Comme le célèbre Dr Moreau de Wells faisait franchir en quelques
jours à des animaux les siècles innombrables qui les séparaient du
stade de l’humanité, de même ils voudraient, eux, des hommes,
brûler les étapes qui les séparent du surhomme. C’est un désir
de pareille nature qui, à quelque degré, consume tous les grands
révolutionnaires impatients de briser les édifices étouffants du
passé et d’avancer à marches forcées vers le royaume de la
liberté; de cette liberté dont parle Engels et qui bien entendu
vaudrait sur le plan politique et social, mais aussi dans la vie tout
entière : au point de vue sexuel et même métaphysique».107
En affirmant l’éternel-retour contre le progrès, Nietzsche se
donnait une assurance contre l'absurdité
qu’est la mort; la mort de Dieu, précédant celle de l’homme, il
n’y avait plus raison d’aspirer en une vie future, l’humanité
actuelle cédant
sa place à une surhumanité affranchie et responsable,  étrangère
au
déclin d'une
humanité froide : «On
comprend le pouvoir d’ébranlement qu’a pu avoir, et que garde
encore pour nous la pensée de Nietzsche, lorsqu’elle a annoncé
sous la forme de l’événement imminent, de la Promesse-Menace, que
l’homme bientôt ne serait plus, - mais le surhomme; ce qui, dans
une philosophie du Retour voulait dire que l’homme, depuis bien
longtemps déjà, avait disparu et ne cessait de disparaître, et que
notre pensée moderne de l’homme, notre sollicitude pour lui, notre
humanisme dormaient sereinement sur sa grondante inexistence. Nous
qui nous croyons liés à une finitude qui n’appartient qu’à
nous et qui nous ouvre, par le connaître, la vérité du monde, ne
faut-il pas nous rappeler que nous sommes attachés sur le dos d’un
tigre?».108
Pour cette humanité froide, ne restait
qu’un monstre froid, celui dénoncé
par Zarathoustra, c’est-à-dire l’État.
On comprend, avec Daniel Halévy, que la surhumanité en est venu à
se passer de l’éternel-retour qui «a
disparu, et, à sa place, paraît une idée différente : celle du
Surhomme. Disons même qu’au premier regard elle est, non seulement
différente, mais contraire : elle intéresse l’avenir, elle rend
un sens à la durée, et par là, au mobile univers. Jetée dans la
circulation aux environs de 1880, communiquée à un public formé
par le vocabulaire darwinien, c’est inévitablement ainsi qu’elle
devait être comprise».109
Mais, comme nous l’avons vue, cette compréhension trahissait la
pensée profonde de Nietzsche. Le surhomme s’orientait
avant toutes choses vers l’expérience individuelle, un mysticisme
athée tourné vers le
étrangère
au
déclin d'une
humanité froide : «On
comprend le pouvoir d’ébranlement qu’a pu avoir, et que garde
encore pour nous la pensée de Nietzsche, lorsqu’elle a annoncé
sous la forme de l’événement imminent, de la Promesse-Menace, que
l’homme bientôt ne serait plus, - mais le surhomme; ce qui, dans
une philosophie du Retour voulait dire que l’homme, depuis bien
longtemps déjà, avait disparu et ne cessait de disparaître, et que
notre pensée moderne de l’homme, notre sollicitude pour lui, notre
humanisme dormaient sereinement sur sa grondante inexistence. Nous
qui nous croyons liés à une finitude qui n’appartient qu’à
nous et qui nous ouvre, par le connaître, la vérité du monde, ne
faut-il pas nous rappeler que nous sommes attachés sur le dos d’un
tigre?».108
Pour cette humanité froide, ne restait
qu’un monstre froid, celui dénoncé
par Zarathoustra, c’est-à-dire l’État.
On comprend, avec Daniel Halévy, que la surhumanité en est venu à
se passer de l’éternel-retour qui «a
disparu, et, à sa place, paraît une idée différente : celle du
Surhomme. Disons même qu’au premier regard elle est, non seulement
différente, mais contraire : elle intéresse l’avenir, elle rend
un sens à la durée, et par là, au mobile univers. Jetée dans la
circulation aux environs de 1880, communiquée à un public formé
par le vocabulaire darwinien, c’est inévitablement ainsi qu’elle
devait être comprise».109
Mais, comme nous l’avons vue, cette compréhension trahissait la
pensée profonde de Nietzsche. Le surhomme s’orientait
avant toutes choses vers l’expérience individuelle, un mysticisme
athée tourné vers le  perfectionnement de l’Être. En cela,
Heidegger est resté un disciple fidèle du philosophe de Sils-Maria.
En remplaçant Dieu par l’Être, on détachait
le sort de
l’homme de la mort de Dieu. Il se voyait, certes, marqué par le
temps, mais il pouvait quand même s’élever, tel l’aigle de
Zarathoustra,
vers les
hauteurs de la transcendance intérieure nouvelle.
Cette question a été adressée par Lou-Andreas Salomé dans un
essai sur le philosophe qu’elle connaissait personnellement :
«Dans son
essai sur Nietzsche de 1894, elle écrivait
: “Nietzsche, dans sa philosophie de l’avenir, ne croit plus que
la surhumanité soit donnée toute faite : il faut d’abord que
l’homme la crée lui-même, et il ne dispose pour cela que des
forces élémentaires que lui fournit la nature. Il ne s’agit donc
pas de préférer à ce monde-ci un au-delà qui le transcende, mais
de faire surgir, au cœur même de l’ici-bas un au-delà d’une
plénitude et d’une richesse insurpassables. Dans Ainsi
Parlait Zarathoustra,
que l’on pourrait appeler l’hymne suprême de l’individualisme
moderne, Nietzsche a trouvé des accents d’une beauté incomparable
pour célébrer la libération des énergies vitales de
l’individualité”».110
perfectionnement de l’Être. En cela,
Heidegger est resté un disciple fidèle du philosophe de Sils-Maria.
En remplaçant Dieu par l’Être, on détachait
le sort de
l’homme de la mort de Dieu. Il se voyait, certes, marqué par le
temps, mais il pouvait quand même s’élever, tel l’aigle de
Zarathoustra,
vers les
hauteurs de la transcendance intérieure nouvelle.
Cette question a été adressée par Lou-Andreas Salomé dans un
essai sur le philosophe qu’elle connaissait personnellement :
«Dans son
essai sur Nietzsche de 1894, elle écrivait
: “Nietzsche, dans sa philosophie de l’avenir, ne croit plus que
la surhumanité soit donnée toute faite : il faut d’abord que
l’homme la crée lui-même, et il ne dispose pour cela que des
forces élémentaires que lui fournit la nature. Il ne s’agit donc
pas de préférer à ce monde-ci un au-delà qui le transcende, mais
de faire surgir, au cœur même de l’ici-bas un au-delà d’une
plénitude et d’une richesse insurpassables. Dans Ainsi
Parlait Zarathoustra,
que l’on pourrait appeler l’hymne suprême de l’individualisme
moderne, Nietzsche a trouvé des accents d’une beauté incomparable
pour célébrer la libération des énergies vitales de
l’individualité”».110 de l’homme fasciste, héritier de l’esprit nihiliste et
“nietzschéen” du squadrisme et des corps francs».112
Sitôt
qu’en 1908 (huit ans après la mort du philosophe), le jeune
Mussolini se fait une vision assez juste de son œuvre : «Le
surhomme est un symbole, il est le représentant de cette période
angoissée et tragique de crise que traverse la conscience européenne
à la recherche de nouvelles sources de plaisir, de beauté et
d’idéal. Il est le constat de notre faiblesse, mais, en même
temps, l’espoir de notre rédemption. Il est le crépuscule - et
l’aurore. Il est surtout un hymne à la vie, à la vie vécue avec
toutes les énergies dans une tension continue vers quelque chose de
plus haut, de plus fin et de plus tentateur».113
Son idée du surhomme nietzschéen se fait alors qu’il est toujours
un socialiste avoué. Mais Mussolini ne lit pas seulement du
Nietzsche; à côté figurent la
psychologie des foules de
Le Bon et surtout Georges Sorel et ses Réflexions
sur la violence (1908) :
«À cette
époque Mussolini paraît avoir commencé à lire Nietzsche qui, avec
son “rien n’est vrai, tout est permis”, fournissait un
magnifique terrain de chasse aux ambitions sans scrupules. Là encore
Mussolini se trouvait avoir été préparé par Sorel, et si le
surhomme
n’a signifié pour lui autre chose que la glorification de sa
personne, pendant un certain nombre d’années il demeura la
glorification du prolétaire. En 1908 le sage vieux juif Claudio
Treves, alors directeur de l’Avanti,
fit à Forli une conférence sur Nietzsche, dans laquelle il définit
le surhomme comme étant une pièce du symbolisme adolescent. Cela
outragea le jeune Mussolini qui fit explosion dans une série
d’articles publiés dans un hebdomadaire local appelé le
Pensiero Romagnolo,
pour défendre la philosophie de la force. Ce fut le début d’une
vendetta personnelle qui dura plusieurs années, mais tourna en
faveur de Mussolini, car ce fut Treves qui fut chassé de l’Avanti
où Mussolini prit sa place en 1912».114
C’était la première épuration intellectuelle de la carrière du
futur Duce.
Celui-ci
au pouvoir deviendra le philosophe par
excellence du
fascisme, renvoyant
de l’homme fasciste, héritier de l’esprit nihiliste et
“nietzschéen” du squadrisme et des corps francs».112
Sitôt
qu’en 1908 (huit ans après la mort du philosophe), le jeune
Mussolini se fait une vision assez juste de son œuvre : «Le
surhomme est un symbole, il est le représentant de cette période
angoissée et tragique de crise que traverse la conscience européenne
à la recherche de nouvelles sources de plaisir, de beauté et
d’idéal. Il est le constat de notre faiblesse, mais, en même
temps, l’espoir de notre rédemption. Il est le crépuscule - et
l’aurore. Il est surtout un hymne à la vie, à la vie vécue avec
toutes les énergies dans une tension continue vers quelque chose de
plus haut, de plus fin et de plus tentateur».113
Son idée du surhomme nietzschéen se fait alors qu’il est toujours
un socialiste avoué. Mais Mussolini ne lit pas seulement du
Nietzsche; à côté figurent la
psychologie des foules de
Le Bon et surtout Georges Sorel et ses Réflexions
sur la violence (1908) :
«À cette
époque Mussolini paraît avoir commencé à lire Nietzsche qui, avec
son “rien n’est vrai, tout est permis”, fournissait un
magnifique terrain de chasse aux ambitions sans scrupules. Là encore
Mussolini se trouvait avoir été préparé par Sorel, et si le
surhomme
n’a signifié pour lui autre chose que la glorification de sa
personne, pendant un certain nombre d’années il demeura la
glorification du prolétaire. En 1908 le sage vieux juif Claudio
Treves, alors directeur de l’Avanti,
fit à Forli une conférence sur Nietzsche, dans laquelle il définit
le surhomme comme étant une pièce du symbolisme adolescent. Cela
outragea le jeune Mussolini qui fit explosion dans une série
d’articles publiés dans un hebdomadaire local appelé le
Pensiero Romagnolo,
pour défendre la philosophie de la force. Ce fut le début d’une
vendetta personnelle qui dura plusieurs années, mais tourna en
faveur de Mussolini, car ce fut Treves qui fut chassé de l’Avanti
où Mussolini prit sa place en 1912».114
C’était la première épuration intellectuelle de la carrière du
futur Duce.
Celui-ci
au pouvoir deviendra le philosophe par
excellence du
fascisme, renvoyant 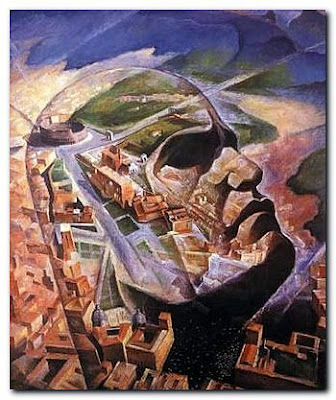 Nietzsche lui-même aux oubliettes : «Les
intellectuels sont par principe tenus en suspicion. L’opinion
fasciste sur la culture est qu’il faut se garder de trop raisonner,
de trop vouloir expliquer les choses. Surtout s’il s’agit des
actes du Duce car, comme le déclare le secrétaire du PNF à des
professeurs réunis à Bologne en 1935, ce serait se placer sur le
même plan que le Duce. Or il y a entre celui-ci et les autres
mortels une distance “tout simplement astronomique”».115
Autant dire que Duce
était
synonyme de Surhomme. Sa chute et son exécution n’en parurent que
plus méprisables. Apprenant la mort de Mussolini, alors qu’il
était lui-même assiégé dans le bunker à Berlin, le ministre de
la Propagande du Reich eut ces mots atroces à l’égard des alliés
italiens : «“Le
Duce entrera dans l’Histoire comme le dernier des Romains”, pensa
et écrivit Gœbbels, “mais derrière sa massive figure un peuple
de romanichels avait pourri”».116
L’aventure du Duce
surhumain
n’avait été qu’une suite de subversions sociales planifiée par
l’État, ce monstre froid sous le ciel chaud
méridional.
Nietzsche lui-même aux oubliettes : «Les
intellectuels sont par principe tenus en suspicion. L’opinion
fasciste sur la culture est qu’il faut se garder de trop raisonner,
de trop vouloir expliquer les choses. Surtout s’il s’agit des
actes du Duce car, comme le déclare le secrétaire du PNF à des
professeurs réunis à Bologne en 1935, ce serait se placer sur le
même plan que le Duce. Or il y a entre celui-ci et les autres
mortels une distance “tout simplement astronomique”».115
Autant dire que Duce
était
synonyme de Surhomme. Sa chute et son exécution n’en parurent que
plus méprisables. Apprenant la mort de Mussolini, alors qu’il
était lui-même assiégé dans le bunker à Berlin, le ministre de
la Propagande du Reich eut ces mots atroces à l’égard des alliés
italiens : «“Le
Duce entrera dans l’Histoire comme le dernier des Romains”, pensa
et écrivit Gœbbels, “mais derrière sa massive figure un peuple
de romanichels avait pourri”».116
L’aventure du Duce
surhumain
n’avait été qu’une suite de subversions sociales planifiée par
l’État, ce monstre froid sous le ciel chaud
méridional. politique et financier
achève de contaminer la IIIe République, l’ordre qui règne en
Allemagne, dans l’obéissance et l’enthousiasme, apparaît comme
tout le contraire d’une société parlementaire
démocratique
corrompue, inefficace et croulante. C’est ce qui frappe les
observateurs français. Au moment où Hitler prend le pouvoir, en
1933, un Thierry Maulnier communie totalement avec la logique du
régime nazi : «Sa
philosophie des relations internationales lui faisait trouver
naturelle celle des nazis, dont elle était très voisine; si une
civilisation est supérieure, il est juste qu’elle triomphe; si
elle est inférieure, il est normal qu’elle disparaisse. La
querelle entre l’Allemagne et la France n’était pas une querelle
de principes : “Si nous contestons le principe allemand d’après
lequel une humanité supérieure a le droit d’asservir une humanité
inférieure, pourquoi avons-nous des colonies? Résoudre cette
question, c’est résoudre en même temps celle de la suprématie”».117
Apparaissent, ici et
là
d’autres antécédents de la surhumanité française : le même
Thierry
politique et financier
achève de contaminer la IIIe République, l’ordre qui règne en
Allemagne, dans l’obéissance et l’enthousiasme, apparaît comme
tout le contraire d’une société parlementaire
démocratique
corrompue, inefficace et croulante. C’est ce qui frappe les
observateurs français. Au moment où Hitler prend le pouvoir, en
1933, un Thierry Maulnier communie totalement avec la logique du
régime nazi : «Sa
philosophie des relations internationales lui faisait trouver
naturelle celle des nazis, dont elle était très voisine; si une
civilisation est supérieure, il est juste qu’elle triomphe; si
elle est inférieure, il est normal qu’elle disparaisse. La
querelle entre l’Allemagne et la France n’était pas une querelle
de principes : “Si nous contestons le principe allemand d’après
lequel une humanité supérieure a le droit d’asservir une humanité
inférieure, pourquoi avons-nous des colonies? Résoudre cette
question, c’est résoudre en même temps celle de la suprématie”».117
Apparaissent, ici et
là
d’autres antécédents de la surhumanité française : le même
Thierry  Maulnier, dans le portrait qu’il trace
de l’écrivain allemand auteur du Troisième
Reich et
qui s’est enlevé la vie, Moeller Van den Bruck, célèbre
«une
virilité profonde et tragique, un penchant naturel à l’héroïsme,
un mépris du bonheur, une recherche du sacrifice par l’élan
naturel de l’être et non pas la discipline subie passivement, d’un
impératif abstrait».118
Toute la droite française n’est d’ailleurs pas également
enthousiasmée par le réveil allemand. Les vieux bonzes de l’Action
Française ne cessent
d’en appeler à la paix pour ne pas avoir à affronter ceux dont
ils craignent l’agressivité. C’est contre ces
vieillards
que se déchaîne le jeune Drieu La Rochelle : «C’est
qu’un monarchiste n’est jamais un moderne : il n’a point la
brutalité, le simplisme barbare d’un moderne».119
Mais au politique
d’abord, de
Maurras répondait plutôt une sévère critique morale, comme le
reconnu Julien Benda : «Le
fascisme de Drieu, écrit Benda, “est bien moins un décret
politique qu’une attaque morale, qui consiste dans la volonté
nietzschéenne de toujours se dépasser
Maulnier, dans le portrait qu’il trace
de l’écrivain allemand auteur du Troisième
Reich et
qui s’est enlevé la vie, Moeller Van den Bruck, célèbre
«une
virilité profonde et tragique, un penchant naturel à l’héroïsme,
un mépris du bonheur, une recherche du sacrifice par l’élan
naturel de l’être et non pas la discipline subie passivement, d’un
impératif abstrait».118
Toute la droite française n’est d’ailleurs pas également
enthousiasmée par le réveil allemand. Les vieux bonzes de l’Action
Française ne cessent
d’en appeler à la paix pour ne pas avoir à affronter ceux dont
ils craignent l’agressivité. C’est contre ces
vieillards
que se déchaîne le jeune Drieu La Rochelle : «C’est
qu’un monarchiste n’est jamais un moderne : il n’a point la
brutalité, le simplisme barbare d’un moderne».119
Mais au politique
d’abord, de
Maurras répondait plutôt une sévère critique morale, comme le
reconnu Julien Benda : «Le
fascisme de Drieu, écrit Benda, “est bien moins un décret
politique qu’une attaque morale, qui consiste dans la volonté
nietzschéenne de toujours se dépasser  dans le mépris de toutes les
stagnations, de tous les statismes, de toutes les jouissances
paisibles, dont la démocratie lui semble le symbole”».120
Même si on concède que Drieu tendait la main à Nietzsche, n’en
demeure pas moins que c’est là un assez mince raccordement. Le
beau-frère de Brasillach, le virulent rédacteur antisémite de Je
suis partout, Maurice
Bardèche, dans un essai de 1961, Qu’est-ce
que le fascisme?, écrira :
«Ce sont
des qualités proprement militaires et pour ainsi dire animales :
elles nous rappellent que la première tâche de l’homme est de
protéger, de dompter, vocation que la vie grégaire et pacifique des
cités nous fait oublier, mais que le danger réveille, et toute
œuvre difficile où l’homme retrouve ses adversaires naturels :
les tempêtes, les catastrophes, les déserts. Ces qualités animales
de l’homme en ont engendré d’autres qui en sont inséparables,
car elles appartiennent au code de l’honneur qui s’est établi
dans le danger : ce sont la loyauté, la fidélité, la solidarité,
le désintéressement».121
L'appel
à la Terre de Zarathoustra n’était
certainement pas cette
poussée vers la
confrontation du
Surhomme avec
la nature,
mais une régression à une conception de l’éthos animal idéalisé.
C’est ce qui fera tant ressembler certains discours idéologiques
des écologistes à de vieilles maximes nazies.
dans le mépris de toutes les
stagnations, de tous les statismes, de toutes les jouissances
paisibles, dont la démocratie lui semble le symbole”».120
Même si on concède que Drieu tendait la main à Nietzsche, n’en
demeure pas moins que c’est là un assez mince raccordement. Le
beau-frère de Brasillach, le virulent rédacteur antisémite de Je
suis partout, Maurice
Bardèche, dans un essai de 1961, Qu’est-ce
que le fascisme?, écrira :
«Ce sont
des qualités proprement militaires et pour ainsi dire animales :
elles nous rappellent que la première tâche de l’homme est de
protéger, de dompter, vocation que la vie grégaire et pacifique des
cités nous fait oublier, mais que le danger réveille, et toute
œuvre difficile où l’homme retrouve ses adversaires naturels :
les tempêtes, les catastrophes, les déserts. Ces qualités animales
de l’homme en ont engendré d’autres qui en sont inséparables,
car elles appartiennent au code de l’honneur qui s’est établi
dans le danger : ce sont la loyauté, la fidélité, la solidarité,
le désintéressement».121
L'appel
à la Terre de Zarathoustra n’était
certainement pas cette
poussée vers la
confrontation du
Surhomme avec
la nature,
mais une régression à une conception de l’éthos animal idéalisé.
C’est ce qui fera tant ressembler certains discours idéologiques
des écologistes à de vieilles maximes nazies. Le
nazisme avait pris le chemin tout à l’opposé de celui que
suggérait Nietzsche. Il était, en effet, une régression vers
l’animalité. Il en dépassait même l’éthos puisqu’il
entraîna les hommes à se comporter comme aucun animal de la nature
ne se comporte, sauf peut-être les abeilles et les fourmis :
«L’attitude
de la communauté, qui tout ensemble attend et redoute le surhomme,
qui se refuse d’abord à lui tant qu’elle n’a pas compris le
sens de son œuvre ou qu’il ne l’a pas complètement accomplie,
et qui l’abandonne à son sort dès qu’elle n’en a plus besoin
ou que cette œuvre la distance, n’est-elle pas comparable à celle
de la reine des abeilles dans le vol nuptial? La société n’est
rétive au génie qu’autant qu’il faut pour qu’elle l’éprouve
vraiment digne de la tâche qu’elle-même attend. Elle ne
s’abandonne que devant l’insistance et la puissance de celui qui
lui apportera le germe d’une métamorphose d’elle-même, d’une
autre elle-même. Et c’est d’ailleurs pourquoi, à l’inverse,
elle accueille sans réaction les talents ordinaires qui eux, n’ont
rien à lui fournir qu’elle n’ait déjà en soi».122
La découverte des camps de la mort pourrait même laisser présager
une sous-animalité, ou
du moins quelque chose qu'annonçait déjà Zarathoustra lorsqu'il
chantait : de
ce grand flux vous voulez être, n’est-ce pas? le reflux, et plutôt
que de surmonter l’homme encore vous préférez revenir à la bête!
Quoi
Le
nazisme avait pris le chemin tout à l’opposé de celui que
suggérait Nietzsche. Il était, en effet, une régression vers
l’animalité. Il en dépassait même l’éthos puisqu’il
entraîna les hommes à se comporter comme aucun animal de la nature
ne se comporte, sauf peut-être les abeilles et les fourmis :
«L’attitude
de la communauté, qui tout ensemble attend et redoute le surhomme,
qui se refuse d’abord à lui tant qu’elle n’a pas compris le
sens de son œuvre ou qu’il ne l’a pas complètement accomplie,
et qui l’abandonne à son sort dès qu’elle n’en a plus besoin
ou que cette œuvre la distance, n’est-elle pas comparable à celle
de la reine des abeilles dans le vol nuptial? La société n’est
rétive au génie qu’autant qu’il faut pour qu’elle l’éprouve
vraiment digne de la tâche qu’elle-même attend. Elle ne
s’abandonne que devant l’insistance et la puissance de celui qui
lui apportera le germe d’une métamorphose d’elle-même, d’une
autre elle-même. Et c’est d’ailleurs pourquoi, à l’inverse,
elle accueille sans réaction les talents ordinaires qui eux, n’ont
rien à lui fournir qu’elle n’ait déjà en soi».122
La découverte des camps de la mort pourrait même laisser présager
une sous-animalité, ou
du moins quelque chose qu'annonçait déjà Zarathoustra lorsqu'il
chantait : de
ce grand flux vous voulez être, n’est-ce pas? le reflux, et plutôt
que de surmonter l’homme encore vous préférez revenir à la bête!
Quoi
 qu'il en soit, cela
n’avait plus rien à voir avec cette «capacité
que possède l’individu de se sacrifier pour la communauté; pour
ses semblables” [Hitler]
conçoit cet “idéalisme” comme la plus haute forme d’obéissance
de l’animal aux lois de la nature, une force que seul l’Aryen est
capable d’assumer…».123
Wiskemann
explique ainsi le lien Nietzsche/Hitler : «L’influence
extérieure qui agit le plus fortement sur Hitler avait été cette
doctrine de Nietzsche, où la puissance et la lutte pour la
puissance, qui signifiait le piétinage des faibles, étaient les
valeurs dernières. Nietzsche avait condamné à la fois le
christianisme et les idées de la première révolution française
comme étant le triomphe d’une mentalité d’esclaves, contre
laquelle il exhortait tous les esprits supérieurs à se révolter;
ceux-ci devaient créer un code nouveau, celui des hommes forts, dont
la base devait être la fermeté impitoyable. “Une race dominante
ne peut s’élever qu’au milieu de
qu'il en soit, cela
n’avait plus rien à voir avec cette «capacité
que possède l’individu de se sacrifier pour la communauté; pour
ses semblables” [Hitler]
conçoit cet “idéalisme” comme la plus haute forme d’obéissance
de l’animal aux lois de la nature, une force que seul l’Aryen est
capable d’assumer…».123
Wiskemann
explique ainsi le lien Nietzsche/Hitler : «L’influence
extérieure qui agit le plus fortement sur Hitler avait été cette
doctrine de Nietzsche, où la puissance et la lutte pour la
puissance, qui signifiait le piétinage des faibles, étaient les
valeurs dernières. Nietzsche avait condamné à la fois le
christianisme et les idées de la première révolution française
comme étant le triomphe d’une mentalité d’esclaves, contre
laquelle il exhortait tous les esprits supérieurs à se révolter;
ceux-ci devaient créer un code nouveau, celui des hommes forts, dont
la base devait être la fermeté impitoyable. “Une race dominante
ne peut s’élever qu’au milieu de  conditions violentes et
terribles. Problème : où sont les barbares du vingtième siècle?
Évidemment ils n’émergeront et ne se consolideront qu’après de
terrifiants bouleversements sociaux”. Mais les rêves de Nietzsche
étaient venus à celui-ci quand il était professeur d’études
classiques dans l’atmosphère humaniste de Bâle; c’étaient des
rêves homériques de héros magnanimes qui savaient prendre des risques, et Nietzsche s’était querellé avec Wagner pour les
monstrueuses conceptions de celui-ci. L’année même de la
naissance de Hitler, Nietzsche devint fou d’une façon permanente,
et il vint irrésistiblement à l’idée que l’hitlérisme est une
forme de la folie de Nietzsche. En lisant Nietzsche, il est évident
que Hitler y a cueilli ce qu’il aimait et ce qu’il croyait
comprendre. Loin de s’échapper d’une époque de
petites-classes-moyennes et de mécanique, la caste de maîtres de
Hitler devait être bâtie sans prendre de risques. Nombre
d’écrivains allemands, du genre Treitschke et Ludendorff, avaient
travaillé à établir une doctrine, non pas de fermeté impitoyable
seule, mais de fermeté impitoyable totale et mécanique; leurs
efforts arrivèrent à culminer dans le
petit bourgeois Hitler
avec son amour des machines et sa théorie de l’économie des
forces».124
Ce rapport Nietzsche/Hitler
était
tout ce qu’il y avait
de plus relatif et ressemblait
à ce qu’a pu être celui
conditions violentes et
terribles. Problème : où sont les barbares du vingtième siècle?
Évidemment ils n’émergeront et ne se consolideront qu’après de
terrifiants bouleversements sociaux”. Mais les rêves de Nietzsche
étaient venus à celui-ci quand il était professeur d’études
classiques dans l’atmosphère humaniste de Bâle; c’étaient des
rêves homériques de héros magnanimes qui savaient prendre des risques, et Nietzsche s’était querellé avec Wagner pour les
monstrueuses conceptions de celui-ci. L’année même de la
naissance de Hitler, Nietzsche devint fou d’une façon permanente,
et il vint irrésistiblement à l’idée que l’hitlérisme est une
forme de la folie de Nietzsche. En lisant Nietzsche, il est évident
que Hitler y a cueilli ce qu’il aimait et ce qu’il croyait
comprendre. Loin de s’échapper d’une époque de
petites-classes-moyennes et de mécanique, la caste de maîtres de
Hitler devait être bâtie sans prendre de risques. Nombre
d’écrivains allemands, du genre Treitschke et Ludendorff, avaient
travaillé à établir une doctrine, non pas de fermeté impitoyable
seule, mais de fermeté impitoyable totale et mécanique; leurs
efforts arrivèrent à culminer dans le
petit bourgeois Hitler
avec son amour des machines et sa théorie de l’économie des
forces».124
Ce rapport Nietzsche/Hitler
était
tout ce qu’il y avait
de plus relatif et ressemblait
à ce qu’a pu être celui  entre Marx et Staline. La rétroprojection
que le
nazisme effectua à travers l’œuvre de Nietzsche, phénomène
courant à l’époque, consistait à faire de lui un prophète
du
nazisme; à lui donner une racine acceptable, puisée dans la
réaction allemande à la modernité. L’esthétique kitsch
de la
Weltanschauung
fasciste
était un Imaginaire coloré de différentes provenances qui
relevaient d’un classicisme ampoulé : «Dans
la tradition encore, mais d’une tradition culturelle plutôt que
religieuse, relevaient d’autres éléments : emprunts aux
mythologies, grecque, latine, germanique, et surtout emprunts aux
grands courants du XIXe siècle. De la tradition romantique
dérivaient la figure du grand homme, développée ensuite par
l’historisme et propagée par le système scolaire, tout comme
celle du génie universel, le chef à la fois penseur, orateur,
artiste. Quelques éléments (mais ceci vaut surtout pour l’Italie)
étaient même empruntés à la tradition de gauche, notamment au
nationalisme mazzinien : figure du chef en éducateur du peuple, en
homme nouveau. Enfin, d’autres éléments dérivaient de la culture
irrationaliste fin-de-siècle : le chef magnétiseur ou hypnotiseur
qui plongeait la foule dans une hallucination ou une extase
collective».125
entre Marx et Staline. La rétroprojection
que le
nazisme effectua à travers l’œuvre de Nietzsche, phénomène
courant à l’époque, consistait à faire de lui un prophète
du
nazisme; à lui donner une racine acceptable, puisée dans la
réaction allemande à la modernité. L’esthétique kitsch
de la
Weltanschauung
fasciste
était un Imaginaire coloré de différentes provenances qui
relevaient d’un classicisme ampoulé : «Dans
la tradition encore, mais d’une tradition culturelle plutôt que
religieuse, relevaient d’autres éléments : emprunts aux
mythologies, grecque, latine, germanique, et surtout emprunts aux
grands courants du XIXe siècle. De la tradition romantique
dérivaient la figure du grand homme, développée ensuite par
l’historisme et propagée par le système scolaire, tout comme
celle du génie universel, le chef à la fois penseur, orateur,
artiste. Quelques éléments (mais ceci vaut surtout pour l’Italie)
étaient même empruntés à la tradition de gauche, notamment au
nationalisme mazzinien : figure du chef en éducateur du peuple, en
homme nouveau. Enfin, d’autres éléments dérivaient de la culture
irrationaliste fin-de-siècle : le chef magnétiseur ou hypnotiseur
qui plongeait la foule dans une hallucination ou une extase
collective».125 l’odieux traité de
Versailles. Maintenant, l’U.R.S.S. renaissait des cendres de
l’empire pétrovien. Dans leur esprit wagnérien, Hitler et ses
séides ne pouvaient voir là que l’appel d’une nouvelle épopée fondatrice, une bataille
impitoyable, qui
«se
conclura par le triomphe des “futurs seigneurs de la terre” : il
apparaîtra un type d’homme capable - en utilisant les mots du
philosophe rapportés par l’historien - de “supporter la cruauté
de la vision de tant de souffrance, d’extinction, de destruction”
: il sera “cruel” lui-même, “par la main et par l’action (et
pas seulement par les yeux de l’esprit)”, et il sera en état de
“causer de la douleur avec plaisir”. “Avec plusieurs années
d’avance, Nietzsche a fourni à l’antimarxisme politique radical
du fascisme son archétype spirituel, et on peut dire que Hitler
lui-même n’a jamais été tout à fait au niveau de cet archétype”
(Nolte)».126
En effet, «pour
Hitler, le surhomme, s’il signifiait pour lui autre chose que la
glorification de sa personne, signifiait le germain héroïque qui ne
doit reconnaître aucune loi des Habsbourgs, en lâchant la bride à
sa terrorisation du Slave et du Juif [La volonté de puissance : “À
la grandeur appartient la terrorisation; qu’on ne se laisse pas
marcher sur les pieds”]. L’effet produit par Nietzsche sur
Hitler fut d’autant plus direct que, si l’esprit du premier était
brillant et celui du second banal, ces hommes souffraient tous deux
de cette paranoïa,
(monomanie chronique des grandeurs orgueilleuses), qui semble
tragiquement fréquente en Allemagne».127
Comme
si tout,
dans l’Imaginaire allemand,
ne pouvait atteindre que
des proportions au
gigantisme.
l’odieux traité de
Versailles. Maintenant, l’U.R.S.S. renaissait des cendres de
l’empire pétrovien. Dans leur esprit wagnérien, Hitler et ses
séides ne pouvaient voir là que l’appel d’une nouvelle épopée fondatrice, une bataille
impitoyable, qui
«se
conclura par le triomphe des “futurs seigneurs de la terre” : il
apparaîtra un type d’homme capable - en utilisant les mots du
philosophe rapportés par l’historien - de “supporter la cruauté
de la vision de tant de souffrance, d’extinction, de destruction”
: il sera “cruel” lui-même, “par la main et par l’action (et
pas seulement par les yeux de l’esprit)”, et il sera en état de
“causer de la douleur avec plaisir”. “Avec plusieurs années
d’avance, Nietzsche a fourni à l’antimarxisme politique radical
du fascisme son archétype spirituel, et on peut dire que Hitler
lui-même n’a jamais été tout à fait au niveau de cet archétype”
(Nolte)».126
En effet, «pour
Hitler, le surhomme, s’il signifiait pour lui autre chose que la
glorification de sa personne, signifiait le germain héroïque qui ne
doit reconnaître aucune loi des Habsbourgs, en lâchant la bride à
sa terrorisation du Slave et du Juif [La volonté de puissance : “À
la grandeur appartient la terrorisation; qu’on ne se laisse pas
marcher sur les pieds”]. L’effet produit par Nietzsche sur
Hitler fut d’autant plus direct que, si l’esprit du premier était
brillant et celui du second banal, ces hommes souffraient tous deux
de cette paranoïa,
(monomanie chronique des grandeurs orgueilleuses), qui semble
tragiquement fréquente en Allemagne».127
Comme
si tout,
dans l’Imaginaire allemand,
ne pouvait atteindre que
des proportions au
gigantisme. Chaque
dictateur veut se présenter comme le surhomme annoncé. Sa présence
est divine plus qu’impériale. Il n’y a plus qu’une seule
pensée, celle du surhomme; plus qu’un seul goût; celui du
surhomme : «Les
étudiants allemands, symboliquement contingentés, n’auront plus
le droit de décorer leurs uniformes des couleurs qui, jadis,
doraient leur prestige. Toutes les distinctions n’appartiennent-elles
pas désormais au seul
volk? Même
l’élite du régime nouveau devra se plier, comme le mitron ou le
SA, aux fastes et aux ridicules du jour. L’ambassadeur saluera d’un
Heil Hitler
comme le concierge, Gœbbels comme Göring feront ostensiblement la
quête pour les besoins croissants du “Secours d’hiver”. De
l’autre côté des Alpes, un scénario identique impose aux
vedettes les mêmes courbettes qu’au quidam. Ciano, comme tout
Italien, reste debout en la
Chaque
dictateur veut se présenter comme le surhomme annoncé. Sa présence
est divine plus qu’impériale. Il n’y a plus qu’une seule
pensée, celle du surhomme; plus qu’un seul goût; celui du
surhomme : «Les
étudiants allemands, symboliquement contingentés, n’auront plus
le droit de décorer leurs uniformes des couleurs qui, jadis,
doraient leur prestige. Toutes les distinctions n’appartiennent-elles
pas désormais au seul
volk? Même
l’élite du régime nouveau devra se plier, comme le mitron ou le
SA, aux fastes et aux ridicules du jour. L’ambassadeur saluera d’un
Heil Hitler
comme le concierge, Gœbbels comme Göring feront ostensiblement la
quête pour les besoins croissants du “Secours d’hiver”. De
l’autre côté des Alpes, un scénario identique impose aux
vedettes les mêmes courbettes qu’au quidam. Ciano, comme tout
Italien, reste debout en la  présence du Duce…».128
La surhumanité pourrait se ramener à la seule ethnie aryenne (même
pas la latine de son allié italien). Dans Mein
Kampf, Hitler
écrivait : «L’Aryen
est le Prométhée du genre humain; l’étincelle divine du génie a
de tout temps jailli de son front lumineux; il a toujours allumé à
nouveau ce feu qui, sous la forme de la connaissance, éclairait la
nuit… Conquérant, il soumit les hommes de race inférieure et
ordonna leur activité pratique sous son commandement, suivant sa
volonté et conformément à ses buts. Mais, en leur imposant une
activité utile, bien que pénible, il n’épargna pas seulement la
vie de ses sujets; il leur fit peut-être même un sort meilleur que
celui qui
présence du Duce…».128
La surhumanité pourrait se ramener à la seule ethnie aryenne (même
pas la latine de son allié italien). Dans Mein
Kampf, Hitler
écrivait : «L’Aryen
est le Prométhée du genre humain; l’étincelle divine du génie a
de tout temps jailli de son front lumineux; il a toujours allumé à
nouveau ce feu qui, sous la forme de la connaissance, éclairait la
nuit… Conquérant, il soumit les hommes de race inférieure et
ordonna leur activité pratique sous son commandement, suivant sa
volonté et conformément à ses buts. Mais, en leur imposant une
activité utile, bien que pénible, il n’épargna pas seulement la
vie de ses sujets; il leur fit peut-être même un sort meilleur que
celui qui  leur était dévolu, lorsqu’ils jouissaient de ce qu’on
appelle leur ancienne “liberté”. Tant qu’il maintint
rigoureusement sa situation morale de maître, il resta non seulement
le maître, mais aussi le conservateur de la civilisation qu’il
continua à développer… Si l’on répartissait l’humanité en
trois espèces : celle qui a créé la civilisation, celle qui en a
conservé le dépôt et celle qui l’a détruit, il n’y aurait que
l’Aryen qu’on pût citer comme représentant de la première…
Si on le faisait disparaître, une profonde obscurité descendrait
sur la terre; en quelques siècles, la civilisation humaine
s’évanouirait et le monde deviendrait un désert».129
Ceci pourrait facilement être pris pour le passage d’amour/haine
envers l’Allemagne telle qu’on la trouve dans le jugement de
Nietzsche. Nietzsche, rappelons-le, voyait dans le crâne
dur des
Allemands un peuple médiocre mais qui pourrait, poussé par la
volonté de puissance, devenir le premier de l’échelle ontologique
des peuples occidentaux. Mais Hitler préférait distinguer
les
Aryens «authentiques»
des
Germains
qui ont été métissés
par l’afflux de peuples divers : Slaves, Juifs, Hongrois… et
qu’il faut purger de ses mauvais éléments. C’est en ce sens que
le racisme devenait une pierre angulaire de tout le système
idéologique.
leur était dévolu, lorsqu’ils jouissaient de ce qu’on
appelle leur ancienne “liberté”. Tant qu’il maintint
rigoureusement sa situation morale de maître, il resta non seulement
le maître, mais aussi le conservateur de la civilisation qu’il
continua à développer… Si l’on répartissait l’humanité en
trois espèces : celle qui a créé la civilisation, celle qui en a
conservé le dépôt et celle qui l’a détruit, il n’y aurait que
l’Aryen qu’on pût citer comme représentant de la première…
Si on le faisait disparaître, une profonde obscurité descendrait
sur la terre; en quelques siècles, la civilisation humaine
s’évanouirait et le monde deviendrait un désert».129
Ceci pourrait facilement être pris pour le passage d’amour/haine
envers l’Allemagne telle qu’on la trouve dans le jugement de
Nietzsche. Nietzsche, rappelons-le, voyait dans le crâne
dur des
Allemands un peuple médiocre mais qui pourrait, poussé par la
volonté de puissance, devenir le premier de l’échelle ontologique
des peuples occidentaux. Mais Hitler préférait distinguer
les
Aryens «authentiques»
des
Germains
qui ont été métissés
par l’afflux de peuples divers : Slaves, Juifs, Hongrois… et
qu’il faut purger de ses mauvais éléments. C’est en ce sens que
le racisme devenait une pierre angulaire de tout le système
idéologique. «Fondamentalement,
les SS estimaient que les Juifs qui arrivaient dans les camps
cessaient de vivre au moment précis où ils descendaient du train.
Ils mettaient en scène des parodies de mariage et autres amusements,
convaincus qu’ils étaient que les objets de leurs divertissements
passeraient sous peu à la chambre à gaz. À Treblinka, ils
montèrent un orchestre de détenus qui jouait un chant propre au
camp, composé par le chef d’orchestre juif
«Fondamentalement,
les SS estimaient que les Juifs qui arrivaient dans les camps
cessaient de vivre au moment précis où ils descendaient du train.
Ils mettaient en scène des parodies de mariage et autres amusements,
convaincus qu’ils étaient que les objets de leurs divertissements
passeraient sous peu à la chambre à gaz. À Treblinka, ils
montèrent un orchestre de détenus qui jouait un chant propre au
camp, composé par le chef d’orchestre juif  [Artur Gold] sur des paroles de
l’Untersturmführer Franz, exaltant le travail, le destin et
l’obéissance. Leur psychologie est symbolisée par l’histoire
d’un chien, Barry*, à propos duquel un tribunal ouest-allemand
rédigea plusieurs pages. Barry était un énorme saint-bernard qu’on
vit d’abord à Sobibór, ensuite à Treblinka. Il avait été
dressé à mutiler les détenus au simple commandement : “Homme,
attaque ce chien! (Mensch,
fasst den Hund!)».131
Voilà comment
les S.S. apparaissaient
surhumains : en abaissant les détenus
en
[Artur Gold] sur des paroles de
l’Untersturmführer Franz, exaltant le travail, le destin et
l’obéissance. Leur psychologie est symbolisée par l’histoire
d’un chien, Barry*, à propos duquel un tribunal ouest-allemand
rédigea plusieurs pages. Barry était un énorme saint-bernard qu’on
vit d’abord à Sobibór, ensuite à Treblinka. Il avait été
dressé à mutiler les détenus au simple commandement : “Homme,
attaque ce chien! (Mensch,
fasst den Hund!)».131
Voilà comment
les S.S. apparaissaient
surhumains : en abaissant les détenus
en  sous-humanité.
Mais
ce privilège leur coûtait cher :
«Ce que
l’on exigeait du candidat SS était bien au-dessus de la moyenne :
il devait mesurer au moins 1,80 m (plus tard, cette exigence ne fut
plus qu’un idéal, et, pendant la guerre, on s’en écarta au
point d’admettre jusqu’aux éclopés de la migration des peuples
et jusqu’à des Indiens mangeurs de racines qui n’avaient plus le
moindre rapport avec l’image du héros germanique); son arbre
généalogique devait pouvoir être suivi jusqu’en 1750 et être de
pur sang allemand; son caractère - au sens national-socialiste -
devait être incontestable. Ce n’était pas le nombre qui importait
à Himmler. En 1929, la SS ne comptait que 250 hommes, et ils
formaient la garde noire de Hitler. En 1930, il n’y avait que 2 000
hommes, un an plus tard 10 000, et, à la veille de la prise du
pouvoir 30 000. C’était la SA qui formait la masse des troupes de
choc du national-socialisme».132
Entendons-nous que si le S.S. était le surhomme du stalag, il
demeurait un Aryen obéissant aux ordres supérieurs,
seule condition pour rester
membre de
la surhumanité nazie. Et leur chef, «Himmler
aurait déclaré que ce qu’il attendait désormais de ces hommes
était “surhumain-inhumain (er
mute ihnen Übermenschlich-Unmenschliches zu)”».133
Déclaration adressée au personnel des camps de Belzec, Sobibór et
Treblinka.
sous-humanité.
Mais
ce privilège leur coûtait cher :
«Ce que
l’on exigeait du candidat SS était bien au-dessus de la moyenne :
il devait mesurer au moins 1,80 m (plus tard, cette exigence ne fut
plus qu’un idéal, et, pendant la guerre, on s’en écarta au
point d’admettre jusqu’aux éclopés de la migration des peuples
et jusqu’à des Indiens mangeurs de racines qui n’avaient plus le
moindre rapport avec l’image du héros germanique); son arbre
généalogique devait pouvoir être suivi jusqu’en 1750 et être de
pur sang allemand; son caractère - au sens national-socialiste -
devait être incontestable. Ce n’était pas le nombre qui importait
à Himmler. En 1929, la SS ne comptait que 250 hommes, et ils
formaient la garde noire de Hitler. En 1930, il n’y avait que 2 000
hommes, un an plus tard 10 000, et, à la veille de la prise du
pouvoir 30 000. C’était la SA qui formait la masse des troupes de
choc du national-socialisme».132
Entendons-nous que si le S.S. était le surhomme du stalag, il
demeurait un Aryen obéissant aux ordres supérieurs,
seule condition pour rester
membre de
la surhumanité nazie. Et leur chef, «Himmler
aurait déclaré que ce qu’il attendait désormais de ces hommes
était “surhumain-inhumain (er
mute ihnen Übermenschlich-Unmenschliches zu)”».133
Déclaration adressée au personnel des camps de Belzec, Sobibór et
Treblinka. Mais
la férocité de Hitler se
limitait plutôt à des vociférations sans suites.
Au cours d’un magnifique déjeuner tenu le 22 août 1939, au moment
de lancer l’offensive contre la Pologne et qui devait déclencher
la Seconde Guerre mondiale, Hitler déclarait à ses généraux :
«Je
donnerai une raison de propagande pour lancer la guerre, que cette
raison soit ou non plausible. On ne demandera pas plus tard au
vainqueur s’il a bien dit la vérité… Fermez vos cœurs à la
pitié. Agissez brutalement… C’est le plus fort qui a raison.
Soyez le plus possible impitoyables».134
Une autre version entre davantage dans les détails : «D’après
la version extrême citée par Gisevus, Hitler avait dit le 22 août
en parlant à ses commandants en chef) que si, cette fois, un
médiateur quelconque intervenait : “Il jetterait personnellement
ce
Schweinehund
(chien de cochon) sur les marches de l’escalier, même s’il
devait le frapper à coups de pied dans le ventre en présence des
Mais
la férocité de Hitler se
limitait plutôt à des vociférations sans suites.
Au cours d’un magnifique déjeuner tenu le 22 août 1939, au moment
de lancer l’offensive contre la Pologne et qui devait déclencher
la Seconde Guerre mondiale, Hitler déclarait à ses généraux :
«Je
donnerai une raison de propagande pour lancer la guerre, que cette
raison soit ou non plausible. On ne demandera pas plus tard au
vainqueur s’il a bien dit la vérité… Fermez vos cœurs à la
pitié. Agissez brutalement… C’est le plus fort qui a raison.
Soyez le plus possible impitoyables».134
Une autre version entre davantage dans les détails : «D’après
la version extrême citée par Gisevus, Hitler avait dit le 22 août
en parlant à ses commandants en chef) que si, cette fois, un
médiateur quelconque intervenait : “Il jetterait personnellement
ce
Schweinehund
(chien de cochon) sur les marches de l’escalier, même s’il
devait le frapper à coups de pied dans le ventre en présence des
 photographes”. Ce médiateur avait déjà été, en 1938, “son
ami Mussolini”, le seul être qu’il consentait à reconnaître
comme le Surhomme numéro deux, et sur lequel il comptait pour
combattre en Italie les influences royales et autres. (Certainement
le Duce lui offrait toujours sa médiation dans des circonstances
extraordinairement favorables). Dans la folie de la personnalité double de Hitler, la partie héroïque et la partie démoniaque se
trouvaient réunies en une seule et même personne. Car il n’y a de
cela aucun doute, les conditions mentales de Hitler en été 1939
étaient de celles que le simple langage appelle folie».135
Or, ce Schweinehund
se
présenta en la personne d’un ami personnel du second du régime,
Herman Göring, un industriel suédois, Birger Dahlerus, qui, le 3
septembre, se mit à courir les chancelleries de Londres et de Berlin
en vue d’en venir à une entente entre l’Axe et les alliés. Pris
de l’une de ces crises d’hystérie dont il avait l’habitude,
Hitler
s’en prit à Dahlerus mais sans le frapper, comme
il s'en était vanté plus tôt :
«affirmant
qu’il est désormais décidé à écraser la résistance polonaise
et la
photographes”. Ce médiateur avait déjà été, en 1938, “son
ami Mussolini”, le seul être qu’il consentait à reconnaître
comme le Surhomme numéro deux, et sur lequel il comptait pour
combattre en Italie les influences royales et autres. (Certainement
le Duce lui offrait toujours sa médiation dans des circonstances
extraordinairement favorables). Dans la folie de la personnalité double de Hitler, la partie héroïque et la partie démoniaque se
trouvaient réunies en une seule et même personne. Car il n’y a de
cela aucun doute, les conditions mentales de Hitler en été 1939
étaient de celles que le simple langage appelle folie».135
Or, ce Schweinehund
se
présenta en la personne d’un ami personnel du second du régime,
Herman Göring, un industriel suédois, Birger Dahlerus, qui, le 3
septembre, se mit à courir les chancelleries de Londres et de Berlin
en vue d’en venir à une entente entre l’Axe et les alliés. Pris
de l’une de ces crises d’hystérie dont il avait l’habitude,
Hitler
s’en prit à Dahlerus mais sans le frapper, comme
il s'en était vanté plus tôt :
«affirmant
qu’il est désormais décidé à écraser la résistance polonaise
et la  Pologne entière. “Et, vocifère-t-il, si les Anglais ne
comprennent pas que c’est leur intérêt d’éviter de se battre
avec moi, ils le regretteront toute leur vie”. Le visage empourpré
et les yeux fixant le vide, Hitler commence à faire des moulinets
avec ses bras comme un dément. Il crie à la face du Suédois :
“Si l’Angleterre veut se battre pendant un an, je combattrai
pendant un an. Si l’Angleterre veut se battre pendant deux ans, je
combattrai pendant deux ans.” Puis, après avoir semblé chercher
ses mots : “Si l’Angleterre veut se battre pendant
trois ans, je combattrai pendant trois ans”. La voix du Führer
n’est plus qu’un long cri aigu. Ses bras continuent à tournoyer.
Son visage est bouleversé par la haine. Tout son corps vibre de
convulsions quand il hurle : (Et s’il le faut, je combattrai
pendant dix ans). Plié en deux par la rage, Hitler martèle le
plancher de ses poings fermés».136
C’est ainsi que, martelant la Terre de
ses poings,
le Führer lui
faisait outrage,
trahissant
l'annonce
de l'évangile de Zarathoustra;
de Nietzsche⌛
Pologne entière. “Et, vocifère-t-il, si les Anglais ne
comprennent pas que c’est leur intérêt d’éviter de se battre
avec moi, ils le regretteront toute leur vie”. Le visage empourpré
et les yeux fixant le vide, Hitler commence à faire des moulinets
avec ses bras comme un dément. Il crie à la face du Suédois :
“Si l’Angleterre veut se battre pendant un an, je combattrai
pendant un an. Si l’Angleterre veut se battre pendant deux ans, je
combattrai pendant deux ans.” Puis, après avoir semblé chercher
ses mots : “Si l’Angleterre veut se battre pendant
trois ans, je combattrai pendant trois ans”. La voix du Führer
n’est plus qu’un long cri aigu. Ses bras continuent à tournoyer.
Son visage est bouleversé par la haine. Tout son corps vibre de
convulsions quand il hurle : (Et s’il le faut, je combattrai
pendant dix ans). Plié en deux par la rage, Hitler martèle le
plancher de ses poings fermés».136
C’est ainsi que, martelant la Terre de
ses poings,
le Führer lui
faisait outrage,
trahissant
l'annonce
de l'évangile de Zarathoustra;
de Nietzsche⌛1 S. Tchakhotine. Le viol des foules par la propagande politique, Paris, Gallimard, Col. 1952, p. 565.






























































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire