 |
Drame humanisto-universitaire. Entarté dans une librairie.
|
POURQUOI LE PETIT BOCK-CÔTÉ S'EST-IL LAISSÉ ENTARTER DANS UNE LIBRAIRIE?
L'universitaire
et chroniqueur journalistique Mathieu Bock-Côté a dû se rendre à
la décision d'un libraire du Plateau Mont-Royal d'annuler la
présentation publique de son dernier livre suite à des menaces
lancés sur les réseaux sociaux. On a dit, à tort ou à raison,
 |
| Xavier Camus, la némésis de Mathieu Bock-Côté. |
qu'il s'agissait du blogueur Xavier Camus, professeur de Cégep et
habitué de la tweetosphère. À l'occasion, le journal Le Soleil
de Québec a rappelé qu'en 2017, Bock-Côté s'était fait
entarter dans une librairie de Québec dans une situation analogue.
Preuve qu'on accorde beaucoup (trop) d'importance à ce que dit ou
écrit ce personnage qui maintenant répand son opinion dans le
journal de droite, Le Figaro. Je pense qu'il est temps, en
effet, qu'on rase le client de près.
J'avais
pensé, au départ, intitulé ce texte : POURQUOI JE DÉTESTE
BOCK-CÔTÉ? En fait, que j'aime ou je déteste le personnage est
sans intérêt aucun. Ce qui est pertinent, par contre, c'est exposer
comment il pense ce qu'il écrit; comment ce qu'il écrit est une
subversion de la critique historique en idéologie toxique pour la
conscience, même nationale, des Québécois, et comment, finalement,
il contribue à ce que son utopie conservatrice du Québec
indépendant devient un obstacle à réaliser même cette
indépendance. Pervers et subversif, Mathieu Bock-Côté? Derrière
sa verbomotricité vide mais drôlatique qui rappelle l'ancien maire
Jean Doré; malgré sa bouille caricaturale des studios
radiophoniques et des plateaux de télé? Eh oui! Celui qui paraît
le plus batailleur des Québécois est celui qui encourage la velléité
de ceux-ci à procrastiner sur la glose de la gnose et la gnose de la
glose pour finir par cultiver le quant à soi des Québécois qui est
la source d'un grand nombre de leurs malheurs.
 |
| En tant que galle de Pierre-Karl Péladeau. |
Par une circonstance imprévue de ma
part, voilà notre animal qui publie dans sa chronique portée par la
léproserie de Péladeau sa philosophie de l'histoire du Québec.
Quel beau cadeau d'anniversaire
il me fait! Dieu est bon pour moi et je l'en remercie les bras en
croix. Pour être honnête envers mes lecteurs, je la transmets à sa
connaissance pour ceux qui ne seraient pas abonnés à la feuille de
chou du Journal de Montréal.
L’histoire
du Québec semble traversée par deux trames contradictoires. Il vaut
la peine de méditer sur les grandes aspirations qu’elles
canalisent pour voir comment elles travaillent encore notre présent,
quoi qu’en pensent ceux qui ont une conception autoréférentielle
de l’actualité, comme si cette dernière était à elle-même son
propre contexte. L’histoire, rappelons-le, est une formidable école
pour s’éduquer politiquement. Bien comprise, elle permet aussi de
comprendre ce qu’on pourrait appeler la psychologie politique d’une
nation, ou du moins, les grands schèmes qui structurent son
imaginaire collectif.
D’un
côté, il est parfaitement possible de repérer dans l’histoire de
notre peuple une aspiration jamais démentie à la pleine existence
nationale, dont le débouché le plus naturel serait l’indépendance,
mais que certains ont préféré traduire par une aspiration à la
refondation d’un Canada binational, ou encore, par la
reconnaissance du Québec comme société distincte dans la
fédération. L’aspiration à une refondation nationale permettant
aux Québécois d’être enfin reconnus comme une nation à part
entière, ne cesse de renaître dans notre histoire, même après les
pires défaites. On a pu dire que les Québécois sont plus doués
pour la survivance que pour l’indépendance. Il y a du vrai dans
cette affirmation, mais à condition de la nuancer considérablement.
Les Québécois ont toujours survécu dans l’espoir secret d’une
renaissance, d’une prochaine étape, qui leur permettrait de se
reprendre en main. Tel est le moteur de la fierté québécoise, qui
s’est exprimée par certains slogans politiques dans notre
histoire, comme «maîtres chez nous» ou «on est capables». Mais
j’y reviens: le jour où nous proclamerons notre indépendance,
rien ne nous aura jamais paru aussi évident et nous nous demanderons
pourquoi nous avons tant tardé à y accéder.
De
l’autre, depuis la Conquête, on peut aussi repérer un sentiment
contradictoire, qu’a déjà analysé avec une grande subtilité
Jean Bouthillette dans son remarquable essai Le Canadien-français et
son double: il s’agit de la tentation d’en finir avec soi, de se
délivrer d’une culture jugée trop lourde à porter, qui nous
enfermerait dans une vie provinciale et nous empêchant d’embrasser
pleinement l’expérience américaine. Bouthillette parlait plus
précisément de la tentation de la mort, comme si nous portions en
nous le désir de nous effacer et de cesser de poursuivre une
histoire qui serait fondamentalement vaine. Dès lors, les plus
radicaux rêvent ouvertement à notre assimilation à l’empire
nord-américain, alors que d’autres, certainement les plus nombreux
de cette tendance, sans renier explicitement leur identité
québécoise, en proposent la définition la plus minimaliste
possible, et veulent en tirer le moins de conséquences politiques
possibles. Ils rêvent alors d’un Québec où le français vivrait
encore mais ne viendrait plus entraver notre conversion réaliste aux
paramètres généralement admis de l’identité nord-américaine. À
gauche, cette aspiration prend la forme d’un cosmopolitisme radical
alors qu’à droite, elle prend plutôt le visage d’une
fascination quasi-morbide pour l’anglais et les États-Unis.
Mais
néanmoins, la première tendance est la plus forte des deux. Au fond
d’eux-mêmes, les Québécois veulent vivre. Leur histoire est
celle d’une résistance admirable et d’un long effort pour
construire ici une société de langue et de culture françaises, où
notre identité fonderait la vie collective, et ne serait pas
optionnelle chez elle. Deux siècles et demi après une défaite qui
aurait dû nous condamner à la disparition, nous sommes toujours là.
Et c’est dans cette perspective qu’on doit comprendre l’appui
massif et manifestement inébranlable de la majorité historique
francophone au projet de laïcité du gouvernement Legault. Certains
soutiennent que la laïcité en elle-même n’est pas nécessairement
identitaire, que c’est un principe universel. Certes. Mais il faut
comprendre que les Québécois investissement la laïcité d’une
charge identitaire dans la mesure où ils en font aujourd’hui le
symbole d’une réaffirmation politique de la majorité historique
francophone, qui se pose désormais comme culture de convergence,
pour reprendre ce concept au cœur de la pensée politique
québécoise. C’est à travers la laïcité qu’on entend refaire
de la culture du pays et des mœurs qui y sont associées la norme de
l’existence commune. De même, à travers la laïcité, les
Québécois réaffirment leur droit d’affirmer leur propre modèle
d’intégration, en s’arrachant aux paramètres idéologiques et
juridiques du multiculturalisme canadien. Après quinze ans de
canadianisation forcée de notre vie collective, nous redécouvrons
peu à peu la capacité à la penser dans nos propres paramètres.
En un mot,
à travers le combat pour la laïcité, les Québécois recommencent
à agir comme peuple. Ils recommencent à vouloir collectivement
affirmer leur identité. Ils se réinscrivent dans l’histoire. Ils
réapprennent à résister aux discours intimidants qui assimilent la
moindre velléité d’affirmation collective à une forme de
suprémacisme ethnique. Ils renouent avec l’idée d’autonomie.
Ils pourraient, à terme, retrouver le goût de l’indépendance.
Mathieu Bock-Côté,
27 avril 2019,
Journal de Montréal.
Voici l'opinion de Bock-Côté, nous allons maintenant déconstruire tout ça.
 |
| Philippulus, le mauvais prophète. |
D'abord,
Bock-Côté prétend se servir de la connaissance historique comme
"laboratoire de sciences humaines", et plus spécifiquement
de sciences politiques, comme on disait autrefois. Machiavel a été
l'un des premiers à penser créer une science politique positive en
l'appuyant sur l'histoire, à travers des ouvrages comme Le Prince
et son Discours sur la première décade de Tite-Live. Or,
malgré la Realpolitik, les leçons politiques qu'on peut
tirer de la connaissance historique sont de peu d'effets. La
malédiction de Cassandre persiste. Les prophètes ne sont pas
entendus. Tout historien consciencieux dira à ses élèves qu'il n'y
a pire subversion de leur métier que prétendre jouer aux prophètes.
Aussi, s'il était possible d'utiliser l'historiographie comme un
livre de recettes de Ricardo, la paix et l'ordre sur terre seraient
choses faites depuis longtemps. Soyons plus modeste et considérons
que la connaissance de l'histoire fournit à peine une science morale,
un savoir sur les conduites et les comportements collectifs, en
matière politique comme en matière économique tout aussi bien que
culturelle. Et comme pour tous, il y a de mauvais élèves et de
bons. Bock-Côté est visiblement un mauvais, son prophétisme ne
reflète donc pas le continuum de tendances de fond de l'histoire
des Québécois.
 |
| C. W. Jefferys. Britanniques et Canadiens chargeantle régiment d'Arnold, Sault-au-Matelot. | | |
|
Notre
prophète nous dit repérer "dans l’histoire de notre
peuple une aspiration jamais démentie à la pleine existence
nationale, dont le débouché le plus naturel serait l’indépendance,
mais que certains ont préféré traduire par une aspiration à la
refondation d’un Canada binational, ou encore, par la
reconnaissance du Québec comme société distincte dans la
fédération". Tout cela est très très récent dans
l'histoire du Québec et ne saurait se mériter la qualification
idéologique d'aspiration jamais démentie. Cette aspiration à
"la pleine existence nationale" est une projection
plus qu'une réalité diachronique. Rappelons les faits, puisque
l'histoire ce sont avant tout des faits avant les théories, qu'une
fois la Conquête achevée (1763), les fils de la Nouvelle-France ont
eu à choisir entre se rallier aux rebelles américains ou restés
colonie de l'Angleterre. Ils ont choisi la seconde, plutôt qu'une
indépendance parallèle avec les colonies. Si tel avait été leur
choix, ils auraient appartenu à la Confédération des États-Unis,
entre 1783 et 1789, institution étatique très décentralisée, et
ils auraient pu très bien faire comme certaines colonies durant un
certains temps, refuser de se rallier à la nouvelle entité et
restés indépendants dans un Canada alors fort minoritairement
anglo-saxon. Certes, ils ne pouvaient prévoir ce que seraient les
lendemains de l'indépendance américaine, si pour autant la
rébellion sortait triomphale de la guerre. Nous naviguons en pleine
uchronie, mais cela nous permet de voir que l'affirmation de
Bock-Côté est fausse pour l'époque. Plutôt, une peur s'est
installée en 1775, au moment de l'invasion américaine du territoire
québécois ou canadien dans les termes de l'époque. Une peur et une
omertá se
sont imposées. La peur de la puissance britannique sur les colons
canadiens et l'omertá de la critique du régime colonial. Peur de subir le sort des Acadiens de 1755 par exemple,
s'ils montraient des velléités de support aux rebelles américains
ou de trahison du serment de 1760 comme rupture de la parole donnée
et proscrite par l'Église. La peur est bien devenue un caractère
psychologique structurel de la population à partir de ce moment-là.
Le refus de l'association avec les rebelles laissait percevoir un
double risque : d'abord la vengeance du conquérant survenant une
défaite du projet américain; ensuite de l'agressivité des
Américains dont le schéma de la Louisiane est venu, a
posteriori, confirmer les inquiétudes d'une association trop
étroite avec l'Union américaine. L'option nationale ne faisait donc
pas partie des choix de 1773 et pas plus de 1791.
 |
| Caldwell's Manor, lieu ou fut lue la Déclaration d'Indépendance du Bas-Canada. |
Elle tirait de l'aile encore en 1837-1838, puisque le Bas-Canada a d'abord pensé
en termes de fière colonie britannique avec les 92 Résolutions et
les Patriotes se sont résolus à attendre de passer seulement à
l'extrême limite de la défaite pour proclamer, par deux fois la
même année (1838), l'Indépendance avant de prendre la poudre d'escampette
vers le New York. Le geste était beau, symbolique mais inopérant.
Les anciens patriotes, par après, ont opté pour la fondation du
Canada binational de l'Union de 1840, auquel se sont ajoutés huit
autres provinces avec le siècle, et cela n'a pas changé depuis.
Donc, une seule tendance de fond demeure, l'impuissance à poser un
geste d'affirmation nationale. La velléité politique confine à la solution
canadienne, l'aspiration nationale submerge sous la structure
psychologique de la peur, n'émergeant que dans le courant des années
1960. Il ne faut donc pas projeter le Québec des 50 dernières
années sur les 200 autres précédentes. C'est une déformation de
perspective historique qui conduit à mal interpréter la situation
actuelle.
 |
| Congrès eucharistique de Montréal 1910. |
Le thème de la survivance est apparue aux lendemains des Troubles de 37-38. Il a été le produit de la Sainte-Église catholique et romaine qui projetait sur l'ensemble de la population québécoise sa propre fièvre obsidionale d'être assiégée par la modernité et l'anticléricalisme. Survivre, c'était d'abord la survivance catholique plus que nationale, à tel point qu'il a fallu l'épiderme sensible de Henri Bourassa pour rappeler à Mgr Bourne, l'Irlandais parvenu, qui dans un discours au parc Sohmer de Montréal, nous disait que nous devions survivre pour notre foi catholique au détriment, s'il le fallait, de notre langue française. Bourassa l'a rabroué publiquement, devant les autres monseigneurs un peu gênés. Donc, l'idée d'une survivance "dans l'espoir secret d'une renaissance, d'une prochaine étape, qui lui permettrait de se reprendre en main", n'est conforme en rien à notre histoire. Le premier espoir des Canadiens consistait à voir revenir les Français, profiter cette fois d'une bonne donne de la guerre, pour reprendre la colonie aux Anglais, comme en 1632. L'exécution de Louis XVI en 1793 et le refus de La Fayette d'étendre la guerre d'indépendance au Canada ont vidé ce moule d'espérances. En s'insérant dans le néo-gothique médiéval de l'Église catholique d'Amérique du Nord, toute idée de renaissance s'évanouissait, au point qu'il a fallu attendre les années 1960 pour voir le slogan Maître chez nous! (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B195tjojRBFyMzV5bnQ5aWZnYWs) exprimer un peu plus qu'une vulgaire campagne électorale. "Tel est le moteur de la fierté québécoise". Les résultats référendaires de 1980 et de 1995 ont plutôt montré que, malgré le vent printanier soufflé sur la province en 1960, la peur restait bien le véritable moteur de la psychologie collective des Québécois. On le voit encore présentement avec la crise de la laïcité. Il est particulièrement pervers de ventiler une espérance quand les esprits sont toujours prisonniers d'une chape culturelle qui leur rappelle qu'ils sont toujours nés pour un petit pain, et qu'un Québécois ne peut pas aller plus haut que la présidence de Québecor tandis qu'un franco-ontarien peut aller jusqu'à la tête de Gesca et de Power Corp. "le jour où nous proclamerons notre indépendance, rien ne nous aura jamais paru aussi évident et nous nous demanderons pourquoi nous avons tant tardé à y accéder". Et si cela est une marque de fierté, je me demande comment s'exprime la peur dans l'esprit de Bock-Côté? Ça ne doit pas être très beau à voir!

Passage obligé, Bock-Côté nous rappelle Jean Boutillette et son ouvrage Le Canadien français et son double. Ce qu'il rappelle de cet ouvrage se résume à cette quatrième de couverture que son ami libraire aime tant exhiber dans ses vidéos-youtubistes avant de s'envoler dans sa rhétorique nombriliste partagés par des gens qui s'ennuient de Tout le monde en parle hors saison. Bouthillette a pris dix ans pour écrire ce petit opuscule qui fait à peine 100 pages. Une introspection. Une crise de conscience individuelle autant que collective. L'épreuve de l'ordalie qui prenait chaque enfant, une fois qu'il terminait sa leçon d'histoire à la fin de la septième année de classe. Qu'est-ce qui se transmettait, inconsciemment, dans l'esprit de ces enfants et lui restait enraciné dans la tête pour le restant de ses jours? Quelle épreuve il a fallu à ceux-ci, dans les années 60, pour sortir de cette programmation psychologique et morale déprimante, qui les conduisait jusqu'alors à répéter inlassablement le même complexe d'échec et ce sentiment d'infériorité lorsqu'il se comparait aux autres peuples de la Terre! Peut-être, si Bock-Côté avait été moins nombriliste de sa petite personne; s'il avait eu une empathie sincère pour ces jeunes que nous étions, il aurait mieux compris les conséquences de cette thérapie que Bouthillette, en s'imposant à lui-même, partageait avec le reste de la population. Bouthillette est resté l'homme d'un seul livre alors que la logorrhée de Bock-Côté se transforme en autant de papiers brochés.
 |
| Centre d'achat, Plattsburg, N.Y. |
La tentation de la mort à laquelle fait référence Bock-Côté, c'est la haine de soi. La Selbsthaß des Juifs, dont parlait Theodor Lessing et qui est partagée par nombre de peuples colonisés. Cette Selbsthaß qui nous attachait à des souvenirs pleins de ruminations envers la France, mère indigne, qui avait abandonné sa progéniture le long du Saint-Laurent; volonté d'une bourgeoisie aliénée qui tenait à se rattacher à une culture classique morte depuis deux siècles en France même. Rejet mais envie aussi de l'Amérique anglo-saxonne à laquelle nous appartenions espace et temps. Cette expérience intérieure, visiblement, échappe à Bock-Côté. Qui sont ces radicaux qu'il suppose rêver ouvertement à notre assimilation à l'empire nord-américain? Elvis Gratton? On chercherait la radicalité chez Elvis Gratton qu'on ne la trouverait pas. Et cette majorité silencieuse qui sans renier explicitement leur identité québécoise, en proposent la définition la plus minimaliste possible tout en en tirant le moins de conséquences politiques possibles, qui, sinon que ces libéraux provinciaux qui ont voté "non" par deux fois au référendum sur la souveraineté du Québec, auxquels il faudrait bien ajouter leurs frères-ennemis du Parti Québécois qui ont fait de l'association la pierre ajustée au cou de la souveraineté lancée à l'eau. Enfin, ces Québec Solidaires qui misent sur le cosmopolitisme radical à côté de la jeunesse américanisée par l'anglais et les bébelles informatiques; d'une jeunesse superficielle et opportuniste qui n'est pas la première de notre histoire. De tout cela, Bock-Côté ne voit pas la mouvance dialectique. La gauche libérale de 1960 qui s'est opposée au nationalisme rance de l'Union Nationale en promettant aux Bob Gratton l'enrichissement à crédit si elle appuyait l'État-providence; la gauche péquiste de 1970 qui s'opposait à cette droite libérale qui préparait le Québec inc. avec les grands barrages de la Baie James; la gauche solidaire de 2020 qui s'oppose au nationalisme conservateur de Legault sans réaliser qu'elle se tire dans le pied en condamnant le projet de loi sur la laïcité au profit du Charkaouidistan. Jeune putain vieille dévote, toujours : le Parti Libéral du Québec, le Parti Québécois, Québec Solidaire. Si tout cela n'est pas la contamination de la Selbsthaß, de génération en génération, qu'est-ce que c'est? Et Bock-Côté de délirer : "Au fond d'eux-mêmes, les Québécois veulent vivre..." Si la chose était si évidente, comme il le suppose, pour le jour où le Québec deviendra indépendant, pourquoi sentir le besoin d'insister sur cette affirmation? Se cherche-t-il à se convaincre lui qui vit d'annoncer la disparition prochaine de ces Québécois?
 |
| X. Dolan. Mommy, suicide final sur air de chanson anglophone. |
Doit-on vraiment regarder l'histoire des Québécois comme "celle d'une résistance admirable et d'un long effort pour construire ici une société de langue et de culture françaises, où notre identité fonderait la vie collective, et ne serait pas optionnelle chez elle"? La question est légitime, en effet, mais elle ne se pose que dans la forme et ne convient pas dans le réel. Cette résistance a été la praxis passive de deux siècles de domination britannique et d'aliénation catholique janséniste. Ce long effort a été celui de l'inertie et non d'une morale activiste de l'histoire qui a été avortée en 1838 et emportée en 1840 afin de se complaire aux solutions de lord Durham. Il n'y a pas de construction d'une identité qui utiliserait la langue et la culture françaises à moins ne pas voir la quasi exclusivité de la chanson anglaise qu'écoutent les jeunes Québécois depuis des générations ou le peu de goût qu'ils ont pour la lecture d'œuvres non seulement québécoises, mais francophones. Tous ces jeunes compositeurs qui ne revendiquent ni Gilles Vignault ni Claude Gauthier comme mentor et préfèrent entrecouper deux mots de français de quatre mots d'anglais dans leur "tunes" afin de faire vendeur. Ou encore ces réalisateurs de cinéma ou de télévision qui illustrent leurs produits de chansons encore-là en anglais. Et cette même jeunesse qui, il y a quelques années encore, s'écriait Fuck l'identité! qui maintenant peine à savoir s'ils sont straight, gay, bi ou trans et ce font de cette quête d'une identité individuelle le problème insoluble du Moi face à sa génitalité.
 |
| Plébiscite du 27 avril 1942. |
Bock-Côté a raison sur une chose : la laïcité n'appartient pas à la petite politique mais bien à la politique structurelle de l'identité québécoise. Cependant, contrairement à ce qu'il pense, ce n'est pas par "la laïcité qu'on entend refaire de la culture du pays et des mœurs qui y sont associées la norme de l'existence commune". C'est tout simplement ignorer ce qu'est la laïcité. La laïcité n'est que la neutralité de l'État et de ses appareils. Une société laïque n'existe que si ses institutions publiques sont neutres en termes de religion. Rien de plus. On ne peut ériger une société ni même une culture sur la laïcité. C'est du simplisme de kangourou pas de poche! Certes, "les Québécois réaffirment leur droit d'affirmer leur propre modèle d'intégration, en s'arrachant aux paramètres idéologiques et juridiques du multiculturalisme canadien". Outre la mauvaise formulation du phrasée, il faut reconnaître que ce propre modèle d'intégration qui résiste et s'oppose au modèle canadien n'est pas actuel. Il remonte au XIXe siècle, sinon comment expliquer ce trait des deux solitudes du Canada? L'identité québécoise est le principal obstacle à créer une identité canadienne. D'un côté, le Canada voudrait que les Québécois partagent l'unanimité des autres Canadiens. On le ressent aujourd'hui depuis que l'on parle du multiculturalisme, mais ce n'est rien comparé aux deux crises de la conscription de 1917 et de 1942, tant le sang des Québécois y fut l'enjeu de l'opposition. De l'autre, les Québécois voudraient qu'on reconnaisse leur droit historique comme Pierre Elliott Trudeau, pris à faux dans son idéologie libérale, a encouragé le droit historique des peuples autochtones qu'on a gratifié depuis de "premières nations" comme s'il y en avait ensuite une "seconde" (les franco-catholiques de l'Empire britannique d'Amérique du Nord) puis une "troisième", la plus nombreuse, la plus évidente, la dominante depuis plus de 150 ans, les Britanniques de l'Empire. Sur ce point, Justin Trudeau maintient la tradition depuis John A. Macdonald. On peut autoriser les "premières nations" à conserver des droits traditionnels et communautaires historiques, étant voués à une disparition, certes plus lente que prévue, mais tout aussi inexorable au niveau démographique. La troisième, étant généralisée, ne se définit plus que comme "nation canadienne", avec son drapeau, son passeport, ses douanes, le siège pour se mettre un péteux à l'ONU, son pétrole qui a remplacé ses blés, son assistance sociale qui a remplacé sa pêche à la morue et ses multiethniques qui gonflent les seuls quartiers de Toronto. Reste la couche intermédiaire, celle des francophones québécois, passive, maintenue dans sa force d'inertie appelée survivance, se grisant de découvertes de patentes à gosses pour se valoriser l'esprit d'inventivité qui persiste jusque dans des multinationales honteuses comme Bombardier et SNC-Lavalin qui, pour se maintenir à hauteur de Boeing ou de WSP Global, profitent de la "péréquation" provinciale en tétant des subventions qu'ils finissent toujours par obtenir des fonds publics, équivalent de B.S. qui tombera dans la poche des hauts gestionnaires des deux entreprises. À ce compte, l'expression canadianisation forcée de notre vie collective est à mettre sur le même compte que les référendums volés et autres croustillantes expressions qui traduisent moins la réalité que des frustrations et des ressentiments.
 |
| 14 000 Yvettes au Forum, 7 avril 1980. |
Résumons-nous. L'exposé de Bock-Côté opère une subversion de la critique historique en idéologie toxique, plus précisément en prophétisme politique. La déontologie du travail historien rejette le prophétisme et ne le considère, chez les philosophes de l'histoire, que comme une variation stylistique sans grande portée autre que le jus des figures de style littéraires. Rien, présentement, n'annonce la disparition des Québécois de la surface de la planète, ni comme êtres physiques, ni par assimilation culturelle. Comme l'en félicite Bock-Côté, les Québécois ont résisté durant 200 ans aux volontés britanniques manifestes ou latentes de les assimiler. Entre l'impossible assimilation et l'inaccessible indépendance, ils se sont placés dans une situation de masse politiquement inerte, cherchant tantôt dans le monde des affaires, tantôt dans les cercles culturels à participer dans un monde où ils ne peuvent apparaître que subsidiaires de forces nationales et internationales qui les dépassent. C'est là où ils sont les plus fragiles, ce que nous rappellent les récits des deux guerres mondiales. Tant que nous prenons la prophétie dépressive de Bock-Côté au sérieux, nous cultivons un mal-être qui paralyse les prises de décisions et les affirmations existentielles des Québécois. Nous ouvrons la porte à la menace fédéraliste affichée durant les deux campagnes référendaires : sans le Canada, les Québécois ne sont rien. Slogan repris par les hystériques du Charkaouidistan lors des manifestations menaçantes contre le respect de la société d'accueil.
 |
| Le Canadien Français et son double. Dorian Gray? |
À un autre niveau, la motivation qui prête à la fierté des Québécois, selon Bock-Côté, est une perversion du seul diagnostic possible de la condition psychologique et morale de la collectivité québécoise. Ce retour de la haine de soi contre laquelle Bouthillettte avait mobilisé l'esprit analytique des intellectuels et des artistes québécois n'a duré qu'une saison, entre 1976 et 1980. Le lourd héritage des conflits psychologiques des Québécois est revenu plus fort après chaque défaite référendaire, bien plus fort que des thérapies, plutôt superficielles, avec lesquelles on a cru stimuler la confiance des Québécois en eux. Il n'a pas suffi de se chanter Gens du pays, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour pour remporter le référendum de 1980, à la soirée duquel l'hymne s'est transformé carrément en chant funèbre. Bock-Côté n'a pas la finesse psychologique pour comprendre le phénomène décrit dans Le Canadien français et son double pour la bonne raison que ce phénomène du doppelgänger place le Québécois aspirant "à la pleine existence nationale" victime de son double Canadien français. Pour ce dernier, la plus vieille forme de définition nationale, c'est le territoire continental nord-américain qui est le lieu d'expression de l'identité. Là où réside, enfoui, son vieux rêve millénariste de convertir l'ensemble du continent à la vraie foi, le catholicisme. La seule poétique de l'espace qui lui permettait de se reconnaître une mission historique. En lui réside la mémoire de la dernière instance au moment où, dans l'isoloir, il doit marquer sa croix sur un oui ou non référendaire. Là réside le geste instinctif, irraisonné, pulsionnel qui l'empêche de voir triompher la plus jeune forme d'appartenance collective, l'identité québécoise. D'autre part, "l'espoir secret" non d'une renaissance, mais bien d'une naissance distincte de la colonie française du XVIIe-XVIIIe siècle, c'est la conscience nationale délimitée par l'appartenance au territoire de la province de Québec en attente d'inscription géo-politique du pays. Nouveau, très nouveau, peut-être encore aujourd'hui trop nouveau, il n'a pas la durée d'application de la première définition. Il n'est pas chargée de symbolique érotique, trop tourné sur lui-même, narcissique consommateur, le nez plongé dans ses complexes qui lui restent entre les mains une fois qu'il s'est usé, en vain, à trucider ses chances. Sa seule réussite, elle est destrudinale. Elle torpille les prétentions d'un Canada unitaire ébauché depuis la commission d'enquête Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme, puis la politique multiculturelle de Pierre Elliott Trudeau. Le refus du Québec, même celui des politiciens libéraux provinciaux pourtant fédéralistes, à entrer dans la Constitution de 1982, traduit l'entêtement à demeurer dans cet état d'indéfinition qui apparaît meilleure qu'une participation assimilée aux politiques canadiennes. Au sein du doppelgänger, la conscience nationale écartelée entre la mémoire canadienne-française et l'aspiration québécoise ne trouve pas suffisamment cette énergie vitale qui lui permettrait de franchir le pont. Dans un sens ou dans un autre.
 |
| Les gales de Pierre-Karl Péladeau. |
L'ignorance de cette situation problématique empêche finalement Bock-Côté de dégager une véritable utopie québécoise autrement que par son émancipation politique. Sans doute vise-t-il la République puisqu'un Québec conservant ses paramètres monarchiques serait anachronique. Mais au-delà, il ne vise rien de plus qu'à servir une clientèle petite-bourgeoise nationaliste mais d'esprit étroit, dont Pierre-Karl Péladeau, son employeur, est le boss. Pour reprendre la dénomination de Gramsci, Mathieu Bock-Côté est un intellectuel organique, entendons qu'il vit d'entreprises capitalistes dont le but est d'assurer le maintien d'une société inégalitaire et entièrement dévouée aux profits de ses entrepreneurs au détriment de l'ensemble de la population. Or, l'échec de Péladeau à convaincre les classes de gens d'affaire à embarquer dans le processus de l'indépendance du Québec montre l'insurmontable alliance des uns avec les autres. La répulsion soulevée par le court passage de Péladeau à la tête du Parti Québécois a été une réaction saine qui a sauvé le projet indépendantiste pour l'avenir. Un seul Péladeau, à ce titre, est plus dangereux pour le pays du Québec que 50 000 musulmans. Par le fait même, l'institution dont Bock-Côté est lui-même l'organe asservi ne peut que saboter son projet idéaliste. À servir de gale à un lépreux, on a guère de chance de poser un geste vibrant de vie⏳
Sherbrooke,
28 avril 2019.





























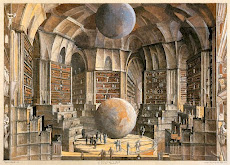
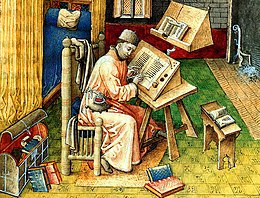







































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire