SOUVENIRS
Les briseurs d’images
 J’aime toutes les histoires. Je ne suis pas de ces capricieux spécialistes avides de «dominer» leur petite part, propriété privée de leur discipline. Je suis plus cochon que ça et mon estomac est solide. C’est toute l’Histoire que je veux… «Quand je saurai la fin de l’histoire…» chantait Renée Claude vers la fin des années soixante. J’aime l’histoire d’Iberville, la ville où je suis né, et celle de sa jumelle d’outre-Richelieu, Saint-Jean-de-Québec, où j’ai grandi et dont je me suis même amusé à écrire l’histoire. J’aime l’histoire du Canada dont j’aurais voulu, dans ma névrose infantile, avoir LE livre où seraient mentionnés tous les faits, toutes les dates et tous les personnages (jusqu’à la chienne Pilote de Lambert Closse!), que je retrouvais dispersés dans les différents manuels. J’aime l’histoire du Canada, mais encore plus celle des États-Unis (mon enfance coïncidait avec
J’aime toutes les histoires. Je ne suis pas de ces capricieux spécialistes avides de «dominer» leur petite part, propriété privée de leur discipline. Je suis plus cochon que ça et mon estomac est solide. C’est toute l’Histoire que je veux… «Quand je saurai la fin de l’histoire…» chantait Renée Claude vers la fin des années soixante. J’aime l’histoire d’Iberville, la ville où je suis né, et celle de sa jumelle d’outre-Richelieu, Saint-Jean-de-Québec, où j’ai grandi et dont je me suis même amusé à écrire l’histoire. J’aime l’histoire du Canada dont j’aurais voulu, dans ma névrose infantile, avoir LE livre où seraient mentionnés tous les faits, toutes les dates et tous les personnages (jusqu’à la chienne Pilote de Lambert Closse!), que je retrouvais dispersés dans les différents manuels. J’aime l’histoire du Canada, mais encore plus celle des États-Unis (mon enfance coïncidait avec l’assassinat des Kennedy et le centenaire de la guerre de Sécession et d’Abraham Lincoln), celle de la France et de son épique révolution à l’ombre de cette guillotine dont j’avais demandé à mon père de me fabriquer un modèle réduit que j’ai toujours! J’aime l’histoire du Mexique, de sa «guerre des petits gâteaux» et de son général d’opérette Santa Anna, celle de la Chine et de son immuable empire, celle de Rome et de ses empereurs fous, j’aime… mais n’en finirai-je jamais d’aimer?
l’assassinat des Kennedy et le centenaire de la guerre de Sécession et d’Abraham Lincoln), celle de la France et de son épique révolution à l’ombre de cette guillotine dont j’avais demandé à mon père de me fabriquer un modèle réduit que j’ai toujours! J’aime l’histoire du Mexique, de sa «guerre des petits gâteaux» et de son général d’opérette Santa Anna, celle de la Chine et de son immuable empire, celle de Rome et de ses empereurs fous, j’aime… mais n’en finirai-je jamais d’aimer?Peut-être est-ce parce que ma vie est trop triste et monotone et mon «histoire» personnelle, vécue, si banale, que je me réfugie dans le rêve de ces historiettes racontées toutefois dans des livres fort sérieux. Car j’ai lu l’Histoire du Canada de Farley-Lamarche, que j’avais demandée comme cadeau de Noël à mes parents dès le mois de septembre, alors que je n’avais que onze ans. Livre dont je n’avais d’ailleurs pas compris grand chose, car qu’est-ce qu’un «acte constitutionnel» pour un enfant de onze ans? J’ai lu l’Histoire des États-Unis de Maurois à l’âge de treize ans, sur mon lit d’hôpital, après une opération pour l’appendicite aigüe. L’intervention retardée de quelques heures et, couic! c’en était fait de moi. Pour moi, comme pour une grande partie des passionnés d’histoire, l’histoire et la mort ne cessent de se renvoyer l’une à l’autre! Un an et demi plus tard, je lisais La Révolution française de Pierre Gaxotte, puis l’Histoire du Mexique de H. B. Parkes, etc. En ce cas, l’Histoire m’offrait l’occasion de fuir la réalité : ton Histoire pour mon histoire? C’est vrai, sans doute. Mais fuir, c’est arriver nulle part, or j’ai l’impression d’être arrivé quelque part, c’est-à-dire où ces fictions historiques conduisent, au plus profond de la représentation mentale; quelque part dans ce twilight zone de la conscience où se déclenchent les motivations les plus énergiques et où se concentrent les intérêts les plus dynamiques et les plus contradictoires à la fois, et qui ensemble, animent, dirigent l’humanité.
Puis, quelqu’un est venu un jour donner un coup de massue dans tout cela. Dollard des Ormeaux? Le brave Dollard dont j’admirais un modèle réduit du beau buste qu’en a fait Alfred Laliberté dans la grande salle de l’école Notre-Dame Auxiliatrice où j’allais, ce brave Dollard donc, mort en héros au Long-Sault, n’était plus qu’un brigand! Madeleine de Verchères? Une pute, elle, cette héroïne qui avait su berner un Sovâge qui la retenait par son foulard! Déboulonnées l’une après l’autre, mes idoles roulaient dans la fange en attendant de tomber dans «les poubelles de l’histoire»! C’était les années soixante et il semblait qu’un vent, que dis-je? un ouragan, raflait toutes les statues du monde entier. Aux États-Unis, l’équivalent de notre Dollard, le général Custer, roulait lui aussi dans la boue de Wounded Knee (2) , et en France, le Général (véritable/vénérable statue vivante) retournait chez lui, à Colombey, pour y mourir.
Le nom de ces iconoclastes? À l’époque je l’ignorais. Beaucoup plus tard, j’ai appris qu’ils se nommaient Jacques Ferron et Léandre Bergeron, et qui encore? Mais j’avais fait le deuil de mes héros d’enfance et je me suis bien amusé à lire Ferron. Bergeron bien moins. Aussi, l’essai que je vous propose ne vise pas à régler mes comptes avec eux. Depuis 1968, on a relevé la statue de Custer tombée au Vietnam et restaurée en Irak et au Panama. Le maire Chirac de Paris est venu livrer à son collègue Doré de Montréal, un monument à la mémoire du Général (un finger fait à l’hôpital Notre-Dame!). Au Québec, la restauration des «monuments de la mémoire» est a peine commencée. On a érigé une statue à la mémoire du chansonnier Félix Leclerc (c’est tout de même mieux qu’une statue au général Schwarzkopf!), mais on l’a cachée dans le fond du parc Lafontaine, là où jadis était situé le «jardin des merveilles»! Lafontaine, Dollard et le monument aux morts des deux guerres bordent les limites du parc, bien à la vue. Et le pauvre Félix? Il faut le chercher… et bien le chercher. Du moins, a-t-on remis la main droite au monument du docteur Chénier. Ça Ferron aurait apprécié.

 Nous ne nous sommes donc pas vraiment remis de cette fureur iconoclaste qui s’est attaquée à l’imaginaire historique des Québécois au cours des années soixante. Aux premiers arrivants français, on a voulu substituer la valeur et le courage des Amérindiens; «l’épopée mystique», à l’origine de la fondation de Montréal, est devenue un vaudeville sordide; l’intrigue qui soutient l’histoire du Québec est une suite de brigandages et d’exploitations; les «Gloires nationales» de Guy Laviolette (3) n’étaient que des nuls et des trous-de-cul. Quels que soient les motifs et la bonne volonté qui se trouvaient à la base de cette entreprise hyper-critique, elle eut un effet de «démoralisation culturelle» qui n’a pas fini de se dissiper. Et ce qu’on a voulu lui substituer – mais au fait, qu’est-ce qu’on a voulu mettre à la place des valeurs du discours historique cléricalo-nationaliste? c’est ce que nous allons nous efforcer de retracer ici –, ne s’est pas montré à la hauteur. De cet échec, nous supportons encore, et de plus en plus, les conséquences.
Nous ne nous sommes donc pas vraiment remis de cette fureur iconoclaste qui s’est attaquée à l’imaginaire historique des Québécois au cours des années soixante. Aux premiers arrivants français, on a voulu substituer la valeur et le courage des Amérindiens; «l’épopée mystique», à l’origine de la fondation de Montréal, est devenue un vaudeville sordide; l’intrigue qui soutient l’histoire du Québec est une suite de brigandages et d’exploitations; les «Gloires nationales» de Guy Laviolette (3) n’étaient que des nuls et des trous-de-cul. Quels que soient les motifs et la bonne volonté qui se trouvaient à la base de cette entreprise hyper-critique, elle eut un effet de «démoralisation culturelle» qui n’a pas fini de se dissiper. Et ce qu’on a voulu lui substituer – mais au fait, qu’est-ce qu’on a voulu mettre à la place des valeurs du discours historique cléricalo-nationaliste? c’est ce que nous allons nous efforcer de retracer ici –, ne s’est pas montré à la hauteur. De cet échec, nous supportons encore, et de plus en plus, les conséquences.Contexte général de démoralisation culturelle
L’hyper-criticisme historiographique des années soixante ne concerne pas uniquement l’imaginaire historique colonisé des Québécois. Il fait partie d’un phénomène historique plus vaste dont je vais essayer de cerner les limites. L’histoire du Québec des années soixante reste à faire. Et j’ai l’impression qu’on va l’attendre encore longtemps. Pour cause: ceux qui ont profité du mouvement général des années soixante et qui se sont installés confortablement aux leviers de commande de l’administration économique, de l’État, des syndicats et des universités, y sont toujours et trônent avec la conviction qu’ils sont de la génération que le Québec attendait pour entrer de plain pied dans la modernité! Politiciens qui négocient une constitution déjà désuète, universitaires dont la chaire loge dans une brochetterie grecque de la rue Duluth (en l’honneur du chevalier Duluth, incontestablement!), hommes d’affaires dont les faillites s’avèrent aussi définitives que spectaculaires fut leur ascension; qui oserait reconnaître, ou même penser que leur génération en fut une de ratés? Un mythe l’entretient, celui de la Révolution tranquille, qui rend historique une illusion d’arrivistes. Après tout, la génération des années soixante n’a-t-elle pas abattu le clergé rétrograde qui maintenait les Québécois dans une culture misérabiliste? Oui, mais ce fut pour lui substituer un État qui entretient toujours parmi la population un état de dépendance infantilisant. Après la «Grande Noirceur» de Duplessis, n’a-t-elle pas été la Lumière des travailleurs? Oui, mais cette «Lumière» a été produite par des centrales syndicales qui ont fini par se faire complices de cette sombre aliénation économique perpétuée par les centrales hydroélectriques (qui sous un autre mode, celui des fils à haute tension plutôt que des chaudières – révolution technologique oblige! – laissent les Québécois dans un état d’éternels porteurs d’eau). Ce syndicalisme de conciliation s’est maintenu au prix de la démobilisation générale et de tout militantisme politique. N’a-t-elle pas haussé le niveau de vie moyen des Québécois? Oui, elle l’a fait en faisant du tiers des Québécois des «bénéficiaires» des programmes sociaux; d’un autre tiers, des «cadres» de la gestion de ces mêmes programmes; et du troisième, le porteur du fardeau de l’entretien des deux autres. N’a-t-elle pas mis le Québec sur la carte internationale? Oui, mais sans lui assurer un siège à l’O.N.U. Ses prétentions, parfois sans bornes, ne sont pas dénuées de tout fondement, mais elles demeurent nettement exagérées et les résultats de ses actions, fort douteux.
Le contexte général de démoralisation, on peut le mesurer en se plaçant aux deux extrémités de la décennie. Ouverte avec le slogan «Maître chez nous!» de «l’équipe du tonnerre» libérale de Jean Lesage, la décennie des années soixante s’achève avec l’occupation militaire du Québec par l’armée canadienne à la demande même du Premier Ministre de la province, Robert Bourassa, du même parti libéral. Sur un tout autre plan, les «boîtes à chanson» où se produisaient les poètes et les chansonniers engagés et qui se voulaient une réplique québécoise du Saint-Germain-des-Prés d’après-guerre, sont pratiquement toutes fermées à la fin de la décennie. Aujourd’hui, les momies empaillées de Cité Libre et les revenants de moins en moins effrayants de Parti Pris se félicitent d’avoir libéralisé et socialisé le Québec d’alors. Ils font entre 60 000 et 90 000 «piastres» par année, quand ce n’est pas plus, rien qu’à le répéter devant un auditoire de jeunes innocents maintenus dans l’ignorance par leurs bons soins, retombées nucléaires d’insignifiance d’un rapport Parent saboté aussitôt installé. Pourtant, fondée en 1950, Cité Libre fermait ses portes en 1966 quand ses colombes décidèrent d’aller respirer un meilleur air sous les cieux plus cléments outre-Outaouais tandis que les échevelés de Parti Pris (1963-1968) quittaient allégrement leur revue de combat pour s’installer dans les postes fraîchement établis – par cette même bourgeoisie qu’ils décriaient d’ailleurs –, au sein des institutions d’État (les CEGEP, les Universités du Québec, Radio-Québec, Hydro-Québec, etc.), de sorte qu’aujourd’hui, ils prient dévotement sainte Touche toutes les deux semaines, sans le moindre scrupule anti-capitaliste et avec toute l’humilité servile digne des anciens frères et des bonnes sœurs. Libéraliser et socialiser le Québec dans les années soixante? Ça a bien payé, merci!
Au début de la décennie, la pratique religieuse était intense। À la fin, elle s’était effondrée, comme ces églises dont on jetait par terre les clochers afin de les reconvertir en centres d’achat ou en condos de luxe। Rien que dans le
 diocèse de Saint-Jean, où je grandissais à l’ombre du clocher de Saint-Edmond, diocièse mi-rural mi-urbain, on estime que la pratique religieuse s’est effondrée de 65% à 27% en l’espace de dix années! (4) Au début des années soixante, on regardait à la télévision Les Belles Histoires des Pays d’en haut de Claude-Henri Grignon et Le Survenant avec les beaux textes de madame Guèvremont. À la fin de la décennie, ils auront cédé la place au moralisme lénifiant de la Rue des Pignons de Mia Riddez et aux subtils textes de Marcel Gamache (probablement appelés à paraître dans son Théâtre complet publié par les soins d’un Jacques Lanctôt dans ce qui sera convenu d’être qualifié de La Pléïade québécoise…). Tremblay et Godbout, Aquin et Ducharme, c’est bien beau, mais la littérature nationale, c’était aussi bien autre chose: une quantité de publications toujours plus volumineuse dont la qualité ne cessait de se diluer dans le lieu commun et la bêtise.
diocèse de Saint-Jean, où je grandissais à l’ombre du clocher de Saint-Edmond, diocièse mi-rural mi-urbain, on estime que la pratique religieuse s’est effondrée de 65% à 27% en l’espace de dix années! (4) Au début des années soixante, on regardait à la télévision Les Belles Histoires des Pays d’en haut de Claude-Henri Grignon et Le Survenant avec les beaux textes de madame Guèvremont. À la fin de la décennie, ils auront cédé la place au moralisme lénifiant de la Rue des Pignons de Mia Riddez et aux subtils textes de Marcel Gamache (probablement appelés à paraître dans son Théâtre complet publié par les soins d’un Jacques Lanctôt dans ce qui sera convenu d’être qualifié de La Pléïade québécoise…). Tremblay et Godbout, Aquin et Ducharme, c’est bien beau, mais la littérature nationale, c’était aussi bien autre chose: une quantité de publications toujours plus volumineuse dont la qualité ne cessait de se diluer dans le lieu commun et la bêtise.Non, il n’y a pas eu de «grandes lumières» aux lendemains de la «Grande Noirceur», il n’y a eu que ce que les sociologues Durkheim et Duvignaud appellent de l’anomie, c’est-à-dire une situation globale «caractérisée par l’effondrement du système d’organisation des valeurs et plus largement de la société elle-même; affectée par une mutation lente ou soudaine». (5) Cette phase d’anomie, dont je ne suis pas sûr que nous soyons vraiment sortis au milieu de ces années quatre-vingt dix, comporte un certain état de démoralisation générale qui frappe une société en voie de passage d’un mode de vie à un autre. Les acquis de la Révolution tranquille ont été le résultat de la modernisation accélérée du Québec d’après-guerre (une première vague de modernisation accompagne les années qui suivent immédiatement la Grande Guerre de 14-18, une seconde, encore plus déterminante, suit la Guerre de 39-45). Cette Révolution tranquille a été beaucoup moins une suite de «remises en question» comme le suggèrent Linteau-Durocher-Robert, de manière trop rapide et irréfléchie, ce qui hypothèque idéologiquement de façon suspecte cette partie de leur ouvrage (6), qu’une consolidation et un peaufinement des entreprises menées entre 1940 et 1960। Croire naïvement aux «glorieuses années soixante» (7), c’est croire au Père Noël et, comme disait le duc de Wellington, «si vous pouvez croire ceci, vous pouvez croire n’importe quoi»!
La démoralisation tranquille est apparue au Québec lorsque les progrès techniques et économiques ont vraiment pénétré la vie quotidienne du commun des Québécois et que les valeurs traditionnelles identificatoires ont été considérées non seulement anachroniques par rapport au nouveau mode de vie nord-américain que s’offrait la population, mais nuisibles, mensongères et fausses! Les écrits de Jacques Ferron, de Léandre Bergeron et de Victor-Lévy Beaulieu que nous allons utiliser témoignent de cette anomie et de cette démoralisation culturelle des Québécois des années soixante. Pour cette raison, ils ne nous intéressent qu’en tant que morceaux d’œuvres littéraires, mais non scientifiques, de ces auteurs et qu’en tant qu’expressions de structures constituant le malaise de la représentation sociale de l’époque. Réagissant contre une historiographie associée aux valeurs anachroniques du discours cléricalo-nationaliste rétrograde, traditionnel, dont le chanoine Groulx reste la tête de Turc par excellence, et non encore familiarisés avec une historiographie supposée plus «scientifique», inspirée des méthodes et des thèmes (économies, sociétés et mentalités) de l’École des Annales – celle-ci n’apparaît vraiment qu’avec l’Histoire économique et sociale du Bas-Canada de Fernand Ouellet (1971) et Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle de Louise Dechêne (1974) (8) –, nos auteurs manifestent l’expression d’une historicité en déroute prise entre des modèles sûrs mais désuets et des modèles anticipés mais aux contours encore flous. Du doute à l’inquiétude, entre la littérature et la science, ils s’en prennent avant-tout à une vision passéiste du culte des (faux) héros et appellent à l’émergence d’une vision activiste et authentique de l’histoire. C’est la crise de la conscience historique québécoise entre les biographies héroïques, surfaites, de Dollard et de Madeleine, et la science positive des groupes sociaux, moteurs de l’Histoire : Amérindiens, ouvriers et «damnés de la terre» du Tiers-Monde, qui s’inscrit, à sa façon, dans un ensemble plus vaste de la démoralisation culturelle, tranquille, phase anomique du Québec d’après-guerre. C’est cela et rien que cela qui m’intéresse ici.
 Cette littérature historique est rongée par la démoralisation tranquille comme le sont toutes les littératures de l’époque, qu’il s’agisse des pièces de théâtre de Michel Tremblay, des romans de Marie-Claire Blais (Une saison dans la vie d’Emmanuel, 1965) ou des films de Pierre Patry (Trouble-fête, 1964 : un étudiant tue une vieille pédale – qui se trouvait être en même temps le notaire Lepotiron des Belles Histoires… citées plus haut –; La corde au cou, 1964, où un homme tue sa maîtresse; Caïn, 1965, du «parfait» Réal Giguère, sombre mélo indigeste, sordide et ridicule; Délivrez-nous du mal, 1965, de Jean-Claude Lord, autre sordide histoire de «tapette à chapelet» incarnée par nul autre que Yvon Deschamps, etc.); la démoralisation se voit, se lit, s’entend et se regarde partout. Elle est cette anomie d’une société catholique et janséniste qui doit reconnaître que pour devenir «mère», une «vierge» doit se faire «putain», et cesser de croire aux Sovâges et aux feuilles de chou, c’est pourquoi elle se précipite pour visionner ces insipides «films de fesses» (Valérie, 1969) réalisés, symptomatiquement, par un historien reconverti en cinéaste-buisinessman du soft-porn! Et peut-être est-ce cela l’anomie; une morale qui en se cherchant se donne le prétexte de folâtrer quelque temps avec la transgression du sordide, du pervers et du subversif de la désobéissance, non sans se fixer comme but de retourner le plus tôt possible à la case départ du conformisme social?
Cette littérature historique est rongée par la démoralisation tranquille comme le sont toutes les littératures de l’époque, qu’il s’agisse des pièces de théâtre de Michel Tremblay, des romans de Marie-Claire Blais (Une saison dans la vie d’Emmanuel, 1965) ou des films de Pierre Patry (Trouble-fête, 1964 : un étudiant tue une vieille pédale – qui se trouvait être en même temps le notaire Lepotiron des Belles Histoires… citées plus haut –; La corde au cou, 1964, où un homme tue sa maîtresse; Caïn, 1965, du «parfait» Réal Giguère, sombre mélo indigeste, sordide et ridicule; Délivrez-nous du mal, 1965, de Jean-Claude Lord, autre sordide histoire de «tapette à chapelet» incarnée par nul autre que Yvon Deschamps, etc.); la démoralisation se voit, se lit, s’entend et se regarde partout. Elle est cette anomie d’une société catholique et janséniste qui doit reconnaître que pour devenir «mère», une «vierge» doit se faire «putain», et cesser de croire aux Sovâges et aux feuilles de chou, c’est pourquoi elle se précipite pour visionner ces insipides «films de fesses» (Valérie, 1969) réalisés, symptomatiquement, par un historien reconverti en cinéaste-buisinessman du soft-porn! Et peut-être est-ce cela l’anomie; une morale qui en se cherchant se donne le prétexte de folâtrer quelque temps avec la transgression du sordide, du pervers et du subversif de la désobéissance, non sans se fixer comme but de retourner le plus tôt possible à la case départ du conformisme social?Cela se vérifie couramment dans la plupart des situations historiques d’anomie sociale et culturelle, mais peut-être aussi y a-t-il quelque chose de plus personnel au Québec dans cette crise de démoralisation des années soixante? C’est cela que nous devons chercher également dans l’action iconoclaste de nos auteurs. Le livre de Jacques Ferron qui déboulonne les statues du Régime français s’appelle Historiettes (Éd. du Jour, 1969), celui de Léandre Bergeron, Le petit manuel d’histoire du Québec (Éd. québécoises, 1970), celui de Victor-Lévy Beaulieu, Le Manuel de la petite littérature du Québec (Ed. de l’Aurore, 1974). Les Historiettes de Ferron sont bien de petites histoires, de petites anecdotes revisitées par l’auteur, mais c’est aussi une historiette, une «petite» et non une «grande» histoire, un processus de miniaturisation qui se poursuit dans la forme même du livre que Bergeron donne à son essai, et du «petit» manuel, nous passons au manuel de la «petite» littérature de V.-L. Beaulieu. Chez Beaulieu, on spécifie qu’il ne s’agit même plus d’un simple «petit» manuel, mais que c’est l’objet traité qui est «petit». Comment ne pas être profondément gêné en se voyant ainsi entraîné à se rétrécir, se ratatiner d’un titre à une forme de livre, et de la forme à l’objet concerné! Sous l’aspect cinglant, critique, voire simpliste de la vision de l’histoire que proposent parfois nos auteurs, ce qui commence par une bonne volonté certaine et sincère finit par reposer sur des affects indéfinis, voire malsains. Un virus, un corps étranger semble miner le projet annoncé comme plus vrai, plus authentique et plus honnête envers soi-même que les démarches passés et dénoncées. L’inconscient historique aurait-il joué ici un mauvais tour à l’entreprise de renouvellement de la représentation sociale du développement des Québécois dans l’espace et dans le temps?
Le bon, la brute et le truand
La critique au Québec, ça n’existe pas. Tous ceux qui sont écrivains ou artistes et ne scribouillent pas pour une gazette ou une revue quelconque vous le diront. Parmi ces scribouilleurs, sur un spectre qui va de l’honnête appréciateur, qui essaie de donner de la forme au genre «René-Homier Roy», au médisant rapporteur de gossips savamment tendancieux (la bitche), en passant par le pensionné de l’université dont la qualité démocratique consiste en ce qu’il serait tout aussi médiocre s’il parlait des choux-fleurs ou de l’administration d’un dépanneur: tous ces prétendus critiques d’art, de lettres et d’histoire, dans les années soixante comme aujourd’hui, se sont avérés incompétents à pénétrer la démoralisation tranquille. Personne n’a analysé cette conscience collective, historique, tels que les ouvrages ici utilisés de Ferron, de Bergeron et de Beaulieu nous la transmettent.
Le premier, Historiettes de Jacques Ferron (1921-1985) a été demandé à l’auteur par l’éditeur Jacques Hébert. Il devait paraître la même année que son roman, Le Ciel de Québec (Éd. du Jour) dont il constitue le matériau documentaire.
 “Chubby” Power, Thérèse Casgrain, l’abbé Surprenant et nombre d’autres anecdotes des Historiettes se retrouvent intégralement dans Le Ciel de Québec. Pierre Cantin, dans son article pour le Dictionnaire des œuvres littéraires (9) souligne «l’étonnement» de Ferron de voir son ouvrage paraître dans la collection «Les Romanciers du Jour». Les Historiettes avaient paru dans un grand nombre de revues et de journaux entre mai 1957 et janvier 1969 : L’Information médicale et paramédicale, Situations, Parti Pris, L’Action nationale et Liberté; aussi, le docteur Ferron s’attendait-il à ce qu’on le considère comme un véritable essayiste et non un simple romancier. Cette incompréhension se poursuit toujours quand Robert Migner, dans son article critique: «Jacques Ferron et l’histoire de la formation sociale québécoise» (1976) qualifie l’ouvrage d’«essai-roman historique». (10) Si Victor-Lévy Beaulieu insiste sur le fait que la «renommée» du docteur Ferron «n’en menait pas très large» au moment de la sortie des Historiettes (11), la critique littéraire lui était déjà passablement acquise et même les historiens, habituellement atteints de scrupules exagérés, n’hésitèrent pas à qualifier ses «contes à charges» comme étant ceux d’un «honnête homme» aux «réquisitoires étoffés» (Pierre Savard) voire même à admettre qu’il se trouvait dans ces «papiers de fou » un assez grand «talent pour tâter de façon troublante du métier d’historien», au point d’y reconnaître que «plusieurs hypothèses sont troublantes et provoqueront sans doute de nouvelles recherches» (Denis Vaugeois)(12). Toutes ces reconnaissances sont exagérées, bien sûr, Ferron travaillant d’une manière différente de celle du tâcheron universitaire, «frégoteur » de documents, il en était proprement l’antithèse. Mais ce qui s’appelait «critique» à l’époque, et après, s’avouait entièrement conquise par le travail de Ferron.
“Chubby” Power, Thérèse Casgrain, l’abbé Surprenant et nombre d’autres anecdotes des Historiettes se retrouvent intégralement dans Le Ciel de Québec. Pierre Cantin, dans son article pour le Dictionnaire des œuvres littéraires (9) souligne «l’étonnement» de Ferron de voir son ouvrage paraître dans la collection «Les Romanciers du Jour». Les Historiettes avaient paru dans un grand nombre de revues et de journaux entre mai 1957 et janvier 1969 : L’Information médicale et paramédicale, Situations, Parti Pris, L’Action nationale et Liberté; aussi, le docteur Ferron s’attendait-il à ce qu’on le considère comme un véritable essayiste et non un simple romancier. Cette incompréhension se poursuit toujours quand Robert Migner, dans son article critique: «Jacques Ferron et l’histoire de la formation sociale québécoise» (1976) qualifie l’ouvrage d’«essai-roman historique». (10) Si Victor-Lévy Beaulieu insiste sur le fait que la «renommée» du docteur Ferron «n’en menait pas très large» au moment de la sortie des Historiettes (11), la critique littéraire lui était déjà passablement acquise et même les historiens, habituellement atteints de scrupules exagérés, n’hésitèrent pas à qualifier ses «contes à charges» comme étant ceux d’un «honnête homme» aux «réquisitoires étoffés» (Pierre Savard) voire même à admettre qu’il se trouvait dans ces «papiers de fou » un assez grand «talent pour tâter de façon troublante du métier d’historien», au point d’y reconnaître que «plusieurs hypothèses sont troublantes et provoqueront sans doute de nouvelles recherches» (Denis Vaugeois)(12). Toutes ces reconnaissances sont exagérées, bien sûr, Ferron travaillant d’une manière différente de celle du tâcheron universitaire, «frégoteur » de documents, il en était proprement l’antithèse. Mais ce qui s’appelait «critique» à l’époque, et après, s’avouait entièrement conquise par le travail de Ferron.Une exception, celle de Robert Migner, historien marxiste imbu de la langue de bois «M-L» (13) de l’époque avec mention de Gramsci et de Goldmann en prime! Sa critique de Ferron, symptomatique d’un engagement militantiste des années soixante-dix, est simpliste et tendancieuse। Il aime Ferron quand Ferron est d’accord avec Migner: «Cette approche matérialiste lui [Ferron] a alors permis de faire du travail d’historien». (14) Mais dès que Ferron ne répond plus au goût de Migner, il «redevient idéaliste». (15) Pour le camarade Migner, «la pensée historique de Jacques Ferron s’articule autour de l’anticléricalisme, du nationalisme, de l’antifédéralisme, du libéralisme, du rejet de la France et de l’idéalisation des Amnérindiens». (16) M. Migner a une définition de la science qui se limite à celle d’une simple énumération. Sa critique se fait dépréciative: «En raison de sa position par rapport à la production sociale, par rapport aux conflits essentiels, elle ne saisit que rarement tous les tenants et aboutissants de l’histoire, ce qui la pousse à se réfugier dans des vues mythiques du passé, mais aussi du présent et de l’avenir». (17) M. Migner considère que les Historiettes ont «très mal vieilli»… (18) Que dire de la critique de M. Migner? Autant Ferron méprisait ceux qui «frégotent» les documents, autant je méprise ceux qui «marxchandent» les interprétations.
 La critique se montrera moins clémente pour les deux ouvrages suivants. Le Petit Manuel d’histoire du Québec de Léandre Bergeron n’a même pas droit à une mention critique dans le tome V du Dictionnaire des œuvres littéraires; pourtant ce fut un ouvrage fort lu dont la disponibilité fut garantie par la note finale de l’auteur: «ce manuel ne peut être vendu à un prix supérieur à $1.25» (B.250). (19) Bref, Bergeron a été marqué de la même malédiction que le frère Guy Laviolette. Les élites culturelles, dans quelque régime que ce soit, méprisent toujours le succès des marginaux. Bergeron (né en 1933) a tout fait pour diffuser sa vision de l’histoire du Québec, allant jusqu’à l’adapter en bandes dessinées, ce qui était encore la méthode qu’utilisait Guy Laviolette dans ses manuels scolaires. Il en fit même une pièce de théâtre! Gilles Lemieux pourra toujours reconnaître que Bergeron a fait «œuvre de précurseur et ceci à un double point de vue: d’abord en regard du public qu’il aura voulu toucher et ensuite, en regard de l’interprétation renouvelée qu’il aura souhaité donner à l’histoire du Québec», et Pierre Savard, plus haut si reconnaissant envers Ferron, qualifiera d’«assez grossier le schéma de lutte des clas-ses du manuel de Bergeron qui raconte une histoire qui n’est pas sans plaire à ceux de nos contemporains qui sont dressés contre toutes les formes d’impérialisme ou friands d’explications simplistes». (20)
La critique se montrera moins clémente pour les deux ouvrages suivants. Le Petit Manuel d’histoire du Québec de Léandre Bergeron n’a même pas droit à une mention critique dans le tome V du Dictionnaire des œuvres littéraires; pourtant ce fut un ouvrage fort lu dont la disponibilité fut garantie par la note finale de l’auteur: «ce manuel ne peut être vendu à un prix supérieur à $1.25» (B.250). (19) Bref, Bergeron a été marqué de la même malédiction que le frère Guy Laviolette. Les élites culturelles, dans quelque régime que ce soit, méprisent toujours le succès des marginaux. Bergeron (né en 1933) a tout fait pour diffuser sa vision de l’histoire du Québec, allant jusqu’à l’adapter en bandes dessinées, ce qui était encore la méthode qu’utilisait Guy Laviolette dans ses manuels scolaires. Il en fit même une pièce de théâtre! Gilles Lemieux pourra toujours reconnaître que Bergeron a fait «œuvre de précurseur et ceci à un double point de vue: d’abord en regard du public qu’il aura voulu toucher et ensuite, en regard de l’interprétation renouvelée qu’il aura souhaité donner à l’histoire du Québec», et Pierre Savard, plus haut si reconnaissant envers Ferron, qualifiera d’«assez grossier le schéma de lutte des clas-ses du manuel de Bergeron qui raconte une histoire qui n’est pas sans plaire à ceux de nos contemporains qui sont dressés contre toutes les formes d’impérialisme ou friands d’explications simplistes». (20)
Le Manuel de la petite littérature du Québec a subi un sort moins indifférent mais tout aussi méprisant de la part de la critique. Publié en 1974, l’historien Nive Voisine rappelle que le manuel de Victor-Lévy Beaulieu (né en 1945) est «né d’une impuissance». Voisine, historien du catholicisme québécois, juge que l’ouvrage manifeste «un certain dédain» pour cette littérature que Beaulieu, visiblement, adore. «Manquant de rigueur méthodologique et même d’un semblant d’analyse», Voisine réitère les commentaires que les historiens adressaient déjà aux ouvrages de Ferron et de Bergeron. Et pour terminer sa présentation du livre de Beaulieu pour le Dictionnaire des œuvres littéraires, on entend la voix de la vertu professionnelle répéter les commérages médisants du rapporteur de gossips de la gazette: «C’est le manuel qui est petit» (Réginald Martel, 25 janvier 1975)!
Cet aperçu indique les circonstances entourant la production des ouvrages et la réception générale qu’on en a fait. Plus pertinents sont les résultats d’une rapide lecture sur laquelle on opère un tri qui partage les personnages (individuels ou collectifs) selon leur appréciation positive ou négative par nos écrivains. Certes, il est difficile d’y inscrire des personnages souvent à peine mentionnés, mais dans l’ensemble, la quantité des personnages dont l’appréciation est négative l’emporte, et de loin, sur celle des personnages pour qui elle est positive. Il est possible de démontrer que si la démoralisation culturelle dépend d’une dépréciation de l’action et du caractère des personnages contenus dans ces récits historiques, alors les Historiettes, Le Petit Manuel… et le Manuel de la petite littérature… contribuent et participent de la démoralisation de la conscience historique des Québécois des années soixante.
Nous obtenons ainsi, dans chaque ouvrage, une liste des personnages à valeur négative plus longue que celle des personnages à valeur positive. Ils forment parfois des dualités antagoniques (type/antitype), c’est le cas chez Ferron qui utilise énormément ce jeu de contraste: patriotisme/nationalisme, professionnels/clergé du XIXe siècle, Riel/Mgr Taché et Jos. Dubuc, F.-G. Marchand/Mgr Bruchési, Chénier/Dollard, Champlain/Cartier, Palestiniens/Israéliens et surtout le couple Angleterre/France (cette dernière apportant la barbarie aux Amérindiens et son peuple paysan étant plus misérable que les fiers guerriers iroquois). Léandre Bergeron utilise également parfois ce jeu de contraste, mais la quantité de ses personnages négatifs laisse loin derrière les correspondants positifs possibles: Iroquois/Espagnols (des plus braves aux plus monstrueux), Louis Hébert/Cartier, Bonaventure Viger/Louis-Joseph Papineau, le dynamiteur de la résidence de Lord Atholstan/Henri Bourassa, les grévistes d’Asbestos/John Mainville, Mgr Charbonneau/Duplessis, etc. Victor-Lévy Beaulieu utilise le mécanisme en vue de contraster le mouvement social (présenté négativement) des victimes individuelles (présentées positivement). On aurait tort de crier trop haut au manichéisme de nos auteurs. Bergeron se voit vite dépassé par sa haine des classes bourgeoises et des personnages historiques en général pour véritablement établir un système manichéen qui soit autre chose que le jeu des antagonismes de classes. C’est un procédé de l’écriture romanesque que de présenter des personnages dégradés dans un univers en constante dégradation. (21) Si les héros ne parviennent pas à redresser la situation, avec tous leurs efforts et toute la bonne volonté du monde (c’est le cas des habitants rebelles de 1837-1838, de Paul Gouin ou de Mgr Charbonneau), c’est qu’ils sont trahis et écrasés par la coalition des forces du mal et l’utilisation de traîtres (le mot revient souvent dans le Petit Manuel de Bergeron); tel est le rôle que l’on aurait fait jouer aux professionnels qui entourent Neilson et Papineau en 1837, à Maurice Duplessis et à John Mainville au XXe siècle, etc। Chez Ferron, plus modéré dans ses rancunes, le procédé romanesque est clair: le nationalisme détourne le patriotisme comme Mgr Taché trahit Riel, et Mgr Bruchési donne un coup de Jarnac à Félix-Gabriel Marchand, etc. Tels sont les premiers traits de démoralisation culturelle de la conscience historique québécoise que nous pouvons dégager de nos ouvrages. Essayons maintenant de les approfondir.
Notes.
1. L’auteur tient ici à remercier M. Henri Tranquille qui a bien voulu lire ce texte et suggérer des corrections fort pertinentes. Il va de soi que les erreurs ou fautes contenues dans ce texte sont de la responsabilité seule de l’auteur.
2. Le général Custer, massacré par les Sioux à Little Big Horn en 1876 servit de modèle ou de prétexte à plusieurs films et séries télévisées. Wounded Knee, endroit où furent massacrés vieillards, femmes et enfants par les soldats américains en 1890, est le lieu d’une manifestation armée en 1973 par des membres de l’American Indian Movement réclamant une enquête sur la violation des traités indiens et sur la mauvaise gestion du Bureau des Affaires Indiennes aux États-Unis.
3. Guy Laviolette, pseudonyme du frère Henri Gingras (décédé en 1980) des Frères de l’Instruction chrétienne, avait créé, dans les années 1930, une série de brochures historiques, «Gloires nationales», galerie de héros de l’histoire québécoise. «De santé fragile et doué d’une facilité d’expression écrite», son succès (plus de 25 000 exemplaires dans le cas des brochures de Gloires nationales) en a fait l’un des historiens les plus lus de l’historiographie québécoise. Guy Laviolette fit publier une série de manuels scolaires entre 1951 et 1954 qui fut au programme des écoles jusqu’en 1967 lorsqu’il fut condamné par le Comité catholique. Ce sont ces manuels et ces brochures qui m’ont donné le goût de l’histoire par l’immense plaisir que j’avais à seulement les feuilleter. «Ce pelé, ce galeux», le manuel de Laviolette, est l’un des outils fondamentaux de la conscience historique des Québécois nés avant 1960. Cf. Louise Charpentier, Le programme et les manuels d’histoire du Canada de la réforme scolaire de 1948, Mémoire de Maîtrise ès Arts (Histoire), Université de Sherbrooke, mars 1983, pp. 103 sq. Également, Aimée Leduc, Les Manuels d’Histoire du Canada, École de Pédagogie et d’Orientation de l’Université Laval, Québec, 1963.
4. P.-A. Linteau, R. Durocher, J.-C. Robert, F. Ricard, Histoire du Québec contemporaine, vol. 2: le Québec depuis 1930, Montréal, Boréal, 1986, p. 592.
5. J. Duvignaud, Hérésie et subversion, essai sur l’anomie, Paris, La Découverte, Col. Armillaire, 1986, p. 38.
6. P.-A. Linteau, R. Durocher, J.-C. Robert, F. Ricard, op. cit. p. 402.
7. P.-A. Linteau, R. Durocher, J.-C. Robert, F. Ricard, ibid, p. 395.
8. Cf. A. Dubuc, «L’influence de l’école des Annales au Québec», in Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 33, # 3, déc. 1979, pp. 357 à 386.
9 P. Cantin, «Historiettes», in Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec: vol. 4: 1960-1969, Montréal, Fidès, 1984, pp. 411-412.
10. R. Migner, «Jacques Ferron et l’histoire de la formation sociale québécoise», in Études Françaises : Jacques Ferron, octobre 1976, p. 344.
11. V.-L. Beaulieu, Docteur Ferron : Pèlerinage, Montréal, Stanké, 1991, p. 221.
12. Cités in P. Cantin, op. cit., p. 412.
13. M.-L.: Marxiste-léniniste.
14. R. Migner, op. cit. p. 350.
15. R. Migner. ibid, p. 350.
16. R. Migner. ibid, p. 351.
17. R. Migner. ibid, p. 351.
18. R. Migner. ibid, p. 352.
19. Désormais nous indiquerons les références aux trois volumes utilisés par les sigles: F. (Ferron), B. (Bergeron) et VLB. (Beaulieu) suivis du folio de la page de l’édition originale.
20. Cité in R. Hamel, J. Hare, P. Wyczynski, Dictionnaire pratique des auteurs québécois, Montréal, Fides, 1976, p. 53.
21. Cf. particulièrement G. Luckacs, La théorie du roman, Paris, Gonthier, Col. Médiations, # 4, 1963.


[(à droite) canadienne-française, Louis-Joseph Papineau;
(à gauche) québécoise, René Lévesque] à 125 ans de distance
Les maudits Français et les bons Sauvages
En posant le problème sous l’angle de la démoralisation, nous nous forçons de le prendre sous l’angle de l’idéologique, c’est-à-dire sous celui du raisonnement et de la justification qui nous permet de nous expliquer l’état d’âme dans lequel nous nous trouvons et de reconnaître l’action déconstructrice et qu’on entend utiliser envers notre conscience historique. Les jugements de valeurs portés sur notre passé s’articulent tout au long d’un chapelet d’actions moralement répréhensibles: violation, usurpation, trahison, extorsion, exploitation, extermination. Ce chapelet d’actions répréhensibles oppose toujours un groupe spoliateur et un groupe spolié.

Les antagonistes fondateurs donnent et maintiennent tout au long des ouvrages le même rythme de pénétration du mal, ce sont les Amérindiens et les Français. Les découvreurs sont des rapaces qui «se lancent sur les mers pour aller piller les ressources naturelles des pays étrangers (B.9)». La répréhension morale est manifeste quand Bergeron reproche à Cartier de prendre «possession du territoire au nom du roi de France sans demander aux Amérindiens si
 c’est
de leur goût de se faire prendre leur pays (B.15)», répréhension morale
réitérée dans les mêmes mots lorsqu’il reproche encore à «Maisonneuve,
Jeanne Mance et leur troupe [qui] arrivent sur l’île sans demander aux
Rouges s’ils sont d’accord, et pire, quand une cérémonie religieuse justifie
la prise de possession (B.30, les italiques sont de moi)», la violation
se doublant ici d’hypocrisie. Plus tard, quand le peuple canayen comme l’appelle Bergeron, se fera passer la Confédération en 1867, il écrira: «Le peuple canayen
est contre mais on ne le consulte pas (B.128)»; c’est la même
répréhension morale qui se perpétue. Face à cette dégueulasserie,
Bergeron dresse la figure des Iroquois qui «ne se laissent pas faire…
Les Iroquois, la tribu rouge la moins servile, défendront longtemps et
avec courage leur territoire menacé (B.26).» Bergeron passe ici sous
silence les alliances tactiques entre les Iroquois
et les Hollandais du Fort Orange puis les Anglais du New-York dans leur
lutte contre les Français et leurs alliés. Bergeron tient à rappeler
que, comme
c’est
de leur goût de se faire prendre leur pays (B.15)», répréhension morale
réitérée dans les mêmes mots lorsqu’il reproche encore à «Maisonneuve,
Jeanne Mance et leur troupe [qui] arrivent sur l’île sans demander aux
Rouges s’ils sont d’accord, et pire, quand une cérémonie religieuse justifie
la prise de possession (B.30, les italiques sont de moi)», la violation
se doublant ici d’hypocrisie. Plus tard, quand le peuple canayen comme l’appelle Bergeron, se fera passer la Confédération en 1867, il écrira: «Le peuple canayen
est contre mais on ne le consulte pas (B.128)»; c’est la même
répréhension morale qui se perpétue. Face à cette dégueulasserie,
Bergeron dresse la figure des Iroquois qui «ne se laissent pas faire…
Les Iroquois, la tribu rouge la moins servile, défendront longtemps et
avec courage leur territoire menacé (B.26).» Bergeron passe ici sous
silence les alliances tactiques entre les Iroquois
et les Hollandais du Fort Orange puis les Anglais du New-York dans leur
lutte contre les Français et leurs alliés. Bergeron tient à rappeler
que, comme  son
maître à penser Karl Marx, la servilité est le défaut qui lui inspire
le plus d’aversion.1 L’homme rouge est le premier personnage positif de
Bergeron à être pris «dans les chaînes du commerce des fourrures, le
vrai producteur et le grand exploité (B.22)»; il sera aussi le premier
sacrifié dans les jeux de coulisses de la politique internationale: «Les
hommes rouges, les premiers habitants du pays, ne sont même pas mis au
courant des jeux politiques des Blancs. On pensera à la rédaction du British North America Act
pour donner au gouvernement central le pouvoir de les mettre dans des
camps de concentration appelés “réserves” (B.128).» Évidemment, un tel
énoncé appelle plusieurs… «réserves»!
son
maître à penser Karl Marx, la servilité est le défaut qui lui inspire
le plus d’aversion.1 L’homme rouge est le premier personnage positif de
Bergeron à être pris «dans les chaînes du commerce des fourrures, le
vrai producteur et le grand exploité (B.22)»; il sera aussi le premier
sacrifié dans les jeux de coulisses de la politique internationale: «Les
hommes rouges, les premiers habitants du pays, ne sont même pas mis au
courant des jeux politiques des Blancs. On pensera à la rédaction du British North America Act
pour donner au gouvernement central le pouvoir de les mettre dans des
camps de concentration appelés “réserves” (B.128).» Évidemment, un tel
énoncé appelle plusieurs… «réserves»! Après l’Amérindien, le second exploité, c’est le colon. Le coureur des bois a la chance de servir d’intermédiaire auprès des Rouges pour l’approvisionnement des compagnies en fourrures. Le colon,
lui, est le soutien de service. Louis Hébert est son prototype. C’est
grâce à son travail que les seigneurs et la France profitent de la
colonie: «On peut croire à première vue que la France a été “généreuse”
pour le Canada, qu’elle a “donné” de ses hommes et de ses ressources
matérielles pour cette “Nouvelle-France”. En réalité, la France retirait
cent fois plus qu’elle y mettait, pillait systématiquement les
ressources sur le dos des hommes rouges et des petits blancs, les
pauvres colons qui croyaient faire fortune dans ce système
d’exploitation (B.36).»
Après l’Amérindien, le second exploité, c’est le colon. Le coureur des bois a la chance de servir d’intermédiaire auprès des Rouges pour l’approvisionnement des compagnies en fourrures. Le colon,
lui, est le soutien de service. Louis Hébert est son prototype. C’est
grâce à son travail que les seigneurs et la France profitent de la
colonie: «On peut croire à première vue que la France a été “généreuse”
pour le Canada, qu’elle a “donné” de ses hommes et de ses ressources
matérielles pour cette “Nouvelle-France”. En réalité, la France retirait
cent fois plus qu’elle y mettait, pillait systématiquement les
ressources sur le dos des hommes rouges et des petits blancs, les
pauvres colons qui croyaient faire fortune dans ce système
d’exploitation (B.36).»Victor-Lévy Beaulieu enchaîne, dans son essai, sur les fausses représentations qu’on a fait miroiter aux colons des XIXe et XXe siècles dans le prolongement de l’exploitation amorcée sous le régime français: «En fait, ce pays a commencé quasiment sous de fausses représentations, matchant à la fois la culture et la religion. Les premiers missionnaires français se croyaient d’une race supérieure. Face à eux, les Amérindiens ne pouvaient être que des minables, des barbares naïfs qu’il fallait évangéliser, éduquer, instruire… et faire monter au ciel (VLB.57).» Pour simpliste que soit cette
 interprétation,
elle lance tout ce misérabilisme avec lequel l’auteur considère les
colons. Le colonialisme a toujours contenu, pour Beaulieu, ce chapelet
d’actions moralement répréhensibles de violations, d’usurpations, de
trahisons, d’extorsions, d’exploitation, voire d’extermination (depuis,
n’a-t-on pas fermé ces hauts lieux de la colonisation des années
quarante et cinquante tels Gagnon et Schefferville?). Outre l’aspect des
misères de l’existence réelle, Beaulieu y voit la source des misères de
l’existence ima-ginaire: il cite cet auteur anonyme d’une monographie
du -siècle dernier qui proclame bien fort que les colons «se retournent
vers la terre natale et lui demandent cette heureuse mé-diocrité qui
fait le bonheur du sage (VLB.23).» Le régime seigneurial, pour sa part,
était déjà cette «vaste entreprise de patronage où les requins du
système trouvaient leur profit (VLB.21).» Ce n’est là ni une
information nouvelle ni une inter-prétation originale. Lorsqu’il parle
de la situation du colon un siècle plus tard, la répréhension morale se
fait encore plus virulente: «La vie quotidienne du colon, à la fin du
XIXe siècle, est un véritable abus de l’homme, la forme la plus
écœurante de l’exploitation que les politiciens crapuleux encourageaient
et glorifiaient avec un cynisme outrageant. Quant aux autres
propagandistes de la colonisation, ils étaient ou de grands naïfs, ou de
grands tatas, ou de grands incons-cients, sinon les trois en même
temps. C’est le cas notamment du curé Labelle, ce précurseur du
créditisme (VLB.24)…» Depuis, les thèses de Morissonneau 2 et de
Dussault 3 ont contredit la vision simpliste de la moralisation de
Beaulieu, mais il ne faut pas oublier que pour V.L.B., même si la
réalité objective de la misère du colon peut être nuancée par l’apport
de la recherche historique, le misérabilisme de l’imaginaire fantasmé
demeure: «Mais de là à dire qu’ils étaient colons par patriotisme et par
catholicisme, il y a une marge qui fut trop souvent franchie. La vérité
est plus prosaïque: on était colon parce qu’on n’avait pas le choix. On
était colon parce qu’on était illettré, parce qu’on n’avait pas une
toquenne pour quitter l’arrière-pays. On était et on restait colon parce
que le curé vous enfirouâpait en vous disant qu’il n’y avait rien comme
la pauvreté “pour avoir une belle place au ciel”. Cela n’a rien de très
romantique, la misère noire n’a jamais rien de très romantique
(VLB.24).» Que la misère noire n’ait rien de très romantique,
Morissonneau et Dussault ne peuvent qu’être d’accord avec cela. La
poursuite du misérabilisme de l’imaginaire traditionnel par Victor-Lévy
Beaulieu est une dénonciation d’un genre de vie rendu caduque par le
modernisme québécois des années quarante-cinquante mais que les élites
cléricales et les politiques de Duplessis continuent d’entretenir avec
nostalgie et édification. Dès le courant des années soixante, le
fantasme imaginaire apparaissait à ce point désuet que le «retour à la
nature» des années soixante-dix se transposa sur des valeurs moins
anachroniques tels le végétarisme, l’écologisme, le nu-disme et les
coopératives agricoles, valeurs pour la plupart égocentriques urbaines
et petites-bourgeoises, et très modernes! «C’est cela que les
monographies de paroisses nous apprennent – jusqu’à quel point on peut
se faire fourrer et être content de l’être. Et jusqu’à quel point se
faire fourrer ne pouvait être que normal quand on était Canadien
français et catholique, né pour un p’tit pain noir sur terre mais pour
une grande place dans le ciel de ce bon “bon Dieu” (VLB.30)…»
interprétation,
elle lance tout ce misérabilisme avec lequel l’auteur considère les
colons. Le colonialisme a toujours contenu, pour Beaulieu, ce chapelet
d’actions moralement répréhensibles de violations, d’usurpations, de
trahisons, d’extorsions, d’exploitation, voire d’extermination (depuis,
n’a-t-on pas fermé ces hauts lieux de la colonisation des années
quarante et cinquante tels Gagnon et Schefferville?). Outre l’aspect des
misères de l’existence réelle, Beaulieu y voit la source des misères de
l’existence ima-ginaire: il cite cet auteur anonyme d’une monographie
du -siècle dernier qui proclame bien fort que les colons «se retournent
vers la terre natale et lui demandent cette heureuse mé-diocrité qui
fait le bonheur du sage (VLB.23).» Le régime seigneurial, pour sa part,
était déjà cette «vaste entreprise de patronage où les requins du
système trouvaient leur profit (VLB.21).» Ce n’est là ni une
information nouvelle ni une inter-prétation originale. Lorsqu’il parle
de la situation du colon un siècle plus tard, la répréhension morale se
fait encore plus virulente: «La vie quotidienne du colon, à la fin du
XIXe siècle, est un véritable abus de l’homme, la forme la plus
écœurante de l’exploitation que les politiciens crapuleux encourageaient
et glorifiaient avec un cynisme outrageant. Quant aux autres
propagandistes de la colonisation, ils étaient ou de grands naïfs, ou de
grands tatas, ou de grands incons-cients, sinon les trois en même
temps. C’est le cas notamment du curé Labelle, ce précurseur du
créditisme (VLB.24)…» Depuis, les thèses de Morissonneau 2 et de
Dussault 3 ont contredit la vision simpliste de la moralisation de
Beaulieu, mais il ne faut pas oublier que pour V.L.B., même si la
réalité objective de la misère du colon peut être nuancée par l’apport
de la recherche historique, le misérabilisme de l’imaginaire fantasmé
demeure: «Mais de là à dire qu’ils étaient colons par patriotisme et par
catholicisme, il y a une marge qui fut trop souvent franchie. La vérité
est plus prosaïque: on était colon parce qu’on n’avait pas le choix. On
était colon parce qu’on était illettré, parce qu’on n’avait pas une
toquenne pour quitter l’arrière-pays. On était et on restait colon parce
que le curé vous enfirouâpait en vous disant qu’il n’y avait rien comme
la pauvreté “pour avoir une belle place au ciel”. Cela n’a rien de très
romantique, la misère noire n’a jamais rien de très romantique
(VLB.24).» Que la misère noire n’ait rien de très romantique,
Morissonneau et Dussault ne peuvent qu’être d’accord avec cela. La
poursuite du misérabilisme de l’imaginaire traditionnel par Victor-Lévy
Beaulieu est une dénonciation d’un genre de vie rendu caduque par le
modernisme québécois des années quarante-cinquante mais que les élites
cléricales et les politiques de Duplessis continuent d’entretenir avec
nostalgie et édification. Dès le courant des années soixante, le
fantasme imaginaire apparaissait à ce point désuet que le «retour à la
nature» des années soixante-dix se transposa sur des valeurs moins
anachroniques tels le végétarisme, l’écologisme, le nu-disme et les
coopératives agricoles, valeurs pour la plupart égocentriques urbaines
et petites-bourgeoises, et très modernes! «C’est cela que les
monographies de paroisses nous apprennent – jusqu’à quel point on peut
se faire fourrer et être content de l’être. Et jusqu’à quel point se
faire fourrer ne pouvait être que normal quand on était Canadien
français et catholique, né pour un p’tit pain noir sur terre mais pour
une grande place dans le ciel de ce bon “bon Dieu” (VLB.30)…»Ce mépris de nous-mêmes se manifestant d’abord dans la vision des faits, se poursuit par l’idéologique à travers le recours à des valeurs justificatives proprement aberrantes. Cette dégradation du tissu social et du fantasme imaginaire est dressée en négatif devant ce modèle positif qu’est l’Amérindien. Plus que le bon sauvage, l’Amérindien des Ferron, Bergeron et Beaulieu est le roi de cet âge d’or hésiodique, perdu et avili par le colonialisme. L’Amérindien est l’ancien Grec des Québécois: «…leur vestimentaire laissait à désirer, mais ils attachaient à la Parole toute son importance. Nus ou revêtus de peaux de bêtes, ils étaient des Athéniens comparés aux Mistigoches 4 . “La démocratie brillait chez eux dans tout son éclat”, écrit l’abbé
 Ferland…
Le peuple était libre, chaque bourgade indépendante, tout chef de
famille maître de ses actions et “dans la cabane chaque enfant réclamait
une liberté presque illimitée. Cette masse de liberté était bien propre
à embarrasser la marche des affaires; aussi les chefs avaient besoin
d’une grande habileté pour les diriger, n’ayant d’autres moyens à leur
disposition que la persuasion, la libéralité et la confiance qu’ils
pouvaient inspirer”. Il n’était pas aisé de garder la cabane achevée 5;
sa perfection restait précaire. Mais le système offrait l’avantage de
former de grands orateurs, des politiciens avertis, des hommes
supérieurement intelligents. Il était humain; il a d’ailleurs prévalu
sur celui que l’Europe nous proposait à la même époque (F.50).» Inspiré
de l’abbé Ferland, le texte de Ferron n’avoue pas tout ce qu’il doit à
l’iconographie française de l’Arcadie perdue des toiles d’un Poussin ou
d’un Lorrain faites pour les yeux du roi et de la cour de Versailles,
pas plus que la résonnance de son apologie de la «démocratie» iroquoise
avec la thèse évolutionniste de l’ethnologue américain Lewis Morgan (Ancient Society,
1877), pour qui, abandonnée à son évolution, la Confédération iroquoise
aurait conduit à un système de gentes semblable à celui que nous
retrouvons chez les Grecs des temps homériques. Il est vrai que l’abbé
Ferland est mort dix ans avant la parution de l’ouvrage de Morgan, mais
Ferland était un auteur documenté et s’il n’avait pas de claires idées
sur un évolutionnisme ethnologique quasi-darwinien, du moins
postulait-il, comme Morgan, «l’unité psychique de l’homme»6. Parlant de
la «théologie» amérindienne de la création du monde, Ferland écrivait:
«Ces récits de la création du monde et de l’origine de l’homme, quelque
extravagants qu’ils puissent paraître, sont aussi raisonnables que les
fables débitées sur les mêmes sujets, par les peuples civilisés de
l’ancienne Grèce et de la vieille Italie.»7 Cette «unité psychique de
l’homme» n’était pas pour déplaire au docteur Ferron ni à Victor
Lévy-Beaulieu: «Ce n’est pas l’un de leurs moindres mérites [aux écrits
missionnaires] que de faire état des choses amérindiennes, et rarement
pour les dénigrer. L’apport des Amérindiens à la socialisation du Québec
n’est pas marginal. Il faut d’abord se rappeler que ce sont eux qui ont
nommé de ce pays, ce que trop de nos poètes ont paraît-il oublié, qui
ont passé leur vie à essayer de le faire dans l’ignorance de leur propre
culture. Les Amérindiens nommaient bellement et justement les choses.
Mon Dieu! quelle différence d’avec le langage des Blancs évan-gélisant
jusqu’aux montagnes, sanctifiant les cours d’eau et exorcisant les lieux
communs (VLB.211)!»
Ferland…
Le peuple était libre, chaque bourgade indépendante, tout chef de
famille maître de ses actions et “dans la cabane chaque enfant réclamait
une liberté presque illimitée. Cette masse de liberté était bien propre
à embarrasser la marche des affaires; aussi les chefs avaient besoin
d’une grande habileté pour les diriger, n’ayant d’autres moyens à leur
disposition que la persuasion, la libéralité et la confiance qu’ils
pouvaient inspirer”. Il n’était pas aisé de garder la cabane achevée 5;
sa perfection restait précaire. Mais le système offrait l’avantage de
former de grands orateurs, des politiciens avertis, des hommes
supérieurement intelligents. Il était humain; il a d’ailleurs prévalu
sur celui que l’Europe nous proposait à la même époque (F.50).» Inspiré
de l’abbé Ferland, le texte de Ferron n’avoue pas tout ce qu’il doit à
l’iconographie française de l’Arcadie perdue des toiles d’un Poussin ou
d’un Lorrain faites pour les yeux du roi et de la cour de Versailles,
pas plus que la résonnance de son apologie de la «démocratie» iroquoise
avec la thèse évolutionniste de l’ethnologue américain Lewis Morgan (Ancient Society,
1877), pour qui, abandonnée à son évolution, la Confédération iroquoise
aurait conduit à un système de gentes semblable à celui que nous
retrouvons chez les Grecs des temps homériques. Il est vrai que l’abbé
Ferland est mort dix ans avant la parution de l’ouvrage de Morgan, mais
Ferland était un auteur documenté et s’il n’avait pas de claires idées
sur un évolutionnisme ethnologique quasi-darwinien, du moins
postulait-il, comme Morgan, «l’unité psychique de l’homme»6. Parlant de
la «théologie» amérindienne de la création du monde, Ferland écrivait:
«Ces récits de la création du monde et de l’origine de l’homme, quelque
extravagants qu’ils puissent paraître, sont aussi raisonnables que les
fables débitées sur les mêmes sujets, par les peuples civilisés de
l’ancienne Grèce et de la vieille Italie.»7 Cette «unité psychique de
l’homme» n’était pas pour déplaire au docteur Ferron ni à Victor
Lévy-Beaulieu: «Ce n’est pas l’un de leurs moindres mérites [aux écrits
missionnaires] que de faire état des choses amérindiennes, et rarement
pour les dénigrer. L’apport des Amérindiens à la socialisation du Québec
n’est pas marginal. Il faut d’abord se rappeler que ce sont eux qui ont
nommé de ce pays, ce que trop de nos poètes ont paraît-il oublié, qui
ont passé leur vie à essayer de le faire dans l’ignorance de leur propre
culture. Les Amérindiens nommaient bellement et justement les choses.
Mon Dieu! quelle différence d’avec le langage des Blancs évan-gélisant
jusqu’aux montagnes, sanctifiant les cours d’eau et exorcisant les lieux
communs (VLB.211)!»Mais Ferron ne partage pas le mépris des missionnaires qu’affiche son puîné. Les Jésuites, par exemple, sont encensés par le docteur qui n’hésite pas à assumer une contradiction apparente: «C’est un grand scandale pour le mécréant que je suis, une infamie du catholicisme européen que l’abolition de l’ordre des Jésuites, les premiers à mettre Dieu au-dessus de la suprématie de la race blanche. Voltaire contre eux, c’était régulier, mais le pape! Et l’on oublie un peu trop que ces hommes furent bien près de transformer le monde et de réussir ce que l’on tente aujourd’hui. Ils devançaient leur siècle. Au fait des
 choses, presque cyniques, ils étaient néanmoins les fous de Dieu. Leur Huronnie,
il ne s’est rien fait de plus beaux en Amérique du Nord. Qu’on nous
fiche la paix avec les méchants Iroquois! Ces Iroquois ne furent que des
comparses et victimes eux aussi d’un malentendu tragique. Ces jésuites
furent saints par eux-mêmes, un point, c’est tout (F.29-30).» Ferron
entend déplacer l’intérêt idéologique du martyre et des luttes indiennes
où périrent les Jésuites vers l’utopie sociale envisagée par ceux-ci
dans leur projet de la Huronnie. Ce passage est l’un des plus importants
idéologiquement, car il nous renseigne sur le projet social même de
Ferron face au Québec de son temps: en faire une sorte de nouvelle
Huronnie, petite société autonome (politiquement souveraine), autarcique
(vivant de la production de ses propres biens) et communautaire
(cherchant l’équilibre social par une égalité la plus parfaite possible
entre ses membres). Il ne faut donc pas s’étonner que le docteur Ferron
se soit retiré du N.P.D. fédéral et n’ait pas rejoint les groupes
nationalistes québécois. Son utopie se situait en dehors de leurs
paramètres idéologiques.
choses, presque cyniques, ils étaient néanmoins les fous de Dieu. Leur Huronnie,
il ne s’est rien fait de plus beaux en Amérique du Nord. Qu’on nous
fiche la paix avec les méchants Iroquois! Ces Iroquois ne furent que des
comparses et victimes eux aussi d’un malentendu tragique. Ces jésuites
furent saints par eux-mêmes, un point, c’est tout (F.29-30).» Ferron
entend déplacer l’intérêt idéologique du martyre et des luttes indiennes
où périrent les Jésuites vers l’utopie sociale envisagée par ceux-ci
dans leur projet de la Huronnie. Ce passage est l’un des plus importants
idéologiquement, car il nous renseigne sur le projet social même de
Ferron face au Québec de son temps: en faire une sorte de nouvelle
Huronnie, petite société autonome (politiquement souveraine), autarcique
(vivant de la production de ses propres biens) et communautaire
(cherchant l’équilibre social par une égalité la plus parfaite possible
entre ses membres). Il ne faut donc pas s’étonner que le docteur Ferron
se soit retiré du N.P.D. fédéral et n’ait pas rejoint les groupes
nationalistes québécois. Son utopie se situait en dehors de leurs
paramètres idéologiques.À plusieurs reprises, Ferron revient sur l’action des Jésuites en Huronnie: «On peut leur adresser bien des reproches; je crois même qu’on l’a fait. Il n’empêche qu’ils ont été des missionnaires admirables. “Les conquérants, a écrit un protestant, n’avaient eu d’autre objet que de dépouiller, enchaîner, exterminer les habitants de l’Amérique. Les Jésuites, seuls s’y sont établis dans des vues d’humanité.” (F.80)» Robert Migner a raison de souligner que Ferron, qui ne pouvait pas ne pas le savoir, passe délibérément sous silence les activités commerciales des Jésuites.8 Léandre Bergeron et Victor-Lévy Beaulieu, eux, ne l’oublieront pas. Cela démontre à quel point il est difficile de faire son deuil du souvenir de «l’épopée mystique» tant cet idéal nous reste collé à la peau (et à l’âme) et recouvre idéologiquement nos intérêts «nationaux».
L’entreprise des Jésuites lui tient tellement à cœur qu’il les associe avec son héros
 romanesque, Cyrano de Bergerac.
Pas celui de Rostand, mais le vrai, l’écrivain de fiction du XVIIe
siècle qui invente l’un des premiers voyages vers la lune. Ferron
rappelle le passage où le navigateur de l’espace de Cyrano se retrouve à
Kebek, et dialogue avec les Jésuites. Ceux-ci «ont cheminé par la même
voie et dans la même direction, eux vers la réunion des hommes, lui vers
leur appartenance à l’Univers» (F.102). Les Jésuites, c’est la
religion, cette mer traversée par le christianisme post tridentin, ce
catholicisme héroïque «se réa-lisant contre le monde (F.170).» Ce sont
les Jésuites d’abord, puis le flux de congrégations religieuses
déversées ou créées ici-même qui rythment le mouvement baroque en
entretenant le réglage du cosmos canadien-français, substituant le
mouvement organique vivant au mouvement mécanique, entropique des
systèmes. Ancien du collège Brébeuf de Montréal, Ferron rend hommage à
ceux qui l’ont inséré dans le mouvement baroque des Canadiens français,
aujourd’hui Québécois. Mais il y a aussi Cyrano. Cyrano le poète, mais
aussi Cyrano l’inventeur, le technicien, l’explorateur, celui qui
jumelle rêve et science et qui dit que sans le rêve, la science n’est
que de la technique, celle-là même qui a donné une heure trompeuse à
l’horloge de l’Univers. Ce voyageur égaré aux portes de Québec devient
l’achétype du petit professionel (le médecin dans ce cas bien
particulier), ou de tout homme de savoir. Là où les Jésuites étendent le
mouvement, Cyrano l’élève jusqu’au Cosmos. C’est la rencontre de Dieu
et de l’Univers créé, la convergence des deux mysticismes relançant le
mouvement vers le zénith du monde. Ferron se sent issu de cette
rencontre des Jésuites du Régime français et de cet ancêtre de son ordre
social; de là naîtront ceux qui résisteront au colonialisme anglais,
les vrais patriotes de 37-38 et ceux qui feront en son temps, du Québec
indépendant et socialisant, la nouvelle Huronnie. «Notre âme qui s’élève
élève l’humanité (VLB.187)», écrivait le jeune apprenti-missionnaire
Gérard Raymond qui, en plus de prier, faisait aussi de la chimie…
romanesque, Cyrano de Bergerac.
Pas celui de Rostand, mais le vrai, l’écrivain de fiction du XVIIe
siècle qui invente l’un des premiers voyages vers la lune. Ferron
rappelle le passage où le navigateur de l’espace de Cyrano se retrouve à
Kebek, et dialogue avec les Jésuites. Ceux-ci «ont cheminé par la même
voie et dans la même direction, eux vers la réunion des hommes, lui vers
leur appartenance à l’Univers» (F.102). Les Jésuites, c’est la
religion, cette mer traversée par le christianisme post tridentin, ce
catholicisme héroïque «se réa-lisant contre le monde (F.170).» Ce sont
les Jésuites d’abord, puis le flux de congrégations religieuses
déversées ou créées ici-même qui rythment le mouvement baroque en
entretenant le réglage du cosmos canadien-français, substituant le
mouvement organique vivant au mouvement mécanique, entropique des
systèmes. Ancien du collège Brébeuf de Montréal, Ferron rend hommage à
ceux qui l’ont inséré dans le mouvement baroque des Canadiens français,
aujourd’hui Québécois. Mais il y a aussi Cyrano. Cyrano le poète, mais
aussi Cyrano l’inventeur, le technicien, l’explorateur, celui qui
jumelle rêve et science et qui dit que sans le rêve, la science n’est
que de la technique, celle-là même qui a donné une heure trompeuse à
l’horloge de l’Univers. Ce voyageur égaré aux portes de Québec devient
l’achétype du petit professionel (le médecin dans ce cas bien
particulier), ou de tout homme de savoir. Là où les Jésuites étendent le
mouvement, Cyrano l’élève jusqu’au Cosmos. C’est la rencontre de Dieu
et de l’Univers créé, la convergence des deux mysticismes relançant le
mouvement vers le zénith du monde. Ferron se sent issu de cette
rencontre des Jésuites du Régime français et de cet ancêtre de son ordre
social; de là naîtront ceux qui résisteront au colonialisme anglais,
les vrais patriotes de 37-38 et ceux qui feront en son temps, du Québec
indépendant et socialisant, la nouvelle Huronnie. «Notre âme qui s’élève
élève l’humanité (VLB.187)», écrivait le jeune apprenti-missionnaire
Gérard Raymond qui, en plus de prier, faisait aussi de la chimie…«Burn-out» collectif
Nous franchissons à présent le seuil critique de la
 Conquête
de 1760. «L’un des grands méfaits de la Conquête, écrit Victor-Lévy
Beaulieu, fut, non pas la ruine de la colonie, mais sa démoralisation
(VLB.59).» Le mot, pour la première fois, est lâché. Le conquérant
anglais et le clergé catholique se liguent comme pour permettre au
mouvement baroque de se poursuivre (c’est l’intérêt du clergé
catholique) tout en déréglant à nouveau l’horloge du cosmos et en
empêchant, coûte que coûte, l’élévation intellectuelle et politique des
Québécois (ou des Canayens), et c’est là l’intérêt du colonisateur
anglais, de ces exploiteurs qui «sont les ancêtres de nos exploiteurs
anglophones contemporains installés sur la montagne et ses abords, à
Westmount, Hampstead, Town of Mount-Royal (B.55).»
Conquête
de 1760. «L’un des grands méfaits de la Conquête, écrit Victor-Lévy
Beaulieu, fut, non pas la ruine de la colonie, mais sa démoralisation
(VLB.59).» Le mot, pour la première fois, est lâché. Le conquérant
anglais et le clergé catholique se liguent comme pour permettre au
mouvement baroque de se poursuivre (c’est l’intérêt du clergé
catholique) tout en déréglant à nouveau l’horloge du cosmos et en
empêchant, coûte que coûte, l’élévation intellectuelle et politique des
Québécois (ou des Canayens), et c’est là l’intérêt du colonisateur
anglais, de ces exploiteurs qui «sont les ancêtres de nos exploiteurs
anglophones contemporains installés sur la montagne et ses abords, à
Westmount, Hampstead, Town of Mount-Royal (B.55).»Un double-standard partage la colonie : «Le Haut-Canada est le district des Loyalistes, le Bas-Canada est la colonie des Canayens (B.68).» La genèse du régime anglais permet le même chapelet de répréhensions morales que lors du récit des débuts du régime français. L’exploité désormais ne sera plus seulement, ni même principalement, l’Amérindien, mais davantage le Canayen, l’habitant français replié sur ses terres et le professionnel qui essaie de servir au mieux les intérêts de la collectivité conquise. Avec le temps, l’exploiteur ne sera plus le colonial anglais, mais le gouvernement canadien: «La dépendance des provinces vis-à-vis Ottawa est assurée dès le début et s’accentura avec les années et surtout durant des périodes de crises (guerres mondiales, dépressions économiques). Les pro-vinces sont en fait des colonies du fédéral. Mais le fédéral lui-même demeure, au niveau politique, colonie de la Grande-Bretagne (B.146)…» L’oppresseur final, c’est l’Américain: «Sous le premier ministre Marchand, les capitalistes américains sont invités à venir nous exploiter (B.176).»
Mais la démoralisation vient surtout de ce jeu stratégique que Bergeron prête au colonisateur anglais: «Il est à remarquer que la puissance coloniale alterne systématiquement entre un gouvernement tyrannique et un gouvernement conciliant… Il ne faut pas être leurré par “l’erreur” de nommer un gouverneur tyrannique et la «bonne volonté» de nommer un gouverneur conciliant. Les deux font partie d’une stratégie de domination. C’est la technique de la carotte et du bâton. Si le bâton ne marche pas pour “gagner” les colonisés à être de bons colonisés, essayons la carotte, le bonbon. Si la carotte ne marche pas on pourra toujours revenir au bâton. Cette technique, on l’a bien connue au Québec, surtout durant cette période où les Canayens ont combattu leurs oppresseurs avec acharnement (B.86).» Une telle explication relève du délire paranoïaque de persécution. Il est surtout infantilisant. Le colonisé, le Canayen est manipulé par l’exploiteur anglais comme une bête qui suffit d’échauffer ou de refroidir pour le faire fonctionner à sa main. Derrière cette vision du conquérant se cache un jugement que l’on porte sur soi-même: celui-ci est démoralisateur car il souligne l’inconstance, la docilité et la lâcheté des Québécois qui se laissent utiliser et malmener à leur guise, alors qu’en réalité leurs ancêtres «ont combattu leurs oppresseurs avec acharnement»! La réprimande de Bergeron se retourne contre les opprimés d’aujourd’hui, des années soixante, et à plus forte raison des années qui suivirent, puisque le jour où le militantisme de gauche, enfin parvenu au pouvoir, reprend à son compte la tactique dénoncée de la carotte et du bâton, il ne la retourne pas contre les oppresseurs impérialistes mais contre le petit peuple qui lui a fait confiance.9
Le premier de ces retournements est imputé au clergé/roi nègre. Le clergé est le premier grand
 traître,
le grand corrupteur de la destinée québécoise. En collaborant, il
protège et mousse ses propres intérêts au détriment de l’émancipation de
la collectivité. Les colonisateurs anglais «ont besoin d’un
intermédiaire pour gouverner les Canayens. C’est le rôle que le clergé se donne. Il devient le porte-parole et le représentant officiel des Canayens
auprès du Conquérant. Il devient le roi-nègre de la colonie. Dès la
capitulation, les Ursulines tricotèrent des bas de laine pour les
soldats écossais. Les curés collaborèrent avec le capitaine de milice
pour faire signer aux habitants le serment d’allégeance et leur
confisquer leurs fusils. Monseigneur Briand, vicaire général, déclara
comme un roi-nègre typique: “Ces nobles vainqueurs ne vous parurent-ils
pas, dès qu’ils furent nos maîtres, oublier qu’ils avaient été nos
ennemis, pour ne s’occuper que de vos besoins et des moyens d’y
subvenir?” (B.54)…» Les bas de laine, les fusils et les déclarations
laudatives du monseigneur ont toutes la même fonction morale:
discréditer l’action du clergé devant le conquérant. Idéologiquement, il
s’agit d’appuyer d’un effet répulsif le rôle assimilateur attribué au
clergé: «Cette élite vendue, comme celle de tout peuple colonisé va
chercher à oublier et à faire oublier au peuple la réalité de sa
défaite, sa déchéance, sa sujétion, en fabriquant des mythes qui
deviendront l’idéologie officielle que cette élite propagera dans le
peuple (B.113).» Puis Bergeron se lance dans un réquisitoire virulent
contre l’action du clergé, qui détourne le peuple des activités
commerciales pour le lancer dans de fausses entreprises missionnaires
qui n’ont, à ses yeux, rien d’édifiant: «Pendant que le peuple, vaincu
deux fois, croupit dans la misère, se fait exploiter économiquement par
les marchands anglais, le clergé va expédier nos jeunes les plus doués
comme missionnaires en Afrique, en Asie et dans l’Arctique. Nos
meilleurs intelligences apprennent le grec, le latin, la philosophie
catholique, la théologie médiévale pour aller perpétuer le colonialisme
blanc anglais en Chine au Basutoland et dans les pays esquimaux… Le
clergé réussira
traître,
le grand corrupteur de la destinée québécoise. En collaborant, il
protège et mousse ses propres intérêts au détriment de l’émancipation de
la collectivité. Les colonisateurs anglais «ont besoin d’un
intermédiaire pour gouverner les Canayens. C’est le rôle que le clergé se donne. Il devient le porte-parole et le représentant officiel des Canayens
auprès du Conquérant. Il devient le roi-nègre de la colonie. Dès la
capitulation, les Ursulines tricotèrent des bas de laine pour les
soldats écossais. Les curés collaborèrent avec le capitaine de milice
pour faire signer aux habitants le serment d’allégeance et leur
confisquer leurs fusils. Monseigneur Briand, vicaire général, déclara
comme un roi-nègre typique: “Ces nobles vainqueurs ne vous parurent-ils
pas, dès qu’ils furent nos maîtres, oublier qu’ils avaient été nos
ennemis, pour ne s’occuper que de vos besoins et des moyens d’y
subvenir?” (B.54)…» Les bas de laine, les fusils et les déclarations
laudatives du monseigneur ont toutes la même fonction morale:
discréditer l’action du clergé devant le conquérant. Idéologiquement, il
s’agit d’appuyer d’un effet répulsif le rôle assimilateur attribué au
clergé: «Cette élite vendue, comme celle de tout peuple colonisé va
chercher à oublier et à faire oublier au peuple la réalité de sa
défaite, sa déchéance, sa sujétion, en fabriquant des mythes qui
deviendront l’idéologie officielle que cette élite propagera dans le
peuple (B.113).» Puis Bergeron se lance dans un réquisitoire virulent
contre l’action du clergé, qui détourne le peuple des activités
commerciales pour le lancer dans de fausses entreprises missionnaires
qui n’ont, à ses yeux, rien d’édifiant: «Pendant que le peuple, vaincu
deux fois, croupit dans la misère, se fait exploiter économiquement par
les marchands anglais, le clergé va expédier nos jeunes les plus doués
comme missionnaires en Afrique, en Asie et dans l’Arctique. Nos
meilleurs intelligences apprennent le grec, le latin, la philosophie
catholique, la théologie médiévale pour aller perpétuer le colonialisme
blanc anglais en Chine au Basutoland et dans les pays esquimaux… Le
clergé réussira  même à mobiliser 135 zouaves
en 1867 pour aller défendre les biens temporels du pape l’année même où
le colonisateur rédigeait dans une cons-titution son occupation pour
une période indéfinie de notre territoire national (B.114).» Ce
réquisitoire contre le clergé est sans doute l’extrait qui exprime le
mieux l’inadéquation des valeurs morales du discours traditionnel face
aux modernisations accomplies au cours de la décennie 1960. Ce sont des
reproches actuels que Bergeron projette sur le passé. Que ce soit aux
lendemains de la Conquête de 1760 ou des défaites militaires des
rébellions de 37-38, le clergé joue toujours le même rôle d’éteignoir
des velléités rebelles et de laudateur de l’administration «généreuse»
du colonisateur. Dans des termes qui rappellent les écrits fort à la
mode à l’époque de Frantz Fanon et d’Albert Memmi, Bergeron présente le
clergé comme un étouffeur des forces vives, une sorte de vampire de
l’intelligence et de la liberté des Canayens-Québécois. Le mensonge est
le produit de l’instruction et la culture en est une de rapetissement à
l’intérieur des cadres idéologiques d’un nationalisme rétrograde: «Le
clergé comprit, lors de la Rébellion, la force du nationalisme. Le
clergé vit des habitants mourir pour la liberté du Québec. Le clergé
comprit qu’il fallait s’emparer du nationalisme des Canayens pour les tenir sous sa tutelle. C’est pour cela qu’elle exigea que Garneau dise dans son “Histoire” que le peuple canayen
ne pouvait pas survivre sans la foi catholique, c’est-à-dire sans le
clergé. Il répandit l’idée dès cette époque que “c’est grâce au clergé
que les Canayens existent
toujours”. On entend encore aujourd’hui cette grossière fabrication.
Mais la vérité est ailleurs (B.136)…» Les intellectuels québécois sont
les pantins du clergé et c’est en considérant la manipulation comme
personnelle que Bergeron condamne le rôle du clergé. Les intellectuels
et le peuple sont les jouets d’une même force de contrôle de la pensée
et le clergé fait figure de barrière infranchissable entre la situation
de colonisé que nous vivons collectivement et la liberté qu’entendent
apporter les idéologues de la Révolution tranquille. Le pattern observé
dans les guerres de décolonisation des pays du «Tiers-Monde» est
transposé au cas québécois, mais la démoralisation imprègne beaucoup
plus profondément l’énoncé de l’historien. La force d’inertie que
représente le peuple mené par la carotte et le bâton conjuguée à
l’action dissolvante du clergé appelle, chez Bergeron, la praxis
d’un renversement de l’ordre clérical comme préalable à toute action
vraiment libératoire. Les intérêts de Bergeron sont associés ici à ceux
du peuple. En chassant les curés et les bonnes sœurs, Léandre Bergeron
ne pensait pas préparer le lit des nouveaux technocrates d’État et
d’Université. En passant de l’Église à l’État, en troquant le collet
romain pour le col blanc – la couleur restant la même, en fait, il n’y a
pas de couleur! –, nos nouveaux intellectuels ont vite appris à dormir
dans de vieux lits saint-sulpiciens recouverts d’une couette
d’idéologies modernisantes.
même à mobiliser 135 zouaves
en 1867 pour aller défendre les biens temporels du pape l’année même où
le colonisateur rédigeait dans une cons-titution son occupation pour
une période indéfinie de notre territoire national (B.114).» Ce
réquisitoire contre le clergé est sans doute l’extrait qui exprime le
mieux l’inadéquation des valeurs morales du discours traditionnel face
aux modernisations accomplies au cours de la décennie 1960. Ce sont des
reproches actuels que Bergeron projette sur le passé. Que ce soit aux
lendemains de la Conquête de 1760 ou des défaites militaires des
rébellions de 37-38, le clergé joue toujours le même rôle d’éteignoir
des velléités rebelles et de laudateur de l’administration «généreuse»
du colonisateur. Dans des termes qui rappellent les écrits fort à la
mode à l’époque de Frantz Fanon et d’Albert Memmi, Bergeron présente le
clergé comme un étouffeur des forces vives, une sorte de vampire de
l’intelligence et de la liberté des Canayens-Québécois. Le mensonge est
le produit de l’instruction et la culture en est une de rapetissement à
l’intérieur des cadres idéologiques d’un nationalisme rétrograde: «Le
clergé comprit, lors de la Rébellion, la force du nationalisme. Le
clergé vit des habitants mourir pour la liberté du Québec. Le clergé
comprit qu’il fallait s’emparer du nationalisme des Canayens pour les tenir sous sa tutelle. C’est pour cela qu’elle exigea que Garneau dise dans son “Histoire” que le peuple canayen
ne pouvait pas survivre sans la foi catholique, c’est-à-dire sans le
clergé. Il répandit l’idée dès cette époque que “c’est grâce au clergé
que les Canayens existent
toujours”. On entend encore aujourd’hui cette grossière fabrication.
Mais la vérité est ailleurs (B.136)…» Les intellectuels québécois sont
les pantins du clergé et c’est en considérant la manipulation comme
personnelle que Bergeron condamne le rôle du clergé. Les intellectuels
et le peuple sont les jouets d’une même force de contrôle de la pensée
et le clergé fait figure de barrière infranchissable entre la situation
de colonisé que nous vivons collectivement et la liberté qu’entendent
apporter les idéologues de la Révolution tranquille. Le pattern observé
dans les guerres de décolonisation des pays du «Tiers-Monde» est
transposé au cas québécois, mais la démoralisation imprègne beaucoup
plus profondément l’énoncé de l’historien. La force d’inertie que
représente le peuple mené par la carotte et le bâton conjuguée à
l’action dissolvante du clergé appelle, chez Bergeron, la praxis
d’un renversement de l’ordre clérical comme préalable à toute action
vraiment libératoire. Les intérêts de Bergeron sont associés ici à ceux
du peuple. En chassant les curés et les bonnes sœurs, Léandre Bergeron
ne pensait pas préparer le lit des nouveaux technocrates d’État et
d’Université. En passant de l’Église à l’État, en troquant le collet
romain pour le col blanc – la couleur restant la même, en fait, il n’y a
pas de couleur! –, nos nouveaux intellectuels ont vite appris à dormir
dans de vieux lits saint-sulpiciens recouverts d’une couette
d’idéologies modernisantes.Cette action néfaste du clergé se retrouve dans les ouvrages de Ferron et de Beaulieu. Tout ce que fait cette coalition perverse du colonisateur et du clergé appartient à la trame d’un
 complot. La Confédération,
chez Ferron par exemple, consiste à «pousser la traque coast to coast…
La Confédération, c’est ça, rien de plus (F.30)». «Que le Québec en ait
d’abord bénéficié, on se l’explique: on avait besoin de lui. Pour ce
qu’il était d’abord. Ensuite pour ce qu’il représentait dans l’Ouest.
Dans l’Ouest, le bison n’avait pas encore été exterminé. Les Amérindiens
restaient une force. On avait besoin pour les amadouer de la présence
française. À cause de cela on fut gentil pour le Québec; on lui accorda
quelques satisfactions, en prenant bien soin toutefois de privilégier la
minorité anglaise (F.30-31).» Il n’est pas aussi certain que les choses
se soient passées tout à fait de cette façon! Ou bien le Québec est
partie prenante dans la Confédération, ou bien il n’est qu’un jouet dans
les mains des puissances coloniales qui visent à réduire les
Amérindiens. La Confédération se réduit-elle vraiment à une stratégie de
manipulation de la population francophone pour réduire la force
potentielle des Amérindiens dans la compétition que les Canadiens
anglais livrent aux Américains dans l’expansion vers l’Ouest? Voilà un
autre élément qui témoigne de la démoralisation culturelle des années
soixante. Le problème de la non appartenance du Québec dans le projet
canadien ne se posait pas particulièrement pour Georges-Etienne Cartier
ni pour John A. Macdonald, mais il interpelle grandement la génération
des Québécois des années soixante qui ne seront jamais satisfaits de
leur place dans le Canada, quelle qu’elle soit.
complot. La Confédération,
chez Ferron par exemple, consiste à «pousser la traque coast to coast…
La Confédération, c’est ça, rien de plus (F.30)». «Que le Québec en ait
d’abord bénéficié, on se l’explique: on avait besoin de lui. Pour ce
qu’il était d’abord. Ensuite pour ce qu’il représentait dans l’Ouest.
Dans l’Ouest, le bison n’avait pas encore été exterminé. Les Amérindiens
restaient une force. On avait besoin pour les amadouer de la présence
française. À cause de cela on fut gentil pour le Québec; on lui accorda
quelques satisfactions, en prenant bien soin toutefois de privilégier la
minorité anglaise (F.30-31).» Il n’est pas aussi certain que les choses
se soient passées tout à fait de cette façon! Ou bien le Québec est
partie prenante dans la Confédération, ou bien il n’est qu’un jouet dans
les mains des puissances coloniales qui visent à réduire les
Amérindiens. La Confédération se réduit-elle vraiment à une stratégie de
manipulation de la population francophone pour réduire la force
potentielle des Amérindiens dans la compétition que les Canadiens
anglais livrent aux Américains dans l’expansion vers l’Ouest? Voilà un
autre élément qui témoigne de la démoralisation culturelle des années
soixante. Le problème de la non appartenance du Québec dans le projet
canadien ne se posait pas particulièrement pour Georges-Etienne Cartier
ni pour John A. Macdonald, mais il interpelle grandement la génération
des Québécois des années soixante qui ne seront jamais satisfaits de
leur place dans le Canada, quelle qu’elle soit.Ferron passe très vite sur la Confédération, comme il passe très vite sur la Rébellion de 37-38. Il en parle surtout pour l’opposer à la supercherie historiographique que représente la Nouvelle-France. À Dollard, faux héros, il préfère Chénier, patriote authentique. Les nuances apparaissent sous la plume de Léandre Bergeron: «La Rébellion était une tentative de Révolution française ici. C’était la tentative de rattacher le Québec à l’évolution historique du monde occidental. En France, en Angleterre, aux États-Unis, la classe bourgeoise avait réussi à partager le pouvoir avec la monarchie si elle n’avait pas réussi à l’assumer complètement (B.110).» Le patriotisme de Ferron dévie ici sur la suspicion de Bergeron concernant les intérêts de classe de la petite-bourgeoisie. Aussi, le projet révolutionnaire de 1837 perd-il de la pureté de ses idéaux et de la netteté de ses aspirations: «Au Québec, la petite bourgeoisie, les professions libérales surtout, voulait elle aussi réintégrer l’histoire, revenir dans le courant historique de l’époque en faisant une révolution bourgeoise. Pour cela il lui fallait mobiliser le peuple, renverser le pouvoir colonial, déclarer l’indépendance, réduire le rôle et l’influence du clergé et s’établir, elle, comme bourgeoisie, à la direction de l’État canayen. Les luttes dans l’Assemblée entre 1800 et 1837 avaient été une tentative de s’emparer du pouvoir graduellement, par la voie légale. La Rébellion était la tentative de prise de pouvoir mais par la lutte armée, après l’échec de la voie légale (B.110).» De Ferron à Bergeron, le soupçon remonte le cours du temps historique du Québec. Avec Bergeron,
 la Rébellion perd cette valeur de consensus national, de patriotisme que lui attribuait Ferron dans ses Historiettes,
pour se réduire à une lutte de factions rivales cherchant à dominer et à
exploiter l’habitant et le travailleur québécois. Il s’agit moins ici
de respecter les canons de l’interprétation marxiste que de mettre en
garde ses lecteurs contre les manipulations stratégiques des classes
politiques actuelles: «Les habitants qui ont versé leur sang pour
produire un tel échec, ont été profondément déçus se sont sentis trahis,
se sont repliés sur eux-mêmes, se sont résignés à leur sort de
colonisés, d’hommes toujours diminués, réduits au rôle de porteurs d’eau
nés pour un petit pain. L’effort des habitants durant la Rébellion a
été si grand que l’échec les a abattus pour un siècle (B.112).» Une
telle déception s’avère aujourd’hui désastreuse! La vision historique de
Bergeron tend vers la répétition cyclique quand il écrit: «Pour le
R.I.N., les Québé-cois ne devraient plus être dominés par la bourgeoisie
cana-dienne-anglaise avec son centre de domination politique à Ottawa.
La bourgeoisie québécoise devait assumer son rôle de bourgeoisie
nationale indépendante de toute autre bourgeoisie. C’étaient nos
nouveaux Patriotes (B.232).» On devine le ton de mise en garde que prend
le rapprochement! Bien qu’elle soit proche parente de celles véhiculées
par le sociologue Gilles Bourque 10 et l’historien Stanley Bréhaut
Ryerson, 11 il manque à l’analyse idéologique de Bergeron sur la
rébellion de 37-38 des nuances essentielles pour s’élever vers une
véritable sociologie des mouvements de contestation au Québec. Le
parallèle qu’on peut établir entre la façon dont il explique le rôle
historique de Louis-Joseph Papineau et l’interprétation politique qu’il
donne de celui de René Lévesque se montre encore plus révélateur.
la Rébellion perd cette valeur de consensus national, de patriotisme que lui attribuait Ferron dans ses Historiettes,
pour se réduire à une lutte de factions rivales cherchant à dominer et à
exploiter l’habitant et le travailleur québécois. Il s’agit moins ici
de respecter les canons de l’interprétation marxiste que de mettre en
garde ses lecteurs contre les manipulations stratégiques des classes
politiques actuelles: «Les habitants qui ont versé leur sang pour
produire un tel échec, ont été profondément déçus se sont sentis trahis,
se sont repliés sur eux-mêmes, se sont résignés à leur sort de
colonisés, d’hommes toujours diminués, réduits au rôle de porteurs d’eau
nés pour un petit pain. L’effort des habitants durant la Rébellion a
été si grand que l’échec les a abattus pour un siècle (B.112).» Une
telle déception s’avère aujourd’hui désastreuse! La vision historique de
Bergeron tend vers la répétition cyclique quand il écrit: «Pour le
R.I.N., les Québé-cois ne devraient plus être dominés par la bourgeoisie
cana-dienne-anglaise avec son centre de domination politique à Ottawa.
La bourgeoisie québécoise devait assumer son rôle de bourgeoisie
nationale indépendante de toute autre bourgeoisie. C’étaient nos
nouveaux Patriotes (B.232).» On devine le ton de mise en garde que prend
le rapprochement! Bien qu’elle soit proche parente de celles véhiculées
par le sociologue Gilles Bourque 10 et l’historien Stanley Bréhaut
Ryerson, 11 il manque à l’analyse idéologique de Bergeron sur la
rébellion de 37-38 des nuances essentielles pour s’élever vers une
véritable sociologie des mouvements de contestation au Québec. Le
parallèle qu’on peut établir entre la façon dont il explique le rôle
historique de Louis-Joseph Papineau et l’interprétation politique qu’il
donne de celui de René Lévesque se montre encore plus révélateur.À propos de Papineau, Bergeron écrit: «Sa logique est plus tortueuse. Il croit que l’Anglais est un oppresseur. Mais il croit aussi que l’Anglais oppresseur cessera d’être un oppresseur si on fait des déclarations éclatantes où on le menace de boycott économique et de séparation avec annexion aux États-Unis. Papineau ne comprend pas la nature de l’impérialisme, de la domination colonialiste. Il croit aux Anglais et au “gentlemen’s agreement”. Il ne comprend pas que la libération d’un peuple soumis à un colonialisme économique ne peut se faire que par la lutte armée. C’est que Papineau est un bourgeois et le demeure. Comme bourgeois, il demeure un “gentleman”, un homme avec qui on peut s’entendre si on sait lui accorder les privilèges de “gentleman”. En somme, Papineau ne veut pas vraiment une révolution qui amènerait l’habitant au pouvoir. Il veut une évolution qui donnerait à la petite bourgeoisie canayenne les mêmes droits et privilèges que possèdent les bourgeois britanniques et les bourgeois américains (B.94-95).» Cette bourgeoisie est aussi rouée que les autres: «en fait, écrit-il en pensant à Papineau, les chefs patriotes exploitaient le ressentiment des habitants pour leurs fins personnelles, et il ajoute: On voit que les chefs patriotes n’avaient pas vraiment confiance dans les habitants. Il [sic!] ne menaient pas une guerre populaire par le simple fait que leur refuge et leur base d’attaque n’était pas la campagne canayenne mais les États-Unis. S’ils avaient mené une guerre populaire, c’est chez l’habitant que les leaders auraient commencé leur lutte, c’est en travaillant avec lui que les deux groupes, leaders et habitants, se seraient politisés, qu’ils auraient entrepris la lutte commune contre le colonisateur et c’est par la guérilla rurale que le peuple canayen aurait réussi à se libérer de la domination anglaise (B.111-112).» L’image de Papineau «gentleman» était déjà apparue chez Ferron (F.13-14) lorsqu’il rappelle comment le jeune Louis Fréchette fut étonné d’entendre Papineau, son idole, parler anglais à la Chambre! Bergeron, lui, n’entend pas s’en amuser. La lutte de classes s’empare ici des protagonistes. Mais si l’on peut identifier les leaders et Papineau à la classe bourgeoise, qui, en cette époque où le prolétariat urbain industriel est à peine ébauché, va donc jouer ce rôle de la classe révolutionnaire? Ne pouvant plus parler des Canayens, puisqu’ils sont divisés entre eux, il parlera des habitants, qu’il compare aux paysans du «Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte» de Marx, cette fraction de classe médiane plus proche finalement de la bourgeoisie, mais ici modèle des intérêts populaires canayens. Quand les villes seront peuplées et les vrais prolétaires grévistes et syndicalistes apparus, alors les habitants pourront réintégrer leur «classe» rétrograde (B.221) entre les petits-bourgeois et les travailleurs…
Bergeron parle des Anglais et des Canayens, des leaders et des habitants. Se voulant simple, sa terminologie ne cesse de dérailler de la théorie marxiste qui lui sert de base. La guérilla devient la stratégie militaire par laquelle l’auteur entend faire la leçon à l’histoire! Il va jouer Bonaventure Viger contre Louis-Joseph Papineau. L’auteur se lance alors dans l’uchronie, l’histoire fictive et dénonce, ni plus ni moins, les «leaders» actuels; c’est ainsi que René Lévesque devient le doublet de Papineau: «Pour René Lévesque, il ne s’agit pas de faire disparaître le capitalisme et l’impérialisme américain du Québec. Il s’agit de rompre avec la confédération pour récu-pérer des impôts qui serviraient mieux le peuple québécois dans un système de sécurité sociale plus équitable. Il s’agit de “civiliser” les capitalistes étrangers en leur demandant de réinvestir leurs profits au Québec et de penser davantage à la po-pulation qu’ils exploitent. Il s’agit d’aider, par le crédit de l’État, les entreprises québécoises, à la merci des Américains et des Canadiens-anglais. Nous l’avons vu, nos Patriotes de 1837 voulaient exactement cela, parvenir comme bourgeoisie à prendre la tête du peuple québécois, en d’autres mots, faire une révolution bourgeoise nationale (B.235).» Ce sentiment que l’histoire se répète a comme corollaire que si les événements se font écho les uns aux autres et que les personnages se réincarnent l’un dans l’autre, de Papineau à Mercier, à Duplessis, à Lévesque, etc., alors, on en vient inexorablement à penser que les mêmes erreurs produiront les mêmes effets dans l’avenir. Dire que Bergeron aurait pu se faire prophète de l’échec référendaire de 1980 et de la déprime post-référendaire qui s’ensuivit, c’est rendre justice à sa philosophie cyclique de l’histoire. Une fois éclaté, le sévère vernis marxiste laisse transparaître tout le déterminisme et le fatalisme de cette vision historique où les travailleurs québécois répétent les mêmes fautes que les habitants du XIXe siècle. En manifestant une méfiance associée à Papineau et reportée sur Lévesque, Bergeron mine la confiance dans la possibilité politique d’améliorer la condition nationale et sociale des Québécois. Les événements postérieurs lui ont donné raison, confirmant la démoralisation que la génération des années soixante entretenait face à son avenir et à sa maturité politique. Ce n’est pas la démoralisation qui est la conséquence de l’échec référendaire, mais bien l’échec référendaire qui est la conséquence de la démoralisation. Il sera toujours temps de revenir en conclusion sur ce point, mais il est d’ores et déjà évident que la démoralisation socio-politique est contenue dans la moralisation idéologique de l’historiographie de Léandre Bergeron.
Comment justifier alors cette tendance à l’échec et l’irrévocabilité du schisme socio-national des Québécois? Nous avons vu l’action historique d’une part des colonisateurs et du clergé, et d’autre part des leaders et des habitants canayens. Le schisme est une réalité objective que la lucidité de nos essayis-tes empêche de nier; pourtant, une réalité subjective opère idéologiquement dans l’histoire en maintenant la cohérence de cette société divisée contre elle-même, prise entre l’assimilation et l’éclatement.
C’est que cette société s’est leurrée, ou plutôt, elle a été leurrée par son clergé, comme on l’a vu, dans la claire conscience qu’elle pouvait avoir d’elle-même. De patriotisme, «vertu naturelle, presque familiale, débonnaire lorsqu’elle est satisfaite, mais qui s’aigrit lorsqu’on la contrarie; elle tend alors à la politique et devient le nationalisme (F.9).» Cette explication de Ferron donne toute la teneur du détournement de la conscience subi par les Québécois au milieu du XIXe siècle. Vertu naturelle, presque familiale, le patriotisme est «la terre du père»12, où le leader était appelé à tenir la place du rassembleur de la nation, ce leader qu’aurait bien été Papineau s’il n’eût pas été Papineau mais Chénier (pour Ferron) ou Bonaventure Viger (pour Bergeron). L’un ayant pris peur et s’étant enfui aux États-Unis et les autres ayant été vaincus par la force des armes du colonisateur, il faudra repasser. Ce n’était pas la dernière fois qu’on se souhaitait «à la prochaine», et la vertu devenue politique entrait en religion: «Notre patriotisme aussi était devenu plus exigeant. Or, au moment où il se serait transformé de lui-même en nationalisme, le clergé, jusque-là indifférent, le revendique. C’était un clergé impérieux, irritable, un peu paranoïaque. Indifférent, il l’avait été pour avoir condamné la révolte de 1837 et appelé brigands ceux que le peuple vénérait; indifférent comme cocu le devient. Mais il n’avait pas oublié. Il est l’enfant du péché. À son image et à sa ressemblance, il le déforma. Et le nationalisme apparut sur nos bords, tout de noir vêtu comme un séminariste. Il était baroque, minable et prétentieux, race-pure et pucelage sec, garanti, nationalisme de droite en soi détestable mais plausible quand même en pays souverain, ici d’un irréalisme déconcertant, à proprement parler ecclésiastique. Aussi viable qu’un monstre, il a vivoté jusqu’à nos jours grâce aux écoles (F.10).»
 Voilà
comment commence le livre de Ferron. Impitoyable, le docteur nous
raconte bien la naissance d’un monstre. C’est à faire peur. Une famille naturelle se transforme en collège de séminaristes,
déviance, aberration, perversion. (Et ce n’est rien encore face au
sanatorium Québec!) De l’amour du pays on passe à celui de la nation. La
figure maternelle se dédouble, d’abord par la «maternalisation» de la
figure paternelle autochtone de la patrie, ensuite par le fait que
l’Église, déjà figure maternelle, affirme un véritable pouvoir de
castration pour quiconque ne s’y soumet point. Pour Ferron, l’histoire
du Québec depuis le milieu du XIXe siècle suit le mouvement de
dépossession de manière tragique: «Jusqu’alors le patriotisme avait été
une vertu populaire, spontanée, naturelle. On était surtout analphabète;
l’école n’avait guère eu d’influence. C’était d’ailleurs plus sain. On
devient Canadien français comme
Voilà
comment commence le livre de Ferron. Impitoyable, le docteur nous
raconte bien la naissance d’un monstre. C’est à faire peur. Une famille naturelle se transforme en collège de séminaristes,
déviance, aberration, perversion. (Et ce n’est rien encore face au
sanatorium Québec!) De l’amour du pays on passe à celui de la nation. La
figure maternelle se dédouble, d’abord par la «maternalisation» de la
figure paternelle autochtone de la patrie, ensuite par le fait que
l’Église, déjà figure maternelle, affirme un véritable pouvoir de
castration pour quiconque ne s’y soumet point. Pour Ferron, l’histoire
du Québec depuis le milieu du XIXe siècle suit le mouvement de
dépossession de manière tragique: «Jusqu’alors le patriotisme avait été
une vertu populaire, spontanée, naturelle. On était surtout analphabète;
l’école n’avait guère eu d’influence. C’était d’ailleurs plus sain. On
devient Canadien français comme  en
France on était devenu Français, sans les clercs, par tradition orale,
en langue commune et franche. Le notable canadien-français s’appuyait
sur ce patriotisme et l’entretenait. Il avait d’ailleurs présidé à sa
naissance. La révolte de 1837 n’avait été que son affaire à lui et non
celle du peuple. Mais le peuple l’avait soutenu sans intérêt immédiat,
par pure solidarité. Une prise de conscience nationale en avait résulté
(F.22)…» C’est en cela que Ferron qualifiait le patriotisme de «vertu
naturelle, presque familiale, débonnaire». Jusque-là, tout suit un cours
normal… «Ces notables garderont leur pouvoir et leur tradition durant
le XIXe siècle, tout en accédant peu à peu au gouvernement du pays.
Marchand en 1895 préside à l’inauguration du monument Chénier. Chénier
déclaré brigand en 1837 qui devint ainsi notre héros national. À ces
notables revenait naturellement la direction politique du peuple. Le
patriotisme était leur force (F.23)…» Et à ces petits professionnels
rassemblés autour du monument Chénier, responsables organiques de la
société laurentienne, Ferron s’associe lui-même. La direction politique
du peuple leur revient naturellement. Poursuivons: «Mais ils avaient
porté ombrage à un clergé déjà ombrageux, de plus en plus puissant, à
qui la puissance montait à la tête, qui ne voulait rien partager, qui
voulait tout avoir. Ce clergé entreprit de les désarmer, et pour le
faire, avec une sorte de démence, il désarma un peuple. L’enseignement
s’était répandu, excellent moyen de propagande. Le clergé en avait le
monopole. Il fit vite. Vingt ans après, c’était le monument Dollard
qu’on élevait. Toutes les notions de notre patriotisme avaient été
perverties. L’Anglais avait cessé d’être notre ennemi. L’ennemi, c’était
désormais l’Iroquois disparu. Les limites du passé étaient repoussées à
l’infini […]. Chénier tomba dans l’oubli, remplacé par un brigand qui
n’était même pas canadien mais qui avait eu la bonne idée, avant de
brigander, de faire une sainte communion. Chénier, lui, avait été
excommunié; on le rayait des cadres. Et tout était à l’avenant: on
défaisait l’histoire pour la réduire à une œuvre de glorification
cléricale (F.23).»
en
France on était devenu Français, sans les clercs, par tradition orale,
en langue commune et franche. Le notable canadien-français s’appuyait
sur ce patriotisme et l’entretenait. Il avait d’ailleurs présidé à sa
naissance. La révolte de 1837 n’avait été que son affaire à lui et non
celle du peuple. Mais le peuple l’avait soutenu sans intérêt immédiat,
par pure solidarité. Une prise de conscience nationale en avait résulté
(F.22)…» C’est en cela que Ferron qualifiait le patriotisme de «vertu
naturelle, presque familiale, débonnaire». Jusque-là, tout suit un cours
normal… «Ces notables garderont leur pouvoir et leur tradition durant
le XIXe siècle, tout en accédant peu à peu au gouvernement du pays.
Marchand en 1895 préside à l’inauguration du monument Chénier. Chénier
déclaré brigand en 1837 qui devint ainsi notre héros national. À ces
notables revenait naturellement la direction politique du peuple. Le
patriotisme était leur force (F.23)…» Et à ces petits professionnels
rassemblés autour du monument Chénier, responsables organiques de la
société laurentienne, Ferron s’associe lui-même. La direction politique
du peuple leur revient naturellement. Poursuivons: «Mais ils avaient
porté ombrage à un clergé déjà ombrageux, de plus en plus puissant, à
qui la puissance montait à la tête, qui ne voulait rien partager, qui
voulait tout avoir. Ce clergé entreprit de les désarmer, et pour le
faire, avec une sorte de démence, il désarma un peuple. L’enseignement
s’était répandu, excellent moyen de propagande. Le clergé en avait le
monopole. Il fit vite. Vingt ans après, c’était le monument Dollard
qu’on élevait. Toutes les notions de notre patriotisme avaient été
perverties. L’Anglais avait cessé d’être notre ennemi. L’ennemi, c’était
désormais l’Iroquois disparu. Les limites du passé étaient repoussées à
l’infini […]. Chénier tomba dans l’oubli, remplacé par un brigand qui
n’était même pas canadien mais qui avait eu la bonne idée, avant de
brigander, de faire une sainte communion. Chénier, lui, avait été
excommunié; on le rayait des cadres. Et tout était à l’avenant: on
défaisait l’histoire pour la réduire à une œuvre de glorification
cléricale (F.23).»
 Ferron
se tient ici au niveau du symbolique, sur lequel nous reviendrons, mais
il entend bien redresser la claire conscience obscurcie par ce
détournement. La «démence» du clergé, on l’aura reconnue, c’est
l’hystérie féminine, «ombrageuse» comme l’est le clergé. L’enseignement,
c’est la fonction éducatrice dévolue généralement à la Mère en ce qui
concerne les premières années de la petite enfance. Dollard, c’est le mythe; Chénier,
c’est l’Histoire. L’Iroquois devient le cauchemar; l’Anglais, la
menace. Chénier/Ferron, réunis doublement par la fonction sociale (la
médecine) et le patriotisme, sont toujours en voie d’être relégués aux
oubliettes par un croc en jambe de l’hystérie maternelle/cléricale.
Chaque Canadien français étant ramené à son état infantile, ce petit
capricieux, qu’il faut civiliser en le retirant de sous la soutane de sa
mère, reste un «pervers polymorphe» dont on ne peut rien attendre de
bon dans l’état actuel de son éducation. Le patriotisme s’est trouvé
perverti puisque l’idéologie cléricale, traditionaliste, l’a subverti
avec le nationalisme rétrograde. Là où Ferron annonce le grand leurre,
Bergeron, qui juge cette idée inconciliable avec sa théorie de la
libération nationale, maintient que «le peuple, lui, n’embarque pas dans
le nationalisme de l’“Action française” parce que tout cela semble de
belles théories d’intellectuels qui ne signifient rien de bon pour lui.
Il y voit la description d’un système dans lequel il se retrouverait
dans une situation aussi mauvaise qu’il connaît à ce moment-là. Pour lui
le catholicisme c’est bien beau mais il y a déjà assez de curés et
d’évêques qui lui disent quoi faire depuis assez longtemps. Et un
dictateur, il n’a jamais aimé ça. En somme, pour lui, il n’y a rien de
bon là-dedans et il s’en tient loin (B.189).» Père débonnaire, mère
ombrageuse, des relations sociales on intériorise et on modèle les
relations interpersonnelles sur ce discours idéologique. Et, par après,
du sein des familles québécoises, les relations interpersonnelles
entretiendront les relations sociales sur le même modèle au point que
l’Enfant-Peuple, véritable peuple enfant, se fait parler par M. Bergeron
comme un tout-petit du temps se faisait parler par Bobino.
Ferron
se tient ici au niveau du symbolique, sur lequel nous reviendrons, mais
il entend bien redresser la claire conscience obscurcie par ce
détournement. La «démence» du clergé, on l’aura reconnue, c’est
l’hystérie féminine, «ombrageuse» comme l’est le clergé. L’enseignement,
c’est la fonction éducatrice dévolue généralement à la Mère en ce qui
concerne les premières années de la petite enfance. Dollard, c’est le mythe; Chénier,
c’est l’Histoire. L’Iroquois devient le cauchemar; l’Anglais, la
menace. Chénier/Ferron, réunis doublement par la fonction sociale (la
médecine) et le patriotisme, sont toujours en voie d’être relégués aux
oubliettes par un croc en jambe de l’hystérie maternelle/cléricale.
Chaque Canadien français étant ramené à son état infantile, ce petit
capricieux, qu’il faut civiliser en le retirant de sous la soutane de sa
mère, reste un «pervers polymorphe» dont on ne peut rien attendre de
bon dans l’état actuel de son éducation. Le patriotisme s’est trouvé
perverti puisque l’idéologie cléricale, traditionaliste, l’a subverti
avec le nationalisme rétrograde. Là où Ferron annonce le grand leurre,
Bergeron, qui juge cette idée inconciliable avec sa théorie de la
libération nationale, maintient que «le peuple, lui, n’embarque pas dans
le nationalisme de l’“Action française” parce que tout cela semble de
belles théories d’intellectuels qui ne signifient rien de bon pour lui.
Il y voit la description d’un système dans lequel il se retrouverait
dans une situation aussi mauvaise qu’il connaît à ce moment-là. Pour lui
le catholicisme c’est bien beau mais il y a déjà assez de curés et
d’évêques qui lui disent quoi faire depuis assez longtemps. Et un
dictateur, il n’a jamais aimé ça. En somme, pour lui, il n’y a rien de
bon là-dedans et il s’en tient loin (B.189).» Père débonnaire, mère
ombrageuse, des relations sociales on intériorise et on modèle les
relations interpersonnelles sur ce discours idéologique. Et, par après,
du sein des familles québécoises, les relations interpersonnelles
entretiendront les relations sociales sur le même modèle au point que
l’Enfant-Peuple, véritable peuple enfant, se fait parler par M. Bergeron
comme un tout-petit du temps se faisait parler par Bobino.Rappelons que la démoralisation des années soixante n’est pas issue de la description historique que donnent nos auteurs; c’est leur façon d’expliquer la démoralisation qu’ils vivent et qu’ils ressentent intérieurement. Cette explication est partiellement juste mais fort approximative. Nos auteurs cherchent à s’expliquer leur condition, et ils nous présentent des ouvrages démoralisés sur une démoralisante démoralisation! On se compare à ceux qui dans le Tiers-Monde souffrent alors des pires inégalités sociales. Pour Bergeron, le Canadien français se différence du Québécois parce qu’il est «comme le Noir américain (le Negro) qui cherche à perdre son identité de Noir et à s’intégrer à la société blanche… [Le Québécois] est comme le Noir américain qui refuse l’intégration à la société blanche qui s’identifie non pas comme Negro mais comme Black et veut libérer tous les Noirs américains de l’oppression qu’ils doivent subir dans la société américaine d’aujourd’hui (B.49, n.2).» Suivant les traces du «nègre blanc d’Amérique» de Pierre Vallières, dans ce combat de libération, trahi par ses propres élites, le Québécois ne peut compter que sur ses propres forces de travail, c’est-à-dire les travailleurs prolétarisés. Même les Canadiens anglais dotés des meilleures dispositions sont des ennemis potentiels, incapables de comprendre ses attentes et les moyens violents qu’il doit utiliser pour les réa-liser. C’est le «Chubby» Power de Ferron (F.18), ministre libéral anglophone et député de Québec-Sud que l’auteur réutilisera à plein pour son roman Le Ciel de Québec. C’est le second de Papineau, John Neilson, «écossais imbu de sympathies radicales» mais imperméable à la condition historique réelle des Canayens. Pour Bergeron, «c’est le protestant anglophone, qui pour ne pas donner le pouvoir au peuple québécois préfère favoriser le clergé catholique. C’est l’anglophone “modéré” qui donne du pouvoir à son roi-nègre, le clergé, au détriment du peuple qui veut sa libération. (Ce genre d’anglais “modéré”, “libéral”, notre ennemi marqué de son libéralisme, on le retrouve tout le long de notre histoire. On en trouve encore aujourd’hui qui sont sympathiques à notre cause pourvu qu’on “aille pas trop loin”) (B.87)…» Philippe Edmonston, quoi!
Le sirop Ferron et les p’tites pilules BergeronDe la démence à la damnation, la démoralisation est la prise de conscience du mal qui habite le Québécois. Jean Bouthillette, dans son remarquable petit essai contemporain des publications de nos auteurs (il lui a fallu toute la décennie des années soixante pour le rédiger et il ne l’a publié qu’en 1972), Le Canadien français et son double, pose directement la question du mal dans l’histoire du Québec et ramasse ainsi tous les sentiments et les impressions erratiques qui tourmentent nos auteurs: «Mais comment se fait-il que notre innocence ne parvienne pas à rendre la terre productive? qu’elle nous vaille misère et pauvreté quand la culpabilité de l’Anglais lui vaut richesse et bonheur? C’est que le mal est en nous, que nous sommes plus coupables que l’Anglais. Nous sommes damnés. Comment justifier notre existence alors? Nous n’avons rien à accomplir ici-bas: notre existence sur ce continent d’exil, sur cette terre ingrate du Québec et en ce monde trop matériel est injustifiable. Il ne nous reste qu’à mourir.»13
Quel beau projet idéologique! Il rejoint carrément les petits martyrs et les jeunes missionnaires de la petite littérature du Québec étudiée par Beaulieu. Nos auteurs n’ont pas le choix, ils disent non à la mort en disant oui, soit à l’humanisme (Ferron), soit à la guérilla politique (Bergeron). Le discours de la Mère-Nation, de l’Église, Jacques Ferron l’a intériorisé plus qu’il ne l’avoue lui-même: «la naissance attache quand même. Ce n’est que la prospérité, le bonheur, la civilisation de son pays qui délient et donnent la permission de le quitter. On part, la maison propre, ce qui n’a jamais été le cas, ici. On passe du bon au pire et non du mauvais au mieux (F.87).» L’esprit romanesque reprend le dessus.
Le courage n’a pas manqué aux Québécois et la sécurité sociale et le confort matériel représentent bien plus que ces gâteries offertes en prime par la technologie moderne: «Avoir nagé le déluge, avoir marché trois siècles, de petite colonie être devenu un peuple, occuper un pays plus grand que la France, fameux résultat! On y arrive complètement dépossédé comme cette famille qui avait tout brûlé dans la maison, les meubles, les armoires, les portes, pour survivre jusqu’au printemps. Le cheptel, moins la vache, les curés, moins leurs simulacres, la technique primitive pour vaincre le climat, l’agriculture, tout ce qui nous avait permis d’avancer, tout ce bon vieux gréement est resté dans les fossés (F.124-125).»
Ce paragraphe de Ferron annonce le discours sur le misérabilisme de Victor-Lévy Beaulieu. On découvre dans son manuel cette sensibilité à la démoralisation qui ne vient pas seulement de ce que nous avons été spoliés, détournés, subvertis, mais surtout de ce que dans ce processus, nous nous soyons perdus nous-mêmes de vue alors que tous nos efforts étaient investis dans la résistance à l’assimilation. C’est, «ce monde que nous avons perdu», cet Être transcendant que nous avons payé comme prix de la survivance d’être-là, et que désormais nous voudrions nous réapproprier. Mais voilà, ni Ferron ni Beaulieu ne regardent au-delà après avoir prononcé la condamnation des mythes rapetissants du passé et du clergé. Ce qui compte pour la conscience, c’est de s’éveiller au fait que nous nous dépensons en pure perte dans un vain combat: «Nous exportons fort peu de choses. On ne peut compter l’amiante, le papier, le fer aliénés avant d’être exploités, ni notre surplus humain, le Canadien français voué à l’exil, émigré de l’intérieur qui se joint au grand courant d’émigration, lequel l’emporte vers Blind River, le Labrador, l’Alberta, vers le Klondyke de l’année. Tout cela n’est que déperdition. Jusqu’à ces derniers temps nous n’avons guère exporté que notre religion sous formes de moines, de nonnes, de prêtres et de numéraires. Cette générosité ne pouvait nous amoindrir, non bien sûr. Néanmoins, nous aurions peut-être pu en tirer meilleur profit. Sans statut international, on ne va jamais loin dans l’Export-Import; on y fait figure d’amateur, sinon de cocu (F.150).» Bergeron ne disait pas autre chose (B.113-114). D’accord. Mais comment atteindre ce statut international maintenant? La praxis de Bergeron passait par la révolution et la guérilla s’il le fallait. Celle de Ferron est bien différente: «Avant de jouer à fond le séparatisme, quand l’attention du monde entier sera tournée vers nous à l’occasion de l’Exposition universelle, le séparatisme qui comporte violence et révolution, rien ne sert de vous leurrer mes agneaux, nous pourrions accepter un compromis: soit un Québec unilingue où les minorités subiraient, comme c’est normal, le poids de notre majorité; la fin de la fourrette confessionnelle, une éducation nationale fondée, comme cela existe partout dans le monde, sur une culture et une langue unique. Le pluralisme du bon apôtre Luchaire, d’accord, mais en français. Et il faudra que le clergé, qui a profité de la situation coloniale pour se mettre au-dessus de tous, se soumette à l’État québécois et cesse de le considérer comme sa vache à lait, même si l’illustre neveu du moins illustre sénateur Lesage, va à la messe tous les matins. Les curés rentreront dans leur soutane (F.27).» Plus de vingt ans après la parution des Historiettes, on peut dire que le programme, ou plutôt l’utopie de Ferron s’est réalisée jusqu’à la limite. Les curés sont rentrés dans leur soutane, même s’ils se montrent encore parfois le bout du nez dans les affaires de famille et de morale sexuelle où ils tiennent bon! Le moins illustre successeur de l’illustre neveu du moins illustre sénateur préfère les longueurs de piscine aux vêpres matutinales. Le pluralisme oui, mais en français… le principe est accepté mais la pratique se montre difficile à asseoir. L’éducation nationale a, par contre, échangé la fourrette confessionnelle pour la crossette ministérielle et on y a perdu au change. La minorité subit le poids de la majorité mais sans jamais s’y résoudre entièrement et, le pire, comble de l’action assimilatrice, les Québécois reconnaissent qu’ils se sentent mieux quand ils sont dans une situation de minoritaires et qu’ils se sentent mal à l’aise dans leur statut de majorité, chez eux, au Québec! Ne reste-t-il donc plus d’autres solutions que la disparition ou la révolution violente prônée par Léandre Bergeron?
«Le génie humain est essentiellement collectif et la participation de l’individu minime, sinon anonyme (F.41).» Le principe est beau mais Ferron y souscrit par convention. Son socialisme
 est
anecdotique, il n’est pas le produit essentiel de sa moralisation de
l’histoire. Le génie humain, c’est avant tout pour lui le génie de
l’individu dont le caractère l’entraîne souvent à aller contre le
collectif. L’humanisme de Ferron est beaucoup plus sincère que son
socialisme dans les Historiettes. On n’a qu’à considérer les dernières lignes écrites sur Borduas, qui deviendra l’un de ses plus authentiques héros (contre Saint-Denys-Garneau) du Ciel de Québec: »L’enseignement du dessin, par lequel il gagnait sa vie, lui répugnait.
est
anecdotique, il n’est pas le produit essentiel de sa moralisation de
l’histoire. Le génie humain, c’est avant tout pour lui le génie de
l’individu dont le caractère l’entraîne souvent à aller contre le
collectif. L’humanisme de Ferron est beaucoup plus sincère que son
socialisme dans les Historiettes. On n’a qu’à considérer les dernières lignes écrites sur Borduas, qui deviendra l’un de ses plus authentiques héros (contre Saint-Denys-Garneau) du Ciel de Québec: »L’enseignement du dessin, par lequel il gagnait sa vie, lui répugnait.  Il
devint un maître pourtant. Si quelqu’un a mérité ce titre au pays,
c’est bien lui: Maître Paul-Emile Borduas, exactement comme Rabelais dit
de Villon : Maître François Villon. Il devient ce maître (et c’est là
sa supériorité sur Pellan) en dehors des écoles, au milieu de disciples
qu’il avait choisis et qui l’avaient choisi, leur dispensant un
enseignement gratuit, d’abord parce que cet enseignement n’avait pas de
prix, ensuite parce qu’il s’instruisait avec eux. Enseignement au sens
critique et noble du mot. Il y a entre ces deux carrières la différence
qu’il y a entre ses élèves de l’École du meuble et ses disciples de
l’Automatisme. La première aurait peut-être mieux convenu à sa famille.
La seconde lui permettra enfin de dépasser Ozias Leduc (F.178).» C’est
l’esprit de la païdeia grecque, humaniste, qui demeure profondément
enracinée dans la moralisation de l’histoire chez Ferron. Il l’a hérité
des Jésuites, ses maîtres, et s’en montre reconnaissant, même lorsqu’il
charge à fond de train le clergé et son nationalisme étroit. Là réside
sa nostalgie des valeurs du passé balayées par le modernisme
technologique. Là aussi se manifestent ses incertitudes envers le futur.
Praxis incertaine et
incomplète vers une utopie floue à laquelle il ne semble pas accorder
plus d’importance qu’il n’en faut. Critique sévère et outré du régime
français, qui n’est pas québécois, il parle essentiellement de lui.
Voilà comment l’inconfort de la position de Ferron se manifeste entre un
monde où les progrès techniques ont pénétré la vie quotidienne et où
les valeurs traditionnelles se révèlent désuètes, voire nuisibles, mais
où l’on est soi-même pris entre le rejet de la modernité technique et
progressiste d’une part et la nostalgie de valeurs qui n’étaient quand
même pas toutes mauvaises ni dénuées d’une certaine part de bonheur. Tel
est le débat tragique qui tourmente la conscience historique déchirée
du docteur Ferron.
Il
devint un maître pourtant. Si quelqu’un a mérité ce titre au pays,
c’est bien lui: Maître Paul-Emile Borduas, exactement comme Rabelais dit
de Villon : Maître François Villon. Il devient ce maître (et c’est là
sa supériorité sur Pellan) en dehors des écoles, au milieu de disciples
qu’il avait choisis et qui l’avaient choisi, leur dispensant un
enseignement gratuit, d’abord parce que cet enseignement n’avait pas de
prix, ensuite parce qu’il s’instruisait avec eux. Enseignement au sens
critique et noble du mot. Il y a entre ces deux carrières la différence
qu’il y a entre ses élèves de l’École du meuble et ses disciples de
l’Automatisme. La première aurait peut-être mieux convenu à sa famille.
La seconde lui permettra enfin de dépasser Ozias Leduc (F.178).» C’est
l’esprit de la païdeia grecque, humaniste, qui demeure profondément
enracinée dans la moralisation de l’histoire chez Ferron. Il l’a hérité
des Jésuites, ses maîtres, et s’en montre reconnaissant, même lorsqu’il
charge à fond de train le clergé et son nationalisme étroit. Là réside
sa nostalgie des valeurs du passé balayées par le modernisme
technologique. Là aussi se manifestent ses incertitudes envers le futur.
Praxis incertaine et
incomplète vers une utopie floue à laquelle il ne semble pas accorder
plus d’importance qu’il n’en faut. Critique sévère et outré du régime
français, qui n’est pas québécois, il parle essentiellement de lui.
Voilà comment l’inconfort de la position de Ferron se manifeste entre un
monde où les progrès techniques ont pénétré la vie quotidienne et où
les valeurs traditionnelles se révèlent désuètes, voire nuisibles, mais
où l’on est soi-même pris entre le rejet de la modernité technique et
progressiste d’une part et la nostalgie de valeurs qui n’étaient quand
même pas toutes mauvaises ni dénuées d’une certaine part de bonheur. Tel
est le débat tragique qui tourmente la conscience historique déchirée
du docteur Ferron.Humanisme insatisfaisant et socialisme mal intériorisé, voilà une contradiction qui n’embarrassera pas Léandre Bergeron qui annonce qu’il faut jouer la carte révolutionnaire jusqu’à la violence si nécessaire. Sa démoralisation n’en apparaîtra que plus sordide! Le projet politique de Bergeron s’ins-crit dès l’ouverture de son manuel : «pour changer notre situation, il faut d’abord la connaître. Pour bien la connaître, il faut analyser les forces historiques qui l’ont amenée (B.5).» Bergeron fait de l’histoire comme Marx faisait de la philosophie. Pour transformer le monde. Sa philosophie de l’histoire rappelle les premières lignes du «Manifeste du parti communiste» (1848) de Marx et Engels: «Ce petit manuel reprend les événements marquants de notre histoire en les situant dans la lutte entre oppresseurs et opprimés, colonisateurs et colonisés, exploiteurs et exploités (B.5).» Plus que Ferron, il veut tirer de l’histoire les leçons qui s’imposent d’elles-mêmes. Pour se faire, il doit en démontrer les lois positives. D’abord, le Québec ne peut se faire que par les Québécois: «Les Canayens qui ont été tentés de se joindre aux Américains se rendent compte que ceux-ci veulent leur “apporter la liberté” pour en réalité les assujettir dans leur nouvelle république. Ils sentent bien qu’ils se trouveraient probablement tout aussi colonisés sous le régime américain que sous le régime britannique. Leur libération ne peut venir que d’eux-mêmes (B.66).» Inutile donc d’attendre après des alumineries françaises ou des magnats britanniques pour relancer l’économie québécoise, leçon que les Pierre-Marc Johnson et Robert Bourassa auraient dû mettre à profit!
La libération ne peut donc se faire que par soi-même, première leçon à tirer de l’observation positive de l’histoire du Québec. La seconde affirme que «le pouvoir est au bout du fusil: «Le peuple, lui, a compris que le pouvoir est au bout du fusil. Le peuple a compris que seule la révolution armée peut libérer le peuple québécois du colonialisme anglo-saxon. La logique de l’habitant est simple et puissante: “Nous sommes opprimés par une classe d’exploiteurs anglais
 et
leurs valets, les seigneurs et le clergé. Cette classe se sert de
l’armée pour maintenir sa domination sur le peuple québécois. La seule
façon de renverser la classe d’oppresseurs est la lutte armée. Aux
armes, Patriotes.”
(B.94)» Cette leçon, seuls les habitants pouvaient la comprendre comme
seuls aujourd’hui les travailleurs vraiment exploités peuvent la saisir.
Il y a là quelque élément messiannique, qui rejoint le dogme mystique
de «la mission historique du prolétariat» pour le substituer à l’ancien
missionnariat catholico-conservateur du curé Labelle et du curé Hébert.
Des rebelles de 1837-1838 à Riel, du dynamiteur de la résidence de lord
Atholstan aux felquistes des années soixante, c’est une loi de
l’histoire qui se manifeste à travers la prise de conscience d’une
classe sociale et nationale à la base de la progression historique du
Québec.
et
leurs valets, les seigneurs et le clergé. Cette classe se sert de
l’armée pour maintenir sa domination sur le peuple québécois. La seule
façon de renverser la classe d’oppresseurs est la lutte armée. Aux
armes, Patriotes.”
(B.94)» Cette leçon, seuls les habitants pouvaient la comprendre comme
seuls aujourd’hui les travailleurs vraiment exploités peuvent la saisir.
Il y a là quelque élément messiannique, qui rejoint le dogme mystique
de «la mission historique du prolétariat» pour le substituer à l’ancien
missionnariat catholico-conservateur du curé Labelle et du curé Hébert.
Des rebelles de 1837-1838 à Riel, du dynamiteur de la résidence de lord
Atholstan aux felquistes des années soixante, c’est une loi de
l’histoire qui se manifeste à travers la prise de conscience d’une
classe sociale et nationale à la base de la progression historique du
Québec.Cette lutte exige une stratégie particulière et elle est empruntée au maquis, celui de la résistance sous l’Occupation nazie, des troupes de libération nationale de la décolonisation: «…il aurait fallu que les Patriotes sortent des villages, se fondent dans le décor et harcèlent systématiquement, à petits coups durs et insistants, la troupe colonialiste pour la démo-raliser, la décimer et la détruire (B.96).» Plus que Ferron, Bergeron a une praxéologie bien définie.
Quatrième leçon, et non la moins importante, c’est que le «temps objectif» est enfin venu pour accomplir ce que les Rebelles de 1837 n’ont pu accomplir en leur temps. L’idéologie marxiste qu’emprunte Bergeron est moins l’annonce eschatologique d’un millénarisme national que la reconnaissance d’un kairos (en théologie chrétienne, le kairos, c’est le temps qui indique qu’il s’est produit quelque chose qui rend une action possible ou impossible (P. Tillich), ici la venue du messie sauveur). Pour le Québec, annonce
 notre historien-prophète, le kairos est enfin venu…. Ainsi, Bergeron explique l’incapacité d’Henri Bourassa,
au début du siècle, à comprendre les vrais besoins nationaux des
Québécois. Plus qu’un véritable nationaliste, Bourassa était davantage
un «anti-impérialiste pro-canadien». Pour cause, le temps du kairos n’était pas encore arrivé: «Le nationalisme québécois voit plutôt le Québec comme la patrie des Canayens
où ils ont à reprendre l’économie qu’on leur a volée, prendre le
pouvoir politique dont on s’est servi pour les dominer et exercer sa
souveraineté comme peuple libre parmi les autres peuples du monde. Ce
nationalisme québécois était inconcevable à l’époque. Il faudra attendre
cinquante ans avant qu’il commence à se manifester (B.174).» Contre ce
modèle de bonne volonté
notre historien-prophète, le kairos est enfin venu…. Ainsi, Bergeron explique l’incapacité d’Henri Bourassa,
au début du siècle, à comprendre les vrais besoins nationaux des
Québécois. Plus qu’un véritable nationaliste, Bourassa était davantage
un «anti-impérialiste pro-canadien». Pour cause, le temps du kairos n’était pas encore arrivé: «Le nationalisme québécois voit plutôt le Québec comme la patrie des Canayens
où ils ont à reprendre l’économie qu’on leur a volée, prendre le
pouvoir politique dont on s’est servi pour les dominer et exercer sa
souveraineté comme peuple libre parmi les autres peuples du monde. Ce
nationalisme québécois était inconcevable à l’époque. Il faudra attendre
cinquante ans avant qu’il commence à se manifester (B.174).» Contre ce
modèle de bonne volonté  mais totalement condamné à l’impuissance, voici que «le 9 août [1917] la propriété de Lord Atholstan
à Cartierville est dynamitée (B.182).»14 Entre Bourassa et le
dynamiteur anonyme se dressent déjà les deux voies qui opposeront plus
tard un autre Bourassa aux terroristes cette fois-ci beaucoup moins
anonymes qui kidnapperont et assassineront l’un de ses ministres.
mais totalement condamné à l’impuissance, voici que «le 9 août [1917] la propriété de Lord Atholstan
à Cartierville est dynamitée (B.182).»14 Entre Bourassa et le
dynamiteur anonyme se dressent déjà les deux voies qui opposeront plus
tard un autre Bourassa aux terroristes cette fois-ci beaucoup moins
anonymes qui kidnapperont et assassineront l’un de ses ministres.Et le rôle de l’historien dans tout cela? Il consiste à ensei-gner les leçons tirées et les lois de l’histoire: la libération nationale ne peut provenir que du peuple opprimé lui-même; elle doit se faire violente; s’insérer dans une stratégie de guérilla et annoncer que le temps est enfin venu pour que tout ça se fasse, «hic et nunc»! C’est sans doute en pensant à lui et en se mettant clairement dans ce rôle de prophète que Bergeron écrit, dans la liste des professions productives et non-productives: «Dans le secteur idéologique les enseignants font un travail productif quand ils transmettent des connaissances. Mais leur travail est non-productif dans la mesure où ils transmettent par leur enseignement l’idéologie du système d’exploitation. Dans le même sens, un enseignant fait un travail productif quand il fait prendre conscience à ces [sic!] élèves que le système que nous connaissons est un système d’exploiteurs et d’exploités (B.219).»
Une fois cette praxis bien établie, que reste-t-il des autres phases de l’idéologique? Pour quelle utopie travaille Bergeron? Parler de la fin de l’exploitation et de la société égalitaire, c’est parler de la vertu. Tous s’en réclament spontanément! Mais précisément, que veut l’auteur? Ferron parlait au moins du génie créateur à travers Borduas. Il idéalisait la «démocratie» amérindienne et encensait la tentative jésuite de la Huronnie, qui devenait son modèle utopique. Sans nous dire quelle société il envisageait dans le détail, il essayait tout de même d’en dégager les grandes lignes directrices dans son discours sur l’Histoire. Léandre Bergeron va moins loin encore. Il surenchérit sur la praxis comme si la question des moyens devenait une fin en soi. Le voici qui sombre dans le scandale facile. Un encart : MOT À BANNIR, honni les découvertes. Le mot y revient, obsessionnellement: «Quand les explorateurs blancs arrivèrent en Amérique, le pays était déjà peuplé d’hommes, d’hommes d’une autre couleur, oui, mais d’hommes tout de même. Dire que Colomb a découvert l’Amérique et Cartier le Canada c’est montrer le racisme profond qui infecte la race blanche depuis des siècles. En disant que Colomb et Cartier sont des découvreurs on dit que seuls les Blancs sont des hommes qui peuvent découvrir pour la race humaine et que les Indiens qui se trouvaient sur le continent n’étaient que des animaux à peine plus évolués que les singes (B.13).» Voilà un discours facile qui n’apprend rien, ergotant sur des lieux communs. Ce délire cohérent, aux métaphores bactériologiques, est à mettre sur le compte d’un sentiment tiers-mondiste commun dans les milieux intellectuels, celui que décrit Pascal Bruckner dans Le Sanglot de l’homme blanc, vague culpabilité très judéo-chrétienne, pour intellectuels ouvertement athées, à la fois masochiste et pleine de condescendance face à l’Autre. Cette culpabilité, que les curés rouges essaient de faire partager à l’ensemble de leurs ouailles souffrant d’un mal-être professionnel bourgeois, véhicule un dolorisme ampoulé qui alimente le mépris envers les abjects colonisés (les Amérindiens dans notre cas) et les auditoires auxquels ils s’adressent (les braves travailleurs, productifs, exploités mais inconscients).
Autre scandale facile, l’action des Espagnols en Amérique, action qui ne concerne pas en soi l’histoire du Québec (B.14), mais qui n’est pas sans lien avec elle puisque le crime commis contre l’Autochtone repose sur les épaules du Blanc (de tous les blancs), et pour être sûr que son lecteur a bien compris qu’il parlait de lui, Bergeron ajoute: «Ce racisme blanc entache encore aujourd’hui la race blanche tout entière et disparaîtra seulement avec la libération intégrale de tous les peuples de couleur (B.15).» Entre ne pas donner à la Sainte-Enfance et ne pas participer à la lutte de libération nationale anti-raciste blanche, la culpabilité des Québécois balance…
L’action des gouvernants est toujours prétexte à se scandaliser : «Ces querelles de rois assoiffés de pouvoir amènent comme toujours la désolation dans le peuple (B.42).» Ou encore: «Le gouvernement fédéral, au service du capitalisme anglais et américain, s’est servi de son pouvoir de taxation sur le peuple pour lui soutirer de l’argent qu’il a mis ensuite à la disposition de l’Angleterre. Au lieu de laisser au peuple québécois la liberté de décider pour lui-même la façon d’aider les puissances alliées à combattre le fascisme hitlérien, Ottawa a imposé sa façon de participer à la guerre sans tenir compte de la volonté du peuple québécois (B.205).» Il est douteux que Churchill ou Roosevelt, Staline ou Mao aient agi autrement que le gouvernement King! Un gouvernement est fait pour gouverner, en temps de guerre encore plus qu’en temps de paix. Si on veut la libre auto-gestion, il faut donc proposer l’élimination de l’État ou la décentralisation des pouvoirs, projets utopiques qui restent à être formulés, mais qui ne semblent toutefois pas être ceux du camarade Bergeron.
Une société qui se veut vraie, authentique, respectueuse de ses membres pris individuellement et collectivement, ne peut se fonder sur des mensonges, des lieux communs, des scandales de vieilles pudibondes ni des anachronismes téléologiques. Outre la valeur symbolique assez simpliste de ces anachronismes, le grotesque de Bergeron laisse plutôt transparaître un certain désarroi: les explorateurs blancs «pratiquent un génocide aussi barbare que Hitler contre les Juifs et que les Américains contre le peuple vietnamien (B.13)»; en 1609, l’arquebuse de Champlain produit, parmi les Iroquois, un effet «semblable à celui de la bombe atomique sur le Japon en 1945 (B.25)»; la petite vérole communiquée par les couvertures infectées de l’homme blanc devient le prototype d’une stratégie d’extermination qui montre «que les Américains ne sont pas les inventeurs de la guerre bactériologique (B.32)»; les militaires du régime français pratiquent une «destruction systématique semblable à celle que font les Américains aujourd’hui au Vietnam et au Laos (B.33)», et «remercient Dieu de leur avoir donné la force de perpétrer ce génocide (B.35)»! Les «réserves» deviennent
 des «camps de concentration» (B.46) et «le lent génocide de la race rouge
est un autre crime sur la conscience de l’homme blanc (B.46)…» Devant
un tel sens des proportions, comment un lecteur pourrait-il ne pas
sortir d’une telle lecture sans se sentir coupable et démoralisé…? Ces
anachronismes, en rapprochant les techniques de destruction de masse
modernes de l’action historique d’autres époques, servent également à
refuser et à dénoncer le progrès et l’emprise de la technique sur la vie
quotidienne, ce qui ne fait sûrement pas partie de la doxa
marxiste! En les dénonçant par leurs manifestations les plus barbares
et les plus meurtrières, Bergeron exprime un refus du modernisme qui le
rapproche à la fois de Ferron et de l’état d’anomie de la société
québécoise de l’époque, prise entre le traditionalisme et le futurisme.
des «camps de concentration» (B.46) et «le lent génocide de la race rouge
est un autre crime sur la conscience de l’homme blanc (B.46)…» Devant
un tel sens des proportions, comment un lecteur pourrait-il ne pas
sortir d’une telle lecture sans se sentir coupable et démoralisé…? Ces
anachronismes, en rapprochant les techniques de destruction de masse
modernes de l’action historique d’autres époques, servent également à
refuser et à dénoncer le progrès et l’emprise de la technique sur la vie
quotidienne, ce qui ne fait sûrement pas partie de la doxa
marxiste! En les dénonçant par leurs manifestations les plus barbares
et les plus meurtrières, Bergeron exprime un refus du modernisme qui le
rapproche à la fois de Ferron et de l’état d’anomie de la société
québécoise de l’époque, prise entre le traditionalisme et le futurisme.D’autres anachronismes parsèment le texte et servent à déconsidérer souvent les Québécois eux-mêmes dans leur propre histoire. Lorsque Bergeron raconte comment, au XIXe siècle, le procureur général Caldwell a dérobé 95 000 livres au trésor public pour faire de la spéculation sur les terres de la couronne, il ajoute malicieusement, entre parenthèses : «On voit où nos patroneux d’aujourd’hui ont appris à voler la population (B.84).» Les autres anachronismes visent à rapprocher les stratégies de la décolonisation des épisodes passés de l’histoire du Québec. Le British Rifle Corps dissout par Dalhousie est présenté comme un équivalent anglais de l’O.A.S. durant la guerre d’Algérie (B.89-90); Bonaventure Viger, lui, «semble être le seul patriote à avoir une notion de la guérilla (B.96)», et l’Australie, où seront envoyés de nombreux patriotes en 1839, est, encore-là, un camp de concentration (B.102 n.1). Certaines notions promues par Riel, selon Bergeron, «se rapprochent de “l’homme nouveau” de Che Guevara (B.158).» Puis, la répression de la crise d’octobre ressemble à un coup de force des nazis: «Les forces de répression agissent vis-à-vis des suspects comme les SS de Hitler. Ils défoncent les portes en pleine nuit, réveillent les “suspects” avec des canons de mitraillettes, les bousculent, les emmènent comme des criminels en laissant derrière eux des femmes terrifiées, des enfants terrorisés (B.244)…» Enfin, les derniers anachronismes repérés sont plutôt des bourdes de l’auteur: l’élection du capitaine de milice attribuée à l’incursion américaine de 1775 remonte, dans les faits, au régime français (B.71) et le traité de Gand en 1817 alors qu’il est de décembre 1814 (B.80).
Tous ces scandales faciles, tous ces anachronismes simplistes sont autant de manifestations de ces «sanglots de l’homme blanc» dont parle Pascal Bruckner. Ses observations s’appliquent très bien à ce type de discours idéologique culpabilisateur, mais qui se veut en même temps mobilisateur et pratique, engagé dans le renouvellement de la condition d’un type national hybride, à la fois oppresseur (de l’Amérindien) et opprimé (par l’Angleterre puis le Canada).
Bruckner affirme que «l’a priori de culpabilité, c’est la béquille qui vient suppléer aux raisonnements défaillants, le petit coup de pouce qui assoit une démonstration incertaine.»15 C’est le manque de perspectives d’avenir qui limite la moralisation de nos auteurs, qui se bornent à idéaliser des groupes opprimés (les Amérindiens, les habitants, les travailleurs productifs, etc.) ou des événements de défaite (la Rébellion de 37-38, l’écrasement du soulèvement métis de Riel, etc.). La question de la culpabilité posée explicitement par Bouthillette correspond peut-être à la genèse des fixations portées sur un idéal perdu et une corruption irréversible. Que la «démocratie» amérindienne représente un retour aux valeurs sûres des sociétés originaires ou que les Québécois ne peuvent se fier qu’à eux-mêmes pour renverser leur condition d’opprimés, ces affirmations reposent moins sur une analyse politique (même si cette analyse est juste) que sur l’idéalisation de l’Autre au prix du rabaissement de Soi. Bruckner suppose que le sanglot de l’homme blanc s’articule sur «la solidarité, modalité de l’être-ensemble; la compassion, modalité de l’être-à-la-place-de; et le mimétisme, catégorie de l’être-comme.»16 L’a priori est l’affirmation d’une solidarité. Mais voilà, laquelle? Pour le Québec, la solidarité nationale est un échec. L’être-ensemble québécois, apparu pour Ferron au début du XIXe siècle, se fractionne. La Rébellion, qui aurait dû en être le premier ciment, est détournée par le clergé. Pour Bergeron, l’être-ensemble doit constamment s’épurer de «traîtres» (dans la petite bourgeoisie aussi bien que dans le clergé) pour en arriver à un noyau social qui est le peuple travailleur et réellement productif. L’être-ensemble est perdu ou vulnérable et sa nostalgie est le premier aveu de la démoralisation de nos auteurs. Contrairement à l’Européen qui est seulement coupable en tant que colonisateur, la génération intellectuelle des années quatre-vingt considère le peuple québécois à la fois comme coupable en tant que colonisateur de l’Amérindien, et comme victime en tant que colonisé de l’Anglais. Ainsi écartelée, elle attend sa réunification au sein d’une identité conciliée rendue possible seulement par l’articulation d’une praxis humaniste ou révolutionnaire. Cette conciliation semble d’autant plus irréalisable qu’une partie de l’ensemble national, ces «Canadiens français», canayens ralliés à la domination anglaise, semblent porter le chapeau du colonisateur avec l’oppresseur national tandis que l’autre partie, ces habitants, Canayens devenus Québécois, travailleurs prolétarisés, semblent dotés du fardeau à la fois du colonisé et de l’opprimé national. Contrairement au sanglot européen, le sanglot québécois coule à la fois pour l’Autre et pour soi.
Ainsi, à la place d’un discours idéologique de ralliement on en trouve un qui ne cesse de dénoncer l’éclatement. On recourt alors à la compassion, la modalité de l’être-à-la-place-de. La culpabilité est sublimée par le salut. C’est là une vieille mora-lisation chrétienne comme le reconnaît Bruckner: «l’autrui lointain pouvait être magnifié selon le schéma chrétien de la chute [ici la découverte, la colonisation, la conquête ou la confédération], et de la rédemption [ici la «démocratie» iroquoise, la guérilla révolutionnaire tiers-mondiste ou la Huronnie jésuite]17.» Mais encore là, alors que l’Européen cumule la responsabilité de la chute et de la rédemption, le Québécois est partagé. Une partie de la minorité nationale est responsable de la chute, celle-là même qui porte le chapeau du colonisateur, et l’autre est responsable du salut, celle qui porte le fardeau du colonisé. Bergeron se met à la place des Rebelles de 1837-1838 et leur dit comment ils auraient dû mener la guérilla plutôt que d’affronter la troupe anglaise à
 l’européenne.
Il salue le dynamiteur de la résidence de Lord Atholstan et conspue
Bourassa. Ferron passe son temps à ridiculiser les prétentions des
personnages du régime français, à l’exception de la Huronnie des pères
Jésuites. Cartier est un Hérode, donc les Amérindiens sont les Saints-Innocents.
Un certain attendrissement hante les textes de nos auteurs. «Faute de
capacité réelle, dit Bruckner, c’est l’attendrissement qui domine. Il ne
s’agit pas tant de faire quelque chose que d’être jugé, le salut est
dans le verdict qui fait de nous des réprouvés, chacun à sa place dans
un monde en ordre.»18 Cet ordre, les petites pyramides sociales qui
parsèment le livre de Bergeron l’illustrent fort bien. L’impuissance de
nos auteurs est réelle, tout autant que leur aspiration au salut, et la
démoralisation est cette nostalgie attendrissante pour un salut qui ne
peut réparer la chute. Le Canadien français recouvert du chapeau du
colonisateur en tant qu’oppresseur de l’Amérindien, du Métis et du
travailleur québécois, est responsable de la chute. Le Québécois écrasé
du fardeau du colonisé en tant qu’opprimé est porteur d’un salut, mais
en acceptant de se laisser coloniser comme l’Amérindien, de se laisser
exploiter comme le colon ou de se laisser opprimer comme le travailleur,
il confie le soin à d’autres – mais à qui? – de réaliser son salut.
Ignorant qui sera ce généreux messie, son salut lui apparait comme
tragiquement inaccessible et le condamne à l’apathie politique. Non
seulement devient-il doublement coupable car il ne peut plus sauver la
part colonisatrice de sa «race», mais en plus, il ne peut plus assurer
son propre salut parce qu’il s’est exclu de cette possibilité par son
statut victimaire dont il ne peut plus s’échapper sans tomber du côté de
l’oppresseur. Refusant son statut «canadien-français» colonisateur, le
Québécois s’est réfugié dans le statut de l’opprimé qui s’est refermé
sur lui, comme une véritable souricière. Son amour et son idéalisation
de l’Amérindien ne le libèrent pas de la complicité canadienne-française
dans l’exploitation de l’opprimé autochtone, pas plus que la Rébellion
de 37-38 ne renverse le Chouayen complice de l’oppresseur de l’habitant.
Cet amour est une valeur faussement positive dont le but est de
souligner la position négative où se situe la condition québécoise.
L’Amérindien s’efface après la Conquête car il peut laisser la place à
l’habitant: il n’était qu’un prétexte au discours idéologique devant
mener au seul véritable opprimé actuel, le travailleur québécois. À leur
tour, l’habitant et le Patriote seront éclipsés par le travailleur
productif révolutionnaire et relégués au rang de complices de la
bourgeoisie opprimante. Impossible de se dégager de la souricière
victimaire sans tomber dans la complicité ou la traîtrise. «C’est une
exploitation atroce, une oppression sans frein qui ont permis notre
croissance actuelle. Nous descendons de si peu, tel est notre dégoût.»19
Et voilà la raison de la critique et du refus du progrès enregistrée
dans la moralisation idéologique de nos auteurs. Il n’y a pas
d’être-à-la-place-de car le colonisateur est déjà le colonisé (en tant
que descendant de l’Amérindien, habitant vaincu de 1837, puis inséré
comme dominé dans le mode de production capitaliste américain) et le
colonisé est déjà le colonisateur (en tant qu’héritier du Français
barbare, de l’Anglais impérialiste et du petit bourgeois québécois
assoiffé de pouvoir et de domination sur les siens). On ne peut pas
être-à-la-place-de quelqu’un qu’on est déjà!
l’européenne.
Il salue le dynamiteur de la résidence de Lord Atholstan et conspue
Bourassa. Ferron passe son temps à ridiculiser les prétentions des
personnages du régime français, à l’exception de la Huronnie des pères
Jésuites. Cartier est un Hérode, donc les Amérindiens sont les Saints-Innocents.
Un certain attendrissement hante les textes de nos auteurs. «Faute de
capacité réelle, dit Bruckner, c’est l’attendrissement qui domine. Il ne
s’agit pas tant de faire quelque chose que d’être jugé, le salut est
dans le verdict qui fait de nous des réprouvés, chacun à sa place dans
un monde en ordre.»18 Cet ordre, les petites pyramides sociales qui
parsèment le livre de Bergeron l’illustrent fort bien. L’impuissance de
nos auteurs est réelle, tout autant que leur aspiration au salut, et la
démoralisation est cette nostalgie attendrissante pour un salut qui ne
peut réparer la chute. Le Canadien français recouvert du chapeau du
colonisateur en tant qu’oppresseur de l’Amérindien, du Métis et du
travailleur québécois, est responsable de la chute. Le Québécois écrasé
du fardeau du colonisé en tant qu’opprimé est porteur d’un salut, mais
en acceptant de se laisser coloniser comme l’Amérindien, de se laisser
exploiter comme le colon ou de se laisser opprimer comme le travailleur,
il confie le soin à d’autres – mais à qui? – de réaliser son salut.
Ignorant qui sera ce généreux messie, son salut lui apparait comme
tragiquement inaccessible et le condamne à l’apathie politique. Non
seulement devient-il doublement coupable car il ne peut plus sauver la
part colonisatrice de sa «race», mais en plus, il ne peut plus assurer
son propre salut parce qu’il s’est exclu de cette possibilité par son
statut victimaire dont il ne peut plus s’échapper sans tomber du côté de
l’oppresseur. Refusant son statut «canadien-français» colonisateur, le
Québécois s’est réfugié dans le statut de l’opprimé qui s’est refermé
sur lui, comme une véritable souricière. Son amour et son idéalisation
de l’Amérindien ne le libèrent pas de la complicité canadienne-française
dans l’exploitation de l’opprimé autochtone, pas plus que la Rébellion
de 37-38 ne renverse le Chouayen complice de l’oppresseur de l’habitant.
Cet amour est une valeur faussement positive dont le but est de
souligner la position négative où se situe la condition québécoise.
L’Amérindien s’efface après la Conquête car il peut laisser la place à
l’habitant: il n’était qu’un prétexte au discours idéologique devant
mener au seul véritable opprimé actuel, le travailleur québécois. À leur
tour, l’habitant et le Patriote seront éclipsés par le travailleur
productif révolutionnaire et relégués au rang de complices de la
bourgeoisie opprimante. Impossible de se dégager de la souricière
victimaire sans tomber dans la complicité ou la traîtrise. «C’est une
exploitation atroce, une oppression sans frein qui ont permis notre
croissance actuelle. Nous descendons de si peu, tel est notre dégoût.»19
Et voilà la raison de la critique et du refus du progrès enregistrée
dans la moralisation idéologique de nos auteurs. Il n’y a pas
d’être-à-la-place-de car le colonisateur est déjà le colonisé (en tant
que descendant de l’Amérindien, habitant vaincu de 1837, puis inséré
comme dominé dans le mode de production capitaliste américain) et le
colonisé est déjà le colonisateur (en tant qu’héritier du Français
barbare, de l’Anglais impérialiste et du petit bourgeois québécois
assoiffé de pouvoir et de domination sur les siens). On ne peut pas
être-à-la-place-de quelqu’un qu’on est déjà!Enfin il y a le mimétisme, l’être-comme, être comme l’Amérindien, le colon, le Patriote, le travailleur productif. Et n’être pas comme Cartier, Lafontaine, Laurier ou Duplessis. À force de compatir pour l’Autre, on finit par s’identifier à lui. Il est le Juste de l’Ancien Testament, et nous nous approprions ses bons côtés: «Si je suis l’Autre, ses victoires deviennent mes victoires.»20 Bruckner parlera encore de «l’émulation fraternelle». Les Iroquois vainquent Dollard parce que les Patriotes ont été vaincus par les Anglais. D’une part, il y a le refoulement de la haine de l’Anglais, dont parle Jean Bouthillette, et d’autre part l’Amérindien est magnifié, comme pour s’assurer une revanche à travers sa filiation pour l’habitant et le travailleur. Mais comment vouloir être à la fois l’Amérindien et l’Anglais, ne plus être vaincu sans être vainqueur? Se comporter comme un Indien tout en lorgnant du côté de Bay Street? Se comporter comme un Businessman tout en rêvant à la course des bois? Ferron et Bergeron vivent de mimétisme par procuration. Nous n’aimons plus l’Autre pour lui-même, mais nous nous haïssons pour n’être pas ce à quoi nous aspirons à ressembler idéalement. La démoralisation ne peut être complète que par notre propre impuissance, notre échec même dans nos sanglots d’homme blanc, notre incapacité d’être-à-la-place-de, d’être-comme, et nous échouons même cela: «Un nouveau fétichisme prit la place de l’émulation fraternelle, fétichisme dont l’idéal était moins de trouver une voie révolutionnaire pour [le Québec] que d’imiter les différents courants insurrectionnels du monde extérieur.»21 Faisons comme l’Amérindien, le travailleur, le dynamiteur, le guérillero, le juste. Imitons-les, ce sont des valeurs sûres. Mais si nous ne sommes pas, nous, une valeur sûre, nous qui sécrétons des violeurs (les découvreurs), des usurpateurs (Dollard, le salaud) et des traîtres (Lafontaine, Cartier, Laurier, ces vendus), des escrocs (le clergé) et des exploiteurs (les seigneurs, les capita-listes), alors notre passé devient gênant pour notre avenir puisqu’il en reste toujours le meilleur garant, comme le rappelle le proverbe. Ni Ferron ni Bergeron ne proposent de solution originale ou de morale du salut car ils sont les premiers à prendre conscience, dans le contexte du sanglot de l’homme blanc, de l’incompatibilité du chapeau du colonisateur et du fardeau du colonisé. Comment ne pas anticiper avec certaines craintes l’engagement dans une quelconque utopie sans penser à la faillite de la Huronnie (qui se termina par l’extermination des Hurons) ou de la guerilla d’Amérique latine (on sait depuis où cela a conduit)? La démoralisation démasquée, c’est la conscience historique révélée non seulement d’une haine de soi latente, mais d’une fracture dont il faut étudier la profondeur psycho-collective.
La haine de soi «est en réalité haine de toutes les cultures en une seule. On commence par ne plus rien trouver d’aimable en soi et l’on finit par désapprendre d’aimer les autres. Si le prix qu’on attache aux sociétés étrangères est fonction du dédain qu’on porte à la nôtre, il y a fort à parier que cet engouement déclinera dès qu’on sera réconcilié avec son milieu ou qu’il sombrera au mieux dans un éclectisme esthétisant.»22 La prophétie de Bruckner s’est réalisée dans les années qui ont suivi la parution de son livre. La cote d’amour du Tiers-Monde a baissé radicalement auprès des intellectuels qui, dix ou vingt ans plus tôt, pleurnichaient comme des Madeleines. Sauf au Québec. L’échec référendaire a empêché la réconciliation tant attendue et la crise d’Oka de l’été 1990 a rallumé en soi le concert des compassions bilieuses auxquelles nous nous sommes abandonnés à nouveau, corps et âme. «Une doctrine qui prêche la libération de l’humanité ne saurait s’appuyer sur le mépris d’une civilisation prise globalement; ce n’est pas à se rétrécir que travaille l’homme mais à accroître son pouvoir»23, et avec Bruckner encore, on ne peut que se méfier d’un humanisme qui commence et s’obstine à dépeupler les premiers siècles de notre histoire seulement parce qu’on a une dent contre Dollard et son comité de soutien clérical.
 «Il
est donc dérisoire de penser que le culte systématique de la honte va
nous ouvrir comme par miracle aux sociétés lointaines, effacer les
malentendus… Peut-on admettre qu’en dehors d’un vague malaise rien ne
nous rattache» aux Amérindiens, aux colons français, aux Patriotes
petits-bourgeois ou aux travailleurs productifs? Il y avait beaucoup de
haine dans les ouvrages de Ferron, de Bergeron et de Beaulieu que nous
étudions ici, une haine qu’ils partageaient avec toute leur génération,
une haine honteuse et retournée contre soi mais ne véhiculant rien de
positif ni d’affirmatif. «On fait un médiocre usage des autres quand on
est fatigué de sa propre existence.»24 Cette fatigue était celle
accumulée par la population québécoise depuis les années quarante, quand
elle ouvrit grandes les portes à la modernisation, la technologie et le
confort. La démoralisation tranquille pouvait exprimer cet ennui
idéologique face au fardeau de la mise à jour de la société québécoise,
cet ennui de manquer un bon programme à la télé pour écouter le chapelet
en famille «callé» par le cardinal Léger! Pour remédier à cette
situation, il fallait agir au plus vite, avant que la morosité ne
l’emporte. Je me souviens que c’était la grande espérance de la soirée
du 15 novembre 1976, lors de la première élection du Parti Québécois au
pouvoir. Espérance vite déçue. Il y avait trop de bile accumulée – celle
qui éclabousse M. de la Dauversière dans Ferron –, et il y en avait
encore plus dans le foie de M. Bergeron qui noya les capitalistes et
les oppresseurs de tout acabit. Mais il y avait aussi de l’humour dans
Ferron et du militantisme dans Bergeron. Dans le poème de Richard
Desjardins publié par «Le Devoir» au printemps 1992, que reste-t-il de
tout cela à part la bile?25
«Il
est donc dérisoire de penser que le culte systématique de la honte va
nous ouvrir comme par miracle aux sociétés lointaines, effacer les
malentendus… Peut-on admettre qu’en dehors d’un vague malaise rien ne
nous rattache» aux Amérindiens, aux colons français, aux Patriotes
petits-bourgeois ou aux travailleurs productifs? Il y avait beaucoup de
haine dans les ouvrages de Ferron, de Bergeron et de Beaulieu que nous
étudions ici, une haine qu’ils partageaient avec toute leur génération,
une haine honteuse et retournée contre soi mais ne véhiculant rien de
positif ni d’affirmatif. «On fait un médiocre usage des autres quand on
est fatigué de sa propre existence.»24 Cette fatigue était celle
accumulée par la population québécoise depuis les années quarante, quand
elle ouvrit grandes les portes à la modernisation, la technologie et le
confort. La démoralisation tranquille pouvait exprimer cet ennui
idéologique face au fardeau de la mise à jour de la société québécoise,
cet ennui de manquer un bon programme à la télé pour écouter le chapelet
en famille «callé» par le cardinal Léger! Pour remédier à cette
situation, il fallait agir au plus vite, avant que la morosité ne
l’emporte. Je me souviens que c’était la grande espérance de la soirée
du 15 novembre 1976, lors de la première élection du Parti Québécois au
pouvoir. Espérance vite déçue. Il y avait trop de bile accumulée – celle
qui éclabousse M. de la Dauversière dans Ferron –, et il y en avait
encore plus dans le foie de M. Bergeron qui noya les capitalistes et
les oppresseurs de tout acabit. Mais il y avait aussi de l’humour dans
Ferron et du militantisme dans Bergeron. Dans le poème de Richard
Desjardins publié par «Le Devoir» au printemps 1992, que reste-t-il de
tout cela à part la bile?25Notes
- Cf. les réponses de Karl Marx au «jeu de la confession» que lui font subir ses filles, in J. Bruhat. Marx/Engels, Paris, U.G.É., Col. 10/18 #630-631, 1971, p. 194.
- C. Morissonneau. La Terre promise: le mythe du Nord québécois, Ville La Salle, Hurtubise HMH, Col. Cahiers du Québec #39, 1978, particulièrement la note infrapaginale, p. 187.
- G. Dussault. Le Curé Labelle, Montréal, Hurtubise HMH, Col. Sciences de l'homme et humanisme #9, 1983.
- Mistigoche, nom méprisant donné aux Français par les Indiens et que reprend Ferron à quelques reprises.
- Nom étymologique des Iroquois.
- J. Poirier. Histoire de l'ethnologie, Paris, P.U.F., Col. Que sais-je? # 1338, 1969, p. 54.
- Abbé Ferland. Cours d'Histoire du Canada, tome 1, p. 98, cité in S. Gagnon. Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920, Québec, P.U.L., Col. Les cahiers d'histoire de l'Université Laval #23, 1978, pp. 339-340.
- R. Migner. «Jacques Ferron et l'histoire de la formation sociale québécoise», in Études Françaises: Jacques Ferron, octobre 1976, p. 348.
- Un exemple sordide confirme tout ceci, depuis la rédaction initiale du texte. Le soir du référendum d'octobre 1995 sur la Souveraineté du Québec, quand, après avoir dénoncé les pouvoirs d'argent comme causes de l'échec du «Oui», le gouvernement Parizeau du Parti Québécois, se retourne contre les pauvres en établissant des mesures vexatoires et répressives aux assistés sociaux.
- G. Bourque. Classes sociales et question nationale au Québec, 1760-1840, Montréal, Parti-Pris, Col. Aspects #7, 1970.
- S. B. Ryerson. Le Capitalisme et la Confédération, Montréal, Parti-Pris, Col. Aspects, 1972. L'édition originale date de 1968.
- Cf. A. Dupront. «Du sentiment national», in M. François (éd.), La France et les Français, Paris, Gallimard, Col. Pléiade, 1972, pp. 1423 à 1473.
- J. Bouthillette. Le Canadien français et son double, Montréal, L'Hexagone, 1972, p. 76.
- Hugh Graham, fait Lord Atholstan, directeur du Montreal Star et partisan libéral de la conscription. Des membres de la Jeunesse libérale, aux «tempéraments méridionaux, violents et provocateurs», infiltrés en plus d'agents subversifs, ne partageaient pas les mêmes vues. Ils firent exploser, dans la nuit du 7 au 8 août 1917, une bombe qui n'atteignit pas le Lord, qui était absent de sa résidence de Cartierville, mais écorcha le balcon. Cet écho annonciateur des pétarades des années soixante est réprimé avec la même exagération que plus tard les interventions felquistes: «À Montréal, les arrestations avaient un peu calmé les plus emballés, mais on s'entretenait beaucoup de l'affaire des "dynamitards". Les inculpés avaient disposé de quelques fusils empruntés ou dérobés à des corps de cadets. La police fédérale persquisitionna dans les collèges… Mais Paul-Émile Lamarche, aidé par des détectives de la police provinciale, parvint à établir le rôle des agents provocateurs. Deux détenus de Saint-Vincent-de-Paul, libérés sous caution, étaient sans doute les auteurs de "l'attentat" contre la résidence de Lord Atholstan. Ils commirent d'autres méfaits, sans rapport avec l'agitation anti-conscriptionniste. L'un d'eux fut arrêté. L'autre - un fils de famille dévoyé - poursuivi et sur le point d'être pris se suicida. Lamarche croyait toute l'affaire des "dynamitards" montée par le gouvernement fédéral, cherchant à provoquer des incidents à Montréals pour y proclamer la loi martiale. Il obtint un mandat d'arrêt contre Ti-Noir Desjardins, auteur de rapports au chef de la police fédérale. Tout Montréal suivit cette affaire bizarre». R. Rumilly. Histoire de la province de Québec, vol. 22: la Conscription, Montréal, Montréal Éditions, s.d., p. 156. On le voit, l'action des mouchards de la G.R.C. ne date pas de la crise d'Octobre!
- P. Bruckner. Le sanglot de l'homme blanc, Paris, Seuil, Col. L'histoire immédiate, 1983, p. 14.
- P. Bruckner. ibid. p. 16.
- P. Bruckner. ibid. p. 53.
- P. Bruckner. ibid. p. 125.
- P. Bruckner. ibid. p. 106.
- P. Bruckner. ibid. p. 48.
- P. Bruckner. ibid. p. 49.
- P. Bruckner. ibid. p. 269.
- P. Bruckner. ibid. p. 269.
- P. Bruckner. ibid. p. 270.
- «Le messie, maintenant, je le crois identifié. Ce sont les immigrants, cette clientèle électorale que courtise vainement le P.Q. sans recevoir de réponses favorables en retour. La déclaration déjà citée du Premier Ministre Parizeau au soir du référendum d'octobre 1995 associait le «vote ethnique» à l'argent comme double cause de l'échec du Oui à l'indépendance du Québec (et donc à la séparation d'avec le Canada). Des immigrants, les indépendantistes québécois attendent l'approbation de la portée historique universelle du geste poliique de souveraineté. Comme la réponse tant attendue ne vient pas, alors ils se renfrognent. Bergeron le disait: la libération ne peut venir que de nous-mêmes, car nous-mêmes détenons la clé de la souricière. On ne peut être dans et hors de l'Histoire en même temps! Ce qu'il y avait de pathétique dans la remarque de M. Parizeau, c'est qu'elle baignait dans une sauce éthylique qui me rappelait les vers de la bonne vieille chanson folklorique «Prendre un verre de bière, mon minou», et qui rimait à peu près ainsi:
Tu m'en offres pas.
J'te fais des belles façons,
J'te chante des belles chansons:
Donnes-moé s'en donc.
2. AU SANA AU PLUS HAUT DES CIEUX
Historiographie nationale et roman familial
De la démoralisation nous passons à la haine de soi. De l’idéologique, nous entrons de plain-pied dans le niveau symbolique de la représentation sociale organisée, nous passons au monde des affects et des significations liés entre eux. Pour pénétrer à l’intérieur de ce niveau de signification, il faut d’abord explorer la définition du Moi québécois que les auteurs de l’époque pouvaient se donner. Celle de Jean Bouthillette est, à cet égard, la mieux circonscrite et celle à laquelle l’ensemble des intellectuels de cette génération pouvaient le mieux se rallier. Une fois ce Moi collectif défini, il faut voir comment il entend se raconter une «histoire familiale». Toute étude du roman national qui exclut ou qui ne s’attarde pas à interroger l’histoire familiale est une étude incomplète. Le temps est venu de passer aux choses sérieuses…
Les Québécois haïsssent le Québec (et le Canada, bien sûr). Si le Canada s’engouffrait demain matin sous les flots et laissait l’océan prendre la place, ça ferait vivre un peu mieux les pêcheurs de la côte nord américaine. Les atlas auraient moins de noms à changer qu’après l’éclatement de l’Union Soviétique, lorsqu’il y eut le rebaptême des villes russes. Les livres d’histoire universelle n’auraient qu’à soustraire une ou deux lignes, effacer quelques dates et l’ensemble de l’ouvrage n’en souffrirait guère. Bref, ce serait un bon débarras. Se tuer à soi-même, est la forme la plus achevée de suicide. C’est celle que les Québécois pratiquent – en lenteur ou en accéléré? – depuis 155 ans!
 Quand
Victor-Lévy Beaulieu fait l’inventaire des petites littératures du
Québec, il les qualifie de littérature «souterraine, pleine de fous, de
névrosés, d’infirmes, d’ivrognes, de mystiques, de martyrs et de
malades.» Il se dit à lui-même que cette littérature avait, devait avoir
un sens (VLB.17), car dans le vécu, c’est carrément insupportable. Tous
ces types lui posent «une énigme» (VLB.17), et il finit par conclure
que ce «cheminement souterrain d’une foule de Québécois qui, dans la
société de leur temps, ne pouvaient être que des laissés-pour-compte ou,
ce qui est pis, les victimes faciles d’un système dont la philosophie
d’étouffement avait quelque chose de prodigieusement inhumain (VLB.18).»
Ce souterrain est l’antre de notre haine de nous-mêmes: «Héritiers
d’une histoire humiliée, nous redoutons toujours, moins de nous pencher
sur elle, comme un entomologiste sur un insecte mort, que sur nous en
elle. Blessure toujours ouverte, notre passé, à seulement en rappeler un
certain visage, semble nous happer, comme pour nous engouffrer à
jamais. Nous fuyons l’image que le miroir de l’intériorisation
collective nous renvoie.»1 Nous pencher sur nous-mêmes dans notre
histoire, c’est descendre dans l’antre, affronter les monstres obscurs
de la brutalité, de la rage, de la démence avec lesquelles nous nous
portons des coups à travers notre déchéance morale. Même aux grands
moments de la Contre-Réforme, aucune société catholique post-tridentine
européenne ne s’est autant flagellée, quotidiennement mortifiée,
publiquement avilie que la société québécoise après l’échec des troubles
de 1837-1838. Ce comportement aberrant se poursuit, du dolorisme
catholique au byzantinisme tâtillon de l’État post-révolution
tranquille. Notre générosité et notre gentillesse n’ont rien de gratuit
ou d’authentique. C’est une haine de nous-mêmes que nous enveloppons
dans du coton ouaté pour mieux nous boucher les yeux, les oreilles, les
narines et tout orifice du corps qui pourrait laisser entrer l’air
libre, la joie, la vie, pour ne laisser ouverts que les orifices par où
le trop plein de matière putride sécrétée par notre corps culturel en
décomposition peut être évacué.
Quand
Victor-Lévy Beaulieu fait l’inventaire des petites littératures du
Québec, il les qualifie de littérature «souterraine, pleine de fous, de
névrosés, d’infirmes, d’ivrognes, de mystiques, de martyrs et de
malades.» Il se dit à lui-même que cette littérature avait, devait avoir
un sens (VLB.17), car dans le vécu, c’est carrément insupportable. Tous
ces types lui posent «une énigme» (VLB.17), et il finit par conclure
que ce «cheminement souterrain d’une foule de Québécois qui, dans la
société de leur temps, ne pouvaient être que des laissés-pour-compte ou,
ce qui est pis, les victimes faciles d’un système dont la philosophie
d’étouffement avait quelque chose de prodigieusement inhumain (VLB.18).»
Ce souterrain est l’antre de notre haine de nous-mêmes: «Héritiers
d’une histoire humiliée, nous redoutons toujours, moins de nous pencher
sur elle, comme un entomologiste sur un insecte mort, que sur nous en
elle. Blessure toujours ouverte, notre passé, à seulement en rappeler un
certain visage, semble nous happer, comme pour nous engouffrer à
jamais. Nous fuyons l’image que le miroir de l’intériorisation
collective nous renvoie.»1 Nous pencher sur nous-mêmes dans notre
histoire, c’est descendre dans l’antre, affronter les monstres obscurs
de la brutalité, de la rage, de la démence avec lesquelles nous nous
portons des coups à travers notre déchéance morale. Même aux grands
moments de la Contre-Réforme, aucune société catholique post-tridentine
européenne ne s’est autant flagellée, quotidiennement mortifiée,
publiquement avilie que la société québécoise après l’échec des troubles
de 1837-1838. Ce comportement aberrant se poursuit, du dolorisme
catholique au byzantinisme tâtillon de l’État post-révolution
tranquille. Notre générosité et notre gentillesse n’ont rien de gratuit
ou d’authentique. C’est une haine de nous-mêmes que nous enveloppons
dans du coton ouaté pour mieux nous boucher les yeux, les oreilles, les
narines et tout orifice du corps qui pourrait laisser entrer l’air
libre, la joie, la vie, pour ne laisser ouverts que les orifices par où
le trop plein de matière putride sécrétée par notre corps culturel en
décomposition peut être évacué.Beaulieu a raison encore de souligner qu’«au fond, nous savons rarement ce dont nous parlons quand il s’agit du Québec (VLB.19)», et lui-même avoue, candidement: «On ne sait jamais trop trop pourquoi certaines choses vous attirent et vous atteignent dans votre sensibilité alors que
 d’autres,
sans doute plus émouvantes, vous laissent indifférent (VLB.125).» Ces
choses sont devenues pour lui «les archétypes et les fixations
(VLB.223)» exacerbées que véhiculent la petite littérature du Québec.
Les infirmes, les tuberculeux, les colons épuisés par le malheur, les
mystiques arriérés mentaux, etc. Mais ce qui est fascinant, c’est de
voir comment, lorsque paraît quelque chose de sain et de vivant à
l’horizon, les mécanismes conscients/inconscients de la société
québécoise se mettent en action afin de l’encercler, de l’isoler, de le
réduire et de l’exterminer: «Je dis tout de suite que Gérard Raymond,
seulement d’un point de vue littéraire, n’était pas sans talent. Son
lyrisme, son sens de la phrase, sa facilité de décrire les choses et les
gens, ses réflexions sur la vie, la musique et l’art, auraient pu, avec
le temps, produire des ouvrages fort valables. Mais tout cela passa
ailleurs, dans l’idéal de la sainteté (VLB.164).» Gérard Raymond n’est
qu’une autre parmi tant de victimes immolées sur l’autel de la pureté
d’âme des Québécois.
d’autres,
sans doute plus émouvantes, vous laissent indifférent (VLB.125).» Ces
choses sont devenues pour lui «les archétypes et les fixations
(VLB.223)» exacerbées que véhiculent la petite littérature du Québec.
Les infirmes, les tuberculeux, les colons épuisés par le malheur, les
mystiques arriérés mentaux, etc. Mais ce qui est fascinant, c’est de
voir comment, lorsque paraît quelque chose de sain et de vivant à
l’horizon, les mécanismes conscients/inconscients de la société
québécoise se mettent en action afin de l’encercler, de l’isoler, de le
réduire et de l’exterminer: «Je dis tout de suite que Gérard Raymond,
seulement d’un point de vue littéraire, n’était pas sans talent. Son
lyrisme, son sens de la phrase, sa facilité de décrire les choses et les
gens, ses réflexions sur la vie, la musique et l’art, auraient pu, avec
le temps, produire des ouvrages fort valables. Mais tout cela passa
ailleurs, dans l’idéal de la sainteté (VLB.164).» Gérard Raymond n’est
qu’une autre parmi tant de victimes immolées sur l’autel de la pureté
d’âme des Québécois.D’une façon un peu différente, Jean Bouthillette se demandait: «Mais comment, dans l’incertitude de soi, naître au monde sans se renier ou sans trahir ses sources? Car nous nous méfions autant du monde que de nous-mêmes.»2 Qui ne se fait pas confiance ne peut faire confiance aux autres, d’où la nécessité d’enlever la ouate pour commencer à respirer avant d’embrasser l’Amérindien ou le guérillero du Tiers-Monde. Ce côté sombre et aberrant de la psyché québécoise, c’est celui que «les récits de nos manuels d’histoire cachent [sous de] puériles complaintes.»3 La reprise de cette chute déjà mentionnée par P. Bruckner et qui, dans le cas spécifiquement québécois, est «notre façon à nous de disparaître, par dissolution du Moi. La chute est le vertige de notre aliénation.»4 Pas étonnant que nous vomissions tant de bile sur nous-mêmes, chiots de ces «chiens de Français» de Richard Desjardins et que la fascination de la «marde» soit le thème central du «Léolo» de Jean-Claude Lauzon.5
Ce processus de dissolution, trop souvent nous l’oublions parce que nous ne faisons qu’en parler, c’est l’assimilation. Pas celle qui consiste à utiliser des anglicismes quand on parle, mais celle, bien plus perverse, de se tuer à soi-même. «S’assimiler, au Québec, écrit encore Jean Bouthillette, ce n’est pas perdre sa langue, c’est se perdre de vue»6; «s’assimiler de fait, c’est mourir à soi pour renaître dans l’Autre; c’est trouver une nouvelle personnalité. Tandis que la chute est une absence à nous-mêmes et une fausse présence au monde, elle est un déracinement psychique, un no man’s land intérieur, une errance de notre âme de peuple dans son exil canadien.»7 On le voit, la démoralisation tranquille sombre, s’enfonce dans les tourments des grands remous, mælström vertigineux de notre souterrain qui fait sortir toujours plus de bile. C’est un mal de mer permanent que de naviguer sur le J.M.S. Québec…8
C’est pour cela qu’à défaut de nous pencher sur nous dans notre histoire, nous nous penchons sur l’histoire elle-même et faisons de l’historiographie nationale un «roman familial». Elle est la marque de cette absence à nous-mêmes dont parle M. Bouthillette: «Absence à nous-mêmes, la chute a pris le visage d’une nostalgie de ce que nous avons été avant la présence anglaise; elle est un regret diffus, une douleur inconsolée; elle est une quête inconsciente de nous-mêmes dans un paradis perdu.»9 C’est pour cela que nous devons utiliser les théories de Marthe Robert pour interroger l’évolution de l’historiographie québécoise, notre véritable «roman familial».
Des théories de Marthe Robert nous tirerons une interprétation freudienne des textes de Ferron, Bergeron et Beaulieu. Cette démarche ne peut nous
 informer
que si nous admettons la possibilité de l’existence d’un inconscient
collectif, d’un refoulé de la conscience collective, d’une censure
exercée sur la connaissance afin de dissimuler, de transférer ou de
déformer les informations qui parviennent à notre conscience. Cette
censure n’est pas consciente. Elle ne s’opère pas au niveau idéologique,
mais au niveau symbolique où les sens portés par les symboles sont
situés entre la multiplicité des signifiants pour un nombre limité de
signifiés.
informer
que si nous admettons la possibilité de l’existence d’un inconscient
collectif, d’un refoulé de la conscience collective, d’une censure
exercée sur la connaissance afin de dissimuler, de transférer ou de
déformer les informations qui parviennent à notre conscience. Cette
censure n’est pas consciente. Elle ne s’opère pas au niveau idéologique,
mais au niveau symbolique où les sens portés par les symboles sont
situés entre la multiplicité des signifiants pour un nombre limité de
signifiés.Pour bien comprendre le mécanisme dont il s’agit ici, nous renvoyons non pas tant à Freud lui-même, dont la pensée à propos de l’inconscient collectif est restée assez floue, ni à C.-G. Jung, dont la pensée est encore plus inconsistante à ce sujet (l’archétype comme trace de l’inconscient collectif, ça n’explique rien si l’on ne le fonde pas dans la sociologie), mais aux
 travaux de Roger Bastide
pour qui «la pensée symbolique, c’est celle où le moi se met dans les
choses, plus exactement celle où le sujet prête aux choses des
significations qui sont celles qu’il y met.»10 Pour Bastide, les
symboles sociaux renvoient aux symboles de la psyché individuelle. Une
«désexualisation du sexuel» finit par rejoindre une «sexualisation du
social»: «les images offertes par la société peuvent, durant la nuit,
descendre dans les remous souterrains du fleuve obscur de la sexualité
qui coule au-dedans de chaque individu et changer alors de
signification, devenir des symboles sexuels. De la même façon, l’acte de
chair est primitivement de la libido, mais comme il unit ce qui est
séparé; il peut se transformer en un rite symbolique d’agrégation, en
montant d’un plan à un autre, par sa participation, à un moment donné, à
une exaltation collective, source […] de toutes les valeurs
sociales.»11 Le mariage devient ainsi un exemple parfait de
«désexualisation du sexuel» en vue d’intérêts de clans, de familles, de
société; tandis que la publicité, recourant au sex-appeal,
opère une «sexualisation du social» en vue de stimuler la vente d’un
quelconque produit de consommation qui n’a parfois vraiment rien
d’érotique (une marque d’automobiles par exemple).
travaux de Roger Bastide
pour qui «la pensée symbolique, c’est celle où le moi se met dans les
choses, plus exactement celle où le sujet prête aux choses des
significations qui sont celles qu’il y met.»10 Pour Bastide, les
symboles sociaux renvoient aux symboles de la psyché individuelle. Une
«désexualisation du sexuel» finit par rejoindre une «sexualisation du
social»: «les images offertes par la société peuvent, durant la nuit,
descendre dans les remous souterrains du fleuve obscur de la sexualité
qui coule au-dedans de chaque individu et changer alors de
signification, devenir des symboles sexuels. De la même façon, l’acte de
chair est primitivement de la libido, mais comme il unit ce qui est
séparé; il peut se transformer en un rite symbolique d’agrégation, en
montant d’un plan à un autre, par sa participation, à un moment donné, à
une exaltation collective, source […] de toutes les valeurs
sociales.»11 Le mariage devient ainsi un exemple parfait de
«désexualisation du sexuel» en vue d’intérêts de clans, de familles, de
société; tandis que la publicité, recourant au sex-appeal,
opère une «sexualisation du social» en vue de stimuler la vente d’un
quelconque produit de consommation qui n’a parfois vraiment rien
d’érotique (une marque d’automobiles par exemple).Les pulsions (de vie et de mort, Éros et Thanathos), les complexes (celui d’Œdipe), les rivalités, les conflits familiaux et les tabous, peuvent donc transiter, inconsciemment, de l’organisation des relations interpersonnelles aux rapports sociaux et vice versa. Comme la mythologie ou le conte populaire, l’art et la littérature, l’historiographie peut être l’un de ces shifters qui font transiter la libido vers le social et le social vers la libido, d’où la pertinence de suivre en détail la démonstration de Mme Robert et de la confronter à l’histoire de l’historiographie québécoise.
En effet, l’historiographie, c’est souvent un roman familial (Familienroman) national écrit du point de vue du peuple, du démos, qui se met lui-même dans la case psychologique de l’enfant qui raconte ses conflits et ses attentes face à des figures parentales, la Mère nourricière (la nation, le territoire) et le Père autoritaire (l’État, les institutuions, les héros patriotiques, etc.). Même la part scientifique de l’historiographie ne parvient jamais à se défaire totalement de cette part fictive. Quoi qu’en pensent les universitaires, l’histoire, jusqu’à nou-vel ordre, reste de la littérature et sa vie dépend de l’imaginaire qu’y investit l’enquêteur. Les méthodes scientifiques ne sont là que pour «mesurer», contenir et limiter une imagination trop débordante, mais ne doivent jamais s’y substituer, sans quoi l’historiographie se déshumanise, péréclite et se fossilise dans sa tour d’ivoire. L’historiographie québécoise, depuis sa mise en place par François-Xavier Garneau au milieu du XIXe siècle, jusqu’à l’œuvre de Groulx et de ses disciples de l’Université de Montréal, dans les années 1950-1960, répon-dait à un même modèle fictionnel que décrit, dans une autre occasion, Marthe Robert: «L’enfant ne vient pas à son “roman familial” uniquement par jeu et par goût du mensonge – encore que naturellement jeu et mensonge ne soient pas les moindres de ses motifs.»12 La critique historiographique de Groulx et de Frégault faite par Ferron et Bergeron ne rend donc pas justice aux historiens. Dollard n’est pas un mensonge, mais bien le rédempteur de l’idylle familiale: parce que l’enfant «en a besoin à un moment de crise grave, pour surmonter la première déception où son idylle familiale risque de sombrer. Longtemps, en effet, le
 petit
enfant voit dans ses parents des puissances tutélaires qui lui
dispensent sans cesse leur amour et leurs soins, en échange de quoi il
les revêt spontanément non seulement d’un pouvoir absolu, mais d’une
capacité d’aimer et d’une perfection infinies qui les placent dans une
sphère à part, bien au-dessus du monde humain. Pour l’être chétif que le
danger menace de partout, cette idéalisation ne va pas sans de sérieux
profits, en fait il y trouve justement ce dont il manque dans le
sentiment de son existence précaire, d’abord un gage de sécurité (des
protecteurs tout-puissants sont plus efficaces que des gens eux-mêmes
désarmés), puis une explication honorable de sa faiblesse (il n’y a pas
de honte à se sentir infime devant l’incarnation de l’absolu), et même
un moyen de renverser toute la situation puisqu’à diviniser ses parents
on devient soi-même l’enfant-dieu.» 13 Cette première phase du
développement relationnel rappelle celle du parfait colonisé. Tous ceux
qui travaillèrent à maintenir le Québec à l’intérieur du système
colonial anglais ou qui travaillent aujourd’hui à maintenir un lien
confédératif désuet, s’associent à la grandeur de la figure parentale
(le gouverneur général, figure paternelle de l’Empire britannique
et le clergé catholique, figure maternelle de l’historiographie
cléricalo-traditionnelle dont les associations anales et orales ont été
condensées depuis dans un concept fourre-tout de «sécurité sociale»
assumée par l’État, dangereux césaro-papisme à visage humain, non dénué
de barbarie technocratique sans être garant d’efficacité, créature
bicéphale de l’Occident du second XXe siècle). Que le Canada remplace
l’Empire, ou le nationa-lisme social de l’État post-révolution
tranquille l’Église, ne change rien au modèle relationnel de base. Le
participant de cette triade qui fait figure d’Enfant-Peuple, fragile et
dominé (par manque de sevrage), reste dans la même relation parce que,
justement fragile et dominé, il finit par interpréter cela comme un
«privilège» qui lui est dû. Mais le «roman familial» ne fait que
commencer…
petit
enfant voit dans ses parents des puissances tutélaires qui lui
dispensent sans cesse leur amour et leurs soins, en échange de quoi il
les revêt spontanément non seulement d’un pouvoir absolu, mais d’une
capacité d’aimer et d’une perfection infinies qui les placent dans une
sphère à part, bien au-dessus du monde humain. Pour l’être chétif que le
danger menace de partout, cette idéalisation ne va pas sans de sérieux
profits, en fait il y trouve justement ce dont il manque dans le
sentiment de son existence précaire, d’abord un gage de sécurité (des
protecteurs tout-puissants sont plus efficaces que des gens eux-mêmes
désarmés), puis une explication honorable de sa faiblesse (il n’y a pas
de honte à se sentir infime devant l’incarnation de l’absolu), et même
un moyen de renverser toute la situation puisqu’à diviniser ses parents
on devient soi-même l’enfant-dieu.» 13 Cette première phase du
développement relationnel rappelle celle du parfait colonisé. Tous ceux
qui travaillèrent à maintenir le Québec à l’intérieur du système
colonial anglais ou qui travaillent aujourd’hui à maintenir un lien
confédératif désuet, s’associent à la grandeur de la figure parentale
(le gouverneur général, figure paternelle de l’Empire britannique
et le clergé catholique, figure maternelle de l’historiographie
cléricalo-traditionnelle dont les associations anales et orales ont été
condensées depuis dans un concept fourre-tout de «sécurité sociale»
assumée par l’État, dangereux césaro-papisme à visage humain, non dénué
de barbarie technocratique sans être garant d’efficacité, créature
bicéphale de l’Occident du second XXe siècle). Que le Canada remplace
l’Empire, ou le nationa-lisme social de l’État post-révolution
tranquille l’Église, ne change rien au modèle relationnel de base. Le
participant de cette triade qui fait figure d’Enfant-Peuple, fragile et
dominé (par manque de sevrage), reste dans la même relation parce que,
justement fragile et dominé, il finit par interpréter cela comme un
«privilège» qui lui est dû. Mais le «roman familial» ne fait que
commencer…«Or, poursuit Marthe Robert, la vie elle-même en décide autrement, car l’enfant grandit, les soins continuels dont on l’entourait commencent de se relâcher, l’amour des siens lui semble donc amoindri, et pour peu qu’il doive le partager effectivement avec un ou plusieurs nouveaux venus, rien ne peut faire qu’il ne se juge pas spolié, victime d’une imposture ou d’une vraie trahison. Non seulement il n’est plus l’unique aimé, l’enfant-roi ou le petit dieu qui avait droit à un intérêt sans faille ni partage, mais en même temps il entrevoit que ses père et mère ne sont pas non plus les seuls parents en ce monde, un début d’expérience sociale lui apprend qu’il en existe d’autres, une foule d’autres parmi lesquels beaucoup sont en quelque façon supérieurs aux siens, ayant plus d’esprit, plus de bonté, plus de fortune ou de rang. C’en est fini du culte aveugle qui résumait naguère tous ses jugements; la déception sentimentale et l’humiliation aidant, il va maintenant observer, comparer, mesurer, bref remplacer la foi par l’esprit d’exa-men, et l’éternité par la réalité trouble du temps. Il va de soi que ce passage nécessaire ne s’accomplit pas sans à-coups, l’enfant s’efforce même de le retarder, étant pris entre les exigences de son éveil intellectuel et son attachement pour des croyances périmées dont l’abandon du reste le mettrait lui-même en péril.»14 On pourrait bien reconnaître dans ce mouvement l’expérience historique québécoise vécue après 1776 (l’arrivée des Loyalistes, cet Autre qui vient rivaliser avec les Bas-Canadiens dans leur relation privilégiée et plutôt assez cordiale avec le gouvernement colonial), la fondation du Haut-Canada qui frustre le Bas (le premier, rappelons-nous le distinguo de Léandre Bergeron, étant un district et le second une colonie!), la reconnaissance d’autres puissances que l’anglaise (la rapide croissance des États-Unis; l’expérience révolutionnaire de la France, etc.), la déception, l’humiliation (sous Craig) auxquelles répond un nouvel esprit de mesure et de parcimonie dont fait preuve
 l’Enfant-Peuple
(la querelle des subsides, chantage mi-affectif mi bureaucratique; les
92 Résolutions de Papineau). Pour ces raisons, l’historiographie ne
produira alors qu’un Michel Bibaud
qui entretiendra la vision de la première phase psychique du roman
familial et du rappel de la situation de colonisation qui est celle du
Bas-Canada d’alors, mais le processus de la conscience historique
commence à peine à se mettre en place… «C’est ainsi qu’il en vient à se
raconter des histoires, ou plutôt une histoire qui n’est rien d’autre en
fait qu’un arrangement tendancieux de la sienne, une fable biographique
conçue tout exprès pour expliquer l’inexplicable honte d’être mal né,
mal loti, mal aimé; et qui lui donne encore le moyen de se plaindre, de
se consoler et de se venger, dans un même mouvement de l’imagination où
on ne sait ce qui l’emporte en fin de compte de la piété ou du
reniement.»15
l’Enfant-Peuple
(la querelle des subsides, chantage mi-affectif mi bureaucratique; les
92 Résolutions de Papineau). Pour ces raisons, l’historiographie ne
produira alors qu’un Michel Bibaud
qui entretiendra la vision de la première phase psychique du roman
familial et du rappel de la situation de colonisation qui est celle du
Bas-Canada d’alors, mais le processus de la conscience historique
commence à peine à se mettre en place… «C’est ainsi qu’il en vient à se
raconter des histoires, ou plutôt une histoire qui n’est rien d’autre en
fait qu’un arrangement tendancieux de la sienne, une fable biographique
conçue tout exprès pour expliquer l’inexplicable honte d’être mal né,
mal loti, mal aimé; et qui lui donne encore le moyen de se plaindre, de
se consoler et de se venger, dans un même mouvement de l’imagination où
on ne sait ce qui l’emporte en fin de compte de la piété ou du
reniement.»15Une fois que l’historiographie trace les premiers traits du roman familial collectif (ici national), tâche accomplie par F.-X. Garneau au lendemain du rapport
 Durham
(1839), la fantasmatique se mêle à l’interprétation des données, tâche
souvent similaire à celle accomplie par l’enfant. «Pour composer
l’intrigue de son “roman familial”, l’enfant n’a d’ailleurs pas besoin
d’une tromperie bien compliquée, il lui suffit de faire passer au compte
d’un fait extérieur le changement tout intérieur dont les motifs lui
restent cachés: devenus méconnaissables à ses yeux depuis qu’il leur
découvre un visage humain, ses parents lui paraissent tellement changés
qu’il ne peut plus les reconnaître pour siens, il en conclut que ce ne
sont pas ses vrais parents, mais littéralement des étrangers, des gens
quelconques avec lesquels il n’a rien de commun si ce n’est qu’ils l’ont
recueilli et élevé.»16 Nous passons d’une vision du «libéralisme
éclairé du gouvernement britannique» à la Michel Bibaud à la race
«d’oppresseurs turbulents et ambitieux» de F.-X. Garneau. Le parent
britannique ne répondant plus aux caprices bas-canadiens, après lui
avoir octroyé l’Acte de Québec (1774) et l’Acte Constitutionnel (1791),
répond maintenant par la répression sauvage de Colborne et l’Acte
d’Union de 1840 visant, ouvertement, à l’assimilation des Canayens.
C’est alors que la frustration de la défaite de 1837-1838 est projetée
sur la Conquête de 1760 et que Garneau peut, pour la première fois,
parler des Canadiens comme «“Des enfants abandonnés” par la France; des
paysans “délaissés par leurs compatriotes les plus riches et les plus
éclairés […] faibles en nombre et mis un instant pour ainsi dire à la
merci des populeuses provinces anglaises”. C’est exactement la situation
de 1840», commente Philippe Reid. 17 «Ayant ainsi interprété le
sentiment d’étrangeté que lui inspirent maintenant ses anciennes idoles
démasquées, il peut désormais se regarder comme un enfant trouvé, ou
adopté, auquel sa vraie famille, royale, bien entendu, ou noble, ou
puissante en quelque façon, se révélera un jour avec éclat pour le
mettre enfin à son rang. Il se sentait délaissé, lésé, injustement
traité par le sort et affligé de parents indignes de lui; il avait
raison puisqu’il a été réellement abandonné, et que ses parents inconnus
ne peuvent lui dispenser ni leur amour ni leurs biens. D’un mot la
fable explique tout, elle justifie les plus graves représailles et
motive le reniement (la faute des nobles parents fictifs est vengée sur
les parents réels, dont la roture redouble et explique l’indignité).»18
La langue française défendue par Lafontaine au Parlement du Canada-Uni
comme le regain de ferveur catholique entretenu par Mgr Bourget se
rejoignent dans le but de donner de véritables «parents nobles» aux
Canadiens français: la France catholique d’Ancien Régime et l’Eglise
ultramontaine, le français et la foi catholique. Laisser aux Anglais le
contrôle de la gestion des affaires économiques et administratives, lier
le sentiment des colonisés à des intérêts d’ordre supérieur, reléguant
au vrai «Père-État» les fonctions bassement triviales; cultiver chez
l’Enfant-Peuple le goût des choses spirituelles. «Cependant grâce à ce
déplacement subtil qui aboutit tout à la fois à une accusation et à une
excuse déguisée – les parents sont coupables de paraître ce qu’ils ne
sont pas, toutefois ils ne sont pas vraiment en cause puisque ce qui
déçoit en eux passe au compte de gens étrangers –, l’enfant parvient au
moins en esprit à résoudre les deux tâches contradictoires – mûrir tout
en refusant le progrès – qu’il n’a autrement aucune chance de concilier.
Car il est vrai qu’il éloigne ses parents pour marquer son désir de
s’éloigner d’eux et rompre ainsi avec la foi irrationnelle de son passé,
mais d’un autre côté il annule la distance puisque les parents de son
imagination ressemblent trait pour trait à ses vieilles divinités, de
sorte que tout en faisant un pas réel vers l’indépendance affective et
l’esprit de libre examen, il réussit à prolonger encore quelque temps
l’idylle familiale dont il pressent lui-même la fin.»19
Durham
(1839), la fantasmatique se mêle à l’interprétation des données, tâche
souvent similaire à celle accomplie par l’enfant. «Pour composer
l’intrigue de son “roman familial”, l’enfant n’a d’ailleurs pas besoin
d’une tromperie bien compliquée, il lui suffit de faire passer au compte
d’un fait extérieur le changement tout intérieur dont les motifs lui
restent cachés: devenus méconnaissables à ses yeux depuis qu’il leur
découvre un visage humain, ses parents lui paraissent tellement changés
qu’il ne peut plus les reconnaître pour siens, il en conclut que ce ne
sont pas ses vrais parents, mais littéralement des étrangers, des gens
quelconques avec lesquels il n’a rien de commun si ce n’est qu’ils l’ont
recueilli et élevé.»16 Nous passons d’une vision du «libéralisme
éclairé du gouvernement britannique» à la Michel Bibaud à la race
«d’oppresseurs turbulents et ambitieux» de F.-X. Garneau. Le parent
britannique ne répondant plus aux caprices bas-canadiens, après lui
avoir octroyé l’Acte de Québec (1774) et l’Acte Constitutionnel (1791),
répond maintenant par la répression sauvage de Colborne et l’Acte
d’Union de 1840 visant, ouvertement, à l’assimilation des Canayens.
C’est alors que la frustration de la défaite de 1837-1838 est projetée
sur la Conquête de 1760 et que Garneau peut, pour la première fois,
parler des Canadiens comme «“Des enfants abandonnés” par la France; des
paysans “délaissés par leurs compatriotes les plus riches et les plus
éclairés […] faibles en nombre et mis un instant pour ainsi dire à la
merci des populeuses provinces anglaises”. C’est exactement la situation
de 1840», commente Philippe Reid. 17 «Ayant ainsi interprété le
sentiment d’étrangeté que lui inspirent maintenant ses anciennes idoles
démasquées, il peut désormais se regarder comme un enfant trouvé, ou
adopté, auquel sa vraie famille, royale, bien entendu, ou noble, ou
puissante en quelque façon, se révélera un jour avec éclat pour le
mettre enfin à son rang. Il se sentait délaissé, lésé, injustement
traité par le sort et affligé de parents indignes de lui; il avait
raison puisqu’il a été réellement abandonné, et que ses parents inconnus
ne peuvent lui dispenser ni leur amour ni leurs biens. D’un mot la
fable explique tout, elle justifie les plus graves représailles et
motive le reniement (la faute des nobles parents fictifs est vengée sur
les parents réels, dont la roture redouble et explique l’indignité).»18
La langue française défendue par Lafontaine au Parlement du Canada-Uni
comme le regain de ferveur catholique entretenu par Mgr Bourget se
rejoignent dans le but de donner de véritables «parents nobles» aux
Canadiens français: la France catholique d’Ancien Régime et l’Eglise
ultramontaine, le français et la foi catholique. Laisser aux Anglais le
contrôle de la gestion des affaires économiques et administratives, lier
le sentiment des colonisés à des intérêts d’ordre supérieur, reléguant
au vrai «Père-État» les fonctions bassement triviales; cultiver chez
l’Enfant-Peuple le goût des choses spirituelles. «Cependant grâce à ce
déplacement subtil qui aboutit tout à la fois à une accusation et à une
excuse déguisée – les parents sont coupables de paraître ce qu’ils ne
sont pas, toutefois ils ne sont pas vraiment en cause puisque ce qui
déçoit en eux passe au compte de gens étrangers –, l’enfant parvient au
moins en esprit à résoudre les deux tâches contradictoires – mûrir tout
en refusant le progrès – qu’il n’a autrement aucune chance de concilier.
Car il est vrai qu’il éloigne ses parents pour marquer son désir de
s’éloigner d’eux et rompre ainsi avec la foi irrationnelle de son passé,
mais d’un autre côté il annule la distance puisque les parents de son
imagination ressemblent trait pour trait à ses vieilles divinités, de
sorte que tout en faisant un pas réel vers l’indépendance affective et
l’esprit de libre examen, il réussit à prolonger encore quelque temps
l’idylle familiale dont il pressent lui-même la fin.»19C’est ce fantasme ludique qui s’est maintenu jusqu’à l’orée des années soixante de ce siècle, et c’est cette histoire d’Enfant trouvé que nos auteurs, Ferron, Bergeron et Beaulieu, con-si-dèrent comme dépassée et veulent mettre à bas. Ce premier roman familial, qui étire indéfiniment la structure psychique infantile de base, entretient le rapport social de l’oppression étrangère et le poids psychique de l’irresponsabilité, de la fragilité, de l’impuissance, bref de l’immaturité. La figure infantile pâmée devant une Nouvelle-France idéalisée sur laquelle les anciens historiens projetaient une idylle familiale intériorisée entre 1760 et 1818 environ, au moment où le peuple Québécois naissait à la vie comme distinct du peuple Français sous la tutelle des institutions britanniques, resta cultivée durant tout le siècle entre 1860 et 1960: «Tant que l’enfant regarde ses père et mère comme des créatures semblables, rien ne l’empêche de les aimer ou de les haïr ensemble, sans s’inquiéter de la différence fondamentale qui préside à leur union…; mais dès qu’il sait à quoi s’en tenir sur les origines de la vie…, il ne laisse pas de deviner la conséquence majeure de cette découverte, la plus troublante de celles qui lui sont réservées: c’est que si les deux parents ne jouent pas le même rôle dans la genèse d’une existence, les deux titres dont ils se prévalaient officiellement n’offrent pas non plus le même degré de certitude, l’un étant toujours sûr, l’autre toujours douteux et par surcroît des plus rebelles aux preuves.»20 On pressent déjà le sort qui enracine la figure maternelle dans le culte idéalisé (de la sanctification et/ou de la damnation), et la
 figure paternelle
dans un rejet viscéral: «Décidé à garder sa vraie mère avec ses
véritables traits et son humble état, l’enfant ne travaille plus que sur
le père dont il connaît le caractère douteux (en passant immédiatement
du soupçon au fait), de sorte qu’avec une mère roturière et un père-roi
chimérique, donc, et d’autant plus absent qu’il est plus haut situé, il
s’attribue une naissance illégitime qui lance sa pseudo-biographie sur
de nouveaux chemins, où l’attendent bien entendu force rebondissements.
L’union indissoluble du couple trouve ici une solide réfutation: chacun
des deux parents devient disponible pour d’autres partenaires amoureux
et s’en va de son côté, la mère exclue de l’affabulation rentre dans la
réalité au moment même où le père en sort, les deux figures
n’appartiennent plus au même monde, elles relèvent de deux catégories
bien distinctes, l’une féminine, proche et triviale; l’autre masculine,
lointaine et noble, dont chacune est coupée en deux. Le roman proprement
dit commence à cette opposition qui, dans la mesure même où elle se
fonde sur la différence des sexes et toutes les antithèses et
distinctions dont le sexe est le modèle, lui ouvre les mille
perspectives de l’aventure, de l’intrigue, du conflit, bref tout un
avenir d’action dans lequel il va pouvoir préciser ses desseins, sans
renoncer pour autant à ses ambiguïtés.»21
figure paternelle
dans un rejet viscéral: «Décidé à garder sa vraie mère avec ses
véritables traits et son humble état, l’enfant ne travaille plus que sur
le père dont il connaît le caractère douteux (en passant immédiatement
du soupçon au fait), de sorte qu’avec une mère roturière et un père-roi
chimérique, donc, et d’autant plus absent qu’il est plus haut situé, il
s’attribue une naissance illégitime qui lance sa pseudo-biographie sur
de nouveaux chemins, où l’attendent bien entendu force rebondissements.
L’union indissoluble du couple trouve ici une solide réfutation: chacun
des deux parents devient disponible pour d’autres partenaires amoureux
et s’en va de son côté, la mère exclue de l’affabulation rentre dans la
réalité au moment même où le père en sort, les deux figures
n’appartiennent plus au même monde, elles relèvent de deux catégories
bien distinctes, l’une féminine, proche et triviale; l’autre masculine,
lointaine et noble, dont chacune est coupée en deux. Le roman proprement
dit commence à cette opposition qui, dans la mesure même où elle se
fonde sur la différence des sexes et toutes les antithèses et
distinctions dont le sexe est le modèle, lui ouvre les mille
perspectives de l’aventure, de l’intrigue, du conflit, bref tout un
avenir d’action dans lequel il va pouvoir préciser ses desseins, sans
renoncer pour autant à ses ambiguïtés.»21Normalement, cette étape aurait dû être assumée par l’historiographie des années soixante, rejetant l’ancien discours de l’Enfant trouvé afin d’engager le «roman familial/national» du Québec dans une véritable et authentique voie d’affirmation de soi, cherchant à s’identifier à la figure du Père-État plutôt que de le rechercher objectalement, et de s’apesantir inutilement sur le culte d’une figure maternelle désuète revitalisée dans un concept poétique de «Terre-Québec», dernier avatar de l’ancien roman
 du
terroir: «En se déclarant illégitime, en effet, l’enfant se place dans
une situation qui, étant nécessairement voulue par lui, permet de
déduire ses vraies raisons, et le cheminement de ses désirs cachés.
D’abord il garde sa mère à ses côtés, et cette proximité crée une
intimité d’autant plus étroite qu’elle s’impose désormais dans le récit
comme le seul lien concret.»22 Or cette mère est «ombrageuse». La
moralisation de l’histoire qui ressort des textes étudiés ici l’associe,
cette mère «ombrageuse», souvent même hystérique, au clergé,
c’est-à-dire à l’Église. Ce n’est plus une mère aimante, mais une mère phallique,
appelée à dominer, castratrice sans remords qui succède à l’insouciante
mère française et à l’acariâtre mère anglaise. Le nationalisme qui veut
lui substituer Terre-Québec ne sait comment l’enjoliver autrement qu’en
chantant «Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver…» – dès lors,
tout ce qui en ressort ne relève ni de la clémence ni de la générosité,
mais de la rigueur et de la frigidité: «puis – mais en fait les deux
procédés se tiennent de si près qu’il n’est guère possible de les
dissocier –, il relègue son père dans un royaume de fantaisie, dans un
au-delà de la famille
du
terroir: «En se déclarant illégitime, en effet, l’enfant se place dans
une situation qui, étant nécessairement voulue par lui, permet de
déduire ses vraies raisons, et le cheminement de ses désirs cachés.
D’abord il garde sa mère à ses côtés, et cette proximité crée une
intimité d’autant plus étroite qu’elle s’impose désormais dans le récit
comme le seul lien concret.»22 Or cette mère est «ombrageuse». La
moralisation de l’histoire qui ressort des textes étudiés ici l’associe,
cette mère «ombrageuse», souvent même hystérique, au clergé,
c’est-à-dire à l’Église. Ce n’est plus une mère aimante, mais une mère phallique,
appelée à dominer, castratrice sans remords qui succède à l’insouciante
mère française et à l’acariâtre mère anglaise. Le nationalisme qui veut
lui substituer Terre-Québec ne sait comment l’enjoliver autrement qu’en
chantant «Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver…» – dès lors,
tout ce qui en ressort ne relève ni de la clémence ni de la générosité,
mais de la rigueur et de la frigidité: «puis – mais en fait les deux
procédés se tiennent de si près qu’il n’est guère possible de les
dissocier –, il relègue son père dans un royaume de fantaisie, dans un
au-delà de la famille  qui
a le sens d’un hommage et plus encore d’un exil, car pour le rôle qu’il
joue alors dans l’ordre ordinaire de la vie, ce père royal et inconnu,
cet éternel absent pourrait tout aussi bien ne pas exister, c’est un
fantôme, un mort auquel on peut certes vouer un culte, mais aussi
quelqu’un dont la place est vide et qu’il est tentant de remplacer.»23
Et cette frigide Mère-Québec, Mère-Patrie, ne donne guère envie qu’on
vienne lui chauffer son lit! Quelque chose de très important avorte ici:
«Si l’on pense que pour le régisseur inconscient qui assure
l’arrangement du conte, tout rapprochement équivaut au rapprochement
sexuel, toute absence à la mort et toute suppression au meurtre
(l’inconscient ignorant la mort, il ne la conçoit jamais que sous la
forme d’une absence prolongée), on voit aussitôt que l’inégalité sociale
des deux parents ne répond pas seulement au jugement de valeur qui
semble la motiver, mais bien plutôt à une situation affective scabreuse,
celle-là
qui
a le sens d’un hommage et plus encore d’un exil, car pour le rôle qu’il
joue alors dans l’ordre ordinaire de la vie, ce père royal et inconnu,
cet éternel absent pourrait tout aussi bien ne pas exister, c’est un
fantôme, un mort auquel on peut certes vouer un culte, mais aussi
quelqu’un dont la place est vide et qu’il est tentant de remplacer.»23
Et cette frigide Mère-Québec, Mère-Patrie, ne donne guère envie qu’on
vienne lui chauffer son lit! Quelque chose de très important avorte ici:
«Si l’on pense que pour le régisseur inconscient qui assure
l’arrangement du conte, tout rapprochement équivaut au rapprochement
sexuel, toute absence à la mort et toute suppression au meurtre
(l’inconscient ignorant la mort, il ne la conçoit jamais que sous la
forme d’une absence prolongée), on voit aussitôt que l’inégalité sociale
des deux parents ne répond pas seulement au jugement de valeur qui
semble la motiver, mais bien plutôt à une situation affective scabreuse,
celle-là  même que le roman a pour tâche de dire et de passer sous silence, tout en s’efforçant de la dénouer.»24
même que le roman a pour tâche de dire et de passer sous silence, tout en s’efforçant de la dénouer.»24Transposons sur le mode historiographique québécois. L’historien est pris ici à la croisée des chemins: où bien il poursuit le fantasme nostalgique du Père-État et déplace cette figure disparue sur le gouvernement siégeant à Québec (c’était déjà l’«autonomie provinciale» de Maurice Duplessis et de son chroniqueur Robert Rumilly), le mariant à la figure maternelle austère et frigide de l’Église catholique ou de la nation québécoise, alors l’Enfant-Peuple sera maintenu dans un état de sevrage et d’infantilisation mentale; ou bien l’on brise tout, on rejette Père-État et Mère-Nation (Église), on affirme sa bâtardise, on rompt les nostalgies, on s’approprie le pouvoir au risque des luttes de faction, et l’on assume son historicité qui, par son acti-vité poétique, nous tire de l’impuissance et de l’imitation des autres. C’est ce coche que la génération des années soixante a manqué. Devant l’irruption de l’Histoire, devant un rôle messiannique dont elle voulait toutes les retombées honorifiques mais sans les engagements et responsabilités qui venaient avec, elle a oublié ces vers intraitables du Grand Corneille:
On triomphe sans gloire.
À travers la démoralisation qui hante les ouvrages de Ferron, Bergeron et Beaulieu, nous constatons leur manque de confiance dans les ressources réelles de la population, ce qui les pousse à ré-infantiliser le peuple, pourtant ouvert à la démocratie et prêt à atteindre une maturité psycho-collective moderne, en idéalisant l’exemple de la Huronnie jésuite ou la simple dépendance étatique. Tel est le choix inconscient de nos auteurs. Les «archétypes» que sont les Amérindiens, les habitants vaincus ou les travailleurs productifs opprimés affirment la figure infantile du Peuple à laquelle on associe une «royauté» naturelle, ethnique et légitime, qui n’est plus celle du Père-État autrement présente dans une autorité odieuse, absolutiste ou bourgeoise capitaliste, mais dans un rapport privilégié avec une Mère-Nation, dont la décléricalisation serait synonyme de guérison de la frigidité,25 qui continue, plus que jamais, à dorloter son petit peuple à elle en chantonnant en chœur, les matins de son anniversaire de naissance (le 24 juin): «Mon cher Tibi 26, c’est à ton tour, de te laisser parler d’amour…» Alors qu’apparaissait à la conscience collective un état de maturité que pressentait l’historiographie
 et
modulé sur l’intrigue du Bâtard, la démoralisation culturelle
signifiait un dérapage du mouvement où l’on se retrouvait lié, d’une
part à une figure paternelle encore plus totalisante (du régime
Duplessis à l’État toujours moins Providence mais toujours plus policier
de cette fin de siècle) et à une figure maternelle dont les valeurs
caritatives se sont transformées en compulsions technocratiques. Le tout
associé à cette idée fantasmatique d’une relation privilégiée entre la
Terre-Québec et son Enfant-Peuple/Petit Prince, non pas celui de
Saint-Exupéry, mais celui de Calderón. Le réajustement nous a glissé des
mains, d’où la permanence de l’état d’anomie culturelle dans lequel
nous macérons: «L’Enfant trouvé ne saisissait ses parents qu’à travers
un mouvement massif de projection ou -d’identification qui les
abolissait en tant que personnes séparées; de là l’équivoque de ses
sentiments, et l’absence de conflit qui paralysait son action.»26 Exeunt
les manuels de Guy Laviolette… «Le Bâtard quant à lui est bien plus
avancé, il sait qu’il aime et qu’il hait, il sait même le pourquoi de sa
préférence, et tout partagé qu’il reste dans cette situation de crise,
il indique apparemment sans équivoque de quelle façon il souhaite régler
le conflit. Mais même pour lui il s’en faut de beaucoup que les choses
soient si nettement tranchées, en réalité il n’échappe pas à
l’ambiguïté, il s’y enfonce au contraire du fait d’une autre division
qui joue cette fois entre l’amour et l’admiration, entre les penchants
sexuels et l’idéal moral, ou pour résumer l’anti-thèse dans une formule
convenue, entre les exigences du cœur et les impératifs non moins
tyranniques de l’esprit.»27 Ne croirait-on pas entendre un bon vieux
discours de Robert Bourassa? «L’inégalité de condition inventée pour les
besoins de la cause œdipienne est encore à cet égard un témoin
irrécusable, elle met à nu de façon presque provocante ce divorce de
l’amour et de l’idéal qui ajoute aux souffrances de l’enfant, non sans
l’aider il est vrai dans son apprentissage difficile. Car la mère ici
n’est rapprochée qu’au prix de son abaissement, c’est l’amour même qui
l’avilit, tandis que le père abhorré demeure toujours dans la zone
idéale qui seule convient à son statut d’exception. De reine qu’elle
était,
et
modulé sur l’intrigue du Bâtard, la démoralisation culturelle
signifiait un dérapage du mouvement où l’on se retrouvait lié, d’une
part à une figure paternelle encore plus totalisante (du régime
Duplessis à l’État toujours moins Providence mais toujours plus policier
de cette fin de siècle) et à une figure maternelle dont les valeurs
caritatives se sont transformées en compulsions technocratiques. Le tout
associé à cette idée fantasmatique d’une relation privilégiée entre la
Terre-Québec et son Enfant-Peuple/Petit Prince, non pas celui de
Saint-Exupéry, mais celui de Calderón. Le réajustement nous a glissé des
mains, d’où la permanence de l’état d’anomie culturelle dans lequel
nous macérons: «L’Enfant trouvé ne saisissait ses parents qu’à travers
un mouvement massif de projection ou -d’identification qui les
abolissait en tant que personnes séparées; de là l’équivoque de ses
sentiments, et l’absence de conflit qui paralysait son action.»26 Exeunt
les manuels de Guy Laviolette… «Le Bâtard quant à lui est bien plus
avancé, il sait qu’il aime et qu’il hait, il sait même le pourquoi de sa
préférence, et tout partagé qu’il reste dans cette situation de crise,
il indique apparemment sans équivoque de quelle façon il souhaite régler
le conflit. Mais même pour lui il s’en faut de beaucoup que les choses
soient si nettement tranchées, en réalité il n’échappe pas à
l’ambiguïté, il s’y enfonce au contraire du fait d’une autre division
qui joue cette fois entre l’amour et l’admiration, entre les penchants
sexuels et l’idéal moral, ou pour résumer l’anti-thèse dans une formule
convenue, entre les exigences du cœur et les impératifs non moins
tyranniques de l’esprit.»27 Ne croirait-on pas entendre un bon vieux
discours de Robert Bourassa? «L’inégalité de condition inventée pour les
besoins de la cause œdipienne est encore à cet égard un témoin
irrécusable, elle met à nu de façon presque provocante ce divorce de
l’amour et de l’idéal qui ajoute aux souffrances de l’enfant, non sans
l’aider il est vrai dans son apprentissage difficile. Car la mère ici
n’est rapprochée qu’au prix de son abaissement, c’est l’amour même qui
l’avilit, tandis que le père abhorré demeure toujours dans la zone
idéale qui seule convient à son statut d’exception. De reine qu’elle
était,  la mère tombe
d’un coup à une condition sociale humiliée, mais à cet état médiocre ou
servile s’ajoute encore une indignité morale, puisque la fable de
l’illégitimité n’a pas d’autre fondement que son adultère supposé.
Condamnée moralement par cela même qui cause sa déchéance sociale, la
mère se voit alors imputer autant d’aventures amoureuses qu’elle a eu
d’enfants ou que le conteur est capable d’en inventer, si bien que,
perdant ensemble son trône et sa vertu, elle descend aussitôt au rang de
la servante, de la femme perdue, voire tout bonnement de la
prostituée.»28
la mère tombe
d’un coup à une condition sociale humiliée, mais à cet état médiocre ou
servile s’ajoute encore une indignité morale, puisque la fable de
l’illégitimité n’a pas d’autre fondement que son adultère supposé.
Condamnée moralement par cela même qui cause sa déchéance sociale, la
mère se voit alors imputer autant d’aventures amoureuses qu’elle a eu
d’enfants ou que le conteur est capable d’en inventer, si bien que,
perdant ensemble son trône et sa vertu, elle descend aussitôt au rang de
la servante, de la femme perdue, voire tout bonnement de la
prostituée.»28«Irréprochable, en effet, la mère ruine par avance tous les espoirs de correction de la vie sur quoi le roman est forcé de tabler…» De la Nouvelle-France à Terre-Québec, en passant par l’Église et le territoire vendu aux capitalistes américains (depuis Félix-Gabriel Marchand, selon Bergeron), l’historiographie québécoise, comme l’ensemble de la production culturelle, n’a pu que déchoir la figure maternelle du scénario de l’Enfant trouvé. La terre amérindienne sur laquelle Ferron appose les frontières de l’Amérique française tient à peu de chose près de la même fiction. Même en discréditant l’historiographie cléricalo-nationaliste, Ferron se sent obligé de maintenir l’idée d’une mère parfaite, car sinon, «coupable et avilie, en revanche, elle laisse l’enfant libre de chasser de sa biographie tous les éléments humiliants ou indésirables – un père médiocre, une existence à jamais bornée, des frères et sœurs dont la présence lui rappelle l’intolérable nécessité du partage. Ainsi la faute maternelle est la condition de son propre relèvement, et il ne se fait pas scrupule de l’exploiter, soit qu’il revendique la bâtardise comme un privilège exclusif, ce qui l’élève au-dessus du reste de la famille et le rend “intéressant”; soit au contraire qu’il change tous ses frères et sœurs en bâtards, ce qui le conduit encore à se singulariser…» La solution adoptée par le Québec, face au reste du Canada, semble être la seconde – même choix pour les Autochtones, qui se proclament, selon l’expression des gouvernements, comme les «premières nations». Et c’est là le point fort et libérateur de la figure du Bâtard: «le point faible de son état civil est nécessairement le point fort du roman, le seul en vérité sur quoi il puisse compter pour se tailler enfin un royaume fictif à la mesure de ses ambitions, et y régner avec quelque apparence de raison en maître absolu de son destin.»30 Le mépris de la figure paternelle seule ne peut pas accomplir la fonction libé-ratrice d’un roman familial qui se veut émancipatoire, donc d’une historiographie «de libération». Dans ce travers nationaliste qui consiste à aimer le Québec au mépris des Québécois, c’est la perversion à l’œuvre derrière la démora-lisation culturelle des années soixante qui survit en se métamorphosant, du vieil inceste de la cléricalité rurale à la fonctionnalité moderne de l’État territorialisé. Les pères honteux, qu’ils s’appellent Duplessis ou Trudeau, restent voués aux gémonies, les fils délirants évoqués comme messies, de Lévesque à Lucien Bouchard, deviennent Premiers Ministres sans opposition (étrange expression de la démocratie où est censé régner une certaine vitalité qui se traduit par les débats). La poésie semble la seule forme d’expression littéraire digne d’une Mère-Patrie si généreuse,31 surtout une poésie où la rationnalité et la rigueur formelle (signes de dégradation de la pure spiritualité) sont pourchassées comme de vilaines taches sur un napperon.
«Coupable et avilie», la figure maternelle délestée de l’inconscient historique aurait permis à Ferron de parler d’autres choses que de la loufoque fondation de Ville-Marie (qui l’obsède tout de même!) ou des histoires de «traques» de la Confédération. Cela aurait permis à Bergeron de passer outre à l’énumération de ces figures de Pères-Concierges que sont les gouvernements et chefs d’État du Canada et du Québec. Cela aurait permis enfin à Victor-Lévy Beaulieu de ne pas se complaire nostalgiquement dans le misérabilisme québécois d’un imaginaire rétréci. Ce dérapage symbolique, nos écrivains ne parviennent pas à bien le saisir, mais mieux qu’aucun autre ils ont compris les enjeux symboliques que représentent la réappropriation de notre Histoire. Qu’ils aient manqué le tournant, c’est une autre histoire, et les conséquences sont d’une ampleur catastrophique au niveau de la psychologie collective du Bâtard: «cette conquête purement sociale n’épuise nullement son appétit de pouvoir, encore qu’elle reste son principal souci; il vise par-delà le rang à l’absolu de la création, et il l’obtient par l’acte imaginaire le plus simple, en s’emparant de cette source de tout pouvoir créateur qu’est à ses yeux la puissance virile paternelle.»32 D’où l’échec à long terme de la réforme de l’éducation, l’inféodation des syndicats au fonctionnarisme technique, le rétrécissement de la culture à la production de consommation ou au divertissement occupationnel, incapacité chronique à faire fructifier les découvertes scientifiques, stérilisation de Radio-Québec, corruption du marché de l’édition par des subventions mondainement négociées, irrespect des lois concernant la promotion et la protection de la langue française. Tout le réseau des fibres communicationnelles culturelles est sauté. La démocratie n’est plus qu’une formalité de convention dans les institutions sensées la pratiquer. «Supprimé, dépossédé, châtré, nié en quelque sorte par tous les moyens concevables, le père est maintenant imité dans sa fonction la plus représentative, et de toutes la plus enviée. Mais l’imitation qui le détruit est aussi comme toujours un acte de dévotion, la preuve même d’une piété que rien n’ébranle ni n’entame, de sorte que le modèle renaît sans cesse et ressuscite le rival. L’imitateur ensorcelé par la magie de son culte infantile reste impuissant à se libérer: le roman dont il voulait faire un acte n’est jamais qu’un adieu impossible, qu’il peut seulement vouloir prolonger. Le Bâtard n’en a jamais fini de tuer son père pour le remplacer, le
 copier
ou aller plus loin que lui en décidant de “faire son chemin”. Criminel
en soi, non par accident, mais totalement, en raison même de son
inspiration, il entraîne le roman à sa suite dans le cycle de la
transgression où il tourne sans fin autour de sa mauvaise conscience et
de sa révolte, scandalisé par les limitations de son être, coupable,
honteux, hanté par l’expiation et le châtiment. Quoi qu’il en dise pour
se justifier dans ses thèmes, le meurtre, la subversion, l’usurpation
sont sa loi, et jusque dans le moralisme de façade qu’il affiche souvent
avec prédilection. Il est vrai qu’en vertu de l’organisation
«œdipienne» qui lui vaut ses affinités particulières avec la
dissimulation, l’intrigue, le complot, il peut à sa guise prendre la
transgression par le biais du ridicule ou de la trivialité, peindre le
crime sous des couleurs affadies, détailler le sacrilège en menus
potins, réduire la fatalité au propos d’alcôves, en confessions ou en
faits divers scabreux…»33
copier
ou aller plus loin que lui en décidant de “faire son chemin”. Criminel
en soi, non par accident, mais totalement, en raison même de son
inspiration, il entraîne le roman à sa suite dans le cycle de la
transgression où il tourne sans fin autour de sa mauvaise conscience et
de sa révolte, scandalisé par les limitations de son être, coupable,
honteux, hanté par l’expiation et le châtiment. Quoi qu’il en dise pour
se justifier dans ses thèmes, le meurtre, la subversion, l’usurpation
sont sa loi, et jusque dans le moralisme de façade qu’il affiche souvent
avec prédilection. Il est vrai qu’en vertu de l’organisation
«œdipienne» qui lui vaut ses affinités particulières avec la
dissimulation, l’intrigue, le complot, il peut à sa guise prendre la
transgression par le biais du ridicule ou de la trivialité, peindre le
crime sous des couleurs affadies, détailler le sacrilège en menus
potins, réduire la fatalité au propos d’alcôves, en confessions ou en
faits divers scabreux…»33Voilà où nous en sommes: l’Enfant trouvé utilise les stratégies d’affirmation du Bâtard mises au service de la permanence de la figure maternelle. Il peut se permettre ainsi de discréditer la figure paternelle, dont il refuse de se départir afin d’assurer ses arrières. Tant de lâchetés et d’efforts exténuants entraînent le reflux du mépris sur l’Enfant-Peuple, et nos récits historiographiques opèrent cette répulsion sous le couvert de la démoralisation sociale. En acceptant la dégradation de la figure maternelle, mais tout en voulant maintenir ses liens privilégiés, l’Enfant-Peuple se condamne lui-même à l’auto-abjection, à l’auto-avortement, ce que les «actes manqués» collectifs des deux référendums (1980-1995) révèlent de façon lamentable! Voulant sauter du stade de l’Enfant trouvé à celui du Bâtard sans rejeter la fonction nourricière des figures parentales, le Québécois se condamne à manquer sa marche psychologique et se vêt de la peau de l’Avorton. Voilà pourquoi notre critique est méprisable car elle utilise le mépris pour entretenir une situation infantilisante. Voilà pourquoi nos intellectuels sont infatués de leur ignorance afin d’entretenir un aveuglement collectif de la conscience. Voilà pourquoi notre historiographie reste banale parce qu’elle veut perdre le souvenir de l’idylle familiale dans la quantification et sauvegarder les structures immuables. Voilà ce qui clôt toute contestation du scénario de l’Enfant trouvé.
Si nous nous sommes attardés si longuement sur la démonstration de Mme Robert, c’est qu’aucune genèse psychologique de l’historiographie n’a encore été tentée, sauf dans le cas de Michelet par la passionnante étude de Roland Barthes.34 Nous connaissons les conditions sociales et intellectuelles de l’émergence de l’historiographie et l’épistémologie nous présente les règles de l’enquête et de la communication du discours historiographique, mais le credo actuel des historiens – surtout québécois –, la «méthodologie scientifique», nous empêche d’interroger la dimension symbolique qui fait partie intégrante de toute historiographie considérée comme représentation sociale. Le modèle du roman élaboré par Marthe Robert est pertinent à l’historiographie si nous considérons les deux formes littéraires comme proches parentes. Reste à dégager les motivations inconscientes de la conscience historique québécoise à laquelle se rattachent nos auteurs. Ces motivations sont à la base de cette haine de soi que notre enquête sur la démoralisation nous a révélée plus haut. L’échec du passage de l’Enfant trouvé au Bâtard apparaîtront ainsi dans les Historiettes de Ferron, comme dans le Petit Manuel de Bergeron et le Manuel de la petite littérature de Beaulieu. De plus, les théories de Jean Bouthillette retrouvent toute leur actualité à la lecture de ces ouvrages sous l’angle de vue de Marthe Robert.
La transgression à laquelle le «roman familial» du Bâtard nous conduit est la mise en scène de la profanation d’une relation idyllique jadis érigée dans la structure psychique de l’historiographie québécoise, celle de l’Enfant trouvé en cette Nouvelle-France entre les Sauvages et les Anglais. Cette transgression reste le moteur de toute l’entreprise avortée. Elle annonce le projet de «dire la vérité», mais se perd dans un bredouillement pas toujours cohérent. Ferron parle moins de son vrai héros, le «Bâtard»/Chénier, qu’il ne s’épuise à dénoncer l’«Enfant trouvé»/Dollard, car dénoncer Dollard, c’est transgresser les symboles de l’historiographie cléricalo-nationaliste. Beaulieu dénonce l’univers de la colonisation, les campagnes de tempérance, le mysticisme des enfants, mais il reste fasciné par ces monstruosités morbides qu’il cultive. Pourtant, la terre québécoise doit bien fabriquer autre chose que des monstruosités… Pourquoi porter tant d’intérêt aux avortons, aux mabouls, aux débiles de tout genre sinon parce qu’ils reflètent, comme des miroirs révélateurs, toute notre haine inhibée de soi?
Le contexte étant situé et la mécanique exposée, nous allons maintenant voir comment le projet de faire passer le niveau symbolique, significatif, de l’historiographie québécoise du «roman familial/national» de l’Enfant trouvé au Bâtard, qui devait concrétiser la dernière étape d’une maturité collective, s’est échoué au rang du «roman familial/national» de l’Avorton.35
«Thou laid, Durham!»
“Race de bâtards!” Je ne sais plus trop qui criait cette injure à notre égard? Il sera facile ici de démontrer qu’il se trompait… royalement. Pourtant, l’injure est prise très au sérieux par MM. Ferron, Bergeron et Beaulieu. Louis XVII au Temple se serait enfuit pour venir finir ses jours au Canada. De sa lignée, les adeptes de l’ésotérisme québécois attendent le retour messianique du «Grand Monarque»! Est-ce le même «Grand Monarque» prêché par le millénariste italien Lazaretti dans son «Manifeste aux peuples et princes chrétiens» de septembre 1876 où il annonce que «l’homme désigné par la divine Providence pour établir le nouvel ordre de choses est un rejeton illégitime, issu du sang des […] et descendant direct de […], et qui est la venue de l’homme le plus pauvre, le plus misérable du monde, méprisé et persécuté par les hommes, annoncé à moi le plus misérable, le plus indigne des hommes, la Majesté divine a promis toute l’étendue de la terre»?36 Mieux que ça. Il serait déjà né… non pas en Italie, bien sûr, mais au Québec, et au cours de la décennie des années soixante (comme par hasard!). Kaspar Hauser (Je suis venu calme orphelin…), lui, est mort avant d’émigrer de Nuremberg à Montréal. Aurait-il été poignardé par la main d’un inconnu ayant partie liée avec les «protecteurs» du «Grand Monarque»? La substitution du Bâtard à l’Enfant trouvé ne s’accomplit pas sans susciter nombre de délires extravagants. Mais le romantisme de la situation plaît assez à nos apprentis-historiens: «Nous sommes un peuple prisonnier», proclame Léandre Bergeron (B.5). Reste à voir si la peau de la plante de nos pieds reste aussi douce que celle de Kaspar, le jour où on le découvrit, errant dans les rues de Nuremberg…
Voilà un peuple prisonnier dont on rappelle souvent qui sont ses geôliers: «les Champlains, les administrateurs français, les commerçants français ou anglais avec la complicité du clergé sous tous les régimes (B.27)», mais dont on ne rappelle jamais que sa prison, c’est le Québec. Parlant de la participation des Québécois à l’ensemble canadien, Bouthillette dit de même: «Nous ne sommes pas un peuple associé, mais confiné»37, et Beaulieu décrira les travaux des colons comme de véritables «travaux forcés». Jamais le Québec n’est vu pourtant comme étant la prison, le lieu d’exil, la punition que fut, selon le mot de Jacques Cartier si souvent répété, «cette terre que Dieu donna à Caïn»! Seule l’activité de l’Enfant-Peuple se trouve décrite en termes de contraintes et les geoliers, le Père-État, le gouverneur, ont «des pouvoirs dictatoriaux (B.57)»: «Le peuple canayen lui n’est pas heureux du tout de l’Acte de Québec parce qu’il ne fait que le confirmer dans sa servitude. Il doit payer la dîme, il doit payer les taxes des seigneurs, il doit prêter serment de fidélité au roi anglais. Rien n’a changé pour l’habitant. Lui n’a que des devoirs pendant que le clergé, les seigneurs, les marchands anglais, les administrateurs anglais se partagent les privilèges sur son dos de travailleur (B.63).» Cette appréciation de l’Acte de Québec est héritée des lectures du manuel Farley-Lamarche des Clercs de Saint-Viateur.38 Ouvrage conforme au nationalisme clérical et modèle des manuels des cours supérieurs jusqu’à 1966 et après, il reste un résidu de la phase psychique du scénario de l’Enfant trouvé. Cet extrait de Bergeron témoigne de la difficulté de s’extraire de cette tradition et de la tentation de couvrir d’une interprétation marxiste une interprétation nationaliste. Le peuple québécois devient une Cendrillon exploitée par des parâtres méprisants et méprisables. Ils sont méprisants comme ce «raciste» de Durham pour qui «nous sommes un tas de crétins (B.108)», ou encore comme sir Wilfrid Laurier
 dans sa fameuse réponse à Henri Bourassa («les Canadiens n’ont pas
d’opinion, ils n’ont que des sentiments»): «Dans cette réponse typique
de Sir Laurier, on voit tout le mépris qu’a ce vendu pour son peuple
d’origine. Il dit dans de beaux mots que les Canayens sont trop
imbéciles pour avoir une idée sur la participation à l’impérialisme
britannique (B.172).» Et Bergeron de ressasser la culpabilité d’être
effectivement, «un tas de crétins: [Les Anglais] nous chantent depuis ce
temps, qu’ils nous ont apporté la démocratie mais que nous n’avons
jamais su nous en servir, en insinuant par là que nous sommes trop
bornés pour comprendre le processus de la démocratie bourgeoise
(B.116).» Et de placer le Canayen
non pas dans la position active dite «du missionnaire», mais bien dans
celle, toute négative, dite «de l’enculé», du vaincu sodomisé par son
vainqueur: «La Confédération va se faire sur le dos de tout le peuple
québécois (B.125)!» Depuis, on pourrait rappeler «la nuit des longs
couteaux» de 1982, «l’accord» du lac Meech, celui de Charlottetown… La
fierté canayenne en a pris pour son rhume! Cet enculé du XXe siècle est
bon consommateur de robots dociles: «Le peuple québécois a subi le
nouveau colonialisme qui le maintient dans la situation d’exploité mais,
de plus, l’appelle à se renier lui-même pour devenir un Américain
moyen, consommateur-robot, petit individualiste borné, conditionné,
comme un rat en cage, dans son travail, dans sa vie de famille, dans ses
loisirs, à ne penser qu’à lui-même, à ses petites possessions, aux
bébelles qu’il peut accumuler, à la sécurité du ver dans son cocon
(B.239).» Rat, ver, les métaphores tirées du bestiaire de la répulsion
et appliquées au peuple québécois «américanisé» ne traduisent plus un
éven-tuel mépris d’un quelconque Durham ou Laurier, mais bien celui de
l’historien pour l’ensemble du peuple. Dans le fond, si le parâtre est
méprisant, n’est-ce pas parce que le peuple est méprisable? Et s’il est
méprisable n’a-t-il pas raison alors de se mépriser lui-même et de
laisser des figures paternelles lui donner des coups de pieds dans les
couilles? Ce que fait Léandre Bergeron, c’est de l’auto-flagellation
alors que le Bâtard assènerait lui-même des coups de pieds dans les
parties sensibles de son géniteur; et si les couteaux des Chénier, des
Riel, des Rose ne suffisaient pas à castrer la figure paternelle, on
remettrait ça avec la génération suivante: on passerait de
l’historiographie fantasmée à l’Histoire vécue.
dans sa fameuse réponse à Henri Bourassa («les Canadiens n’ont pas
d’opinion, ils n’ont que des sentiments»): «Dans cette réponse typique
de Sir Laurier, on voit tout le mépris qu’a ce vendu pour son peuple
d’origine. Il dit dans de beaux mots que les Canayens sont trop
imbéciles pour avoir une idée sur la participation à l’impérialisme
britannique (B.172).» Et Bergeron de ressasser la culpabilité d’être
effectivement, «un tas de crétins: [Les Anglais] nous chantent depuis ce
temps, qu’ils nous ont apporté la démocratie mais que nous n’avons
jamais su nous en servir, en insinuant par là que nous sommes trop
bornés pour comprendre le processus de la démocratie bourgeoise
(B.116).» Et de placer le Canayen
non pas dans la position active dite «du missionnaire», mais bien dans
celle, toute négative, dite «de l’enculé», du vaincu sodomisé par son
vainqueur: «La Confédération va se faire sur le dos de tout le peuple
québécois (B.125)!» Depuis, on pourrait rappeler «la nuit des longs
couteaux» de 1982, «l’accord» du lac Meech, celui de Charlottetown… La
fierté canayenne en a pris pour son rhume! Cet enculé du XXe siècle est
bon consommateur de robots dociles: «Le peuple québécois a subi le
nouveau colonialisme qui le maintient dans la situation d’exploité mais,
de plus, l’appelle à se renier lui-même pour devenir un Américain
moyen, consommateur-robot, petit individualiste borné, conditionné,
comme un rat en cage, dans son travail, dans sa vie de famille, dans ses
loisirs, à ne penser qu’à lui-même, à ses petites possessions, aux
bébelles qu’il peut accumuler, à la sécurité du ver dans son cocon
(B.239).» Rat, ver, les métaphores tirées du bestiaire de la répulsion
et appliquées au peuple québécois «américanisé» ne traduisent plus un
éven-tuel mépris d’un quelconque Durham ou Laurier, mais bien celui de
l’historien pour l’ensemble du peuple. Dans le fond, si le parâtre est
méprisant, n’est-ce pas parce que le peuple est méprisable? Et s’il est
méprisable n’a-t-il pas raison alors de se mépriser lui-même et de
laisser des figures paternelles lui donner des coups de pieds dans les
couilles? Ce que fait Léandre Bergeron, c’est de l’auto-flagellation
alors que le Bâtard assènerait lui-même des coups de pieds dans les
parties sensibles de son géniteur; et si les couteaux des Chénier, des
Riel, des Rose ne suffisaient pas à castrer la figure paternelle, on
remettrait ça avec la génération suivante: on passerait de
l’historiographie fantasmée à l’Histoire vécue.Pourtant, la réaction de l’Enfant-Peuple est plus que timorée et pleine d’impuissance mi-avouée. Sa rébellion est velléitaire: «Ce fut Marie-Victorin qui fit faire à Lord Durham une
 réponse célèbre. Celui-ci avait écrit en 1840 que nous n’avions
réponse célèbre. Celui-ci avait écrit en 1840 que nous n’avions  pas
d’histoire. Cela ne manquait pas de pertinence : notre histoire n’avait
alors pour toute substance que l’avenir; elle consistait en une
naissante et fort émouvante foi que Durham, faute d’être dans notre
peau, ne pouvait guère partager. Il nous fit quand même l’honneur d’un
chef-d’œuvre littéraire politique. À ce grand seigneur, dont
j’accepterais volontiers la statue dans une de nos places publiques,
Marie-Victorin prit sur lui de répondre, soixante-dix ans après et par
personne interposée, en l’occurence Madeleine de Verchères,
grande gueule et grande mamelle : “T’as menti, Durham!”. Il fallait que
cela soit dit. La scène d’ailleurs illustre assez bien le malentendu
historique dont j’ai parlé : ce refoulement dans le passé indéfini du
futur (F.16).» Ferron se montre ici génial. Utilisant le dernier des Récits laurentiens
(1919) du Frère Marie-Victorin, il traduit en français les lettres de
feu tracées en anglais par Madeleine sur le rapport Durham : “Thou laid, Durham!”
Il montre que le refoulement du futur du Bâtard se voit entraîné par
voie régressive jusque dans le scénario de l’Enfant trouvé. Le principe
de réalité, exprimé par le rapport Durham, est détourné par le principe
de plaisir (grande gueule et grande mamelle) de renouer avec une
Mère-Église idyllique, royale et chevaleresque, plutôt que d’émanciper
la figure de l’Enfant-Peuple à qui, supposément, «appartient l’avenir»
et le contrôle de son Histoire. Pas étonnant que tout doive se faire à
pas feutrés. Se choisit-on une devise? «On était timide, on la jugeait
audacieuse, on n’osa pas la faire adopter formellement. On passa par les
travaux publics. La façade du Parlement était en réparation; on y grava
“Je me souviens”, puis on fit voter les réparations, lesquelles furent
approuvées par un arrêté de son Excellence le lieutenant-gouverneur en
conseil, le 22 janvier 1883, et avec ses réparations subrepticement,
notre fière devise(F.14).» Ce n’est plus le Père ici qui est débonnaire
mais bien le Bâtard qui, pour réussir, se doit de posséder toutes les
audaces plutôt qu’un bon ministère des Travaux publics. Ferron, du
moins, insiste sur le fait que «quand le pays se vota un drapeau, on
n’eut pas à l’adopter à la sauvette comme le “Je me souviens” (F.16).»
Bien sûr, c’était le temps de l’«auto-nomie provinciale» et non plus de
ce temps de valse hésitation caractéristique du temps de régression
illustrée par l’affaire Guibord (1867), dont Bergeron tire la conclusion
significative: «Ce conflit montre à quel point la société canayenne
avait régressé en si peu de temps après le grand conflit économique et
politique de la Rébellion. Le colonisé vaincu, mis à l’écart du grand
courant de l’Histoire, retournait maintenant des siècles en arrière et
se retrouvait à orienter toute son énergie dans des querelles du Moyen
Âge. Le colonisateur trouvait très amusant de voir les colonisés
trimbaler un cadavre d’un cimetière à l’autre en s’engueulant
profusément (B.133-134).» “Thou laid, Durham!”
pas
d’histoire. Cela ne manquait pas de pertinence : notre histoire n’avait
alors pour toute substance que l’avenir; elle consistait en une
naissante et fort émouvante foi que Durham, faute d’être dans notre
peau, ne pouvait guère partager. Il nous fit quand même l’honneur d’un
chef-d’œuvre littéraire politique. À ce grand seigneur, dont
j’accepterais volontiers la statue dans une de nos places publiques,
Marie-Victorin prit sur lui de répondre, soixante-dix ans après et par
personne interposée, en l’occurence Madeleine de Verchères,
grande gueule et grande mamelle : “T’as menti, Durham!”. Il fallait que
cela soit dit. La scène d’ailleurs illustre assez bien le malentendu
historique dont j’ai parlé : ce refoulement dans le passé indéfini du
futur (F.16).» Ferron se montre ici génial. Utilisant le dernier des Récits laurentiens
(1919) du Frère Marie-Victorin, il traduit en français les lettres de
feu tracées en anglais par Madeleine sur le rapport Durham : “Thou laid, Durham!”
Il montre que le refoulement du futur du Bâtard se voit entraîné par
voie régressive jusque dans le scénario de l’Enfant trouvé. Le principe
de réalité, exprimé par le rapport Durham, est détourné par le principe
de plaisir (grande gueule et grande mamelle) de renouer avec une
Mère-Église idyllique, royale et chevaleresque, plutôt que d’émanciper
la figure de l’Enfant-Peuple à qui, supposément, «appartient l’avenir»
et le contrôle de son Histoire. Pas étonnant que tout doive se faire à
pas feutrés. Se choisit-on une devise? «On était timide, on la jugeait
audacieuse, on n’osa pas la faire adopter formellement. On passa par les
travaux publics. La façade du Parlement était en réparation; on y grava
“Je me souviens”, puis on fit voter les réparations, lesquelles furent
approuvées par un arrêté de son Excellence le lieutenant-gouverneur en
conseil, le 22 janvier 1883, et avec ses réparations subrepticement,
notre fière devise(F.14).» Ce n’est plus le Père ici qui est débonnaire
mais bien le Bâtard qui, pour réussir, se doit de posséder toutes les
audaces plutôt qu’un bon ministère des Travaux publics. Ferron, du
moins, insiste sur le fait que «quand le pays se vota un drapeau, on
n’eut pas à l’adopter à la sauvette comme le “Je me souviens” (F.16).»
Bien sûr, c’était le temps de l’«auto-nomie provinciale» et non plus de
ce temps de valse hésitation caractéristique du temps de régression
illustrée par l’affaire Guibord (1867), dont Bergeron tire la conclusion
significative: «Ce conflit montre à quel point la société canayenne
avait régressé en si peu de temps après le grand conflit économique et
politique de la Rébellion. Le colonisé vaincu, mis à l’écart du grand
courant de l’Histoire, retournait maintenant des siècles en arrière et
se retrouvait à orienter toute son énergie dans des querelles du Moyen
Âge. Le colonisateur trouvait très amusant de voir les colonisés
trimbaler un cadavre d’un cimetière à l’autre en s’engueulant
profusément (B.133-134).» “Thou laid, Durham!”La régression est le mouvement de rapetissement que subit la vision de l’histoire du Québec en insistant sur les gestes historiques régressifs plutôt que sur les expansifs. Bergeron voit la régression du Québec à partir d’une anecdote compulsive: la promenade du cadavre de Guibord, libéral excommunié par Mgr Bourget, d’un cimetière protestant à un catholique. Plus graves et moins sordides sont d’autres faits évoqués par Ferron: «Nos surplus humains étaient emportés dans le flot de l’immigration européenne. Ces exilés nous apprirent les limites de notre domaine. La civilisation industrielle commençait. Nous nous sentions menacés (F.10).» Mais il serait faux de croire que la régression est un phénomène de la réalité extérieure venant écraser le Canadien comme une boîte qui se rapetisserait autour de lui, comme dans Alice aux pays des Merveilles. Pour Ferron, le phénomène relève également d’une réalité intérieure, d’un inconfort psychique: «L’esprit aventureux de nos ancêtres, qui leur faisait emprunter volontiers le mode de vie amérindien, leur venait sans doute de l’inconfort de la Nouvelle-France. C’était à proprement parler un esprit de fuite. La Canadienne restait à la maison. Son sexe fort ramenait les nomades. C’est elle qui a fixé le pays. Autour de ses jupes (F.106).» Et l’hiver c’est ce «déluge de neige» inconnu de l’Européen. C’est la seule allusion, je pense, que nos auteurs font à l’inhospitalité de Terre-Québec, la Mère-Nation. Mais très vite, le reproche est détourné de la figure: «Car il ne faudrait pas croire que nous avons choisi notre isolement. Il nous a été imposé. Voici maintenant qu’on nous le reproche : “Ouvrez les frontières, ce pays étouffe!” Il n’a jamais tenu à nous d’ouvrir ou de fermer le pays… La seule frontière qui nous ait été soumise a été une
 clôture
d’habitant. Et justement, faute de statut international, nous nous
sommes trouvés dans une sorte de camp de concentration et entourés de
barbelés pour bétail (F.110).» Encore un peu, et on en arrivera à la
vache, mais chaque chose en son temps! Bref, «nous étions comme la fille
de bordel qui ne choisit pas son monde (F.110).» Ferron annonce ici la
métaphore du camp de concentration très prisée, on l’a vue, par Léandre
Bergeron. Associé au bordel, le pays deviendra aussi un couvent:
«Après ce voyage [de la Capricieuse, en 1855], la France pourra
continuer de remonter jusqu’à Québec et de nous voir, mais ce sera
toujours, comme dans les couvents et les prisons, en présence d’un
tiers. Nous étions sortis du secret pour tomber sous surveillance. Un
siècle de secret, un siècle de surveillance. Il est vrai que nous avions
plaidé coupables d’être Français. Sentence : deux siècles. Et nous
l’avons payé. Nous avons bien gagné, il me semble, notre libération
(F.111).» Restera un pas à faire, et du camp de concentration de
Bergeron au bordel conventuel (ou du couvent bordélique, au choix) de
Ferron, on passera à la plus forte des métaphores d’enfermement: celle
du sanatorium de Victor-Lévy Beaulieu. Mais auparavant, il convient d’en
finir avec l’échec symbolique du «roman familial» du Bâtard qui se
reconnaît comme bâtard et prend conscience de sa bâtardise, la proclame
tout haut comme une affirmation mais cherche à retourner, loin en
arrière, dans ce temps où il se considérait comme Enfant trouvé.
clôture
d’habitant. Et justement, faute de statut international, nous nous
sommes trouvés dans une sorte de camp de concentration et entourés de
barbelés pour bétail (F.110).» Encore un peu, et on en arrivera à la
vache, mais chaque chose en son temps! Bref, «nous étions comme la fille
de bordel qui ne choisit pas son monde (F.110).» Ferron annonce ici la
métaphore du camp de concentration très prisée, on l’a vue, par Léandre
Bergeron. Associé au bordel, le pays deviendra aussi un couvent:
«Après ce voyage [de la Capricieuse, en 1855], la France pourra
continuer de remonter jusqu’à Québec et de nous voir, mais ce sera
toujours, comme dans les couvents et les prisons, en présence d’un
tiers. Nous étions sortis du secret pour tomber sous surveillance. Un
siècle de secret, un siècle de surveillance. Il est vrai que nous avions
plaidé coupables d’être Français. Sentence : deux siècles. Et nous
l’avons payé. Nous avons bien gagné, il me semble, notre libération
(F.111).» Restera un pas à faire, et du camp de concentration de
Bergeron au bordel conventuel (ou du couvent bordélique, au choix) de
Ferron, on passera à la plus forte des métaphores d’enfermement: celle
du sanatorium de Victor-Lévy Beaulieu. Mais auparavant, il convient d’en
finir avec l’échec symbolique du «roman familial» du Bâtard qui se
reconnaît comme bâtard et prend conscience de sa bâtardise, la proclame
tout haut comme une affirmation mais cherche à retourner, loin en
arrière, dans ce temps où il se considérait comme Enfant trouvé.La complexité du phénomène oblige Ferron à détourner la régression afin de permettre à la dénonciation de l’étouffement et à l’affirmation positive de faire son chemin. Il ne peut le faire qu’en critiquant le «roman familial» de l’Enfant trouvé propre à l’historiographie cléricalo-nationaliste et à proclamer que le royaume dont le Bâtard est roi n’est pas celui annoncé (la Nouvelle-France) mais pas non plus celui à venir, au contraire, mais cette Amérique amérindienne, plus réelle, plus «historique» que la terre fantasmée et qui est cette terre inconfortable, ombrageuse, «déluge de neige» et impropre à la colonisation. La Nouvelle-France se voit reléguée au rang de «mythe» historiographique pour faire place au véritable territoire perdu, l’Amérique amérindienne: «On ne peut percevoir dans cette évolution de la régression que l’École de Montréal 39 a cru trouver dans notre histoire à la suite de la conquête. Cette théorie s’explique toutefois: elle a vu le jour au moment où nous commencions à comprendre que la souveraineté nous était nécessaire. On a projeté une aspiration contemporaine sur le passé. On s’est trompé de temps. Cela arrive même assez souvent aux historiens. D’ailleurs on a confondu l’Amérique française, au peuplement amérindien, et le Canada français, au peuplement européen. Il se peut que la France, en restant maîtresse de ces deux possessions, aurait permis à la première de survivre. Non que la France fût plus douce. Elle était simplement moins empressée de faire de l’Amérique le refuge de l’Europe. Elle envoyait peu de colons et donnait ainsi au continent le temps de s’adapter à la civilisation européenne. Ce fut la brutalité de l’immigration massive qui a anéanti les nations amérindiennes après leur passage de l’hégémonie française à la domination anglaise. Là certes, il y a eu régression. Mais ce ne fut pas directement la nôtre. Si elle nous touche, c’est que, dans des circonstances plus propices à ces malheureuses nations notre pays québécois aurait pu leur servir de modèle». (F.126-127) On entrevoit déjà l’effet de transfert sur l’histori-cité: Amérique française (territoire amérindien sous hégémonie française) et Canada français (sous domination anglaise). Les espaces se confondent, les temps s’intervertissent, l’intrigue se complexifie, s’emmêle, s’embrouille, se perd de vue... La régression amérindienne ne fut pas directement la nôtre, mais comme il le répétait ailleurs, en parlant des immigrants, «ces exilés nous apprirent les limites de notre domaine (F.10)», c’est ici que Ferron détourne la régression, la faisant porter sur le dos de l’Autre (l’Amérindien) qu’il affilie à nous («ce pays québécois [qui] aurait pu… servir de modèle» aux exilés). Il se trompe exactement de temps, comme les Groulx et autres se trompaient de temps en transposant la défaite de Chénier sur le compte de Dollard: «Notre révolution nationale, inspirée par le génie du continent, avorta et de tous les peuples des Amériques nous restâmes le seul assujetti. La rébellion nous avait quand même apporté du neuf, le patriotisme; ce ne fut pas sans raison que les morts, les exilés, les pendus de 1837 furent les Patriotes. Et de ce patriotisme naquit l’idée d’un héros national à opposer à la reine d’Angleterre. Tout annonçait que ce héros serait Chénier, qui avait livré à Saint-Eustache un combat glorieux. Les Espagnols, les Portugais du Sud, les Anglais des États-Unis, les Français de Haïti avaient choisi le leur parmi les artisans de leur libération. Chénier était le contemporain de Bolivar. Et pourtant ce ne fut pas lui ni un Canadien ni un ennemi de nos ennemis; ce fut un Français, un Mistigoche qui avait été à la petite guerre contre les Iroquois, un brigand de l’Outaouais qui fut déclaré notre héros. Comment cela est-il arrivé? Allez le demander aux curés. Après avoir été les adversaires des Patriotes, ils ont tout simplement confisqué le patriotisme à leur profit et par un tour de passe-passe remplacé Chénier par Dollard. Il est vrai que celui-ci était sorti de la fange… Il était tout frais, tout net, récuré. On le poussa sur le piédestal que les Patriotes avaient préparé. C’était vers 1920, dans une sorte de trou qui puait la décomposition de tout un peuple. Nous n’en sommes pas encore sortis (F.143-144).» Nous voilà encore ramenés au souterrain… Nous retrouvons ici les shifters symboliques qui maintiennent, au niveau idéologique, l’opposition du patriotisme et du nationalisme chez Ferron. Le déplacement de Chénier vers Dollard dénoncé par Ferron est celui-là même qu’il entend réinstaurer idéologiquement, mais voilà, de Chénier, il ne dit rien de plus que ce qu’il mentionne dans le texte cité plus haut. De Dollard, il a beaucoup plus à dire. Le premier est un héros libérateur; le second est un Mistigoche, un Français méprisé par les Indiens, un brigand de la petite guerre (même pas de la grande), sorti tout droit de la fange, nettoyé, récuré (ré-curé!) qui pue «la décomposition de tout un peuple», un héros qui sort tout droit des égouts, du soupirail de l’abjection.
Ferron s’acharne plus à démolir la figure de Dollard qu’à restaurer celle de Chénier. Il se détourne ici de la moralisation première pour se vautrer dans cette fange signifiante. Discré-diter Dollard, c’est d’abord discréditer les témoins des événements du Long-Sault: «Trois ans après l’affaire du Long-Sault il y eut tremblement de terre : “On voyait, écrit le Père Ragueneau, des arpents de forêt sauter en l’air, les arbres faire la culbute et retomber les branches en bas”. Des lacs, des ri-vières, des montagnes même disparurent. Dans les villes, “les cheminées et le haut des logis pliaient comme des branches agitées du vent”. Néanmoins personne ne fut blessé, aucune maison endommagée. C’avait été un tremblement de terre purement théâtral. On avait alors de l’imagination… On voyait voler les serpents. Quelques petites secousses devenaient un tremblement de tous les tonnerres. D’un rien on faisait une armée d’iroquois (F.135-136).» Et c’est reparti… beaucoup de bruit pour rien tiré d’un Iroquois soumis à la torture pour savoir le fin mot de l’affaire! Pour Ferron, aucun lien causal ne lie le Long-Sault au salut de la colonie (F.139-140); c’est comme si, dans deux cents ans, un parti d’ultra-nationalistes québécois faisait du caporal Lemay de la Sûreté du Québec, mort à Oka en juillet 1990, le héros sacrifié, sauveur de la ville de Montréal menacée d’une invasion des Mohawks! Et, comme le Long-Sault n’est pas très loin de la réserve, mixer les deux événements par-delà le gouffre du temps – un peu comme ces historiens polonais dont parlait Marc Ferro, et qui transféraient le massacre des habitants du faubourg de Praga par les troupes russes en 1795 à la «répression anti-ouvrière» par le national-fasciste polonais Pilsudski en 1926 40 –, opérer une «condensation» de la conscience historique. Rumeur et panique, affolement du gouverneur et de l’évêque, le récit proposé par Ferron tend à discréditer celui, devenu classique, de Groulx. C’est bien le but de cet exercice littéraire car, en soi, il ne contredit pas l’événement historique: «En 1660 les canons de Québec saluent les braves qui viennent de sauver la Nouvelle-France… Dollard et ses compagnons? Voyons, ne soyez pas si bêtes : ils
 saluent Chouart et Radisson.
La colonie ne vit pas de sang mais de fourrures et tout
particulièrement de belles et bonnes peaux de castor. Or depuis quelques
années celles-ci n’arrivent plus à cause des brigands, iroquois et
autres… ce fut alors que Chouart et Radisson, à la tête d’une flotille
de canots lourdement chargés, s’amenèrent des confins du lac Supérieur,
vous vous imaginez l’accueil, canons et tout; cinq jours durant on les
traita. Ces deux héros ne sauraient être comparés à Dollard et à ses
compagnons; ce sont de vrais Canadiens pour ne pas dire des Sauvages
alors que ceux-là ne sont que des Français; ils poussent la découverte,
l’étendant du Missouri à la Baie d’Hudson, entrant en contact avec des
nations nouvelles, sont capables de lever une armée indigène de cinq
cents hommes, de la conduire jusqu’à Québec et d’apporter ainsi les
ballots de castors qui sont la seule ressource de la colonie; ils font
partie de la grande histoire continentale alors que ceux-là
n’intéressent que la petite, la toute petite histoire locale du
brigandage sur l’Outaouais (F.139-140).» Une fois bien établi que le
combat du Long-Sault est surfait, on s’attendrait à ce que Ferron dresse
la figure du Bâtard (Chouart et Radisson et, en poussant un peu plus
loin, d’Iberville, le seul véritable héros positif et vainqueur de
l’histoire du Québec) à l’encontre des prétentions de la figure de
l’Enfant trouvé (ici Dollard, le petit brigand/pervers polymorphe de
l’idéologie). Chénier, le vrai héros, devrait réapparaître en majesté,
renvoyant Dollard aux oubliettes. Nenni. C’est Chouart et Radisson, des
Mistigoches quand même, et, derrière eux, l’image du «Sovâge» qui sont
présentés comme les vrais héros de 1660!
saluent Chouart et Radisson.
La colonie ne vit pas de sang mais de fourrures et tout
particulièrement de belles et bonnes peaux de castor. Or depuis quelques
années celles-ci n’arrivent plus à cause des brigands, iroquois et
autres… ce fut alors que Chouart et Radisson, à la tête d’une flotille
de canots lourdement chargés, s’amenèrent des confins du lac Supérieur,
vous vous imaginez l’accueil, canons et tout; cinq jours durant on les
traita. Ces deux héros ne sauraient être comparés à Dollard et à ses
compagnons; ce sont de vrais Canadiens pour ne pas dire des Sauvages
alors que ceux-là ne sont que des Français; ils poussent la découverte,
l’étendant du Missouri à la Baie d’Hudson, entrant en contact avec des
nations nouvelles, sont capables de lever une armée indigène de cinq
cents hommes, de la conduire jusqu’à Québec et d’apporter ainsi les
ballots de castors qui sont la seule ressource de la colonie; ils font
partie de la grande histoire continentale alors que ceux-là
n’intéressent que la petite, la toute petite histoire locale du
brigandage sur l’Outaouais (F.139-140).» Une fois bien établi que le
combat du Long-Sault est surfait, on s’attendrait à ce que Ferron dresse
la figure du Bâtard (Chouart et Radisson et, en poussant un peu plus
loin, d’Iberville, le seul véritable héros positif et vainqueur de
l’histoire du Québec) à l’encontre des prétentions de la figure de
l’Enfant trouvé (ici Dollard, le petit brigand/pervers polymorphe de
l’idéologie). Chénier, le vrai héros, devrait réapparaître en majesté,
renvoyant Dollard aux oubliettes. Nenni. C’est Chouart et Radisson, des
Mistigoches quand même, et, derrière eux, l’image du «Sovâge» qui sont
présentés comme les vrais héros de 1660!L’érotisme, chez Ferron, reste un caractère détenu par la figure autochtone. Il en va de même chez Bergeron. «L’homme rouge accueille bien l’homme blanc et le considère comme un honorable visiteur (B.15).» L’Amérindien est l’ange gardien des Français. Laissés à Tadoussac, les hommes de Chauvin «seraient tous morts si les Iroquois ne leur avaient pas appris à s’alimenter comme il faut pour survivre dans ce climat. De nouveau les Rouges manifestent leur générosité à l’égard des hommes blancs qui, eux, sont venus ici simplement pour les exploiter». (B.18) L’angélisme des uns fait ressortir la diablerie des autres. Le procédé est purement littéraire et n’a rien d’historique. Les Amérindiens sont des passionnés d’amour selon Ferron: «…l’admiration qu’ils ont pour [Cartier], une admiration sans borne, qui fait qu’ils veulent le garder toujours si cela se peut, se convertir à lui en l’assimilant d’une façon ou d’une autre – bref, de l’amour. Ce n’était pas le compte du sieur Cartier : il voulait de l’or, rien d’autre (F.44-45).» Bien autrement traitera-t-il de la
 figure de Champlain:
«Champlain était de Saintonge, quelque peu huguenot, mais au-dessous
des querelles religieuses à cause de sa bonne santé. Avant de s’attacher
aux sauvagesses, il aime sans doute charnellement cette terre
d’Amérique. Il chassera la brume, il établira clairement le Canada et en
deviendra le père à juste titre. Comment s’y prendra-t-il? Par le seul
moyen possible : le catholicisme et la conversion des pauvres sauvages
(F.54-55).» Champlain est l’antithèse de Cartier, ce malade du scorbut
qui mourra de la peste dans son manoir de Saint-Malo. Champlain, lui,
est de «bonne santé». Il vient s’établir au Québec et non seulement y
passer pour trouver de l’or. Il a aimé la Terre avant d’en aimer les
petites sauvagesses. De ce mélange de sang, on doit attendre le Bâtard,
le Canayen, le Québécois… «Il
chassera la brume.» Le prix de la vérité de la naissance, la bâtardise,
est la disparition de l’infantile famille royale, la fin de l’idylle
fami-liale de l’Enfant trouvé, ce Roi qui envoie Cartier reluquer du
côté de l’Amérique, mais aussi le renoncement final au fantasme du
«Grand Monarque». En reconnaissant la bâtardise, Ferron fait de
Champlain une image de Père libérateur, modèle de la figure du Père
indispensable à toute évolution psychique, même collective. Il reste un
modèle exemplaire parce qu’il ne viole pas par profanation, comme
Cartier. Il donne la vie. La Nouvelle-France reste la permanence de la
revendication de la paternité royale, de Fontainebleau à Versailles, du
Père autoritaire et dictatorial qui annonce Duplessis et le René
Lévesque des «renérendums». L’Amérique française, terre indienne de
métissage des races, est la vraie Mère et la conversion devient ici
métaphore de l’accouplement entre le Sauvage et le Français. Riel est le
fruit de ce mariage malsain: «À certains moments, il a des visions
fantastiques : la création dans l’Ouest d’une société libérée de
l’exploitation où la pauvreté et la misère disparaîtraient, où les
hommes s’aimeraient, travailleraient ensemble, créeraient ensemble un
monde idéal… Ces visions font peur aux missionnaires pour qui l’homme
est un être nécessairement méchant, qui doit vivre dans la misère, la
culpabilité et la crainte pour gagner son ciel. Un homme qui parle d’une
société meilleure ici-bas est à redouter (B.158).» Les sens
s’entrecroisent. Bergeron est-il secrètement d’accord avec les
missionnaires? Les marxistes-léninistes, autant que les missionnaires
catholiques, redoutent les rêveurs, c’est
figure de Champlain:
«Champlain était de Saintonge, quelque peu huguenot, mais au-dessous
des querelles religieuses à cause de sa bonne santé. Avant de s’attacher
aux sauvagesses, il aime sans doute charnellement cette terre
d’Amérique. Il chassera la brume, il établira clairement le Canada et en
deviendra le père à juste titre. Comment s’y prendra-t-il? Par le seul
moyen possible : le catholicisme et la conversion des pauvres sauvages
(F.54-55).» Champlain est l’antithèse de Cartier, ce malade du scorbut
qui mourra de la peste dans son manoir de Saint-Malo. Champlain, lui,
est de «bonne santé». Il vient s’établir au Québec et non seulement y
passer pour trouver de l’or. Il a aimé la Terre avant d’en aimer les
petites sauvagesses. De ce mélange de sang, on doit attendre le Bâtard,
le Canayen, le Québécois… «Il
chassera la brume.» Le prix de la vérité de la naissance, la bâtardise,
est la disparition de l’infantile famille royale, la fin de l’idylle
fami-liale de l’Enfant trouvé, ce Roi qui envoie Cartier reluquer du
côté de l’Amérique, mais aussi le renoncement final au fantasme du
«Grand Monarque». En reconnaissant la bâtardise, Ferron fait de
Champlain une image de Père libérateur, modèle de la figure du Père
indispensable à toute évolution psychique, même collective. Il reste un
modèle exemplaire parce qu’il ne viole pas par profanation, comme
Cartier. Il donne la vie. La Nouvelle-France reste la permanence de la
revendication de la paternité royale, de Fontainebleau à Versailles, du
Père autoritaire et dictatorial qui annonce Duplessis et le René
Lévesque des «renérendums». L’Amérique française, terre indienne de
métissage des races, est la vraie Mère et la conversion devient ici
métaphore de l’accouplement entre le Sauvage et le Français. Riel est le
fruit de ce mariage malsain: «À certains moments, il a des visions
fantastiques : la création dans l’Ouest d’une société libérée de
l’exploitation où la pauvreté et la misère disparaîtraient, où les
hommes s’aimeraient, travailleraient ensemble, créeraient ensemble un
monde idéal… Ces visions font peur aux missionnaires pour qui l’homme
est un être nécessairement méchant, qui doit vivre dans la misère, la
culpabilité et la crainte pour gagner son ciel. Un homme qui parle d’une
société meilleure ici-bas est à redouter (B.158).» Les sens
s’entrecroisent. Bergeron est-il secrètement d’accord avec les
missionnaires? Les marxistes-léninistes, autant que les missionnaires
catholiques, redoutent les rêveurs, c’est  connu. «Cependant Riel
dit vrai, poursuit l’historien. Il parle le langage de la vérité simple
et brutale. Si l’on s’entend pour dire que le mot Dieu est synonyme
d’amour, de vie, d’épanouissement, Riel possède bien ce Dieu en lui. Il
est le leader qui veut mener son peuple par la lutte de libération à la
création d’une société meilleure où règnera l’amour, la justice, la vie
libre et épanouie. De plus, il est juste de dire que “Rome est tombée”
parce que l’Église catholique, fondée par un révolutionnaire qui voulait
établir un royaume d’amour, est devenue une institution capitaliste,
exploitrice, assoiffée, de domination et de colonialisme (B.159).» Il
n’y a pas à dire, malgré le discrédit dans lequel on veut l’entraîner,
l’interprétation de l’abbé Groulx a porté au-delà des espérances
voulues.
connu. «Cependant Riel
dit vrai, poursuit l’historien. Il parle le langage de la vérité simple
et brutale. Si l’on s’entend pour dire que le mot Dieu est synonyme
d’amour, de vie, d’épanouissement, Riel possède bien ce Dieu en lui. Il
est le leader qui veut mener son peuple par la lutte de libération à la
création d’une société meilleure où règnera l’amour, la justice, la vie
libre et épanouie. De plus, il est juste de dire que “Rome est tombée”
parce que l’Église catholique, fondée par un révolutionnaire qui voulait
établir un royaume d’amour, est devenue une institution capitaliste,
exploitrice, assoiffée, de domination et de colonialisme (B.159).» Il
n’y a pas à dire, malgré le discrédit dans lequel on veut l’entraîner,
l’interprétation de l’abbé Groulx a porté au-delà des espérances
voulues.Et elle a porté d’autant mieux que la figure de l’Amérindien devient, chez nos auteurs, une véritable figure christique, héritière de ce que Groulx avait jadis attribué à Dollard, le Mistigoche. Chénier est, pour une seconde fois, spolié de son titre de héros national des Québécois. Le Bâtard est remis dans le placard. L’Amérindien, Champlain, Riel ramènent à nouveau l’histoire du Québec dans le «roman familial» de l’Enfant trouvé. Mais si Ferron pousse de l’avant le nom de Champlain comme Père de la colonie – à la suite d’un frère Guy Laviolette, qui sous-titrait sa brochure sur Champlain: «Fondateur et Père de la patrie»41 –, il est loin de faire l’unanimité. Le rejet généralisé du Régime français finira par l’emporter chez Bergeron. Champlain se voyait bien mal placé dans la polarisation de l’anta-gonisme entre le Français (la chute) et l’Amérindien (le salut).
Car, dès l’arrivée de Cartier, l’Amérindien devient la proie de l’homme blanc: «À Gaspé deux jeunes indigènes avaient subi le même sort [d’être enlevés]; Cartier les avait accoutrés d’une livrée et d’un bonnet rouge, les tournant en dérision, Hérode à sa manière. Il venait encore d’élever une croix, “une croix de trente pieds de hault”. Quand le jour se leva après la nuit des gémissements, c’était le 4 mai 1536, l’agouhanna fut montré à son peuple : voici notre homme. On l’emmena ensuite mourir en France. La croix resta sur les rives du Saint-Laurent. Une sorte de passion venait de commencer (F.44).» «Il en fut de la barbarie comme de la picote et de la vérole; les Blancs la leur donnèrent (F.48).» Nos historiens utilisent abondamment la maladie comme métaphore de l’Histoire. Pour Ferron, l’Amérindien
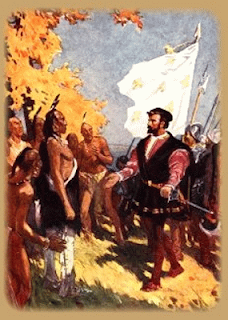 prend bien figure christique. Cartier
est un Hérode de pacotille dont l’action en sera une de
déstructuration, c’est-à-dire de mort pour l’Amérindien. En 1603, sur
les rives jadis explorées par Cartier, «toute trace de civilisation a
disparu. Il ne reste que quelques bandes d’Algonquins, batailleurs et
grossiers (F.49).» Cette passion confine au génocide, terme maintes fois
répété par Bergeron. Il regrette même que les armes à feu échangées par
les compagnies de fourrures pour des tonnes de peaux ne l’aient pas été
en assez grand nombre pour que «l’homme rouge s’en serve pour nettoyer
son pays de la peste blanche (B.22)»! On ne peut trouver plus claire
expression de notre haine de soi.
prend bien figure christique. Cartier
est un Hérode de pacotille dont l’action en sera une de
déstructuration, c’est-à-dire de mort pour l’Amérindien. En 1603, sur
les rives jadis explorées par Cartier, «toute trace de civilisation a
disparu. Il ne reste que quelques bandes d’Algonquins, batailleurs et
grossiers (F.49).» Cette passion confine au génocide, terme maintes fois
répété par Bergeron. Il regrette même que les armes à feu échangées par
les compagnies de fourrures pour des tonnes de peaux ne l’aient pas été
en assez grand nombre pour que «l’homme rouge s’en serve pour nettoyer
son pays de la peste blanche (B.22)»! On ne peut trouver plus claire
expression de notre haine de soi.Mais la peste blanche n’est pas qu’une métaphore anti-coloniale. Bergeron rappelle que «les Hurons sont affaiblis par la petite vérole que les Français leur ont apportée (B.31)» avec la barbarie. «Pour l’homme rouge la Conquête signifie une spoliation encore plus rapide de son territoire (B.55).» Là aussi l’utilisation de la dépossession de l’Amérindien (sans être anhistorique) sert de transfert à la spoliation du Québec par les conquérants anglais contre l’habitant canayen. Ce n’est que plus loin que Bergeron reconnaîtra ce fait: «La construction des centrales électriques causèrent [sic!] l’inondation de terres cultivables. Ceci est symbolique. Les Canayens voyaient leurs terres défrichées avec peine et misère disparaître sous l’effet de l’industrialisation. L’habitant devait devenir l’employé de grandes compagnies qui venaient lui voler ses terres et ses ressources (B.186).» La dépossession de l’un annonce la spoliation de l’autre… «En 1926, le gouvernement fédéral amène la question du Labrador au Conseil privé de Londres, qui décide sans consulter le Québec que le Labrador revient à Terreneuve. On vole 110 000 milles carrés au Québec et le gouvernement-concierge de Taschereau ne dit pas un mot (B.191).» Il en fallait cependant plus pour faire du Labrador l’Alsace-Lorraine des Québécois!
 Mais
nous n’en sommes pas là. Le Québécois a cependant acquis, au cours de
ces citations, le statut d’intermédiaire, de médiateur, alors qu’il est
devenu, en fait, le véritable sujet de l’étude. Son rôle d’intermédiaire
auquel la régression déviée, transférée sur la figure de l’Amérindien,
le confine nous ramène dans le paradoxe du sanglot québécois de l’homme
blanc: «…nous avions déjà dans le pays d’En-Haut des curés, des sœurs
grises, des métis et même un archevêque avec sa cathédrale. tout cela y
avait été apporté en canot et par partage, avant la destruction du bison
et le génocide érigé en système, sur l’amitié amérindienne. […] Notre
rôle d’intermédiaire entre le colonisé par excellence, qui l’a été à en
crever, l’Amérindien, et le colonisateur. Nous tenions et de l’un et de
l’autre, mais plutôt de l’un par le métis et l’aventurier que de l’autre
par le Sir Joseph [Dubuc] et son archevêque [Mgr Taché]
(F.17-18).» Nous y chercherions en vain une excuse ou une justification
d’une quelconque culpabilité. La gêne n’est pas tant envers
l’Amérindien qu’envers la contribution
Mais
nous n’en sommes pas là. Le Québécois a cependant acquis, au cours de
ces citations, le statut d’intermédiaire, de médiateur, alors qu’il est
devenu, en fait, le véritable sujet de l’étude. Son rôle d’intermédiaire
auquel la régression déviée, transférée sur la figure de l’Amérindien,
le confine nous ramène dans le paradoxe du sanglot québécois de l’homme
blanc: «…nous avions déjà dans le pays d’En-Haut des curés, des sœurs
grises, des métis et même un archevêque avec sa cathédrale. tout cela y
avait été apporté en canot et par partage, avant la destruction du bison
et le génocide érigé en système, sur l’amitié amérindienne. […] Notre
rôle d’intermédiaire entre le colonisé par excellence, qui l’a été à en
crever, l’Amérindien, et le colonisateur. Nous tenions et de l’un et de
l’autre, mais plutôt de l’un par le métis et l’aventurier que de l’autre
par le Sir Joseph [Dubuc] et son archevêque [Mgr Taché]
(F.17-18).» Nous y chercherions en vain une excuse ou une justification
d’une quelconque culpabilité. La gêne n’est pas tant envers
l’Amérindien qu’envers la contribution  (présentée
ici comme inconsciente) du Québécois à son extermination. Chez
Bergeron, les symboles sont plus clairs (et plus simples) que chez
Ferron. C’est l’Anglais qui tue l’Indien, et mieux, le Métis: «Tuer un
Métis devient un sport, comme tuer un noir l’est pour les Sudistes
blancs des États-Unis. Ainsi deux soldats des “Ontario Rifles”
assassinent Elzéar Goulet comme on n’oserait pas abattre un chien, et
au lieu de les arrêter, on les encourage et on loue leur bravoure
(B.154-155)».42 De même, «les Canadiens veulent la tête de Riel parce
que celui-ci avait songé à faire de l’Ouest une province canayenne avec
ses Métis canayens. En Riel, c’est le peuple canayen que l’on vise
(B.161).» La passion amérindienne, commencée avec les enlevés de
Cartier/Hérode, se termine (pour le moment) sur l’échafaud de Riel.
Entre-temps, le sang français s’est ajouté au sang indien…
(présentée
ici comme inconsciente) du Québécois à son extermination. Chez
Bergeron, les symboles sont plus clairs (et plus simples) que chez
Ferron. C’est l’Anglais qui tue l’Indien, et mieux, le Métis: «Tuer un
Métis devient un sport, comme tuer un noir l’est pour les Sudistes
blancs des États-Unis. Ainsi deux soldats des “Ontario Rifles”
assassinent Elzéar Goulet comme on n’oserait pas abattre un chien, et
au lieu de les arrêter, on les encourage et on loue leur bravoure
(B.154-155)».42 De même, «les Canadiens veulent la tête de Riel parce
que celui-ci avait songé à faire de l’Ouest une province canayenne avec
ses Métis canayens. En Riel, c’est le peuple canayen que l’on vise
(B.161).» La passion amérindienne, commencée avec les enlevés de
Cartier/Hérode, se termine (pour le moment) sur l’échafaud de Riel.
Entre-temps, le sang français s’est ajouté au sang indien…Cette situation de candidat à l’extermination à travers le génocide Amérindien/Métis, puis la menace potentielle que cela représente pour l’avenir des Canadiens français/Québécois, conditionne tout le traitement de la question de l’antisémitisme. Antijudaïsme ou antisémitisme des Québécois? Il faut expliquer une répulsion répugnante en soi et qu’on ne peut traiter qu’en brandissant le spectre du seul génocide qui nous horrifie vraiment, c’est-à-dire le nôtre. Bergeron se cabre: «L’antisémitisme québécois n’a jamais existé, sauf dans l’esprit des Anglais qui étaient tout heureux de voir dans la révolte des Québécois devant son exploiteur juif, une autre preuve que les Québécois ne sont, pour lui, qu’un peuple réactionnaire et fasciste. L’Anglais se réjouissait d’autant plus que les Québécois voyaient plutôt le Juif comme son exploiteur. Caché derrière les grandes entreprises et les institutions de la haute finance, l’Anglais et son frère le capitaliste américain se frottaient les mains de joie en jouant les Juifs contre les Québécois (B.201).» Mais en quoi le fait d’argumenter, d’une manière aussi paranoïaque, sur l’antisémitisme anglais démontre-t-il l’inexistence de l’antisémitisme québécois? Pis, comment articuler une explication machia-vélique de cet antisémitisme quand on affirme comme fait historique l’existence d’«un exploiteur juif»? La démonstration elle-même ne véhicule-t-elle pas un certain antisémitisme?
Ferron s’en sort un peu mieux en recourant à la nuance de l’antisionisme: «Les Israéliens ne sont plus les Israélites, autrement dit des juifs. “Ah! me dira-t-on, vous les regrettez ces bonnes victimes!” Et je serai chanceux si l’on ne prétend pas que c’est moi qui les ai gazées. Eh bien! c’est un chantage que je n’accepte pas. Et j’ai une raison assez forte pour me récuser comme bourreau, la voici: tous les Allemands, tous les sadiques, tous les pervers qui ont humé avec délices l’odeur qui se dégageait des fours hitlériens, ils se délectent aujourd’hui des charognes égyptiennes du Sinaï, tous les partisans du génocide vietnamien sont du côté israélien. Je dirai plus: Israël c’est une répétition du Farouest américain où les Palestiniens ont pris la relève des Amérindiens (F.159).» Comment un peuple lui-même menacé de disparaître pourrait-il jouir du génocide d’un autre? Pourtant, l’anecdote que raconte Ferron, une page et demie plus loin, lui fait apprécier le Juif à partir du moment où il nie la qualité de Peuple Élu rattachée à la religion hébraïque.43 C’est donc quand le Juif est parfaitement assimilé à la civilisation occidentale qu’il prend de la valeur aux yeux de Ferron qui suit ici Voltaire à la trace.
De tout ceci, nous pouvons retenir que ce n’est pas l’antisémitisme qui terrorise la conscience historique de l’époque. Celle-ci s’ignore comme antisémite et laisse agir librement ses répulsions. C’est la crainte de passer pour antisémite qui fait le cauchemar de ses nuits, car ce serait trop nier le royaume harmonieux et infantile de l’Enfant trouvé que d’admettre que les autres puissent accuser encore le Québécois de «mouiller son lit»! L’antisémitisme est une haine et une haine de l’Autre qui ramènerait le Québécois à la haine de ses parents idéaux et à son narcissisme infantile. Comment pourrait-il se montrer «méchant» et haïr ses petits frères Amérindiens et Juifs? Ne serait-ce pas là un aveu implicite de cette haine dissimulée, la plus importante de toutes, la haine de soi qui règne dans son univers affectif? La Sûreté du Québec pourra toujours frapper à grands coups de matraque sur la population québécoise au pont de Beauharnois, mais il y aura toujours un Brian Mulroney pour se scandaliser de voir des voyous lancer des roches sur un convoi d’Autochtones en fuite à la sortie du pont Mercier. Soyons donc plus courageux (ou plus lucides) que Ferron et Bergeron et avouons-nous carrément: «Oui, nous sommes antisémites et oui, nous dédaignons un grand nombre de valeurs juives.» Ceci dit, nous apprécions bien le smoked meat, et cela prouve qu’il sera toujours possible de rogner sur notre xénophobie. Mais surtout, récupérons notre faculté d’haïr l’Autre, particulièrement ceux qui nous veulent du mal ou qui n’hésiteront pas à nous en causer pour leurs intérêts particuliers qui vont à l’encontre des nôtres, sans éprouver pour autant cette fausse culpabilité exagérée, comme s’il s’agissait là d’une tare qui nous est spécifique. C’est ainsi que toute collectivité saine réagit pour se défendre contre la mort, car comment celui qui ne veut pas assumer ses haines pourrait-il accéder à l’amour véritable, sincère et authentique de l’Autre?
C’est ça être en vie…, et c’est bon d’être en vie!
Mais tel n’est pas le sentiment qui émane des textes de nos auteurs. L’hésitante défense de quelques actions haineuses se renverse en excuses face aux accusations de lâchetés des Anglais à notre égard. Bergeron, par exemple, en est obsédé. Les crises de la conscription l’ont profondément marqué: «Au Canada, le gouvernement libéral de King proclame en juin 1941 le
 service militaire obligatoire
mais pour la défense du pays seulement. Les Québécois ne font aucune
opposition à cette loi. Le peuple québécois est prêt à défendre le pays.
Cette réaction contredit toutes les accusations de lâcheté que les
Canadiens-anglais ont lancé contre le peuple québécois. Les Québécois
sont prêts à lutter quand il s’agit de défendre le Québec mais ils n’ont
aucune envie d’aller se faire massacrer pour défendre les intérêts de
puissance colonialistes (B.197).» Voilà une argumentation bien
présomptueuse. La peur n’a rien à voir ici avec l’objet pour lequel
combattre. Sa présence ou son absence ne sont pas plus discutées que ne
l’était l’antisémitisme historique dans le débat précédent. C’est la
réputation, encore, qui est en jeu: «Sur un total de 18 943 déserteurs
le Québec en comptait près de 10 000. Ces Québécois tous en uniformes et
prêts à défendre leur pays jusqu’à la mort s’il était attaqué,
refusaient d’aller se faire bousiller en Europe pour les intérêts de
l’Angleterre, de la France et des États-Unis. Ces patriotes que les
Canadiens-anglais traitaient de lâches et de traîtres, avaient le
courage de combattre par cet acte individuel le colonialisme d’Ottawa,
de Londres et de Washington et d’en accepter les conséquences (B.204).»
C’est dans cet extrait, qui est construit exactement sur le modèle du
«roman familial» de l’Enfant trouvé (le discrédit fait à son honneur,
l’action contraignante et odieuse des parâtres) que Bergeron s’approche
le mieux de l’éventuelle émergence du Bâtard (l’affirmation de soi par
désobéissance). Qu’il soit combattant pour le Royal 22th Regiment
ou qu’il soit déserteur, le Québécois est courageux lorsqu’il combat
selon ses convictions propres et non par pure opportunisme ou par
désobéissance entêtée. Qu’il soit combattant ou déserteur, il demeure un
vrai Patriote lorsqu’il manifeste son Être à l’Histoire et entend lui
donner un sens jusque-là orienté par des forces qui lui étaient
extérieures. Le Québécois fait preuve ici d’une maturité qu’il n’a pas
encore systématisée en comportement social. Ce «roman familial» aurait
pu être la fin de tout «roman familial» s’il n’avait pas avorté comme le
montre encore cette leçon sociale qu’il donne du travail du
contremaître: «Le contre-maître fait du travail productif seulement dans
la mesure où il aide les ouvriers dans leur travail comme par exemple,
l’initiation à telle ou telle technique. Mais dans la mesure où il
transmet des ordres d’en haut, il fait du travail non-productif. À ce
moment-là il participe à l’exploitation des ouvriers. Transmettre des
ordres à des ouvriers c’est les empêcher, eux, de prendre des décisions.
C’est aller à l’encontre du mieux-être humain (B.218).» Le ton
anarchisant de cette explication nie tout pouvoir d’autorité sur la
liberté individuelle alors que, socialement, ce pouvoir s’avère
indispen-sable pour le fonctionnement de toute entreprise, capitaliste
ou socialiste. Au moment où luit la maturité du Bâtard, nous retombons
dans la crise égotiste de l’Enfant trouvé…
service militaire obligatoire
mais pour la défense du pays seulement. Les Québécois ne font aucune
opposition à cette loi. Le peuple québécois est prêt à défendre le pays.
Cette réaction contredit toutes les accusations de lâcheté que les
Canadiens-anglais ont lancé contre le peuple québécois. Les Québécois
sont prêts à lutter quand il s’agit de défendre le Québec mais ils n’ont
aucune envie d’aller se faire massacrer pour défendre les intérêts de
puissance colonialistes (B.197).» Voilà une argumentation bien
présomptueuse. La peur n’a rien à voir ici avec l’objet pour lequel
combattre. Sa présence ou son absence ne sont pas plus discutées que ne
l’était l’antisémitisme historique dans le débat précédent. C’est la
réputation, encore, qui est en jeu: «Sur un total de 18 943 déserteurs
le Québec en comptait près de 10 000. Ces Québécois tous en uniformes et
prêts à défendre leur pays jusqu’à la mort s’il était attaqué,
refusaient d’aller se faire bousiller en Europe pour les intérêts de
l’Angleterre, de la France et des États-Unis. Ces patriotes que les
Canadiens-anglais traitaient de lâches et de traîtres, avaient le
courage de combattre par cet acte individuel le colonialisme d’Ottawa,
de Londres et de Washington et d’en accepter les conséquences (B.204).»
C’est dans cet extrait, qui est construit exactement sur le modèle du
«roman familial» de l’Enfant trouvé (le discrédit fait à son honneur,
l’action contraignante et odieuse des parâtres) que Bergeron s’approche
le mieux de l’éventuelle émergence du Bâtard (l’affirmation de soi par
désobéissance). Qu’il soit combattant pour le Royal 22th Regiment
ou qu’il soit déserteur, le Québécois est courageux lorsqu’il combat
selon ses convictions propres et non par pure opportunisme ou par
désobéissance entêtée. Qu’il soit combattant ou déserteur, il demeure un
vrai Patriote lorsqu’il manifeste son Être à l’Histoire et entend lui
donner un sens jusque-là orienté par des forces qui lui étaient
extérieures. Le Québécois fait preuve ici d’une maturité qu’il n’a pas
encore systématisée en comportement social. Ce «roman familial» aurait
pu être la fin de tout «roman familial» s’il n’avait pas avorté comme le
montre encore cette leçon sociale qu’il donne du travail du
contremaître: «Le contre-maître fait du travail productif seulement dans
la mesure où il aide les ouvriers dans leur travail comme par exemple,
l’initiation à telle ou telle technique. Mais dans la mesure où il
transmet des ordres d’en haut, il fait du travail non-productif. À ce
moment-là il participe à l’exploitation des ouvriers. Transmettre des
ordres à des ouvriers c’est les empêcher, eux, de prendre des décisions.
C’est aller à l’encontre du mieux-être humain (B.218).» Le ton
anarchisant de cette explication nie tout pouvoir d’autorité sur la
liberté individuelle alors que, socialement, ce pouvoir s’avère
indispen-sable pour le fonctionnement de toute entreprise, capitaliste
ou socialiste. Au moment où luit la maturité du Bâtard, nous retombons
dans la crise égotiste de l’Enfant trouvé…Evidemment, le Bâtard ne peut pas faire figure de lâche sous peine de se discréditer à ses propres yeux. L’Enfant trouvé, par sa nature fragile, peut se le permettre. Cela devient même un atout, car par sa lâcheté, il fait montre de vulnérabilité et justifie ainsi la permanence de l’action des figures parentales appropriées par l’État
 ou
l’Église. Le lâche par excellence de cette historiographie, c’est
Maisonneuve. Ce «dadais» de Maisonneuve, cette «rabatteuse» de Jeanne
Mance, cette «bonne poire» de Madame de Bullion
et surtout, ce tartuffe de la Dauversière sont autant de personnages
dignes de vaudeville qui rivalisent de tartes à la crème et de coups de
pieds au cul. Ferron transforme «l’épopée mystique», pierre angulaire de
l’historiographie cléricalo-nationaliste, en extraits du «théâtre
complet» de Marcel Gamache déjà cité. L’ironie mordante du docteur
Ferron se donne ici libre cours. Par elle, il reconnaît le «bon sens» de
l’histoire lorsqu’«on peut penser que les bonnes sœurs de l’Hôtel-Dieu
exagèrent un peu avec leur vénération pour la de Bullion, le hasard
naguère montrait plus de discernement quand la rue de Bullion était
célèbre pour ses bordels (F.63).» On ne retrouve que des moments de
«haute comédie (F.67)» dans cette histoire qu’on présentait jusqu’alors
comme une fondation sacrée, une geste digne de la Quête du Graal. Ferron
profane.
ou
l’Église. Le lâche par excellence de cette historiographie, c’est
Maisonneuve. Ce «dadais» de Maisonneuve, cette «rabatteuse» de Jeanne
Mance, cette «bonne poire» de Madame de Bullion
et surtout, ce tartuffe de la Dauversière sont autant de personnages
dignes de vaudeville qui rivalisent de tartes à la crème et de coups de
pieds au cul. Ferron transforme «l’épopée mystique», pierre angulaire de
l’historiographie cléricalo-nationaliste, en extraits du «théâtre
complet» de Marcel Gamache déjà cité. L’ironie mordante du docteur
Ferron se donne ici libre cours. Par elle, il reconnaît le «bon sens» de
l’histoire lorsqu’«on peut penser que les bonnes sœurs de l’Hôtel-Dieu
exagèrent un peu avec leur vénération pour la de Bullion, le hasard
naguère montrait plus de discernement quand la rue de Bullion était
célèbre pour ses bordels (F.63).» On ne retrouve que des moments de
«haute comédie (F.67)» dans cette histoire qu’on présentait jusqu’alors
comme une fondation sacrée, une geste digne de la Quête du Graal. Ferron
profane.  Ferron transgresse… «Mance
continua à Paris, où elle attaqua sa bonne poire, la de Bullion, en lui
laissant entendre qu’elle pourrait bien s’adresser à la duchesse
d’Aiguillon, dont celle-là était jalouse, pour doter les hospitalières
prêtes à la traversée, en vain. Alors elle pensa à son bras; elle était
manchotte des suites d’une luxation d’épaule. L’ayant fait savoir à des
médecins, elle alla prier devant le cœur de monsieur Olier et son bras
bougea: c’était un miracle. Et le miracle opéra où le chantage n’avait
pas réussi: la de Bullion émerveillée donna encore vingt mille livres,
qui allèrent dans la poche de Monsieur de La Dauversière et dont les
Hospitalières ne virent jamais la couleur (F.65-66).»
Ferron transgresse… «Mance
continua à Paris, où elle attaqua sa bonne poire, la de Bullion, en lui
laissant entendre qu’elle pourrait bien s’adresser à la duchesse
d’Aiguillon, dont celle-là était jalouse, pour doter les hospitalières
prêtes à la traversée, en vain. Alors elle pensa à son bras; elle était
manchotte des suites d’une luxation d’épaule. L’ayant fait savoir à des
médecins, elle alla prier devant le cœur de monsieur Olier et son bras
bougea: c’était un miracle. Et le miracle opéra où le chantage n’avait
pas réussi: la de Bullion émerveillée donna encore vingt mille livres,
qui allèrent dans la poche de Monsieur de La Dauversière et dont les
Hospitalières ne virent jamais la couleur (F.65-66).»On peut se demander comment de si crédules personnes purent être en même temps de si grands coquins, des escrocs qui entreprirent même d’exploiter de la façon la plus vile le Nouveau Monde? Bien sûr, Ferron fait des excès de mauvaise humeur comme les thuriféraires de Ville-Marie, jadis, faisaient un zèle de bonne foi. Ce qu’il faut comprendre, c’est la part symbolique de ces «historiettes», comment, surtout, c’est en elles que s’ancre la haine de soi reprise et systématisée par notre historiographie «marginale» des années soixante.
La prise Parmanda
C’est alors que nous sommes ramenés à l’Éros laissé en suspens lors du traitement de l’image de l’Amérindien. Nous avons dit que s’il n’est pas le seul détenteur de l’Éros dans l’histoire québécoise, l’Amérindien en est le principal héraut/héros. Face à lui se dresse le Mistigoche/moche, l’impuissant et le fourbe par excellence, c’est l’in-signifiant, comme l’in-fant reste l’Enfant trouvé. C’est le lâche Maisonneuve.
 L’humiliation
est à son comble dans cette figures d’anti-Éros lorsque Ferron rapporte
un commérage de la Mère Bourgeoys: «“Son confesseur lui dit un jour de
se marier à cause de certaines peines d’esprit qu’il souffrait; luy,
bien en peine, ne savait comment s’y prendre et s’y sentait des
répugnances horribles”. Heureusement, Sœur Bourgeoys veillait : Elle lui
conseilla au contraire de faire un vœu de chasteté perpétuelle, ce qui
lui donna la paix de l’âme (F.131).» La puissance de l’un fait
l’impuissance de l’autre. Pensez! Ferron ne laisse même pas la chance à
Maisonneuve d’être un «pédé»! Le sexe est le pro-blème numéro un de
toute historiographie dans la mesure où l’historiographie est aussi
écriture de désir. Elle peut être, comme dit Michel de Certeau, cette
écriture du manque qui est par lequel on éprouve le désir :
«L’historiographie est une manière contemporaine de pratiquer le deuil.
Elle s’inscrit à la place d’une absence et elle ne produit que des
simulacres, si scientifiques soient-ils. Elle met une représentation à
la place d’une séparation.»90 Aussi infantile soit-il dans le
prolongement du «roman familial» de l’Enfant trouvé, ce désir devient
érotique et à connotation sexuelle lorsqu’il s’inscrit dans une intrigue
mature du «roman familial» du Bâtard. Si l’Amérindien représente le
transfert de la libido infantile de l’idyllique rapport familial qu’il
se reconstruit en vue de s’émanciper des figures parentales, alors le
Français, le Père, ce Champlain qu’admire tant Ferron, devient vite une
menace qu’on ne se sent pas prêt à affronter. Il faudrait ce «meurtre du
Père» par une figure historique, comme ce Duval qui attenta aux jours
de Champlain et fut pendu à Québec, et sur lequel Heinz Weinmann élabore
toute une théorie. Comment conserver une telle figure paternelle tout
en voulant assumer la maturité de l’Enfant-Peuple qui ne peut se
réaliser que dans le deuil et la succession du Père? Or Duval n’apparaît
ni chez Ferron, ni même chez Bergeron! Au lieu de castrer la figure
paternelle, nos historiens décident d’en présupposer l’émasculation
préalable, bref, le Père est un couillon! Voilà comment contourner le
problème d’identification.
L’humiliation
est à son comble dans cette figures d’anti-Éros lorsque Ferron rapporte
un commérage de la Mère Bourgeoys: «“Son confesseur lui dit un jour de
se marier à cause de certaines peines d’esprit qu’il souffrait; luy,
bien en peine, ne savait comment s’y prendre et s’y sentait des
répugnances horribles”. Heureusement, Sœur Bourgeoys veillait : Elle lui
conseilla au contraire de faire un vœu de chasteté perpétuelle, ce qui
lui donna la paix de l’âme (F.131).» La puissance de l’un fait
l’impuissance de l’autre. Pensez! Ferron ne laisse même pas la chance à
Maisonneuve d’être un «pédé»! Le sexe est le pro-blème numéro un de
toute historiographie dans la mesure où l’historiographie est aussi
écriture de désir. Elle peut être, comme dit Michel de Certeau, cette
écriture du manque qui est par lequel on éprouve le désir :
«L’historiographie est une manière contemporaine de pratiquer le deuil.
Elle s’inscrit à la place d’une absence et elle ne produit que des
simulacres, si scientifiques soient-ils. Elle met une représentation à
la place d’une séparation.»90 Aussi infantile soit-il dans le
prolongement du «roman familial» de l’Enfant trouvé, ce désir devient
érotique et à connotation sexuelle lorsqu’il s’inscrit dans une intrigue
mature du «roman familial» du Bâtard. Si l’Amérindien représente le
transfert de la libido infantile de l’idyllique rapport familial qu’il
se reconstruit en vue de s’émanciper des figures parentales, alors le
Français, le Père, ce Champlain qu’admire tant Ferron, devient vite une
menace qu’on ne se sent pas prêt à affronter. Il faudrait ce «meurtre du
Père» par une figure historique, comme ce Duval qui attenta aux jours
de Champlain et fut pendu à Québec, et sur lequel Heinz Weinmann élabore
toute une théorie. Comment conserver une telle figure paternelle tout
en voulant assumer la maturité de l’Enfant-Peuple qui ne peut se
réaliser que dans le deuil et la succession du Père? Or Duval n’apparaît
ni chez Ferron, ni même chez Bergeron! Au lieu de castrer la figure
paternelle, nos historiens décident d’en présupposer l’émasculation
préalable, bref, le Père est un couillon! Voilà comment contourner le
problème d’identification.Plus simplement, l’historiographie de nos auteurs exprime brutalement notre manque de couilles en tant qu’Enfant-Peuple puisque, bon sang ne saurait mentir, nous provenons tous d’un impuissant, d’un chaste ascète, peureux et lâche. La pierre d’assise du symbolique dans les Historiettes de Ferron, c’est cette suite d’anecdotes tirées essentiellement de Dollier de Casson, véritable «Décameron» de la fondation de Ville-Marie, genre que prise particulièrement le docteur Ferron et dont l’épisode central tourne autour de la «prise Parmanda».
 Première
anecdote : Une bonne femme était aux champs, à deux portées de fusil du
fort; les Iroquois lui tombèrent dessus et l’assommèrent; l’un d’eux
allait la scalper, «mais notre amazone se sentant ainsi saisir, tout
d’un coup reprit ses sens, se leva et plus furieuse que jamais elle
saisit ce cruel avec tant de violence par un endroit que la pudeur nous
défend de nommer, qu’à peine se put-il jamais échapper, il lui donnait
des coups de hache par la tête, toujours elle tenait bon jusqu’à ce que
derechef elle tombe évanouie par terre et par sa chute elle donna lieu à
cet Iroquois de s’enfuir au plus vite, ce qui était l’unique chose à
quoi il pensait pour lors, car il était prêt d’être joint par nos
Français qui venaient au secours. Un des Français, après avoir relevé la
bonne femme, l’embrassa par un témoignage d’amitié et de compassion;
elle, revenant à soi et se sentant embrassée, déchargea un grand
soufflet à ce client affectueux, ce qui obligea les autres à lui dire: –
“Que faites-vous? Cet homme vous témoigne amitié sans penser à mal,
pourquoi le frappez-vous? – Parmanda, répondit-elle, je croyais qu’il me
voulait baiser”…»
Première
anecdote : Une bonne femme était aux champs, à deux portées de fusil du
fort; les Iroquois lui tombèrent dessus et l’assommèrent; l’un d’eux
allait la scalper, «mais notre amazone se sentant ainsi saisir, tout
d’un coup reprit ses sens, se leva et plus furieuse que jamais elle
saisit ce cruel avec tant de violence par un endroit que la pudeur nous
défend de nommer, qu’à peine se put-il jamais échapper, il lui donnait
des coups de hache par la tête, toujours elle tenait bon jusqu’à ce que
derechef elle tombe évanouie par terre et par sa chute elle donna lieu à
cet Iroquois de s’enfuir au plus vite, ce qui était l’unique chose à
quoi il pensait pour lors, car il était prêt d’être joint par nos
Français qui venaient au secours. Un des Français, après avoir relevé la
bonne femme, l’embrassa par un témoignage d’amitié et de compassion;
elle, revenant à soi et se sentant embrassée, déchargea un grand
soufflet à ce client affectueux, ce qui obligea les autres à lui dire: –
“Que faites-vous? Cet homme vous témoigne amitié sans penser à mal,
pourquoi le frappez-vous? – Parmanda, répondit-elle, je croyais qu’il me
voulait baiser”…»Deuxième anecdote : La petite Sœur Morin surprit un jour un Iroquois traité à l’hôpital et qui sans doute se portait mieux, en train d’écraser Sœur de Bressoles contre le mur, derrière une porte, dans un endroit secret. Sœur de Bressoles souffrait silencieusement son martyre; la petite Sœur Morin cria, elle, à l’assassin, ne pouvant concevoir un moyen terme. Les soldats d’accourir. «“Ils battirent Monsieur l’Yroquois et lui en donnèrent en riant autant qu’il en put porter; lui de sa part adret et rusé, prenant aussy en riant les coups qu’on lui donnait, dit par excuse qu’il ne pensait pas à faire de mal à celle qui lui fesait mil bien.” Pensez ce que vous voudrez; pour moi la chose est claire. Il serait toutefois ignoble d’en rester là. Sœur de Bressoles venait d’une période troublée, où on enlevait les filles à leurs parents par zèle de religion: elle en fut. On la confia à La Dauversière, qui la séquestra dans un de ses couvents. Cela partait mal une nonne. Elle était par ailleurs bonne hospitalière, connaissait les simples, soignait bien. Les Sau-vages la nommaient: le soleil qui luit…»
Troisième anecdote : En 1643, arrive à Ville-Marie Mon-sieur de La Barre à la tête de soixante hommes dont il a le commandement… C’est un précieux renfort qui met toutefois le Sieur de Maisonneuve devant un dilemme, le nez incertain entre deux yeux différents : le bon œil pour le renfort, le mauvais pour le rival introduit dans la place. Monsieur de La Barre est dévot… mais qu’à cela ne tienne! Monsieur de Maisonneuve l’est tout autant. Les voici donc qui se surveillent, «qui minaudent et se détestent comme deux matous du bon Dieu». Finalement, c’est Maisonneuve qui l’emporte. Il a remarqué que La Barre a du goût pour les sous-bois; il le fait suivre et surprendre avec une sauvagesse; la sauvagesse est grosse : La Barre l’aura engrossée! Il n’en faut pas davantage pour mettre celui-ci aux fers et le renvoyer en France comme le dernier des criminels! C’était une façon de régler un conflit d’autorité. La prise Parmanda resta toujours en honneur à Ville-Marie (F. 127 à 130).
Cette tactique de la prise Parmanda demeurera en fait tout au long de l’histoire du Québec. Qu’on en juge lorsque Bergeron parle de la rupture de l’Union sacrée de Paul Gouin et de Maurice Duplessis : «Duplessis a exploité la situation pour rafler tous les collaborateurs de Gouin et laisse celui-ci en plan… Duplessis a donc recueilli tout le travail de Gouin et son programme de réformes. Mais arrivé au pouvoir, il n’en fait rien (B.194).» Le rapprochement n’est pas fortuit. Duplessis, comme Maisonneuve, est un «vieux garçon» retord! Maisonneuve est puceau et a, comme on l’a su par Mère Bourgeoys, une aversion pour les choses du sexe au point que Ferron doit «conclure d’ailleurs en toute honnêteté que, faute de ce que la pudeur […] défend de nommer, la prise Parmanda ne pouvait réussir contre lui (F.135).» Duplessis, pour sa part, comme l’on sait depuis grâce aux commérages cette fois de Conrad Black, souffrait d’une malformation de la verge. La prise Parmanda ne pouvait donc réussir contre lui non plus. La prise Parmanda reste la force des impuissants, le coup de Jarnac que les Québécois, Bâtards avortés, se portent entre eux comme le raconte encore Léandre Bergeron dans l’affaire de la Johns Mainville, en 1949: «Le 5 mai un convoi de 25 voitures de la P.P. se dirige vers Asbestos. On arrête 180 ouvriers. On les bat à coups de poing, à coups de garcette, à coups de pieds dans les testicules. Des Québécois battent ainsi d’autres Québécois, salariés comme eux. Les policiers de la P.P., braves Québécois qui sont entrés dans la police parce que c’est une job, servant Duplessis qui sert John Mainville qui exploite des ouvriers québécois. C’est John Mainville qu’il fallait battre. Personne d’autre, même pas Duplessis-concierge. C’est Mainville le responsable (B.208 – c’est moi qui souligne).»
 La
prise Parmanda, une nouvelle tare régressive à rajouter au tableau de
nos auteurs. Comme le souligne encore le docteur Ferron: «Voilà comment
on était à Ville-Marie, le quant à soi rétif, la continence bavarde,
mais le sexe toujours prêt, entretenu sournoisement et ressortant de la
façon la plus cocasse [dans la première et la troisième anecdote]. Il
arrivait aussi qu’on se tût [dans la seconde] (F.127).» Mais la
cocasserie laisse place à un silence bien inconfortable lorsqu’on passe
par la Conquête, et il fallut passer par la Conquête pour en arriver aux
saloperies de Duplessis.
La
prise Parmanda, une nouvelle tare régressive à rajouter au tableau de
nos auteurs. Comme le souligne encore le docteur Ferron: «Voilà comment
on était à Ville-Marie, le quant à soi rétif, la continence bavarde,
mais le sexe toujours prêt, entretenu sournoisement et ressortant de la
façon la plus cocasse [dans la première et la troisième anecdote]. Il
arrivait aussi qu’on se tût [dans la seconde] (F.127).» Mais la
cocasserie laisse place à un silence bien inconfortable lorsqu’on passe
par la Conquête, et il fallut passer par la Conquête pour en arriver aux
saloperies de Duplessis.Jean Bouthillette a raison d’écrire: «la Conquête avait engen-dré en nous le terrible dialogue de la liberté et de la mort. C’est dans le dialogue de la liberté et de la vie que se fera notre Reconquête. Mais à l’heure de tous les possibles et des échéances déchirantes, ce que doit d’abord vaincre notre peuple, c’est sa grande fatigue, cette sournoise tentation de la mort». 44 Tout en affirmant, comme Heinz Weinemann, que la fantasmatique québécoise a reporté la blessure narcissique de l’échec des insurrections de 1837-1838 sur la Conquête antérieure de 1760, il faut reconnaître que le discours contenu dans le «roman familial» de l’Enfant trouvé et concernant la Conquête est, lui, tout aussi historique en soi que fantasmatique. Il pose le véritable problème de la haine sans laquelle l’échec de 1837-1838 et ses conséquences resteraient inintelligibles. «C’est sous forme de résidu scolaire que la Conquête s’intériorise d’abord en nous, inoculée dans nos âmes d’enfants par une histoire bien divisée en deux parts qui se repoussent : avant, après; qui sonnent comme toujours, jamais. Un régime français tout glorieux de notre présence héroïque et généreuse. Puis la cassure. C’est comme si tout d’un coup nous n’étions plus là, comme si notre vie s’arrêtait, le souffle de notre histoire coupé net. C’est désormais l’Anglais qui bâtit ce pays à son image; et nous devenons les spectateurs d’une histoire qui semble ne plus être la nôtre. Il y a les bons gouverneurs anglais, soit ceux qui aimaient les Canadiens français; et les autres, qui tramaient notre perte.»45 On se souvient comment Léandre Bergeron nous mettait en garde contre ce dyptique (B.86) en dénonçant la tactique assimilatrice de l’alternance du coup de bâton et de la carotte. Contrairement à la Conquête de 1760, les Rébellions ne marquent pas de rupture périodique de notre conscience historique, même si elles furent suivies de l’Acte d’Union de 1840 à la base du Canada contemporain. Pourtant, nos auteurs ne cessent de se rapporter à elles. Dans le «roman familial» de l’Enfant trouvé, l’événement de 1760 fonde tout son psychodrame (donc le sociodrame québécois) car il raconte comment l’Enfant trouvé s’est «trouvé» séparé de ses parents légitimes, répondant ainsi à la défaite implicite: pourquoi s’est-il soulevé et pourquoi a-t-il été réprimé/puni par la marâtre britannique? Même s’il conserve près de lui la présence de la bonne fée Église catholique et du bon pasteur Clergé ultramontain, l’Enfant-Peuple passe son «âge ingrat» et fait sa crise. La fée et le pasteur interviennent. Ils sauront ramener l’Enfant à la raison: «Coupé trop tôt, et brutalement, le cordon ombilical qui nous reliait à la mère patrie, nous avons été amenés, par compensation à en tisser un artificiellement, non avec la France en tant que pays étranger mais en tant que mère. La chute est un retour au sein maternel. Mais la France, c’est aussi la mère qui nous a abandonné après 1760. D’où la dualité de nos sentiments exacerbés : amour et haine à la fois, aussi irraisonnés l’un que l’autre. La brisure de la Conquête, qui est devenue celle de notre être même, nous a plongés dans un isolement intérieur qui n’a fait que s’accentuer avec le temps et la France – celle de notre Ancien Régime –, par la magie du souvenir que la présence conquérante de l’Anglais exaspérait en nous, est devenue à nos yeux ce qu’elle n’avait probablement jamais été pour nous avant même la Conquête. Nous avons ainsi développé le complexe de l’abandonné. Nous sommes des orphelins qui retournent au pays de l’enfance pour mieux retrouver une mère perdue ou la mieux flétrir. Or c’est de nous-mêmes que sans le savoir nous sommes orphelins.»46 La situation décrite par Bouthillette reflète la régression effectuée non seulement par les historiens mythomanes de la Nouvelle-France, mais aussi par les écrivains que nous étudions. Dans le rôle de l’Enfant trouvé le colon français, abandonné par la Cession de 1763, a cédé la place à l’Amérindien, «colonisé jusqu’à en crever», mais la structure symbolique de ces écrits est analogue à celle des écrits tant décriés des historiens cléricalo-nationalistes. Nous butons toujours sur la même incapacité de détourner la haine que nous nous portons à nous-mêmes car les deuils inconsolables nous coupent de notre présence à l’Histoire: «Notre inconscient refus de l’Anglais s’abreuve donc de cette haine issue de la Conquête. Mais comme pour la Conquête, nous avons “oublié” la haine, qui s’est tapie en nous comme une bête. Car elle est toujours là, arraisonnée en apparence mais qui nous dévore sans que nous le sachions et nous para-lyse face à l’Anglais contemporain, qui est un compatriote, un Canadien comme nous. Comment haïr cet Anglais qui n’a plus rien d’un soldat de Wolfe? […] Qu’est-il alors advenu de cette haine originale? Intériorisée la Conquête, elle a été, comme le refus dont elle est inséparable, désamorcée de son objet. Et l’Anglais innocenté, elle est devenue coupable. Le refus de nous-même exprime cette haine coupable de l’Anglais retourné contre nous-mêmes».47
On comprend alors que le mépris porté à Cartier, à Maisonneuve et aux Mistigoches n’est plus un simple renversement du positif en négatif des héros de l’historiographie cléricalo-nationaliste. Une fois étouffée la velléité de changer la vision québécoise de l’histoire, on revient aux mêmes affects de base sauf que le dédain de l’Anglais (ou ce respect condes-cendant des manuels de Guy Laviolette) se déplace sur les héros de la Nouvelle-France et la haine contenue jusqu’alors déferle comme si le borderline venait de céder tel un barrage devant un réservoir.
 Et
de fait, il a cédé. Un flot d’abjection rafle tout sur son passage!
Chez Léandre Bergeron, tout n’est que violence, hypocrisie, cynisme et
duplicité: «Les premiers mots de l’homme blanc sont un mensonge. L’homme
blanc montre déjà son vrai visage… L’homme blanc, hypocrite, menteur,
voleur se joue de l’honnêteté et de la naïveté du Rouge. On se demandera
par la suite pourquoi le Rouge parlera de la langue fourchue du Blanc
(B.15). Le très chrétien homme blanc manifeste de nouveau sa vilénie
(B.17).» L’abjection se manifeste par la dégradation en déchets du corps
physique de l’Amérindien.
Et
de fait, il a cédé. Un flot d’abjection rafle tout sur son passage!
Chez Léandre Bergeron, tout n’est que violence, hypocrisie, cynisme et
duplicité: «Les premiers mots de l’homme blanc sont un mensonge. L’homme
blanc montre déjà son vrai visage… L’homme blanc, hypocrite, menteur,
voleur se joue de l’honnêteté et de la naïveté du Rouge. On se demandera
par la suite pourquoi le Rouge parlera de la langue fourchue du Blanc
(B.15). Le très chrétien homme blanc manifeste de nouveau sa vilénie
(B.17).» L’abjection se manifeste par la dégradation en déchets du corps
physique de l’Amérindien.  «Après
ces massacres, les Français chantent le Te Deum sur les ruines fumantes
et les corps déchiquetés des Iroquois (B.38).» «L’homme rouge est la
chair à canon des Blancs, Anglais et Français, rivaux commerciaux
(B.38).» Cette haine de l’Amérindien porteur de l’Éros, manifestée par
les Français nos ancêtres, est bien notre haine de soi que nous nous
manifestons par victime (idéalisée) interposée. Avec la déportation des
Acadiens, le véritable objet de notre haine se découvre subitement: «7
000 Acadiens sont embarqués comme des animaux dans des bateaux et
dispersés sur les côtes américaines. La barbarie blanche qui s’était
acharnée surtout contre l’homme rouge, s’acharne contre le Blanc
(B.44).» Et la boucherie de Dieppe
(1942) sera l’occasion de reprendre ce discours utilisé jusqu’alors à
propos de l’Amérindien : «Les Québécois refusaient de se faire mettre
l’uniforme sur le dos pour se faire expédier outre-mer comme chair à
canon anglais (B.198).»
«Après
ces massacres, les Français chantent le Te Deum sur les ruines fumantes
et les corps déchiquetés des Iroquois (B.38).» «L’homme rouge est la
chair à canon des Blancs, Anglais et Français, rivaux commerciaux
(B.38).» Cette haine de l’Amérindien porteur de l’Éros, manifestée par
les Français nos ancêtres, est bien notre haine de soi que nous nous
manifestons par victime (idéalisée) interposée. Avec la déportation des
Acadiens, le véritable objet de notre haine se découvre subitement: «7
000 Acadiens sont embarqués comme des animaux dans des bateaux et
dispersés sur les côtes américaines. La barbarie blanche qui s’était
acharnée surtout contre l’homme rouge, s’acharne contre le Blanc
(B.44).» Et la boucherie de Dieppe
(1942) sera l’occasion de reprendre ce discours utilisé jusqu’alors à
propos de l’Amérindien : «Les Québécois refusaient de se faire mettre
l’uniforme sur le dos pour se faire expédier outre-mer comme chair à
canon anglais (B.198).»Alors que l’historiographie construite sur le «roman familial» du Bâtard aurait dû polariser la haine sur le Conquérant et le vainqueur de 1837-1838 afin de la dominer par son historicité, Jacques Ferron humilie et ridiculise les fondateurs de la Nouvelle-France et encense l’Angleterre: opération néfaste entre toutes! «Tout n’est pas perdu du souvenir anglais et […] on lui gardera, avec un sourire amusé, à défaut d’autre place, une petite niche dans le cœur québécois (F.106).» Ce n’est pas seulement le monument de Wolfe, cible d’une bombe felquiste qui entraîne cette larme de gratitude du docteur Ferron. Pour lui, déjà Durham était «un Anglais de génie, le seul que nous ne vîmes jamais (F.144).» Mais le contraste est tout aussi grand lorsqu’il passe des individus aux peuples. Des Français de l’époque de la Nouvelle-France, il écrit: «Le bon peuple de France opprimé, inculte, plus sauvage que les sauvages, et ceux de l’Amérique du Nord aussi misérables, mais libres, fiers et humains (F.48)…» De l’Anglais, rien de barbare ni de misérable ne teint le portrait naguère tracé par l’abbé Surprenant, dont on retrouvera encore mention dans Le Ciel de Québec, et l’Angleterre prendra alors la physionomie maternelle dans cet extrait que rapporte Ferron: «“La brume n’y est que vapeurs de lait, car de cette république, il faut juger par les mamelles qui sont l’une, la chance, l’autre la famine, et qui pour s’opposer tendent néanmoins à l’unité des contraires et s’épa-nouis-sent harmonieusement dans la gorge victorienne…” (F.154). Voici l’abbé Surprenant pastichant Sully: «Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France.» Mais ici, les mamelles sont, l’une la chance et l’autre la famine! Voilà une infirmité bien gênante pour une Mère nourricière! Il y a pénurie de mamelles; mais le bon docteur và trouver le moyen d’arranger la chose!
Après l’Amérindien, après Champlain, voici l’Angleterre. Décidément, quelque chose chez Ferron cherche à brouiller les cartes. Bergeron, par son militantisme politique, va plus directement aux racines. Sa haine de la France et de ses administrateurs comme de l’Angleterre et de ses gouverneurs ne souffre aucune de ces nuances qui font errer Ferron. Le seul qui sera sauvé de l’anathème qu’il porte au Régime français, c’est
 Louis Hébert:
«le véritable père du peuple québécois. C’est cette souche d’exploités,
qui comprendra repris de justice, vagabonds et filles du roi, qui
donnera naissance à ce peuple exploité que nous sommes, exploité d’abord
par les marchands français et leurs complices de la noblesse, puis par
les Anglais et enfin aujourd’hui par les Américains (B.26-27).» Avec
plus d’audace que Ferron, Bergeron annonce qu’il va faire basculer le
«roman familial» de l’Enfant trouvé dans celui de la filiation bâtarde :
colons/prostituées: «Des filles du roi, bâtardes de grandes dames de
Frances, orphelines, prostituées par nécessités. Les déshérités. Les
déclassés, les désavoués sont expédiés en “Nouvelle-France” pour former
la racine principale de notre souche française (B.35).» Bergeron insiste
sur cette bâtardisation des premiers parents des Québécois (B.39-40).
Une nouvelle voie s’ouvre-t-elle à nous? De la lignée qui conduit de
l’Amérindien à Champlain, passerions-nous à
Louis Hébert:
«le véritable père du peuple québécois. C’est cette souche d’exploités,
qui comprendra repris de justice, vagabonds et filles du roi, qui
donnera naissance à ce peuple exploité que nous sommes, exploité d’abord
par les marchands français et leurs complices de la noblesse, puis par
les Anglais et enfin aujourd’hui par les Américains (B.26-27).» Avec
plus d’audace que Ferron, Bergeron annonce qu’il va faire basculer le
«roman familial» de l’Enfant trouvé dans celui de la filiation bâtarde :
colons/prostituées: «Des filles du roi, bâtardes de grandes dames de
Frances, orphelines, prostituées par nécessités. Les déshérités. Les
déclassés, les désavoués sont expédiés en “Nouvelle-France” pour former
la racine principale de notre souche française (B.35).» Bergeron insiste
sur cette bâtardisation des premiers parents des Québécois (B.39-40).
Une nouvelle voie s’ouvre-t-elle à nous? De la lignée qui conduit de
l’Amérindien à Champlain, passerions-nous à  celle qui conduit de l’Amérindien à Louis Hébert, avec les Filles du Roy
comme Mère? Tout irait déjà un peu mieux si elles n’étaient pas toutes
rattrapées par ces «grandes dames de France» dont elles sont les
bâtardes! Moyen subtil de réinsérer la figure de l’Enfant trouvé après
avoir dépensé tant d’efforts pour s’en libérer! Le deuil de
l’orphelin(e) l’emporte encore sur l’émancipation de l’Enfant-Peuple.
«On tâchait de réveiller chez le peuple l’allégeance à une mère-patrie
qu’il avait rejeté [sic!] depuis longtemps, à cette bonne vieille maman
qui avait fauté, il faut le dire, en tombant dans les bras de la
Révolution. […] On moussait chez le colonisé canayen une dépendance
vis-à-vis une mère qu’il ne pourrait jamais revoir mais dont on lui
montrait quelques portraits. […] On le maintenait dans l’ailleurs, dans
des rêves de grandeur passée quand la France dominait le Canada. De
cette façon, on empêchait le colonisé canayen de compter sur lui-même, de se définir comme canayen,
de s’identifier à l’homme d’ici, colonisé, certes mais prêt à lutter
contre ce colonialisme. On essayait de le maintenir dans l’enfance
(B.137-138).»
celle qui conduit de l’Amérindien à Louis Hébert, avec les Filles du Roy
comme Mère? Tout irait déjà un peu mieux si elles n’étaient pas toutes
rattrapées par ces «grandes dames de France» dont elles sont les
bâtardes! Moyen subtil de réinsérer la figure de l’Enfant trouvé après
avoir dépensé tant d’efforts pour s’en libérer! Le deuil de
l’orphelin(e) l’emporte encore sur l’émancipation de l’Enfant-Peuple.
«On tâchait de réveiller chez le peuple l’allégeance à une mère-patrie
qu’il avait rejeté [sic!] depuis longtemps, à cette bonne vieille maman
qui avait fauté, il faut le dire, en tombant dans les bras de la
Révolution. […] On moussait chez le colonisé canayen une dépendance
vis-à-vis une mère qu’il ne pourrait jamais revoir mais dont on lui
montrait quelques portraits. […] On le maintenait dans l’ailleurs, dans
des rêves de grandeur passée quand la France dominait le Canada. De
cette façon, on empêchait le colonisé canayen de compter sur lui-même, de se définir comme canayen,
de s’identifier à l’homme d’ici, colonisé, certes mais prêt à lutter
contre ce colonialisme. On essayait de le maintenir dans l’enfance
(B.137-138).»Marthe Robert n’aurait aucune difficulté à reconnaître dans cet extrait le «roman familial» du Bâtard. Des poussées de lucidité ne cessent de remonter dans le cours des écrits de Ferron, de Bergeron et de Beaulieu, mais pour se retrouver aussitôt ravalées à l’intérieur du «roman familial» de l’Enfant trouvé qu’on espérait quitter définitivement. Lorsque la figure du Bâtard parvient à émerger, elle ne ressemble plus qu’à un avorton. Par la prise Parmanda, on assiste à la difficile descente des testicules dans le scrotum. L’habitant rebelle, le Patriote canayen, l’insurgé Métis, le travailleur productif en lutte de classes sont autant d’images de l’Enfant-Peuple écartelé entre son idéalisation compulsive de l’idylle du Régime français et son débat névrotique avec une réalité qui lui bloque l’accès à ses aspirations de souveraineté québécoise. La France et l’Angleterre sont des mères désuètes, idéalisées certes mais momifiées, pétrifiées dans l’inconscient collectif, elles demeurent des simulacres idéologiques des références politiques. Mais ce qu’on voulait de la Mère, après tout, n’était-ce pas ses mamelles (Grande gueule, grandes mamelles…) et qui peut avoir autant de saines mamelles qu’une vache vivante? «Un de nos agronomes, Firmin Létourneau, a fait parler la vache. Elle a dit: “Je suis ici depuis trois siècles, mes ancêtres viennent de Bretagne et de Normandie. J’ai mangé de la misère. Malgré tout j’ai donné du lait. Je ne suis plus une Normande ni une Bretonne. Je suis une Canadienne. J’ai du potentiel dans le corps. À mon âge la Jersey, la Guernesey, la Ayrchire n’en avaient pas plus que moi. Tandis que la sélection et l’alimentation feraient de moi une des meilleures races laitières au monde, les croisements vont me détruire” (F.122).» Et Firmin Létourneau de continuer, ce que Ferron ne rapporte pas : «Ces animaux, on les croise avec les bovins canadiens. Résultat? La vache canadienne perd de ses caractères.»48 Puis, Ferron poursuit le portrait de ce qu’il présente un peu comme notre véritable Mère à tous: «Cette raciste (c’est d’elle que nous tenons nos penchants nazis bien connus) était noirâtre avec un cercle jaune autour du mufle et une raie jaune ou rouge sur le dos… Les bêtes, canadiennes comme nous le sommes, étaient de race naturelle, dit mon agronome, “mais après deux siècles de rude existence et d’adaptation difficile aux conditions climatiques et culturelles du Québec, elles n’étaient pas en état de rivaliser avec les races de culture” arrivant d’Europe. Le conflit et cette défaite ne surviendront, toutefois, qu’un siècle après la bataille des Plaines d’Abraham. La première Ayrshire débarqua en 1821, soixante-deux ans après le général Wolfe. Et la défaite ne fut complète qu’aux débuts du présent siècle (F.122-123).» Voilà qui est bien compromettant pour la figure idéalisée de l’Amérindien! Celle du colon apparaît comme assez immuable, et voilà maintenant l’intrusion de cette bête mythologique. «J’ai mangé de la misère, dit-elle. C’est l’épouse parfaite pour Louis Hébert, celle qui fixe notre colon exploité autour de ses jupes (F.106)»! «“Malgré tout, j’ai donné du lait. Sans moi, bien des enfants de la Nouvelle-France seraient morts de faim. Je me suis adaptée aux conditions du pays…”49» Cela, le docteur l’omet dans sa citation. «Les habitants du Québec, dans de petites fermes pas toujours rentables, ne peuvent pas concurrencer la production du blé du Mid-West américain. Ils tâchent de diversifier en s’orientant vers l’industrie laitière (B.141)» rappelle brièvement Bergeron. Que la «grande corne» du parti Rhinocéros ait eu un penchant pour la vache cana-dienne, cela relève du bestiaire politique autorisé. Mais nous ne cessons de perdre nos caractères d’humanité. L’Amérindien, ça passait toujours, mais la vache…
 Nous
pourrions pousser l’affaire jusqu’au soupçon de bestialité si nous ne
connaissions pas le genre d’humour propre au bon docteur et son amour
passionné de la vie. C’est à elle que nous devons cette filiation par
l’imaginaire à ces bêtes «canadiennes comme nous le sommes». Cela relève
de la pure mythologie, comme Léda et le Cygne. Sauf qu’ici, c’est la
figure maternelle qui est métamorphosée en bête, et nous sommes le
produit de cet accouplement étrange. L’Angleterre de l’abbé Surprenant?
De la diversion, une façon de parler de la chose pour ne pas en parler
précisément; «brumes de vapeurs de lait». L’Angleterre de Ferron
fonctionne comme celle de l’historiographie cléricalo-nationaliste. La
haine viscérale que nous lui portons est telle, comme l’a diagnostiquée
Jean Bouthillette, que nous ne pouvons pas avouer une véritable
filia-tion maternelle. Tout au mieux restera-t-elle cette marâtre qui,
après avoir assassinée, absentifiée la vraie Mère, la naturelle, s’y
substitue et déploie tout son sadisme stérile sur l’Enfant-Peuple, un
peu comme dans le film La Petite Aurore l’enfant martyre (1951). En substituant la vache à la France ou à l’Angleterre, Ferron consolide la part du «roman familial» du Bâtard dans ses Historiettes
tout en permettant à la métamorphose hybride de faire naître cet
avorton, prix à payer pour sauver les résidus des figures parentales
nécessaires pour maintenir ce que le symbolique familialiste «idyllique»
de l’historiographie cléricalo-nationaliste avait établi depuis le
début du siècle. Ferron bouleverse cette historiographie traditionnelle
mais ne parvient pas à changer la structure foncière de ses paradigmes
symboliques. «Labourage et paturage sont les deux mamelles…» labourage,
c’est le cheval, plus précisément le colon misérable et exploité, Louis
Hébert, «le véritable père du peuple québécois», dernier avatar d’une
figure qui a longuement cheminé et qui a ramassé en cours de route
Jacques Cartier et Samuel de Champlain; pâturage, c’est la vache
canadienne, cette Mère débarquée en même temps que les Filles du Roy et
qui, parce qu’elle a allaité les enfants de la Nouvelle-France, a pu
être associée aux mamelles desséchées de l’Église post-tridentine du
XIXe siècle et à l’Angleterre mamectomisée de l’abbé Surprenant. La
chance était rarement au rendez-vous, mais la famine resta assurée par
l’ingratitude du sol québécois et la rigueur du climat canadien. Sur une
plaque de glace, Louis Hébert tomba et se tua; c’en était fait de la
chance et de la figure d’un Père le moindrement honorable. Avec lui
mouraient Cartier (devenu Hérode) et Champlain. La famine (toute crise
économique vécue depuis le temps de la monnaie de cartes jusqu’aux
coupures actuelles des ministères) ne cessa de nous rappeler, même en
pleine prospérité d’après-guerre, que nous vivions bien sur cette
Terre-Québec que Dieu donna à Caïn! Ferron utilise, à son insu, la
citation de l’abbé Surprenant comme un contraste anti-Sully. Reste une
vache qui s’épuise en métissages inquiétants. Métissage des ethnies
néo-québécoises? N’anticipons pas et ne plongeons pas Ferron dans un
contre-sens anachronique. Métissage britannique. Oui, il le mentionne.
Métissage amérindien? Nous brûlons.
Nous
pourrions pousser l’affaire jusqu’au soupçon de bestialité si nous ne
connaissions pas le genre d’humour propre au bon docteur et son amour
passionné de la vie. C’est à elle que nous devons cette filiation par
l’imaginaire à ces bêtes «canadiennes comme nous le sommes». Cela relève
de la pure mythologie, comme Léda et le Cygne. Sauf qu’ici, c’est la
figure maternelle qui est métamorphosée en bête, et nous sommes le
produit de cet accouplement étrange. L’Angleterre de l’abbé Surprenant?
De la diversion, une façon de parler de la chose pour ne pas en parler
précisément; «brumes de vapeurs de lait». L’Angleterre de Ferron
fonctionne comme celle de l’historiographie cléricalo-nationaliste. La
haine viscérale que nous lui portons est telle, comme l’a diagnostiquée
Jean Bouthillette, que nous ne pouvons pas avouer une véritable
filia-tion maternelle. Tout au mieux restera-t-elle cette marâtre qui,
après avoir assassinée, absentifiée la vraie Mère, la naturelle, s’y
substitue et déploie tout son sadisme stérile sur l’Enfant-Peuple, un
peu comme dans le film La Petite Aurore l’enfant martyre (1951). En substituant la vache à la France ou à l’Angleterre, Ferron consolide la part du «roman familial» du Bâtard dans ses Historiettes
tout en permettant à la métamorphose hybride de faire naître cet
avorton, prix à payer pour sauver les résidus des figures parentales
nécessaires pour maintenir ce que le symbolique familialiste «idyllique»
de l’historiographie cléricalo-nationaliste avait établi depuis le
début du siècle. Ferron bouleverse cette historiographie traditionnelle
mais ne parvient pas à changer la structure foncière de ses paradigmes
symboliques. «Labourage et paturage sont les deux mamelles…» labourage,
c’est le cheval, plus précisément le colon misérable et exploité, Louis
Hébert, «le véritable père du peuple québécois», dernier avatar d’une
figure qui a longuement cheminé et qui a ramassé en cours de route
Jacques Cartier et Samuel de Champlain; pâturage, c’est la vache
canadienne, cette Mère débarquée en même temps que les Filles du Roy et
qui, parce qu’elle a allaité les enfants de la Nouvelle-France, a pu
être associée aux mamelles desséchées de l’Église post-tridentine du
XIXe siècle et à l’Angleterre mamectomisée de l’abbé Surprenant. La
chance était rarement au rendez-vous, mais la famine resta assurée par
l’ingratitude du sol québécois et la rigueur du climat canadien. Sur une
plaque de glace, Louis Hébert tomba et se tua; c’en était fait de la
chance et de la figure d’un Père le moindrement honorable. Avec lui
mouraient Cartier (devenu Hérode) et Champlain. La famine (toute crise
économique vécue depuis le temps de la monnaie de cartes jusqu’aux
coupures actuelles des ministères) ne cessa de nous rappeler, même en
pleine prospérité d’après-guerre, que nous vivions bien sur cette
Terre-Québec que Dieu donna à Caïn! Ferron utilise, à son insu, la
citation de l’abbé Surprenant comme un contraste anti-Sully. Reste une
vache qui s’épuise en métissages inquiétants. Métissage des ethnies
néo-québécoises? N’anticipons pas et ne plongeons pas Ferron dans un
contre-sens anachronique. Métissage britannique. Oui, il le mentionne.
Métissage amérindien? Nous brûlons.Car, qu’en est-il en fait, de la figure de l’Amérindien une fois les couches sédimentaires symboliques décapées? La progression de notre enquête de la structure symbolique confirme bien que l’Amérindien n’est qu’un fétiche/factice. Il dissimule Louis Hébert (ou Champlain) comme l’Angleterre de l’abbé Surprenant dissimule la vache canadienne (et les Filles du Roy). L’Indien et l’Anglais sont de ces parents nobles inventés par nos écrivains pour avillir une France «barbare» et un État canadien désavoué. Mais ils ne sont qu’un produit de substitution afin de cacher la parenté roturière et humiliante d’un colon exploité par les siens et de sa vache corrompue par des accouplements dégradants.50 Pour mythologique, belle ou poétique que soit la métaphore, elle est de la même nature et de la même substance que tout ce qui est produit de notre haine de soi depuis 1838.
Mais pourquoi alors l’Amérindien ne peut-il jouer ce rôle affectif paternel ou identificatoire que nos auteurs voudraient tant lui attribuer mais dont les structures significatives rejettent viscéralement l’idéal pour entretenir ce colon pouilleux et cette vache dégénérée? Est-ce une question de racisme? Sûrement pas, car ce serait croire que notre répulsion de l’Amérindien est structurelle alors que nous ne cessons de le convoiter, de l’idéaliser. L’origine du rejet de l’Amérindien doit être cherchée ailleurs, non dans une structure symbolique mais dans une conjoncture relationnelle, rencontre traumatisante que nous avons de la difficulté à dégager de son hypothèque affective. La haine que nous lui portons est refoulée de la même manière que celle que nous portons à l’Anglais. Mais tandis que le rapport que nous entretenons avec l’Anglais est clair, celui que nous entretenons avec l’Amérindien demeure obscur. L’Anglais est celui qui nous a vaincu tandis que nous ne sommes jamais arrivés à vaincre définitivement l’Amérindien. Un composé de culpabilité masochiste et de comportement de colonisé nous empêche de mettre les choses au clair avec lui, ou, si nous préférons, notre statut de colonisé rompu sous le lourd fardeau de deux siècles de domination étrangère se révèle davantage à notre sensibilité que le statut de colonisateur dont on ne se rappelle plus à quelle occasion il nous est arrivé de porter triomphalement le chapeau. Nous souhaiterions que l’Amérindien soit notre partenaire, mais bientôt ses réactions nous apparaissent empreintes d’hostilité et de dégoût à notre égard. Nous avons formé avec lui un couple de mutuelle ignorance qui vaut à lui seul toutes les «deux solitudes» qui hantent notre littérature. Au lieu de mépriser comme Ferron la résurrection cléricalo-nationaliste de Dollard, que le clergé a récupéré pour évacuer la défaite des Patriotes et la mort de Chénier tué par les Anglais dans l’Église de Saint-Eustache en 1837, plongeons dans la plaie vive.
 Affirmons notre hypothèse: c’est parce que nous tenons les Indiens, et plus particulièrement les Mohawks de Kanesatake
et de Kenawake, responsables de la trahison des Patriotes, que notre
rancune à leur égard est tenace. Derrière l’identité des lieux
historiques (le Long-Sault n’est pas tellement loin de l’actuelle
réserve d’Oka comme nous l’avons déjà souligné) et l’alliance
traditionnelle de l’Anglais et de l’Iroquois dans les luttes pour la
suprématie coloniale en Amérique du Nord, il y a l’épisode tabou du 29
novembre 1837, quand les Rebelles Girod et Chénier accompagnés de 180 hommes se rendent piller un magasin de munitions de la Compagnie de la Baie d’Hudson. N’y trouvant pas le
Affirmons notre hypothèse: c’est parce que nous tenons les Indiens, et plus particulièrement les Mohawks de Kanesatake
et de Kenawake, responsables de la trahison des Patriotes, que notre
rancune à leur égard est tenace. Derrière l’identité des lieux
historiques (le Long-Sault n’est pas tellement loin de l’actuelle
réserve d’Oka comme nous l’avons déjà souligné) et l’alliance
traditionnelle de l’Anglais et de l’Iroquois dans les luttes pour la
suprématie coloniale en Amérique du Nord, il y a l’épisode tabou du 29
novembre 1837, quand les Rebelles Girod et Chénier accompagnés de 180 hommes se rendent piller un magasin de munitions de la Compagnie de la Baie d’Hudson. N’y trouvant pas le  butin
espéré, Girod «eut encore moins de succès avec les Indiens lorsqu’il
voulut leur emprunter leurs fusils et deux petits canons. Toute sa ruse
ne parvint pas à convaincre les chefs qui semblaient même tellement
décidés à ne pas céder qu’il n’osa pas insister.»51 À défaut de pouvoir
maugréer notre haine de l’Anglais, le vrai vainqueur, notre rancune
s’est portée sur l’Amérindien mais toujours sans nous l’avouer, pas plus
que nous n’osions avouer intellectuellement notre haine du Juif.
butin
espéré, Girod «eut encore moins de succès avec les Indiens lorsqu’il
voulut leur emprunter leurs fusils et deux petits canons. Toute sa ruse
ne parvint pas à convaincre les chefs qui semblaient même tellement
décidés à ne pas céder qu’il n’osa pas insister.»51 À défaut de pouvoir
maugréer notre haine de l’Anglais, le vrai vainqueur, notre rancune
s’est portée sur l’Amérindien mais toujours sans nous l’avouer, pas plus
que nous n’osions avouer intellectuellement notre haine du Juif. Mais
les choses ne s’arrêtent pas là. La non participation des Amérindiens
d’Oka à la Rébellion de 1837 se double d’un acte considéré comme
relevant de l’ignoble, de la traîtrise. Lors des troubles de l’hiver
1838 un parti de Patriotes décida de s’emparer des armes des Iroquois de
Kanawake. Gérard Filteau raconte ainsi ce second échec encore plus
humiliant que la rebuffade d’Oka: «Restait à s’emparer des armes des
Sauvages de Caughnawagha. Au milieu de la nuit [du 4 novembre 1838],
Cardinal partit à la tête d’une bande d’environ 75 Patriotes
dont 36 avaient des fusils. Ils arrivèrent près de la réserve au lever
du soleil. C’était un dimanche matin et la plupart des Indiens étaient à
l’église. Les Patriotes se cachèrent dans les broussailles, tandis que
cinq d’entre eux, Cardinal, Duquette, Lepailleur et deux autres,
prenaient les devants pour tenter de se procurer des armes au moyen
d’une ruse. Ils étaient à parlementer avec quelques Sauvages, soi-disant
pour emprunter leurs fusils, lorsqu’une Squaw, partie à la recherche
d’une vache, tomba au milieu des Patriotes embusqués et s’enfuit
aussitôt, effarée, raconter aux chefs ce qu’elle avait vu. Les Indiens
désireux de s’attirer les bonnes grâces du gouvernement, quittèrent
aussitôt le service divin, s’armèrent en hâte tout en se consultant. Les
chefs décidèrent d’attirer les Patriotes dans le village et de les
arrêter. Quelques Sauvages leur furent délégués et leur laissèrent
croire qu’il y aurait moyen de s’entendre avec les chefs s’ils voulaient
venir les rencontrer au village. Les Patriotes donnèrent dans le
panneau et s’élancèrent sans défiance. Pendant ce temps, une quarantaine
de sauvages bien armés s’étaient dissimulés sur leur route. Sur l’ordre
des chefs, ils s’élancèrent en poussant le cri de guerre
Mais
les choses ne s’arrêtent pas là. La non participation des Amérindiens
d’Oka à la Rébellion de 1837 se double d’un acte considéré comme
relevant de l’ignoble, de la traîtrise. Lors des troubles de l’hiver
1838 un parti de Patriotes décida de s’emparer des armes des Iroquois de
Kanawake. Gérard Filteau raconte ainsi ce second échec encore plus
humiliant que la rebuffade d’Oka: «Restait à s’emparer des armes des
Sauvages de Caughnawagha. Au milieu de la nuit [du 4 novembre 1838],
Cardinal partit à la tête d’une bande d’environ 75 Patriotes
dont 36 avaient des fusils. Ils arrivèrent près de la réserve au lever
du soleil. C’était un dimanche matin et la plupart des Indiens étaient à
l’église. Les Patriotes se cachèrent dans les broussailles, tandis que
cinq d’entre eux, Cardinal, Duquette, Lepailleur et deux autres,
prenaient les devants pour tenter de se procurer des armes au moyen
d’une ruse. Ils étaient à parlementer avec quelques Sauvages, soi-disant
pour emprunter leurs fusils, lorsqu’une Squaw, partie à la recherche
d’une vache, tomba au milieu des Patriotes embusqués et s’enfuit
aussitôt, effarée, raconter aux chefs ce qu’elle avait vu. Les Indiens
désireux de s’attirer les bonnes grâces du gouvernement, quittèrent
aussitôt le service divin, s’armèrent en hâte tout en se consultant. Les
chefs décidèrent d’attirer les Patriotes dans le village et de les
arrêter. Quelques Sauvages leur furent délégués et leur laissèrent
croire qu’il y aurait moyen de s’entendre avec les chefs s’ils voulaient
venir les rencontrer au village. Les Patriotes donnèrent dans le
panneau et s’élancèrent sans défiance. Pendant ce temps, une quarantaine
de sauvages bien armés s’étaient dissimulés sur leur route. Sur l’ordre
des chefs, ils s’élancèrent en poussant le cri de guerre  et
entourèrent les Patriotes. Ceux-ci durent se rendre. Quelques-uns
parvinrent à s’échapper à la faveur du désordres, mais 64 restèrent aux
mains des Sauvages qui les conduisirent à Lachine, puis à Montréal où on
les reçut en triomphe. L’insurrection à Châteauguay ainsi décapitée de
ses chefs se trouva virtuellement matée et ce, moins d’une journée après
son début.»52 Il y a de tout dans ce paragraphe : l’aliénation
culturelle des Amérindiens à l’Église et au clergé (l’ombre noire
veille), la tactique de guérilla tant vantée par Léandre Bergeron (et
qui se trouvera trahie), la Squaw qui tient un rôle semblable à celui de
Laura Secord qui avait employé une ruse identique pour avertir les
soldats anglais de l’approche de l’armée américaine en 1813, la vache de
Ferron (bien canadienne), les Amérindiens «colonisés jusqu’à en
crever», et qui veulent «s’attirer les bonnes grâces du gouvernement»,
le cri de guerre, résonance de celui poussé par les Iroquois à l’assaut
du Long-Sault en 1660, enfin l’insurrection «décapitée» (inutile de
remonter à l’exécution de Louis XVI comme le fait Weinemann) et, pour
terminer, le fait que ce sont les Patriotes tombés dans l’embuscade
tendue par les chefs de Kanawake qui seront pendus à la prison au Pied-du-Courant après la justice expéditive de Colborne…
et
entourèrent les Patriotes. Ceux-ci durent se rendre. Quelques-uns
parvinrent à s’échapper à la faveur du désordres, mais 64 restèrent aux
mains des Sauvages qui les conduisirent à Lachine, puis à Montréal où on
les reçut en triomphe. L’insurrection à Châteauguay ainsi décapitée de
ses chefs se trouva virtuellement matée et ce, moins d’une journée après
son début.»52 Il y a de tout dans ce paragraphe : l’aliénation
culturelle des Amérindiens à l’Église et au clergé (l’ombre noire
veille), la tactique de guérilla tant vantée par Léandre Bergeron (et
qui se trouvera trahie), la Squaw qui tient un rôle semblable à celui de
Laura Secord qui avait employé une ruse identique pour avertir les
soldats anglais de l’approche de l’armée américaine en 1813, la vache de
Ferron (bien canadienne), les Amérindiens «colonisés jusqu’à en
crever», et qui veulent «s’attirer les bonnes grâces du gouvernement»,
le cri de guerre, résonance de celui poussé par les Iroquois à l’assaut
du Long-Sault en 1660, enfin l’insurrection «décapitée» (inutile de
remonter à l’exécution de Louis XVI comme le fait Weinemann) et, pour
terminer, le fait que ce sont les Patriotes tombés dans l’embuscade
tendue par les chefs de Kanawake qui seront pendus à la prison au Pied-du-Courant après la justice expéditive de Colborne…Ce comportement des Autochtones d’Oka et de Caughnawagha se compare à l’action des Hurons et des Algonquins réfugiés avec Dollard au Long-Sault et qui s’enfuirent dans les bras des Iroquois, poussés par la terreur, trahissant le petit nombre des défenseurs du fortin. En ce sens, il serait bien futile de croire à la crédibilité de l’Amérindien comme symbole du Bâtard libérateur. Il est trop loin désormais de cette arrogance que manifestait le chef sauteux Minweweh lorsqu’il déclarait aux Britanniques, peu après la Conquête de 1760: «Même si vous avez conquis les Français, vous ne nous avez pas conquis. Nous ne sommes pas vos esclaves. Ces lacs, ces forêts et ces montagnes nous ont été laissés par nos ancêtres. Ils constituent notre héritage; et nous ne les céderons à personne.»53 Mais voici que les Patriotes invitent l’Amérindien à faire sauter le joug de la colonisation britannique; dans l’article 3 de la Déclaration d’Indépendance du Bas-Canada, ils proposent que «tous les citoyens auront les mêmes droits» et que «les sauvages cesseront d’être sujets a aucune disqualification civile quelconque, et jouiront des mêmes droits que les autres citoyens de l’État du Bas-Canada,54 et il réplique en se faisant le valet de l’autorité militaire! Le voilà enfoncé encore plus loin que le commun des cocus colonisés canadiens-français dans son «roman familial» de l’Enfant trouvé. La condescendance des discours des années soixante cherchait moins à le présenter comme un modèle de fierté indépendante qu’à le disculper de ses lâchetés et de sa trahison envers les Rebelles, expliquant (implicitement) cet acte peu glorieux par la déculturation qu’il a subie et dont nous serions les seuls responsables! Si, en 1760, «ce ne sont pas les Indiens qui ont été conquis», ceux-ci, en 1837-1838, se comportent bien en esclaves et en domestiques. Qu’importent les justifications et les explications fournies par l’anthropologie, le seul souvenir du fait rappelle inconsciemment que le «noble sauvage» s’est comporté ces jours-là d’une manière bien peu autonome et fière: il avait la légitimité de refuser son aide aux Patriotes sans s’abaisser pour autant à l’humilier et à le livrer comme du bétail à l’autorité britannique coloniale! En faisant cocus les Patriotes, l’Amérindien s’auto-sodomisait avec le bâton de commandement du général Colborne. Complice de notre ennemi par infantilisme et sou-mission, on lui doit un chien de notre chienne et les bouffonneries de l’été 1990 n’ont fait que nous le rendre encore plus odieux. Il est un instrument parfait de notre haine de soi et le jour où notre masochisme pourrait se transformer en sadisme, son protecteur canadien le laissera tout simplement tomber, le réel historique étant cyniquement cruel en soi.
Le refus de reconnaître et d’assumer notre haine de l’Amérindien est la cause première de ce blocage et l’idéalisation qu’en ont fait Ferron, Bergeron, Beaulieu et consorts n’a pas réussi, bien au contraire, à éclaircir notre relation avec les «vrais» Amérindiens. Reconnaître notre haine de l’Autochtone, c’est s’avouer d’abord ce que nous avons à lui reprocher et s’expliquer sa conduite sans chercher à l’excuser ni à lui vouer une confiance condescendante. Un mépris sincère serait plus souhaitable. Refuser la haine de soi consiste d’abord à assumer sa haine de l’Autre non pas afin de la masquer mais de la bien dominer, et admettre que chacun agit dans des intérêts qui lui sont propres et que la meilleure coopération demeure toujours le chacun pour soi dans un respect mutuel des intérêts de tous. Cela demande beaucoup, beaucoup -d’éducation. Certes, le danger du racisme existe toujours, mais il peut être mieux contrôlé lorsqu’on le reconnaît comme tel et qu’on n’essaie pas de le nier par fausse amabilité. Apprendre à affronter les frictions et se faire respecter selon ses besoins vaudra toujours mieux que de concéder la victoire sans combattre et retourner nos frustrations contre nous-mêmes. Ce sera toujours plus «mature» que négocier avec des «braves» guerriers mohawks masqués à la Lasagne ou d’échapper malgré soi une vilaine remarque sur «les vieilles maudites anglaises de chez Eaton»!
Mais l’inconscient collectif demeure toujours rebelle à ce genre de prise de conscience qui exige que l’on assume ses répulsions. Le reproche couve sous d’apparents sourires amicaux. Voilà la grande hypocrisie. Au moment où le «roman familial» passait de la dégradation parentale à la prise en main par le Bâtard de son propre destin, la situation se retourne contre lui et il se réveille comme avorton né de l’accouplement du misérable colon Louis Hébert et de la vache canadienne. Par la trahison ressentie et l’humiliation venant à la fois du vainqueur (l’Anglais) et de l’à-moitié-vaincu (le Sauvage), la souveraineté du Patriote devient la dépendance du handicapé. Cette distance sépare la première de la dernière page des Historiettes de Ferron. Ouvertes sur l’affirmation des prétentions du Bâtard, valeureux et courageux, le livre de Ferron se termine sur un avorton génial mais incompris. Incompris non parce que génial, mais parce que handicapé: «La révolte de 37 avait été de bon profit : de peu de pendus nous avions tiré beaucoup de héros; et, souvenir impérissable, nous nous étions manifestés pour la première fois, la fois fameuse entre toutes, celle dont on ne revient pas, que l’on soit peuple, fille ou garçon. Cette révolte ne nous appartenait pas en propre; le Haut-Canada avait même eu plus de pendus que nous. Mais c’était là de mauvais pendus; ils en étaient morts plus ou moins. Tandis que les nôtres, bien soignés, se portaient à merveille. Et l’on finit, comme pour l’électricité, par nationaliser l’événement (F.9).» Le Haut-Canada, qui n’était qu’un district pour Léandre Bergeron, ne pouvait sécréter que des rebelles; le Bas-Canada, qui était une colonie, se devait de sécréter des Patriotes. En ce qui a trait au génie, l’échec des Patriotes ne pouvait générer un Hugo ou un Michel-Ange, mais un Paul-Émile Borduas: «Changeant sa manière de peindre, il a fait un grand brouhaha qui a étonné le pays. Refus global de la situation existante, recours aux puissances cosmiques précédant toute civilisation, aux influences telluriques et à l’amour fou. Un délire extravagant et laborieux dont je rigolais. Borduas décapait sa toile pour recommencer à neuf. Un petit homme poli, avec un dentier qui le gênait, un petit monsieur chauve qui s’était fait enlever l’estomac parce qu’il avait des ulcères. Et c’était ça qui vivait la révolution de tout un monde pour changer sa peinture! Cette emphase m’étonnait. Je ne connaissais rien à l’art. Aujourd’hui je ne rigole plus (F.179).»
Bergeron ne rigole pas non plus lorsqu’il trace les portraits de tous ces traîtres qui sont autant de métaphores historiques de l’avorton redevenu Enfant trouvé. Dès le régime anglais, Carleton fuit Montréal «déguisé en habitant, évidemment (B.66)», et la trahison devient le lot du commun des Rebelles vaincus: Georges-Etienne Cartier «vendra le Québec à Ottawa (B.94)»; Papineau «ne sait pas assumer le leadership du mouvement révolutionnaire (B.94)», il «trahit […] la cause du peuple québécois (B.95).» Autre «vendu» qu’est ce Hippolyte Lafontaine (B.97) tandis que Mgr Bourget, qui «avait lui aussi des sympathies patriotes» ne les manifestait pas (B.97). Lafontaine, encore, «publie un manifeste où il accepte de lécher les bottes anglaises (B.118).» On peut toujours parler des «mani-gances» de Sydenham (B.118), mais ce n’est rien à côté de ce déversement de bile haineuse qui inonde les anciens rebelles, les anciens libéraux, les anciens Patriotes réconciliés avec leur oppresseur.
Avec Georges-Etienne Cartier – «vendu qu’il était à la bourgeoisie anglaise, il avait le rôle de faire avaler la Confédération aux Canayens qu’il avait l’audace d’appeler ses compa-triotes (B.130)» –, le clergé reste le traître par excellence: «Si le peuple canayen a survécu c’est malgré le clergé qui, lui, était prêt aux pires trahisons nationales pour conserver sa domination (B.136)»; «le clergé instaurait un régime théocratique et enfermait le peuple canadien dans les catacombes de l’Histoire pour un siècle à venir (B.139).» Après les lâchetés de Papineau, les bassesses de Lafontaine et la corruption de Cartier, Wilfrid Laurier apparaît comme un condensé de toutes ces abjections de soi. «Non, Laurier était de cette race de petits bonshommes qui exploitent les gestes et même la mort des autres, pour se faire du capital politique (B.163).» Honoré Mercier «lui aussi exploite à des fins toutes personnelles le meurtre de Riel (B.164).» «Un conservateur canayen, le vendu Philippe Landry, dépose une motion de profond regret pour l’exécution de Riel. En d’autres mots, les tueurs disaient qu’ils regrettaient d’avoir tuer [sic!] Riel (B.165).» Comble de cynisme, Laurier, vampire de Riel, relaie Cartier: il devient «ce vendu par excellence (B.165).» La corruption de ces hommes finit par révéler l’opportunisme hâbleur à la base de leur engagement politique: «Aux élections de 1892, le parti national bâti sur l’échafaud de Riel, s’effondre dans la corruption politique la plus abjecte. Pacaud et Mercier devaient subir leur procès un peu après (B.168).» Enfin, ce qui intéresse Laurier «ce n’est pas de protéger les Canayens contre la domination anglaise. C’est de gouverner un pays d’une mer à l’autre au nom de la Reine Victoria (B.170).» Pour Bergeron, c’est toute la validité et la légitimité de la Rébellion de 1837-1838 qui sont remises en cause.
Après cela, comment s’étonner de voir Bergeron mentionner la pègre comme étant ce «frère infirme qu’on cherche à cacher (B.226)»! L’auteur emploiera ici l’insulte de «concierge» pour dédaigner les gouvernements canadiens et québécois. Son utilisation dénote un mépris certain de l’auteur pour ces salariés au travail productif dont il prétend faire l’éducation. Les gouvernants provinciaux sont tous ainsi affublés du vocable méprisant pour souligner ce que Ferron dénonçait déjà chez Maisonneuve: la lâcheté, l’hypocrisie, la malhonnêteté: «les gouvernements provinciaux ont des pouvoirs pour la plupart insignifiants, des pouvoirs de concierge (B.144)»; «il est clair que le gouvernement provincial n’était qu’un concierge pour les capitalistes anglo-saxons (B.186)»; «Lomer Gouin qui est tout heureux de servir comme roi-nègre au fédéral (B.190)» se voit lâché par King qui «appelle Ernest Lapointe qui accourt comme un chien fidèle (B.190).» Du premier minis-tre Taschereau, Bergeron dit que «les financiers anglais lui graissent les pattes et il devient leur concierge (B.191)», ce qui n’empêche pas de considérer le gouvernement fédéral aussi comme concierge des américains: «Le gouvernement fédéral est un gouvernement-concierge pour les exploiteurs américains. Le gouvernement provincial fait de même. Les gouvernements fédéral et provincial sont des concierges élus par le peuple pour servir les monopoles industriels et financiers qui viennent nous voler nos richesses naturelles (B.205).» Ce sont eux qui avilissent la vache canadienne! Ces figures pater-nelles dégradées propres au «roman familial» de l’Enfant trouvé sont autant de symboles d’avortons issus de la Rébellion manquée. Ils ne sont plus que des misérables, tout juste bons à faire des concierges chargés des basses besognes telles ramasser les matières abjectes, rebus de la société québécoise toute entière: «le gouvernement concierge construit des routes… Les concierges gardent le perron propre pour les exploiteurs internationaux (B.192).» L’abondance de ces vendus, de ces traîtres et de ces concierges confine à la nausée.
Si les hommes politiques sont les concierges, le clergé tient la place du portier : «Le clergé prenait en mains nos destinées, écrit Ferron. Ce n’était pas le grand choléra. Le peuple canadien-français ne disparut pas pour autant (F.15).» Moins sévère pour les libéraux québécois que Bergeron, Ferron, pour l’inauguration du monument Chénier et à propos de son projet de ministère de l’Éducation, nuance la personnalité du premier ministre Félix-Gabriel Marchand en soulignant qu’il «mourut […] convenablement, avec toutes ses facultés. Son principal adversaire, Mgr Bruchési, lui, est mort fou (F.21).» Tandis que pour Bergeron, le clergé est le traître parfait, le roi-nègre par excellence, Ferron lui découvre des intentions louables: «Que voulaient-ils au juste, ces clercs? Le savaient-ils eux-mêmes? Reconstituer le Moyen Âge? Repartir théocratie avec boutique de scapulaires à chaque coin de rue? En tout cas, une chose certaine : ils voulaient être les seuls à exercer le pouvoir sur la terre comme dans les cieux (F.24).»
Ferron entrevoit partout le clergé comme un instrument bien réel de notre haine de soi, de ce misérablisme que déve-loppera Victor-Lévy Beaulieu. Ainsi, lorsqu’il parle du sort réservé au notable Rodolphe Girard, auteur de Marie Calumet, «repoussé du côté anglais», c’est-à-dire vers Ottawa et le poète Nelligan, interné chez «les fous», à la Longue-Pointe, il rappelle comment le clergé fut notre éteignoir de l’instruction populaire, antilibéral et antiprogressiste, ultramontain et papolâtre, il «maintint ses positions jusqu’à la dernière guerre. Il s’était opposé à l’instruction obligatoire. Et ce fut encore d’Ottawa, par paradoxe, que nous vint la lumière. Le père King était malin: il contourna les théologiens. Il donnait les allocations familiales à une petite condition: la fréquentation scolaire. C’était plus fort que la loi divine. L’instruction obligatoire fut votée en 1942, un siècle après la Suède (F.26).» Le père King, petit père Combes de la laïcisation de l’éducation au Québec! On n’en est pas à une ironie près. L’aboutissement de cette mesure, de la loi provinciale de l’instruction obligatoire, fut le création d’un véritable Ministère de l’Éducation lors de la Révolution tranquille. Pour Ferron, tout ce processus vise non pas à évacuer complètement le clergé de l’éducation (il pense à ses Jésuites), mais plutôt à le mettre à sa place. «Ils nous accepteront en tant que citoyens et nous les accepterons de même. Ils ont tenté de nous perdre, et bien! si jamais nous nous sentions perdus, comme ils sont très vulnérables, nous ne pourrions pas résister au sale plaisir de leur rendre la pareille, qu’ils le sachent bien (F.27-28)!» Bref, jamais plus le clergé ne sera autorisé à pratiquer la prise Parmanda à ses ouailles.
Le repos cadavérique
Mais rien n’empêchera d’autres instances, d’autres institutions de prendre le relais du clergé. Quelque chose de plus odieux que les mesures politiques permettait jadis au clergé de contrôler l’univers symbolique de la population québécoise. Ainsi, Victor-Lévy Beaulieu associe plus directement le rôle du clergé à notre «névrose collective: la grande période de notre névrose couvra un siècle, atteint son apogée entre les années 1900 et 1940 et va comme un gant au système qui l’a fait naître et éclore comme une odieuse fleur noire (VLB. 30).» Née du fanatisme, l’Église est, à ses yeux, impérialiste et opprimante: «Pendant que des peuples entiers crevaient de faim, que faisait l’Église? Elle ne faisait qu’ajouter un peu plus à l’exploitation de l’homme par l’homme: elle inventait la torture, Torquemada, les bûchers et la mort. Elle détruisait les forces vives du monde, faisant chanter Galilée, assassinant Giordano Bruno et Savonarole, brûlant ces sorciers et ces sorcières qui n’avaient que la mauvaise grâce de ne pas parler comme elle avec deux serpents dans les yeux (VLB.57).
Ferron avait déjà évoqué, dans ses Historiettes le cas d’Urbain Grandier et de la possession de Loudun. Beaulieu, lui, ne fait qu’accumuler des clichés où se mêlent des personnages bigarrés sans penser à les approfondir. «Tout le sado-masochisme religieux québécois de notre grande noirceur. Être une hostie vivante, aimer la beauté de la vie souffrante, accepter joyeusement la douleur, vivre plus intensément malade que bien portant, que voilà des expressions entendues souvent (VLB.128).» Pour lui, c’est le signe du «rétrécissement» de la collectivité québécoise: «Il y a des sociétés qui évoluent vers un rétrécissement d’elles-mêmes, qui tournent contre elles-mêmes leurs forces vives, dans une aberration destructive. C’est un peu ce qui s’est passé au Québec, parti-culièrement de 1850 à 1950, au nom de la survivance française et catholique. L’autorité de l’Église était excessive, son pouvoir immense. Mais l’Église a été incapable de donner un véritable sens à son pouvoir (VLB.153).» Par son exposé, Victor-Lévy Beaulieu tend la main aux idées de Bouthillette: «Y a-t-il un peuple sur terre qui se soit plus flagellé que le nôtre! Il y a en nous une sorte de joie secrète, morbide, à nous diminuer, à nous ravaler comme si nous étions marqués au fer rouge de la malédiction. La haine qu’inconsciemment nous nous portons à pris souvent l’ampleur d’un masochisme national.»55
L’erreur de Beaulieu serait de croire que le clergé reste l’acteur principal de cette aberration alors qu’il n’en est que le metteur en scène: «Car il ne faut pas rire de tous ces gens avec lesquels on a voulu faire des saints ou des héros de la vie spi-rituelle. À la lecture de toutes ces biographies écrites sur nos mystiques et nos martyrs, on ne peut qu’être rempli d’une belle tristesse, à laquelle s’ajoute une sourde colère pour les curieux individus qui les ont rédigées (VLB.155).» La tristesse est belle mais la colère est sourde! La nostalgie l’emporte sur la révolte, le ressassement sur l’indignation. Pour ne pas voir l’action de la haine de soi, Beaulieu devient, à son tour, l’artisan de la perpétuation de cette haine à travers la fantasmatique de ses «archétypes».
Une certaine complaisance dans le misérabilisme se dégage de son manuel, misérabilisme qui, bien que basé sur des faits réels, apparaît ici onirique, comme dans les contes de fées: «…les terres défrichées dans la p’tite misère sont retournées à l’état sauvage: après que le pauvre monde se fut usé à les essoucher, à les défardocher, à les errocher, le gouvernement, aujourd’hui, les reboise. Quel gaspillage! Que de vies perdues! Que de sueurs pour rien! En vingt-cinq ans, les pays québécois se sont rapetissés : quelques villes, quelques banlieues, quel-ques petits villages de chômeurs et la boucle est bouclée. L’éclatement du rêve et son amenuisement (VLB.30).» Et Beaulieu n’avait encore rien vu! Depuis, l’homme qui a mis la clé dans Shefferville, la fierté des manuels de géographie de ma petite enfance, la met aujourd’hui dans le Canada au complet! Beaulieu dénonce notre trahison de Louis Hébert et de sa vache
 canadienne,
Enfant trouvé que nous sommes, prêts à toutes les compromissions pour
reconstituer l’idylle de la prime enfance. Pour Beaulieu, le
rétrécissement de l’espace québécois renvoie au rapetissement de
l’esprit et, éventuellement, au racourcissement de la durée de vie – et
de l’existence nationale; car le «rapetissement de l’espace québécois»
est le «synonyme de rapetissement de la vie (VLB.30).» Il donne bien la
juste qualité de cet univers décrié par Ferron et Bergeron; le Québec
des clercs nationaux, Québec sordide et misérable. Misérable comme l’est
le milieu où évoluent les personnages de Marie-Claire Blais, sordide
comme le sont les films de Pierre Patry. Un siècle après l’homélie de Mgr de Nancy faite devant nos ancêtres où il leur prêchait: «Vous êtes donc tous des mourants (VLB.67)», un poète
canadienne,
Enfant trouvé que nous sommes, prêts à toutes les compromissions pour
reconstituer l’idylle de la prime enfance. Pour Beaulieu, le
rétrécissement de l’espace québécois renvoie au rapetissement de
l’esprit et, éventuellement, au racourcissement de la durée de vie – et
de l’existence nationale; car le «rapetissement de l’espace québécois»
est le «synonyme de rapetissement de la vie (VLB.30).» Il donne bien la
juste qualité de cet univers décrié par Ferron et Bergeron; le Québec
des clercs nationaux, Québec sordide et misérable. Misérable comme l’est
le milieu où évoluent les personnages de Marie-Claire Blais, sordide
comme le sont les films de Pierre Patry. Un siècle après l’homélie de Mgr de Nancy faite devant nos ancêtres où il leur prêchait: «Vous êtes donc tous des mourants (VLB.67)», un poète  de
la génération des années soixante et un sculpteur qui en a tiré une
murale, fort mal appréciée d’ailleurs, répondaient: «Vous êtes pas
écœurés de mourir, bande de caves? C’est assez!» Le sculpteur est mort
quelques années plus tard et le poète s’est fait faire, dans une crise
aiguë de narcissisme, une vasectomie…
de
la génération des années soixante et un sculpteur qui en a tiré une
murale, fort mal appréciée d’ailleurs, répondaient: «Vous êtes pas
écœurés de mourir, bande de caves? C’est assez!» Le sculpteur est mort
quelques années plus tard et le poète s’est fait faire, dans une crise
aiguë de narcissisme, une vasectomie…«C’est tragique, tout cela, cette glorification de la mort par défaut de pouvoir vivre une vie normale (VLB.128)», écrit Beaulieu. Le curé biographe du petit Gérard Raymond dit de lui qu’«il est mort martyr de désir (VLB.166)»! Désir du mourir de ne pas vivre? Désir de mourir de vivre? Vivre du désir de mourir? Vivre de mourir de désir? Mourir de vivre de désir? Mourir de désir de vivre? De
 quelque
manière qu’on retourne la question, on en arrive à une «consomption»
chronique, non pas une assomption, comme chez les vrais mystiques, mais à
une consumation, un feu ardent intérieur, angoissant, obsédant,
inextinguible, qui dévore jusqu’à en mourir tout l’Être des gens qui ne
peuvent «vivre une vie normale». C’est-à-dire être heureux d’être en
vie, tout simplement. De faire quelque chose avec sa vie qui soit autre
chose qu’une stratégie de survie en attente prolongée de la mort.
Survivre à tout prix, même au prix de la vie elle-même; survivre jusqu’à
tuer la vie qui cherche à émerger en nous. Combien tragique est ce
diagnostic de Jeanne Lapointe, paru dans Le Devoir (15 novembre 1955):
«Notre évolution historique locale, crispée dans sa volonté de
survivance et par son jansénisme théocentrique, nous a peu à peu vidés
du goût de la vie. Notre raison de vivre a été la survivance; maintenant
que nous survivons, nous n’en voyons plus les raisons. Nous vivons sans
aimer la vie; elle ne nous intéresse pas; nous ne savons qu’en faire.
Nous subsistons, mais sans raison d’être. C’est à un tournant semblable
qu’il arrive à certains de se démettre de la vie.» 56 Beaulieu, lui, se
révolte, s’indigne, avec raison. Voilà pourquoi, de la tempérance au
sanatorium, de l’intempérance aux petits martyrs, des colons miséreux
aux missionnaires appelés à l’oblation totale au pôle Nord ou en
Afrique, des «archétypes» de Beaulieu, l’imaginaire des écrivains et des
artistes des années soixante ne parvient pas à se libérer, ni à sortir
de ce mal-être qui se nourrit de nos fantasmatiques. Avec Jean
Bouthillette, ils parlent de ce «nous que la dépendance économique a
longtemps cantonné dans le petit monde fermé de la famille, de l’école,
de l’épicerie du coin et de la politique provinciale. Notre langue est
devenue réserve dans la réserve.»57 Et le rétrécissement de se prolonger
de ce petit univers en un encore plus petit et qu’on appelle le
sanatorium, celui des enfants morts prématurément et dont des laudateurs
écrivent la biographie édifiante. Enfin, le rapetissement moral de tout
ce monde se retrouve dans une existence qui risque de se terminer un
peu comme ce qui arrive à cet agriculteur-musicien qui meurt de ne
pouvoir plus jouer de sa clarinette alors qu’il vient de perdre son bras
coincé dans un instrument aratoire: «Mais monsieur Lapierre le voyant
tout couvert de sang lui dit: “Regardez, je crois que c’est… c’est votre
bras.” Et il n’eut pas le temps de finir, que Joseph s’écria : “Mon
Dieu!… Mon Dieu!… mais c’est… mon bras!” Il lança un cri déchirant de
désespoir en disant : “Je ne pourrai plus jouer ma clarinette! O mon
Dieu! Que vais-je devenir! Que vais-je devenir sans mon bras?” Il
pleurait comme un enfant!… et il disait: “Je ne pourrai plus jouer ma
clarinette!… ma clarinette!” (VLB.227-228).» Ce pathétique,
«abjectogène», qui oserait croire qu’il sécrète encore en nous, dedans
chacun de nous, comme dedans toute la collectivité québécoise: «Il
pleurait comme un enfant». Un enfant qui a perdu moins un membre ou un
symbole incons-cient de sa virilité que l’accès, rendu désormais
inaccessible, à son univers idyllique. Pas étonnant que le titre du
dernier livre présenté dans l’anthologie de Victor-Lévy Beaulieu porte:
la fin du monde (VLB.243-251)!
quelque
manière qu’on retourne la question, on en arrive à une «consomption»
chronique, non pas une assomption, comme chez les vrais mystiques, mais à
une consumation, un feu ardent intérieur, angoissant, obsédant,
inextinguible, qui dévore jusqu’à en mourir tout l’Être des gens qui ne
peuvent «vivre une vie normale». C’est-à-dire être heureux d’être en
vie, tout simplement. De faire quelque chose avec sa vie qui soit autre
chose qu’une stratégie de survie en attente prolongée de la mort.
Survivre à tout prix, même au prix de la vie elle-même; survivre jusqu’à
tuer la vie qui cherche à émerger en nous. Combien tragique est ce
diagnostic de Jeanne Lapointe, paru dans Le Devoir (15 novembre 1955):
«Notre évolution historique locale, crispée dans sa volonté de
survivance et par son jansénisme théocentrique, nous a peu à peu vidés
du goût de la vie. Notre raison de vivre a été la survivance; maintenant
que nous survivons, nous n’en voyons plus les raisons. Nous vivons sans
aimer la vie; elle ne nous intéresse pas; nous ne savons qu’en faire.
Nous subsistons, mais sans raison d’être. C’est à un tournant semblable
qu’il arrive à certains de se démettre de la vie.» 56 Beaulieu, lui, se
révolte, s’indigne, avec raison. Voilà pourquoi, de la tempérance au
sanatorium, de l’intempérance aux petits martyrs, des colons miséreux
aux missionnaires appelés à l’oblation totale au pôle Nord ou en
Afrique, des «archétypes» de Beaulieu, l’imaginaire des écrivains et des
artistes des années soixante ne parvient pas à se libérer, ni à sortir
de ce mal-être qui se nourrit de nos fantasmatiques. Avec Jean
Bouthillette, ils parlent de ce «nous que la dépendance économique a
longtemps cantonné dans le petit monde fermé de la famille, de l’école,
de l’épicerie du coin et de la politique provinciale. Notre langue est
devenue réserve dans la réserve.»57 Et le rétrécissement de se prolonger
de ce petit univers en un encore plus petit et qu’on appelle le
sanatorium, celui des enfants morts prématurément et dont des laudateurs
écrivent la biographie édifiante. Enfin, le rapetissement moral de tout
ce monde se retrouve dans une existence qui risque de se terminer un
peu comme ce qui arrive à cet agriculteur-musicien qui meurt de ne
pouvoir plus jouer de sa clarinette alors qu’il vient de perdre son bras
coincé dans un instrument aratoire: «Mais monsieur Lapierre le voyant
tout couvert de sang lui dit: “Regardez, je crois que c’est… c’est votre
bras.” Et il n’eut pas le temps de finir, que Joseph s’écria : “Mon
Dieu!… Mon Dieu!… mais c’est… mon bras!” Il lança un cri déchirant de
désespoir en disant : “Je ne pourrai plus jouer ma clarinette! O mon
Dieu! Que vais-je devenir! Que vais-je devenir sans mon bras?” Il
pleurait comme un enfant!… et il disait: “Je ne pourrai plus jouer ma
clarinette!… ma clarinette!” (VLB.227-228).» Ce pathétique,
«abjectogène», qui oserait croire qu’il sécrète encore en nous, dedans
chacun de nous, comme dedans toute la collectivité québécoise: «Il
pleurait comme un enfant». Un enfant qui a perdu moins un membre ou un
symbole incons-cient de sa virilité que l’accès, rendu désormais
inaccessible, à son univers idyllique. Pas étonnant que le titre du
dernier livre présenté dans l’anthologie de Victor-Lévy Beaulieu porte:
la fin du monde (VLB.243-251)!Les Québécois ont le pathétique facile et refusent la responsabilité de leur destin. C’est encore cela que raconte le manuel de Beaulieu. Alors que Ferron et Bergeron dénoncent l’impuissance des grands événements, Beaulieu dénonce cette même impuissance face au quotidien. La maladie comme métaphore, on en a usé jusqu’à la nausée symbolique. Le choléra, l’alcoolisme, la scarlatine, les oreillons, la grippe espagnole, la fibrose kystique et surtout la poliomyélite et la tuberculose hantent nos cauchemars d’enfants. Porteuses de dégénérescences aussi bien physiques que morales, ces maladies nous renvoient à notre mort collective.
De toutes ces maladies, outre l’alcoolisme que Beaulieu retient dans son chapitre sur la tempérance, c’est la tuberculose qui sert de plaque tournante à son essai.
 Elle
est le lien du colon misérable à l’ivrogne invétéré, de l’incroyant
crédule au mystique agonisant, de l’enfant-martyr au missionnaire qui se
meurt, dans le fond de son pensionnat, de ne pouvoir partir convertir
les petits païens. La tuberculose, c’est tibi, le mot lui-même rétréci,
qui s’interpelle en une exclamation alarmante. Comme le sanatorium
deviendra le sana,
appellation également réduite d’un espace clos, restreint et isolé dans
une nature idyllique qui nous semble désormais interdite mais qui sert
d’écran. «Sana», c’est le royaume de «Tibi». Autre moyen de nier que la
vie se déroule désormais ailleurs, dans les villes, par exemple! Le
sanatorium est le fantasme imaginé du beau château qui inscrit dans le
sol l’univers de l’Enfant trouvé condamné à mourir et à être enseveli
dans un beau petit cercueil tout blanc…
Elle
est le lien du colon misérable à l’ivrogne invétéré, de l’incroyant
crédule au mystique agonisant, de l’enfant-martyr au missionnaire qui se
meurt, dans le fond de son pensionnat, de ne pouvoir partir convertir
les petits païens. La tuberculose, c’est tibi, le mot lui-même rétréci,
qui s’interpelle en une exclamation alarmante. Comme le sanatorium
deviendra le sana,
appellation également réduite d’un espace clos, restreint et isolé dans
une nature idyllique qui nous semble désormais interdite mais qui sert
d’écran. «Sana», c’est le royaume de «Tibi». Autre moyen de nier que la
vie se déroule désormais ailleurs, dans les villes, par exemple! Le
sanatorium est le fantasme imaginé du beau château qui inscrit dans le
sol l’univers de l’Enfant trouvé condamné à mourir et à être enseveli
dans un beau petit cercueil tout blanc…L’auteur américaine Susan Sontag a étudié la tuberculose comme métaphore littéraire et comme métaphore quoti-dienne. Confrontée à ce que dit Beaulieu, elle nous révèle des choses fort intéressantes sur notre haine de soi. Écartons tout de suite toute idée à la Groddeck qui voudrait que notre haine de soi ait généré tous les cas de tuberculose ou de poliomyélite de notre passé. Ce serait sombrer nous-mêmes dans la tentation de l’explication moniste. Mais le discours sur la tuberculose, les traitements proposés ont un contenu qui nous renvoie à cette haine de soi. En 1935, un rescapé de la tuberculose pu-bliait un journal de son séjour au «sana», «Tibi», que Beaulieu épluche avec minutie. Paul Rainville est ici le vivant témoin de cette réalité subjective québécoise qui ressource sa haine de soi aux bacilles de Koch.
La tuberculose est «la maladie du soi souffrant»58, reconnaît Susan Sontag. «Dans le domaine de la métaphore, la maladie des poumons est une maladie de l’âme.»59 C’est l’aboutissement logique de la haine de soi dans le cadre du masochisme chrétien, d’un orgueil démesuré de la souffrance, de cette perversion transmise par les valeurs idéologiques du clergé, entre le christianisme post-tridentin et le nationalisme traditionaliste. La tuberculose véhicule un fantasme collectif profond de retourner au sein d’une famille unie autour du sacrifié volontaire, c’est-à-dire l’Enfant trouvé dont la mort permet de réconcilier des parents écartés par le réel historique, mais réunis par son oblation fantasmatique. C’est une forme particulièrement perverse de chantage affectif imposé par notre névrose collective: «La maladie mortelle a toujours été considérée comme une mise à l’épreuve de la force morale, mais le XIXe siècle affiche une répugnance marquée à montrer quelqu’un qui échouerait. Et les êtres déjà vertueux ne le de-viennent que davantage à mesure qu’ils glissent vers la mort. Dans les romans, la belle mort tuberculeuse est l’ultime et courante réussite. Elle s’accompagne de la spiritualisation automatique de cette maladie, en même temps que de la récupération sentimentale de ses aspects insoutenables. La tuberculose est la mort salvatrice qui rachète les êtres déchus.»60
Pas étonnant que Beaulieu en fasse la maladie-fétiche de l’imaginaire québécois. «La littérature du XIXe siècle, rappelle encore Mme Sontag, abonde de descriptions nous montrant des tuberculeux mourant sans présenter, ou presque, le moindre symptôme clinique, apaisés, frôlant la béatitude, surtout des enfants.»61 La tuberculose pourrait être ce fantasme d’une mort douce (un génocide en douce?), certes oui, mais pas au Québec! La tuberculose ici s’accompagne de souffrances et d’abjections. Elle est la manifestation de la seule volonté infantile de retourner dans le ventre de la Mère/vache canadienne pure race. Elle représente bien ce que Susan Sontag dit ailleurs: «la mort passive par excellence, s’apparentant parfois même à un véritable suicide.»62 Elle est une mort baroque parfaitement adaptée à ce peuple baroque qu’est le peuple québécois: «Le poitrinaire était une épave, un éternel vagabond en quête d’un lieu salubre. Dès le début du XIXe siècle, la tuberculose devint un nouveau prétexte à l’exil, à une existence principalement faite de voyage… les destinations les plus contradictoires furent proposées. Le Sud, les montagnes, le désert, les îles. Leur variété même montre ce qu’elles ont en commun : le rejet de la ville.»63 «C’est une façon de se retirer du monde sans avoir à prendre la responsabilité de cette décision»,64 ajoute S. Sontag, et ces aspects nous rapprochent un peu plus de la fantasmatique du sanatorium. Comme nous n’avons pris le convoi des sanatoriums qu’au début du XXe siècle, guidés par le jumelage du curé et du
 médecin
unis par le goût de la mort en groupe, le voyage du Canadien français
se poursuit non plus dans cette grande marche du continent, en quête des
grands espaces, comme à la fin du XVIIIe siècle, mais plutôt à la
recherche d’un endroit bucolique
pour mourir. Le rejet de la ville, principale incriminée des maladies
pulmonaires, est rejet du temps qui passe, de la modernité, mais surtout
du principe de réalité. Une réalité où l’arrogance masochiste pousse
jusqu’à transformer une inéluctable issue en assomption par consomption!
La tuberculose, au service de la perversion masochiste chrétienne, nous
rappelle à notre névrose, à notre propre corruption. Ne
s’accompagne-t-elle pas «d’une haleine fétide»?65 «Le contact avec une
personne atteinte d’une maladie mystérieuse s’apparente obligatoirement à
une transgression; pire, à la violation d’un tabou. Le nom même de ces
affections semble doté d’un pouvoir magique»,66 écrit encore Sontag, et
tel est ce frisson qui parcourait l’échine du commun des Canadiens
français lorsqu’on prononçait le mot de consomption.
médecin
unis par le goût de la mort en groupe, le voyage du Canadien français
se poursuit non plus dans cette grande marche du continent, en quête des
grands espaces, comme à la fin du XVIIIe siècle, mais plutôt à la
recherche d’un endroit bucolique
pour mourir. Le rejet de la ville, principale incriminée des maladies
pulmonaires, est rejet du temps qui passe, de la modernité, mais surtout
du principe de réalité. Une réalité où l’arrogance masochiste pousse
jusqu’à transformer une inéluctable issue en assomption par consomption!
La tuberculose, au service de la perversion masochiste chrétienne, nous
rappelle à notre névrose, à notre propre corruption. Ne
s’accompagne-t-elle pas «d’une haleine fétide»?65 «Le contact avec une
personne atteinte d’une maladie mystérieuse s’apparente obligatoirement à
une transgression; pire, à la violation d’un tabou. Le nom même de ces
affections semble doté d’un pouvoir magique»,66 écrit encore Sontag, et
tel est ce frisson qui parcourait l’échine du commun des Canadiens
français lorsqu’on prononçait le mot de consomption.La tuberculose est hypocrite comme l’est le
 comportement
social d’une petite communauté incestueuse, médisante et calomnieuse.
Elle convient parfaitement à un peuple que les Amérindiens qualifiaient
de langue fourchue. Elle est un faux-semblant qui correspond assez bien
avec cette prétention que les frères Goncourt lui prêtaient, dans leur
roman Madame Gervaisais (1869),
comme «maladie des parties nobles et élevées de l’être humain pour
couvrir les humeurs qui habituellement se laissent dévorer par des
maladies des organes grossiers et vils du corps, qui obstruent et
souillent l’esprit du patient.»67 En fait, la tuberculose est
consomption parce que «la fièvre témoigne d’un feu intérieur, qui
“consume” le tuberculeux et entraîne la désagrégation du corps. Le
recours aux images empruntées à la maladie pour décrire l’amour – la
“maladie” d’amour, la passion qui “consume” – est bien antérieur au
mouvement romantique»,68 ce qui parachève son aspect baroque. Il ne
reste plus au curé et à son médecin qu’à «spiritualiser» la fièvre
brûlante et le tour est joué. Se mourir d’amour, de langueur lancinante
et voluptueuse, par une dernière prise Parmanda qu’on se fait à
soi-même, non pas pour une femme ou pour un homme, mais pour
Notre-Seigneur Jésus-Christ et pour son Église souffrante, pour les âmes
du Purgatoire, pour la conversion des pécheurs. Le désir est détourné
de son objet concret pour une élévation sordide qui confine à la
démence.
comportement
social d’une petite communauté incestueuse, médisante et calomnieuse.
Elle convient parfaitement à un peuple que les Amérindiens qualifiaient
de langue fourchue. Elle est un faux-semblant qui correspond assez bien
avec cette prétention que les frères Goncourt lui prêtaient, dans leur
roman Madame Gervaisais (1869),
comme «maladie des parties nobles et élevées de l’être humain pour
couvrir les humeurs qui habituellement se laissent dévorer par des
maladies des organes grossiers et vils du corps, qui obstruent et
souillent l’esprit du patient.»67 En fait, la tuberculose est
consomption parce que «la fièvre témoigne d’un feu intérieur, qui
“consume” le tuberculeux et entraîne la désagrégation du corps. Le
recours aux images empruntées à la maladie pour décrire l’amour – la
“maladie” d’amour, la passion qui “consume” – est bien antérieur au
mouvement romantique»,68 ce qui parachève son aspect baroque. Il ne
reste plus au curé et à son médecin qu’à «spiritualiser» la fièvre
brûlante et le tour est joué. Se mourir d’amour, de langueur lancinante
et voluptueuse, par une dernière prise Parmanda qu’on se fait à
soi-même, non pas pour une femme ou pour un homme, mais pour
Notre-Seigneur Jésus-Christ et pour son Église souffrante, pour les âmes
du Purgatoire, pour la conversion des pécheurs. Le désir est détourné
de son objet concret pour une élévation sordide qui confine à la
démence.Car «aussi passionné qu’on la décrive, la tuberculose se singularise davantage encore par son
 manque
d’énergie vitale, d’appétit de vivre… La tuberculose est l’apanage des
victimes-nées, des gens passifs qui n’aiment pas assez la vie pour être à
même de survivre.»69 Ce constat de Susan Sontag, le plus important à
mon avis, en ce qui rejoint notre développement, se confirme par le
traitement que Paul Rainville rapporte dans son livre «Tibi», le «repos cadavérique»,
qui serait, selon le Dr Lessard, l’invention du Dr Jaquerode du
sanatorium suisse de Leysin. Le «repos cadavérique» est la thérapie la
mieux adaptée que l’on pouvait imaginer pour confirmer notre passivité
totale au désir de mourir: «immobilité complète pendant deux heures,
couché sur le dos, les bras parallèles au corps, avec respiration lente
et faible (VLB.130).» La justification médicale? «Vous réalisez donc que
l’immobilité la plus complète aide efficacement le tissus à se
cicatriser ou se renouveler. Bref, le silence absolu pendant deux heures
par jour, dans la position horizontale, est une cure nécessaire,
essentielle (VLB.130).»
manque
d’énergie vitale, d’appétit de vivre… La tuberculose est l’apanage des
victimes-nées, des gens passifs qui n’aiment pas assez la vie pour être à
même de survivre.»69 Ce constat de Susan Sontag, le plus important à
mon avis, en ce qui rejoint notre développement, se confirme par le
traitement que Paul Rainville rapporte dans son livre «Tibi», le «repos cadavérique»,
qui serait, selon le Dr Lessard, l’invention du Dr Jaquerode du
sanatorium suisse de Leysin. Le «repos cadavérique» est la thérapie la
mieux adaptée que l’on pouvait imaginer pour confirmer notre passivité
totale au désir de mourir: «immobilité complète pendant deux heures,
couché sur le dos, les bras parallèles au corps, avec respiration lente
et faible (VLB.130).» La justification médicale? «Vous réalisez donc que
l’immobilité la plus complète aide efficacement le tissus à se
cicatriser ou se renouveler. Bref, le silence absolu pendant deux heures
par jour, dans la position horizontale, est une cure nécessaire,
essentielle (VLB.130).»Le sanatorium devient donc cet espace ramené en campagne, où se distribuent les lits côte à côte, exposés au soleil de grandes vitrines et où tous les tuberculeux sont dans la pose du «repos cadavérique», sous le regard attentif des religieuses. Mais alors qu’ailleurs on considère du devoir du malade de guérir,70 ici il est déjà donné comme perdant. Le repos cadavérique devient une préparation à l’état cadavérique!
Tous les rapetissements de la société québécoise se rejoignent dans cet espace clos où nos auteurs criaient déjà qu’ils étouffaient. Rétrécissement de l’espace, raccourcissement de la longévité, rapetissement de l’imaginaire. Rainville raconte dans son livre le procès dérisoire qu’on mène à un ours, probablement la mascotte du sanatorium. C’est devenu un lieu nécessaire et essentiel aux tuberculeux alors qu’ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, «le séjour au sanatorium n’est pourtant que l’une des dimensions des thérapeutiques complexes auxquelles on fait appel dans l’entre-deux-guerres.»71 Ici, on se rabat par inhibition sur cette thérapeutique car elle rejoint notre armoire bien remplie d’outils auto-destructeurs. Quel site merveilleux et fort bien approprié pour y envoyer jeunes garçons et jeunes filles issus de différents milieux et qui rêvent de se faire frères, sœurs, prêtres-missionnaires, tous martyrs, à défaut de païens comme les pères Jogues ou Brébeuf, leurs modèles, de la maladie noble par excellence! Du collège ou couvent au sanatorium, puis à la tombe, dans le plus grand décorum pompier qui contredit toute la prétention à l’humilité de l’oblation. La consomption, présentée comme le feu incandescent de leur foi dans le Christ, transforme le sanatorium en annexe des communautés religieuses pour laïques souffreteux. On y meurt au monde et non pas seulement sous une forme métaphorique!
À partir de ce moment, les malades chroniques, arriérés mentaux et déficients de tous genres, dont la religion est l’unique soutien moral, deviennent des modèles de valeurs sociales pour les jeunes Québécois. Ils sont ceux qui ressemblent le plus à cet avorton né de l’accouplement mythique du colon misérable et de la vache canadienne, ce monstre hybride qui circule en chaise roulante (maintenant motorisée), béquilles (de l’Oratoire Saint-Joseph), prothèses orthopédiques (le Québec est mondialement reconnu pour la qualité de celles-ci), grabats roulants (avec pneus quatre saisons) et auto-collants pour stationnement. Et le roi, c’est le fou! D’Ottawa, la génération des années soixante nous a ramenés tranquillement à Longue-Pointe.
Car d’appellation courante d’une clinique réservée aux tuberculeux, le «sana» est devenu un euphémisme particulièrement répandu désignant un asile de fous.72 Désormais, «certaines caractéristiques de la tuberculose sont attribuées à la folie, l’idée par exemple que le malade est une créature fiévreuse et désordonnée, extrême et passionnée, un être trop sensible pour supporter les horreurs du monde vulgaire et quotidien.»73 Les élucubrations du fou deviennent poésie formelle, voir philosophie ésotérique ou sagesse populaire. La récente désinstitutionnalisation des malades psychiatriques, en renvoyant par mesures budgétaires tous ces «bénéficiaires» au soutien «véritablement» public, nous a confrontés à une «poésie» et une «philosophie» d’un genre particulièrement moins surréaliste que captatif. «Au XXe siècle, la maladie repoussante, déchirante, celle qui désigne une sensibilité supérieure et véhicule les sentiments “spirituels” et l’insatisfaction «critique», c’est la folie»74 ; mais nous abordons bientôt le XXIe siècle!
Voilà comment, de traitement particulier, le «repos cadavérique» est devenu une métaphore/traitement de choc de la collectivité québécoise au grand complet. Incurie devant le manque d’emplois, assistance sociale et assurance-chômage, retraite anticipée, garderies et foyers pour personnes âgées, le tout occupant une part importante de la population active qui, relevant de plusieurs paliers de gouvernement, ne cessent de voir leurs juridictions se recouper : tout cela ne perpétue-t-il pas cette longue agonie amorcée depuis plus d’un siècle, mais sous un aspect cette fois purement profane en comparai-son de l’enrobage sacré que lui procurait le discours moralo-religieux du premier XXe siècle? Les querelles de clochers sont maintenant des querelles de juridictions. Victor-Lévy Beaulieu, croyant dénoncer un fantasme morbide de rapetissement de l’imaginaire, dans le contexte de la crise anomique des années soixante, n’annonçait-il pas du même souffle un regain éventuel de nos pulsions auto-destructrices et la perpétuation de notre inhibition de l’action? Est-il possible d’adapter à une société qui refuse désormais l’ascèse-dans-le-monde pour la consommation hédoniste la thérapie du «repos cadavérique»? Il n’y a qu’à comparer les tables d’impôt pour les gouvernements de Québec et d’Ottawa et la politique de l’assistance sociale pour constater que le valeureux qui ose réintégrer le marché du travail est tout de suite pénalisé par rapport à celui qui reste sagement dans l’inactivité. Autant qu’une fabrique à cheap labor, la pratique de l’assistance-sociale poursuit le fantasme du sanatorium.
Par le sanatorium, nous sommes revenus à l’inconfort de départ, la claustration ressentie par nos auteurs. La haine de soi a été posée à la même époque par Jean Bouthillette et, uti-lisant les essais de Marthe Robert et Susan Sontag, nous avons pu pénétrer beaucoup plus loin dans l’analyse de notre structure symbolique qui sert de paradigme affectif à notre représentation sociale. Reconnaître que l’Angleterre de Ferron est une mère factice qui dissimule une vache pure race, et que le colon exploité, Louis Hébert, se dissimule derrière une image idéalisée de l’Amérindien, nous permet de comprendre l’impossibilité d’accéder au «roman familial» du Bâtard et de constater notre régression permanente dans le «roman familial» de l’Enfant trouvé rajoutant sans cesse des couches de récits. Un deuil inassumé. Tout ceci reste commun
 et latent dans les Historiettes, le Petit Manuel et le Manuel de la petite littérature. Les premières pièces de théâtre de Ferron, Les Grands Soleils (1958) et La Tête du Roi (1963) soulevaient déjà ces symboles. La première mettait en scène trois archétypes réutilisés dans les Historiettes:
le docteur Chénier, l’Indien Sauvageau et le robineux (l’intempérant)
Mithridate : le Québécois entre l’enracinement américain et la mémoire
ethnique originelle. La seconde donnait une inversion de la Fête-Dieu en
prome-nant une statue décapitée – comme le sera la statue de Saint-Jean
Baptiste lors du défilé de 1969: «Le symbole de la servitude du peuple
québécois est à terre. La jeunesse québécoise renverse l’image
traditionnelle que l’élite imposait au peuple québécois depuis la
défaite de la Rébellion (B.237)» – et fait descendre la scène dans la
rue en criant ce non-dit dénoncé tout au long de notre enquête: «Laisse
éclater ta haine, sois coupable, sois laid!… Le sang, vois-tu, il n’y a
rien d’autre qui regénère un peuple!» Mais le cri prémonitoire est vite
étouffé par l’esprit de sanatorium qui revient au galop quand Ferron
ajoute, malheureusement: «Dans un pays dont la force est l’inertie,
comment réussir une révolution si l’on n’est pas poète?»76 Au sana au
plus haut des cieux!…
et latent dans les Historiettes, le Petit Manuel et le Manuel de la petite littérature. Les premières pièces de théâtre de Ferron, Les Grands Soleils (1958) et La Tête du Roi (1963) soulevaient déjà ces symboles. La première mettait en scène trois archétypes réutilisés dans les Historiettes:
le docteur Chénier, l’Indien Sauvageau et le robineux (l’intempérant)
Mithridate : le Québécois entre l’enracinement américain et la mémoire
ethnique originelle. La seconde donnait une inversion de la Fête-Dieu en
prome-nant une statue décapitée – comme le sera la statue de Saint-Jean
Baptiste lors du défilé de 1969: «Le symbole de la servitude du peuple
québécois est à terre. La jeunesse québécoise renverse l’image
traditionnelle que l’élite imposait au peuple québécois depuis la
défaite de la Rébellion (B.237)» – et fait descendre la scène dans la
rue en criant ce non-dit dénoncé tout au long de notre enquête: «Laisse
éclater ta haine, sois coupable, sois laid!… Le sang, vois-tu, il n’y a
rien d’autre qui regénère un peuple!» Mais le cri prémonitoire est vite
étouffé par l’esprit de sanatorium qui revient au galop quand Ferron
ajoute, malheureusement: «Dans un pays dont la force est l’inertie,
comment réussir une révolution si l’on n’est pas poète?»76 Au sana au
plus haut des cieux!…Notes
- J. Bouthillette. Le Canadien français et son double, Montréal, L'Hexagone, 1972, p. 13.
- J. Bouthillette, ibid. p. 14.
- J. Bouthillette. ibid. p. 21.
- J. Bouthillette. ibid. p. 50.
- Par ailleurs un excellent film. Comme Léolo, nous produisons de la conscience, de la littérature (de la vraie, sans mondanité), des arts (des vrais, sans mondanité), mais plus souvent, nous les jetons aux poubelles. Y a-t-il seulement quelqu'un qui, comme cette conscience universelle interprétée par Pierre Bourgault, passe derrière nous pour les ramasser et les conserver, quelque part, dans cette bibliothèque fantastique où s'empile l'essentiel du patrimoine de l'humanité? Québécois, ferons-nous jamais partis de l'histoire de l'humanité?
- J. Bouthillette. ibid. p. 48.
- J. Bouthillette. ibid. p. 50.
- J.M.S.?… Je Me Souviens, Voyons!
- J. Bouthillette. ibid. pp. 50-51.
- R. Bastide. Sociologie et psychanalyse, Paris, P.U.F., Col. Bibliothèque de sociologie contemporaine, 1950, p. 269.
- R. Bastide. ibid. pp. 268-269.
- M. Robert. Roman des origines et origine du roman, Paris, Gallimard, Col. Tel #13, 1972, p. 44.
- M. Robert. ibid. pp. 44-45.
- M. Robert. ibid. pp. 45-46.
- M. Robert. ibid. p. 46.
- M. Robert. ibid. pp. 46-47.
- P. Reid. «François-Xavier Garneau et l'infériorité numérique des Canadiens français», in Recherches sociographiques, L'historiographie, Québec, P.U.L.Livre XV, #1, 1974, p. 37.
- M. Robert. op. cit. p. 47.
- M. Robert. ibid. pp. 47-48.
- M. Robert. ibid. pp. 49-50.
- M. Robert. ibid. pp. 50-51.
- M. Robert. ibid. p. 51.
- M. Robert. ibid. p. 51.
- M. Robert. ibid. pp. 51-52.
- Mais les collets romains s'étant transformés en cols blancs, et l'Église catholique en sécurité sociale, on l'a vu, tout ça n'est que fausse illusion!
- Tibi, la Tuberculose.
- M. Robert. ibid. p. 54.
- M. Robert. ibid. pp. 54-55.
- M. Robert. ibid. p. 55.
- M. Robert. ibid. pp. 56-57.
- Je renvoie au film de Robert Favreau sur Nelligan où la poésie comme substitut à l'inceste refoulé demeure la critique la plus pertinente à un certain investissement affectif malsain et immature de la poésie au Québec. Le jeune et beau Nelligan est courtisé par une femme, Idola Saint-Jean, première figure de la transgression (elle lui offre en cadeau Les Fleurs du Mal de Baudelaire, alors censuré), future féministe, et un poète homosexuel, Arthur de Bussières, seconde figure de la transgression, qui, dans une scène de séduction exhibitionniste, essaie de le tirer de sa poésie psychogène. Tour à tour, il refusera la bouche d'Idola et le corps nu de Bussières pour finir par s'enliser dans un asile d'aliénés où il récitera - presqu'à la Gauvreau -, les vers du Vaisseau d'Or en vue du divertissement d'un monseigneur et d'une Mère supérieure, figures parentales austères et stériles. Nous nous enfonçons ici entre le surréalisme et les abysses de l'absurde.
- M. Robert. ibid. p. 57.
- M. Robert. ibid. pp. 59 à 61.
- R. Barthes. Michelet par lui-même, Paris, Seuil, Col. Écrivains de toujours #19, 1954, 192 p. Ce livre a donné lieu à des recherches complémentaires de J. Cabanis. Michelet, le prêtre et la femme, Paris, Gallimard, 1978, 246 p. et de T. Moreau. Le sang de l'Histoire Michelet L'Histoire et l'idée de la femme au XIXe siècle, Paris, Flammarion, Col. Nouvelle Bibliothèque scientifique, 1982, 250 p.
- Je voudrais saisir l'occasion de la fin de cette section théorique pour dire quelques mots d'un livre que le lecteur informé sera sans doute étonné de ne pas voir cité ici puisque ma démarche ressemble terriblement à la sienne, c'est-à-dire, le livre de H. Weinmann. Du Canada au Québec, Généalogie d'un histoire, Montréal, L'Hexagone, 1987, 480 p. J'ai accueilli la parution de ce livre avec un grand enthousiasme. Enfin, un vent d'air frais dans l'historiographie et la philosophie québécoise de l'histoire. Je savais que les historiens professionnels et universitaires bouderaient ce livre, mais tant pis, sinon tant mieux, car l'historiographie, comme l'art et la littérature, la musique et le théâtre doivent vivre hors des institutitons officielles pour être socialement vivants. Mais je considère que ce livre a deux gros défauts qui m'empêchent de l'utiliser, et ses défauts se résument en deux noms: Jung et Girard. Le premier, à cause de sa faiblesse au niveau de la sociologie de l'inconscient collectif; le second par son manque de maîtrise de la psychanalyse qu'il réduit à son anthropologie hégélienne qui rappelle trop souvent l'invention de la roue ou celle de l'eau tiède. C'est ce qui gâche toute l'entreprise de M. Weinmann et dont la preuve, à mes yeux, se trouve dans le résultat hirsute d'une philosophie allemande de l'histoire du Québec. Va pour la philosophie allemande de l'histoire allemande d'un Emil Ludwig par exemple, ou de la philosophie italienne de l'histoire italienne de Guiseppe Prezzolini, mais si l'on veut faire une philosophie allemande de l'histoire du Québec, par honnêteté intellectuelle, il faut se l'avouer, et nous l'accepterons, avec enthousiasme, pour telle!
- Cité in J. Delumeau. Une histoire du paradis, t. 2: Mille ans de bonheur, Paris, Fayard, 1995, p. 397.
- J. Bouthillette. op. cit. p. 36.
- P.-É. Farley et G. Lamarche. Histoire du Canada, Trois-Rivières, Clercs de Saint-Viateur, 1935, p. 240.
- C'est-à-dire les historiens de l'Université de Montréal des années 1940-1960, héritiers de l'enseignement du chanoine Groulx, tels Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunet. Voir l'excellente thèse publiée sur cette école d'historiographie québécoise: J. Lamarre. Le devenir de la nation québécoise, Québec, Septentrion, 1993, 570 p.
- M. Ferro. Comment on raconte l'histoire aux enfants, Paris, Payot, 1981, pp. 218-219.
- G. Laviolette. Samuel de Champlain, Montréal/Sherbrooke, L'Apostolat de la Presse, Col. Gloires nationales, 1954, 32 p.
- Elzéar Goulet avait voté la mort de Scott lors de l'occupation métisse de Fort Garry en 1870. Il fut tué dans la poursuite, mais la version soutenue par Bergeron n'est pas exempte de fortes exagérations. Cf. B. Saint-Aubin. Louis Riel, Montréal, La Presse, 1985, pp. 152-153. Outre Goulet, François Guilmette fut assassiné dans des conditions restées mystérieuses et André Nault, cousin de Riel, échappa de peu à la mort. La chasse au Métis menée par les Ontariens avait pour but de venger sauvagement le procès et l'exécution de Thomas Scott.
- L'occasion est bonne pour nous arrêter un moment sur ce pitre génial de Mordechaï Richler, l'un de ces instruments de haute gamme que tout parfait masochiste se doit de posséder dans sa trousse entre le chat à neuf queues, les escarpins à talon haut et les électrodes. Pour les Québécois, chacune des déclarations méprisantes à leur égard que fait cet auteur dont la carrière littéraire est davantage derrière que devant lui, est malsainement ressassée alors que la moindre règle de santé voudrait qu'on n'y prête pas la moindre attention. En ce sens, Mordechaï Richeler est bien une invention de la haine de soi dont souffrent les Québécois, et l'auteur juif, qui se prête à ce jeu avec assez bonne grâce merci, ne peut pas être exempt d'une haine semblable envers les siens. Pour les Juifs de Montréal, Mordechaï Richler sert à alimenter une angoisse paranoïde qui vit d'un délire de persécution. Si, comme le définit Léon Poliakov (Histoire de l'antisémitisme, t. 1: l'âge de la foi, Paris, Pluriel # 8370, 1981, p. 7), l'antisémitisme est «une animosité à l'égard des Juifs radicalement différente, en raison de son intensité et de sa pérennité de tous les autres conflits et haines historiques», on doit reconnaître qu'il est une réaction à cette prétention du peuple Juif à se reconnaître comme ce Peuple Élu de Yahweh qui heurte aussi bien un égalitarisme social fort démocratique qu'une prétention raciale/raciste aujourd'hui fort douteuse - et précisément, depuis l'Holocauste hitlérien! Comment oublier la prétention de ce «peuple marqué à tout jamais pour Le servir, peuple "qui a sa demeure à part, et ne fait pas partie des autres nations" (Nombre XXIIII, 9) (ibid. p. 11)», prétention qui place dès lors celui qui n'y souscrit pas dans la position (potentielle) d'antisémitisme. Tout chrétien devient passible du préjugé d'antisémitisme, comme tout Occidental qui se considère comme n'étant pas héritier de la tradition judéo-chrétienne, et, porquoi pas, tout antisioniste dont l'éthique l'oblige à condamner le nationalisme de l'État d'Israël. C'était la position du docteur Ferron qui haïssait le racisme et assimilait la prétention à l'élection divine du Peuple Juif à une forme de racisme, et comme il n'y a pas de racisme positif… Enfin, pour ce qui est des Canadiens anglais, je dirai seulement qu'avec les soins aux petits oignons qu'ils apportent à bien chouchouter cette grande gueule de Mordechaï, je ne peux que penser que si Hitler avait été Canadien anglais, ce n'est peut-être pas six millions de Juifs qui auraie iians ls chambres à gaz et les fours crématoires! Pour les Québécois, le mieux est d'oublier Mordechaï et de cultiver un autre maudit bon Juif montréalais, je parle de Leonard Cohen qui représente encore mieux sa communauté sur la scène internationale et qui a le mérite de vivre sa littérature sans nous prendre pour ses boucs émissaires.
- M. de Certeau. La Fable mystique, p. 21, cité in L. Girard, H. Martin et J. Revel. Histoire, mystique et politique: Michel de Certeau, Grenoble, Jérôme Millon, 1991, p. 79.
- J. Bouthillette. op. cit. p. 97.
- J. Bouthillette. ibid. pp. 20-21.
- J. Bouthillette. ibid. pp. 51-52.
- J. Bouthillette. ibid. p. 71.
- F. Létourneau. Histoire de l'Agriculture (Canada-français), Montréal, Imprimerie Populaire, 1952, p. 187.
- F. Létourneau. ibid. p. 186.
- Je me souviens que, dans mon enfance, mes parents appréciaient beaucoup ce film où l'on voit Fernandel, habillé en pauvre gueux, se sauver d'un camp de prisonniers en poussant une vache devant lui. Il s'agit du film d'Henri Verneuil, La vache et le prisonnier (1959). Revenu en France, le prisonnier prenait le mauvais train qui le ramenait en Allemagne d'où il devait attendre la fin de la guerre pour être libéré. Un de mes amis m'étonnait récemment en me rappelant que la vache s'appelait Marguerite!
- G. Filteau. Histoire des Patriotes, Montréal, L'Aurore, 1975, p. 359.
- G. Filteau. ibid. p. 409.
- Cité in O. P. Dickason. Les Premières nations du Canada, Québec, Septentrion, 1996, p. 177.
- Cité in J.-P. Bernard (éd.) Assemblées publiques, résolutions et déclarations de 1837-1838, Montréal, VLB éditeur, Col. Études québécoises, 1988, p. 302.
- J. Bouthillette. op. cit. p. 82.
- J. Lapointe, citée in C. Racine. L'anticléricalisme dans le roman québécois 1940-1965, Montréal, Hurtubise HMH, Col. Cahiers du Québec-Littérature #6, 1972, p. 13.
- J. Bouthillette. op. cit. p. 40.
- S. Sontag. La maladie comme métaphore, Paris, Seuil, 1979, p. 83.
- S. Sontag. ibid. p. 26.
- S. Sontag. ibid. p. 53.
- S. Sontag. ibid. p. 88.
- S. Sontag. ibid. p. 33.
- S. Sontag. ibid. pp. 43 et 89.
- S. Sontag. ibid. p. 44.
- S. Sontag. ibid. p. 39.
- S. Sontag. ibid. p. 12.
- S. Sontag. ibid. p. 26, n. 1.
- S. Sontag. ibid. pp. 28-29.
- S. Sontag. ibid. pp. 33-34.
- P. Guillaume. Du désespoir au salut: les tuberculeux aux 19e et 20e siècles, Paris, Aubier, Col. historique, 1986, p. 238.
- P. Guillaume. ibid. p. 217.
- S. Sontag. op. cit. p. 46.
- S. Sontag. ibid. pp. 46-47.
- S. Sontag. ibid. p. 46.
- J. Ferron, cité in L. Mailhot. La littérature québécoise, Paris, P.U.F., Col. Que sais-je? #1579, 1974, pp. 110-111.

Frégoter Groulx jusqu’à ce que Trudel s’en suive.
FRÉGOTER v. tr. (XXe s., de Guy Frégault, historien québécois emporté par la guerre de la Conquête); action de déterrer des pénis et d’en faire des thèses. «Jean-Claude frégote un document»; «Vous ne frégotâtes plus dans les dépôts d’archives à partir du moment où vous putes prendre votre chaire à l’université.»

Nous voilà donc rendus à la partie de notre enquête qui porte directement sur l’historicité telle que vue par Ferron, Bergeron et Beaulieu. Un mot résume assez bien le rejet de l’historio-graphie cléricalo-nationaliste du Québec: frégoter. On le retrouve dès la dédicace de Ferron à Jacques Hébert, au début des Historiettes: «…ces jocrisses, qui, sous prétexte de frégoter le document, ont été des faussaires et ont tout fait pour mettre le passé au temps mort – et pourtant l’histoire vit comme un roman (F.7).» Amplifiant cette réplique à la Guizot, Beaulieu ouvre son manuel par la citation d’un Oblat, le père Simard, qui dit: «Vivons de l’histoire et faisons vivre l’histoire (VLB.13).»
Si nous avions suivi la démarche classique que nous utili-sons habituellement dans nos enquêtes de la représentation sociale, nous aurions dû commencer par établir la base de
 l’historicité
de nos auteurs. Ferron, Bergeron et Beaulieu commencent tous par une
critique sévère et impitoyable de l’historiographie et annoncent le
projet d’orienter la pensée historienne sur une nouvelle base. Partant
de la démoralisation, nous remontons maintenant à la source de
l’imaginaire historiographique. «On peut dire, relance Beaulieu, qu’il y
a eu et qu’il y a encore une littérature parallèle au Québec, autrement
dit une manière d’underground littéraire dont nos historiens n’ont pas
souvent parlé (VLB.15).» Ce constat rejoint celui, unanime à l’époque,
de l’amorce d’un désintérêt manifeste des jeunes Québécois pour leur
histoire, ce qui donne l’occasion à Ferron de répliquer à Lionel Groulx:
«Groulx raconte qu’avant 1900, on n’enseignait pas l’histoire dans les
écoles. C’est vrai, mais à qui la faute? Et quand on s’y est mis, ce fut
pour l’enseigner contre la tradition, en nous présentant de nous-mêmes
une image totalement fausse. Avec le résultat qu’aujourd’hui le Canadien
français n’a aucune culture historique et ne sait plus très bien qui il
est (F.25).»
l’historicité
de nos auteurs. Ferron, Bergeron et Beaulieu commencent tous par une
critique sévère et impitoyable de l’historiographie et annoncent le
projet d’orienter la pensée historienne sur une nouvelle base. Partant
de la démoralisation, nous remontons maintenant à la source de
l’imaginaire historiographique. «On peut dire, relance Beaulieu, qu’il y
a eu et qu’il y a encore une littérature parallèle au Québec, autrement
dit une manière d’underground littéraire dont nos historiens n’ont pas
souvent parlé (VLB.15).» Ce constat rejoint celui, unanime à l’époque,
de l’amorce d’un désintérêt manifeste des jeunes Québécois pour leur
histoire, ce qui donne l’occasion à Ferron de répliquer à Lionel Groulx:
«Groulx raconte qu’avant 1900, on n’enseignait pas l’histoire dans les
écoles. C’est vrai, mais à qui la faute? Et quand on s’y est mis, ce fut
pour l’enseigner contre la tradition, en nous présentant de nous-mêmes
une image totalement fausse. Avec le résultat qu’aujourd’hui le Canadien
français n’a aucune culture historique et ne sait plus très bien qui il
est (F.25).»La question n’apparaît pas de moindre importance pour Ferron. La tradition dont il parle, c’est celle de la première historiographie et qu’il considère comme «sacrée»: «…nos historiens trimaient dur; enfin ils nous la livrèrent in-quarto, cette histoire. Ils y avaient mis tout ce qu’ils avaient pu trouver, tout sans exception et ce tout était sacré (F.l44).» Ce tout, c’est l’Histoire du Canada de F.-X. Garneau, écrite comme relève du défi lancé par le rapport Durham. Pour Ferron, elle est comme une suite, sur un autre plan tout aussi fondamental, sinon même plus, de la prise des armes de 1837-1838. Et il ne pardonne pas au clergé d’avoir tripoté cette Histoire pour la -rendre conforme à son nationalisme de «séminariste».
C’est alors que notre devise nationale devient un rappel de «notre amnésie sur le plan historique (VLB.153).» Et Victor-Lévy Beaulieu d’ajouter: «Il faut se méfier d’un pays dont la devise est : “Je me souviens”. Car il y a bien des chances que cela veuille dire: “Je me souviens… que j’oublie”… Bien sûr, “notre histoire en est une des pas pire”, à condition de ne pas faire acte de foi total dans tous “ces frégoteurs de documents” qui ne disent bien souvent que la froide officialité des choses, celles qui ont été conçues d’en haut et qui, souvent, n’ont que très peu de rapport avec la vie réelle, la p’tite vie comme on dit, celle qui est quotidienne et ne se résume pas dans des masses inflationnistes de papiers sur lesquels on a apposé le sceau des Archives nationales (VLB.19).» Léandre Bergeron endosse la même critique: «Nos élites nous ont raconté des histoires sur notre passé. Elles n’ont jamais situé notre passé dans l’Histoire. Les histoires qu’elles nous ont racontées sur notre passé étaient conçues pour nous maintenir, nous, peuple québécois, en dehors de l’Histoire. […] Au lieu de lutter pour débarasser le Québec du colonisateur, [l’élite] s’est retournée vers un passé “héroïque” pour ne pas faire face au présent. Elle s’est mise à glorifier les exploits des Champlain, des Madeleine de Verchères, des Saints Martyrs Canadiens pour nous faire croire qu’à une certaine époque nous aussi nous étions de grands colonisateurs, bâtisseurs de pays. Colonisés par les Anglais, nous pouvions trouver compensation dans l’idée que nous avions, nous, colonisé l’homme rouge. Notre élite nous fit rêver au Grand Empire Français d’Amérique du Temps de Frontenac pour ne pas nous sentir trop humiliés dans notre situation de peuple conquis, emprisonné dans la Confédération (B.4).»
Il est intéressant de constater l’unanimité de la critique de nos trois auteurs. Elle permet de reconnaître, pour ceux qui auraient eu tendance jusqu’alors à les opposer sur les points de détails, une certaine communauté de pensée et une solidarité dans une obscure mais commune certitude que le sens et la morale de l’histoire du Québec suivent une logique autre que celle avancée par les frégoteurs de documents. À ce titre, Bergeron est le pourfendeur le plus vitriolique de la fausse pudeur scientifique. Si le Tartuffe de Ferron porte la robe des dévots de La Dauversière, celui de Bergeron porte le complet-cravate des intellectuels qui ont transité du sanatorium, via le séminaire, à l’Université: «Sous le couvert de “l’objectivité”, de la recherche scientifique de “faits historiques”, des historiens entretenus dans nos universités, accumulèrent beaucoup de “faits”, beaucoup de documents historiques. Mais là s’arrêtait leur travail. Pour eux, l’historien se situe en dehors de l’Histoire. Il est comme l’ange de la connaissance qui fouille les dépotoirs de l’humanité pour en tirer de belles fiches nécrologiques. Avec eux, notre histoire est un long déterrement qui confirme, sans le dire, notre défaite et notre sujétion. En empruntant aux Américains leur méthode de recherche, ils leur ont également emprunté leur point de vue, c’est-à-dire la suprématie de l’ordre capitaliste américain et la marginalité des petits peuples, vestiges d’un autre âge (B.5).» Il suffit d’être passé par l’UQAM, moins de dix ans après que furent écrites ces lignes, pour se rendre compte à quel point il sous-estimait la progression de cet esprit de l’historiographie comme «gestion des biens des morts»! Mieux que Ferron, Bergeron désavoue ouvertement les pressions du clergé sur l’histoire «sacrée» de Garneau: «Garneau, qui avait eu des sympathies patriotes, les oublia le plus possible et dans les volumes sui-vants tâcha de se corriger en affirmant que la survie du peuple canayen était absolument liée à la foi catholique. Mais ce n’était pas suffisant. L’édition de 1859 de son Histoire fut soumise à la censure du clergé qui coupa des paragraphes et demanda à l’auteur d’en réécrire certaines pages. Notre premier historien se soumit à la dictature du clergé (B.135-136).» Il y a là une fibre sensible que nos écrivains entreprennent de révéler: l’étroite liaison entre l’historiographie comme écri-ture et comme présence à l’Histoire du Québec. L’utilisation de l’historiographie comme aliénation à l’Histoire devient le péché majeur qu’ils reprochent à l’interprétation cléricalo-nationaliste: «Ces trois vocations du peuple canayen, la vocation missionnaire du clergé, la vocation “civilisatrice” de l’élite laïque, la vocation agricole de l’habitant, notre élite cléricalo-bourgeoise va si bien les propager par ses moyens de propagande que sont l’église et l’école que le peuple canayen sera contraint à vivre cents [sic!] ans d’obscurantisme, cent ans de moyen âge, cent ans en marge de l’histoire avant de pouvoir réorienter son destin (B.115).»
Victor-Lévy Beaulieu également, avant d’en arriver à une critique de l’interprétation cléricalo-nationaliste, part d’une critique du «scientisme» des historiens en se ralliant à ce que dit Ferron dans les Historiettes: «Jacques Ferron, quand on lui demanda de s’expliquer sur ses “papiers de fou”, répondit de belle façon : “Je m’occupe d’histoire parce que la sottise des historiens m’écœure”. Après lui, je me sens tenté d’ajouter : “Je m’occupe de la littérature parce que la sottise des littérateurs m’écœure”. La sottise des faiseux de thèses, des compteurs de virgules, des déterreurs de pénis, des citeux de bouttes de textes, des paraplégiques de la pensée soi-disant psychanalytique et de toute cette gagne de crève-l’imagination qui n’ont de bourses que pour se débourser. Il ne faudra donc pas s’attendre à trouver beaucoup de ces parasites dans mon p’tit livre (VLB.15).» C’est dommage, car s’il en avait eu de ces parasites, peut-être que je n’aurais pas eu à reprendre toute cette information pour en tirer une critique de la conscience historique qui aurait dû être faite depuis longtemps. Enfin! Cette étroitesse mise à part, je reconnais la grande contribution du manuel de Beaulieu: «Si je me suis tant intéressé aux monographies, c’est pour des choses de ce genre, ces petits renseignements sur la vie du colon, qui m’en disent plus que les gros livres savantastes (VLB.25).» C’est sans doute sa façon de contredire ce classique qu’est le manuel de l’abbé Casgrain qui, rappelle le copain de VLB, Léandre, «s’érigea lui-même en critique littéraire et gouverna la littérature de l’époque comme un dictateur.» À chacun son Duplessis! Pour Ferron, ce fut l’abbé Groulx avec lequel il polémiqua autour de Dollard.
Le monument de Dollard, du sculpteur Alfred Laliberté, et situé au Parc Lafontaine de Montréal, date de 1920. Le premier coup à lui être porté, et cela vaut bien les pétards des felquistes au monument Wolfe dans les années soixante, partit de l’Université McGill en 1932, douze ans après l’érection du monument… C’était un professeur anglophone, E. R. Ader, qui affirmait que non seulement Dollard n’avait pu sauver la colonie, mais qu’en plus, il en avait risqué la perte. L’historien, «iconoclaste et acerbe», considérait que Dollard devait être relégué au «museum of historical myths.»1 C’était une époque où les historiens canadiens-anglais souffraient d’hypercritique et déboulonnaient leurs propres statues de Wolfe et de Laura Secord. Le manque de communication entre les deux groupes nationaux du Canada empêcha la contradiction de se transformer en affrontement violent, mais le ver était dans la pomme.
Et c’est Jacques Ferron qui mordit le fruit. Les articles repris dans les Historiettes ouvrirent la polémique avec le chanoine Groulx qui publia, en 1960, une plaquette en réponse aux détracteurs de son héros, Dollard est-il un mythe? (Montréal, Fides, 1960) dont l’ouverture porte une mention implicite aux attaques de Ferron lorsqu’il évoque le terme de «bandit» au sujet de Dollard, terme qui revient souvent sous la plume du Dr Ferron. Et Groulx, qui, pour une fois semble-t-il, se laisse emporter par un «grain d’humeur», parle de ce »phénomène hélas, d’un peuple décadent que cet acharnement à salir son lit et à détruire sa propre histoire.»2 Le chanoine ne savait pas à quel point, sans avoir fait de psychanalyse, il touchait à quelque chose de sérieux! Groulx apparaît comme la bête noire des historiens mais Ferron conserve toutefois envers lui certains ménagements (ce qui ne sera plus le cas à propos de Trudel). Pour Ferron, le nationalisme clérical est un nationalisme dépassé que l’on «prolonge pour ne pas chagriner le vieux chanoine. À toutes fins pratiques il est désintégré (F.10)»: «Le chanoine Groulx n’est pas né mauvais garçon. Il avait de l’âme; c’est sans doute pour cela qu’il vit si vieux… C’est le nationa-lisme qui l’a gâté; il l’a choisi en France – du côté de l’Action française et de sainte Jeanne d’Arc –. En France, il était déjà malsain, tourné contre le socialisme et le juif Dreyfus. Au Canada il devint une sorte de trémoussement devant la race pure et le haras; doux Jésus! que nous étions français, plus français qu’en France parce que français et catholique, ouida! Cela pouvait se défendre en y mettant de la rhétorique et nous ne demandions pas mieux, vu que nous étions bâtards comme tout. Groulx devint orateur et mauvais historien (F.28).» Bâtard! Reste à voir, mais jusque-là, rien de bien méchant. Puis, Ferron avoue peu à peu les raisons de sa profonde rancune: «Des sauvages il n’a fait qu’une petite bouchée. Ils nuisaient à sa théorie, les pauvres bougres! Tout au plus servaient-ils de repoussoir à la vertu française. Contre ces dégénérés, la race pure! Sans trop s’en rendre compte, le bon abbé trouva là l’accent d’un puritain de Boston. C’est pour cela qu’il est assez bien considéré au Canada anglais et qu’Ottawa en 1960 lui a donné un petit timbre pour célébrer Dollard, sa créature, son fils – le plus beau petit salaud qui fût jamais (F.28-29).» Le ton monte. Groulx pour sa part, avait répliqué, en 1960, que «la jeunesse peut célébrer, sans scrupule, la fête de Dollard et qu’elle pourra de même acheter et propager les timbres officiels de Dollard. Et si l’on en vient coller à ma porte, ainsi qu’on m’en a menacé, j’en serai très honoré. Et je ne les décollerai point.»3 Le vitriol se répand: «ce vieux toqué de Chanoine Groulx qui ne démord de rien, même des pires erreurs qui nuisent à ce que son œuvre a de bon (F.113)», et lorsque Groulx publie Le Canada français missonnaire (1962), Ferron poursuit sa mauvaise humeur: «Le chanoine Groulx est bien vieux pour écrire un livre sur le sujet. Sa génération a singulièrement manqué d’humanité. Et il est mal venu de parler d’évangélisation, lui qui a contribué à faire et le plus faussement du monde, de l’Amérindien notre ennemi (F.152).»
Beaulieu, le disciple de Ferron, ne pourra s’empêcher d’égratigner à son tour le vénérable chanoine dans son manuel (VLB.163), mais sans conséquence, Groulx étant mort depuis quelques années déjà. Léandre Bergeron répète à sa façon les accusations de Ferron. «L’abbé Groulx a écrit un livre au titre très significatif : Notre Maître le passé. Il glorifie le passé, nos ancêtres, le régime français où, d’après lui, la religion catholique et la culture française ont rayonné magnifiquement sur l’Amérique du Nord. Il fait des héros de ceux qui ont exploité l’homme rouge, Dollard des Ormeaux, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et les autres (B.188).»
Mais ce n’est rien comparé à ce que Ferron dit des autres historiens. Frégault, de qui il tire son verbe «frégoter», a de la sacristie (F.89), mais surtout
 Marcel Trudel:
«Il réédite à prix fort toutes les conneries de ses prédécesseurs et
trouve moyen d’être plus con qu’eux. Subventionné par le Conseil des
Arts, passé pour des raisons assez obscurs de Laval à Carleton, il se
croit tenu à donner l’histoire en gage à ses bienfaiteurs. Il en met
tant et plus sur un certain Cabot qui, en 1497, passa au large du Cap
Breton. Vous comprendrez le zèle de Trudel : ce touriste était appointé
par l’Angleterre; sur sa pérégrination maritime se fonde le premier
droit de celui-ci au Canada (F.53-54).» Pour peu, il l’accuserait de
traître! Et si Ferron défendait ici Cartier – Hérode! – contre Cabot? Où
aboutirait donc sa supposée idéalisation de l’Angleterre si elle
devenait Mère-patrie légitime du Canada contre ce «Mistigoche» de
Saint-Malo? Seul l’abbé Ferland trouve grâce à ses yeux: «cet historien
remarquable, cet homme méconnu (F.50)», défenseur des Amérindiens dans
l’histoire canadienne. La balance de ses jugements penche vers la
négative: «Qu’on sache là-dessus que je m’occupe d’histoire simplement
parce que la sottise des historiens me fâche. On ne peut se fier à rien
ni à personne dans ce bordel de pays (F.54)!»
Marcel Trudel:
«Il réédite à prix fort toutes les conneries de ses prédécesseurs et
trouve moyen d’être plus con qu’eux. Subventionné par le Conseil des
Arts, passé pour des raisons assez obscurs de Laval à Carleton, il se
croit tenu à donner l’histoire en gage à ses bienfaiteurs. Il en met
tant et plus sur un certain Cabot qui, en 1497, passa au large du Cap
Breton. Vous comprendrez le zèle de Trudel : ce touriste était appointé
par l’Angleterre; sur sa pérégrination maritime se fonde le premier
droit de celui-ci au Canada (F.53-54).» Pour peu, il l’accuserait de
traître! Et si Ferron défendait ici Cartier – Hérode! – contre Cabot? Où
aboutirait donc sa supposée idéalisation de l’Angleterre si elle
devenait Mère-patrie légitime du Canada contre ce «Mistigoche» de
Saint-Malo? Seul l’abbé Ferland trouve grâce à ses yeux: «cet historien
remarquable, cet homme méconnu (F.50)», défenseur des Amérindiens dans
l’histoire canadienne. La balance de ses jugements penche vers la
négative: «Qu’on sache là-dessus que je m’occupe d’histoire simplement
parce que la sottise des historiens me fâche. On ne peut se fier à rien
ni à personne dans ce bordel de pays (F.54)!»Et quel bordel! «Pourtant nous nous cherchons, écrit Jean Bouthillette. Avidement. Mais nous nous méfions de nos sources.»4 Telle est également la réaction de nos écrivains face aux historiens. Face aux premiers chroniqueurs, Ferron juge que le frère Sagard a de «la gentille naïveté» (F.54) et dit du père Charlevoix qu’il est «notre premier historien»; il trouve grâce à ses yeux car il ne parle pas de Dollard (F.142)! Le Sulpicien Dollier de Casson, qui lui a fourni dans son Histoire du Montréal l’épisode de la prise Parmanda, est d’abord mentionné comme «excellent (F.82)», puis comme œuvrant par «ouï-dire (F.134)», enfin comme fournisseur d’un «invraisemblable récit…, qui fixe la légende et brouille l’histoire (F.143)». Bien sûr, il s’agit toujours de l’affaire Dollard. Enfin, il n’est plus qu’un «sulpicien botté», rien qu’un «énergumène (F.138)»!
Si les sources sont boiteuses et les historiens serviles et traitres, qu’entendent faire nos auteurs pour y remédier, eux qui ne sont pas d’abord des historiens? Le projet de Victor-Lévy Beaulieu est présenté comme modeste: «Je répète que mon intention en écrivant ce “Manuel” n’est pas de produire une étude exhaustive de la petite littérature québécoise. Tout au plus d’en donner un aperçu en souhaitant que des chercheurs, avec de meilleures armes que les miennes, aillent plus loin (VLB.223).» Malgré tout, se décident-ils à appeler les déterreurs de pénis à la rescousse!
Les intentions de Léandre Bergeron sont davantage orientées vers le militantisme politique et social : «Depuis quelques temps, certains de nos historiens osent interpréter les faits, osent situer leur propre travail d’historien dans la vie du peuple québécois, osent se situer eux-mêmes dans l’évolution du peuple québécois vers sa libération. Ce petit manuel d’histoire du Québec s’insère dans cette dernière orientation (B.5).» Bien que se voulant un anti-Guy Laviolette, Bergeron, par certains objectifs, lui ressemble: «Ce petit manuel est au programme. Au programme de l’école de la rue, pour l’homme de la rue, pour le peuple de la rue, pour le peuple Québécois jeté dans la rue, dépossédé de sa maison, du fruit de son travail, de sa vie quotidienne. Ce petit manuel se veut une repossession de nous-mêmes pour passer au grand pas, la possession de notre avenir (B.6).» Aussi, quelles que soient les critiques faites contre Le petit manuel de Bergeron, on ne peut douter de la sincérité de sa praxéologie. C’est le militantisme qui a nui à ce que son ouvrage a de généreux, confondant l’instruction rudimentaire avec l’arrièration mentale, sans doute le péché mortel de la plupart des intellectuels de cette génération. Du moins n’a-t-il pas débouché sur la démagogie opportuniste jusqu’à se creuser un nid en milieu universitaire au nom de l’homme de la rue et du travailleur productif et avec la complicité des bureaucraties syndicales! Son honnêteté et son dédain de la servilité en ont fait un «historien dans la rue».
Mais le Manifeste du groupe, il vient de Jacques Ferron: «L’histoire d’un peuple débute au
 moment
où il prend conscience de lui-même et acquiert la certitude de son
avenir. Or cette foi et cette conscience n’ont pas été ressenties au
Bas-Canada avant le XIXe siècle. Tout ce qui précède n’est que
littérature (F.11).» C’est-à-dire la littérature faite par les Groulx et
Frégault et qui, pour Ferron, déforme notre vision du passé. «Vraiment
on ne peut assumer que le passé qu’on a vécu (F.13)», c’est-à-dire celui
où le Canadien français a pris cons-cience de lui-même en réaction à la
colonisation anglaise. Avant cela, il n’y avait que des Français: la
prise du Canada par l’Angleterre, contrairement aux prétentions de
l’École de Montréal, n’a guère été ressentie par les Canadiens français.
Elle a cependant modifié leur comportement. Ils se sont adaptés aux
institutions anglaises et servis d’elles pour continuer de progresser
(F.126).» Les conclusions récentes de Fernand Dumont sur l’histoire et la conscience historique des Québécois divergent-elles autant que cela de la position du docteur Ferron? 5
moment
où il prend conscience de lui-même et acquiert la certitude de son
avenir. Or cette foi et cette conscience n’ont pas été ressenties au
Bas-Canada avant le XIXe siècle. Tout ce qui précède n’est que
littérature (F.11).» C’est-à-dire la littérature faite par les Groulx et
Frégault et qui, pour Ferron, déforme notre vision du passé. «Vraiment
on ne peut assumer que le passé qu’on a vécu (F.13)», c’est-à-dire celui
où le Canadien français a pris cons-cience de lui-même en réaction à la
colonisation anglaise. Avant cela, il n’y avait que des Français: la
prise du Canada par l’Angleterre, contrairement aux prétentions de
l’École de Montréal, n’a guère été ressentie par les Canadiens français.
Elle a cependant modifié leur comportement. Ils se sont adaptés aux
institutions anglaises et servis d’elles pour continuer de progresser
(F.126).» Les conclusions récentes de Fernand Dumont sur l’histoire et la conscience historique des Québécois divergent-elles autant que cela de la position du docteur Ferron? 5Ferron s’oppose ici à la thèse de Frégault lorsqu’il reconnaissait que les Canadiens n’étaient déjà plus des Français en 1760,6 mais Ferron entend dégager que l’histoire de la conscience ne suit pas toujours immédiatement la progression événementielle. «Se concevoir comme peuple» est une chose, un «pour soi»; et l’évolution du peuple, «en soi», est une autre chose. Distinction ontologique sans doute, mais non sans d’im-portantes répercussions psychologiques et sociologiques. C’est l’histoire de la conception qui intéresse Ferron parce que le peuple québécois de son temps vit une «crise de conception», une crise d’identité de la conscience collective. La souveraineté devient alors la jonction de la progression événementielle et de la conscience comme historicité, car «il n’y a rien pour un peuple conscient de lui-même qui remplace la souveraineté (F.126).» C’est le moment stratégique déjà mentionné du kairos. L’élection du Parti Québécois le soir du 15 novembre 1976 parut être l’annonce de ce moment messianique où l’«obscure certitude» se ferait enfin lumière historiale. Le soir du 20 mai 1980, les Québécois se sont eux-mêmes coupé le courant!
Le syndrome du Chouayen
Le rejet du régime français a-t-il quelque chose à voir avec cette auto-interruption de courant? Certes, il s’agit bien du rejet d’un mythe de l’inconscient historique, de l’errement d’une fausse conscience ou d’un accès de mélancolie de la «conscience malheureuse», appelez-ça comme vous voudrez, mais l’ambiguïté persiste malgré les «actes manqués» comme ces référendums de 1980 et 1995. Parlant de Rabelais, Ferron écrit : «Il est plaisant de lire les vieux auteurs français; ils sont nôtres à plus d’un titre (F.48).» Si Cartier, Champlain et Maisonneuve font partie de la conscience historique française et non de la conscience historique québécoise, comment alors Rabelais peut-il faire partie de notre aventure littéraire? L’opération n’est possible que si l’on considère la progression événementielle comme relevant d’un fait de contingence. Ainsi, «la découverte de l’Amérique, imprévisible, ne pouvait être qu’un accident. On la cueillera en passant pour l’ajouter au reste de la terre (F.41).» Le rejet du mythe s’accompagne, lui, du rejet des déterminismes, telle «la vieille explication généalogique, rabattue et fallacieuse, liée à la notion d’héritage, qui est sans doute le pire chien-dent de l’esprit humain (F.91).» Jusqu’aux plus récents romans et à la série télé que Radio-Canada en a tiré, L’Héritage, le disciple de Ferron, Victor-Lévy Beaulieu, reconverti en Marcel Gamache pour intellectuels yuppets à la Robert-Guy Scully, maintiendra cette option idéologique du maître.
Léandre Bergeron n’est pas loin de penser de même l’ordre chronologique, l’unité de temps, de l’histoire québécoise. À l’ancien triptyque du régime français, du régime anglais et du Canada de la Confédération, il substitue dans son ouvrage une division en quatre régimes: régime français (1534-1760), régime anglais (1760-1919), régime américain (1920-?) et une place pour un éventuel régime québécois, «régime où les Québécois seraient maîtres de leur destinée. Ça a toujours été le régime des autres. Nous, Québécois, avons toujours subi la domination des autres (B.8).» Cette succession est beaucoup plus idéologique qu’imaginaire. En fait, l’historicité de Bergeron est partagée entre son analyse marxiste, tiers-mondiste, très déterministe, sa structure symbolique plutôt fataliste et une lecture historique propre à l’optimisme manifeste et superficiel des années soixante qui privilégie l’étude de la période 1760-1867 avec les ouvrages de Fernand Ouellet, Jean-Paul Bernard, Jean-Pierre Wallot, Jean Hamelin, Yves Roby et Gilles Bourque. Ainsi, tandis que 52 pages du Petit Manuel sont réservées au régime français et 61 au régime américain, 131 portent sur le régime anglais, prolongé il est vrai, jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est significatif qu’aucune partie spécifique (ou liminaire) ne porte sur les Amérindiens qui n’apparaissent qu’avec l’arrivée des Blancs pour disparaître avec la Conquête anglaise et leur remplacement par l’habitant canayen; sur ce point, malgré leurs dénonciations, nos auteurs n’ont pas changé profondément leur structure relationnelle. Le régime québécois, pour sa part, doit se contenter des deux dernières lignes du manuel: «L’ordre régnant se défend pendant que les Québécois réfléchissent. L’Histoire continue (B.246).» Il y a là une fracture de l’historicité qui est bien réelle et qu’on pouvait soupçonner chez Ferron sans vraiment pouvoir l’identifier. On peut dire que Bergeron et Ferron s’entendent assez bien pour dire que la souveraineté est la jonction de la progression événementielle et de la conscience collective mûrie à point; une adéquation du réel et du subjectif collectif. Comme cette adéquation est prévue dans l’immédiateté, la périodisation de l’histoire, l’unité de temps de l’historiographie se trouve fractionnée désormais en fonction de cette eschatologie imminente du kairos. Comme l’écrit avec pertinence Jean Bouthillette: il «s’est consommée en nous une rupture entre la réalité nationale, désormais fixée dans un passé irrémédiablement fini, et la réalité socio-économique, assimilée au temps de l’Anglais – à un présent.»7 La réalité nationale ayant été projetée dans l’histoire idéalisée du régime français, et l’oppression coloniale polarisée sous la domination anglaise et canadienne, le présent demeure aliéné. Devant l’«obscure certitude» de l’historicité, il offre une «claire certitude» du nowhere qui rassurre notre inhibition de l’action et dont la meilleure traduction littéraire serait les dernières lignes du conte d’Edgar Poë, Le démon de la perversité: «Aujourd’hui je porte ces chaînes, et suis ici! Demain, je sera libre! – mais où?»8
Mais c’est la fin de notre aliénation qu’annoncent nos
 écrivains,
à une époque où ils peuvent y croire sans se douter que leur conviction
ou leur certitude repose encore sur une historicité erratique. La déprime post-référendaire a remis les pendules à l’heure. Ce kairos
n’était pas de leur temps, mais si fracturé que soit le temps, cela
n’est rien en comparaison de la fracture de l’unité de lieu. La
fluctuation historique des frontières n’a rien pour consolider la
conscience historique québécoise sur une limite géographique unanime. On
le constate déjà chez Ferron dans sa polémique avec Groulx: «L’erreur
de ce brave homme fut la suivante: il n’a pas compris que l’Amérique
française n’était au fond que l’Amérique amérindienne. Par le
Saint-Laurent, les Grands Lacs et le Mississipi, les Français avaient
organisé un réseau commercial, rien de plus. L’Amérique amérindienne
était divisée par les langues; l’Amérique française l’unifia et jusqu’à
un certain point la pacifia. C’est encore par le commerce que des
civilisations étrangères s’habituent le mieux les unes aux autres. Les
Français y trouvaient leur profit, les Amérindiens, qui n’avaient pas de
métallurgie, le leur (F.29).» Mais parler de l’Amérique amérindienne
est un pléonasme car il n’y avait que des Amérindiens partout, sur tout
le territoire de l’Amérique, d’un pôle à l’autre, avant la venue des
Européens. Pourquoi celle organisée par la France serait-elle plus
«amérindienne» que l’anglaise ou l’espagnole? «Que l’Amérique française
ait persisté jusqu’à la fin du siècle dernier, on le sait par la
chronique du Farouest, mais on n’en parle guère. Elle a persisté par la
fidélité et la nostalgie de l’Amérique amérindienne. Et elle est morte
avec celle-ci. Durant plus d’un siècle, elle fut une fenêtre, une
échappée, une ouverture à l’ouest du Québec. Elle nous fournit aussi un
atout politique (F.30).» Plus loin, Ferron écrit encore: «La
Nouvelle-France, relativement petite et bien délimitée, se doublait
d’une Amérique française immense qui n’était en somme que l’Amérique
amérindienne quelque peu réunie et pacifiée par une hégémonie française
(F.126).» Cet enchâssement de territoires, pour ne parler que du seul
qui nous intéresse, opère de la même manière que la représentation de la
périodisation dans l’historiographie cléricalo-nationaliste. Il faut le
jouer à l’inverse, comme au jeu des poupées russes, la plus grande,
l’Amérique amérindienne contenant la moins grande, l’Amérique française,
puis la moins petite, la Nouvelle-France (notamment la Province of Quebec
de l’Acte de 1774 qui réunissait à la vallée du Saint-Laurent tout le
bassin fluvial des Grands Lacs), enfin la plus petite de toutes, le
Québec de 1867. Et constater, avec Jean Bouthillette: «le Canada
français, comme une peau de chagrin, se rétrécit aux limites du Québec.»
9
écrivains,
à une époque où ils peuvent y croire sans se douter que leur conviction
ou leur certitude repose encore sur une historicité erratique. La déprime post-référendaire a remis les pendules à l’heure. Ce kairos
n’était pas de leur temps, mais si fracturé que soit le temps, cela
n’est rien en comparaison de la fracture de l’unité de lieu. La
fluctuation historique des frontières n’a rien pour consolider la
conscience historique québécoise sur une limite géographique unanime. On
le constate déjà chez Ferron dans sa polémique avec Groulx: «L’erreur
de ce brave homme fut la suivante: il n’a pas compris que l’Amérique
française n’était au fond que l’Amérique amérindienne. Par le
Saint-Laurent, les Grands Lacs et le Mississipi, les Français avaient
organisé un réseau commercial, rien de plus. L’Amérique amérindienne
était divisée par les langues; l’Amérique française l’unifia et jusqu’à
un certain point la pacifia. C’est encore par le commerce que des
civilisations étrangères s’habituent le mieux les unes aux autres. Les
Français y trouvaient leur profit, les Amérindiens, qui n’avaient pas de
métallurgie, le leur (F.29).» Mais parler de l’Amérique amérindienne
est un pléonasme car il n’y avait que des Amérindiens partout, sur tout
le territoire de l’Amérique, d’un pôle à l’autre, avant la venue des
Européens. Pourquoi celle organisée par la France serait-elle plus
«amérindienne» que l’anglaise ou l’espagnole? «Que l’Amérique française
ait persisté jusqu’à la fin du siècle dernier, on le sait par la
chronique du Farouest, mais on n’en parle guère. Elle a persisté par la
fidélité et la nostalgie de l’Amérique amérindienne. Et elle est morte
avec celle-ci. Durant plus d’un siècle, elle fut une fenêtre, une
échappée, une ouverture à l’ouest du Québec. Elle nous fournit aussi un
atout politique (F.30).» Plus loin, Ferron écrit encore: «La
Nouvelle-France, relativement petite et bien délimitée, se doublait
d’une Amérique française immense qui n’était en somme que l’Amérique
amérindienne quelque peu réunie et pacifiée par une hégémonie française
(F.126).» Cet enchâssement de territoires, pour ne parler que du seul
qui nous intéresse, opère de la même manière que la représentation de la
périodisation dans l’historiographie cléricalo-nationaliste. Il faut le
jouer à l’inverse, comme au jeu des poupées russes, la plus grande,
l’Amérique amérindienne contenant la moins grande, l’Amérique française,
puis la moins petite, la Nouvelle-France (notamment la Province of Quebec
de l’Acte de 1774 qui réunissait à la vallée du Saint-Laurent tout le
bassin fluvial des Grands Lacs), enfin la plus petite de toutes, le
Québec de 1867. Et constater, avec Jean Bouthillette: «le Canada
français, comme une peau de chagrin, se rétrécit aux limites du Québec.»
9La fracture de l’espace nous conduit enfin à la fracture de l’unité d’action, de l’intrigue que vit la collectivité québécoise. C’est la fracture la plus pénible à supporter car elle est celle qui nous rappelle le risque de l’éclatement (Québec divisé contre lui-même, le syndrome hérité de l’habitude qu’ont les Français de laver leur linge sale dans le sang de la famille), comme la tentation de nous assimiler à l’Autre (l’Autochtone, l’Anglais, l’Américain et, pourquoi pas, le Néo-Québécois, le nouvel arrivant?). Ces lignes, encore de Bouthillette, résument assez bien toute la problématique de la fracture de l’intrigue québécoise: «Prise au piège de la fiction juridique, notre identité réelle s’est secrètement disloquée. La distance que la langue établit entre l’Anglais et nous, c’est en nous qu’elle s’est absurdement creusée, écartelant notre être canadienfrançais jusqu’à la rupture. Canadien d’abord, français ensuite – ou ses variantes – nous voyons maintenant que le langage courant traduit un éclatement réel de notre identité une et indivisible nous nous séparons en deux parts qui ne se reconnaissent plus, qui se dressent même l’une contre l’autre. Déchirée notre unité intérieure et éclatée notre synthèse organique, nous projetons dans la réalité canadienne une image brisée de nous-mêmes qui est l’expression d’un dédoublement de la personnalité collective. Nous sommes atteints dans la notion même de notre identité.»10 Ce qui apparaît de manière éclatante lorsqu’on voit comment Léandre Bergeron essaie de distinguer le Canadien français du Canayen, puis du Québécois… «Pour ne pas confondre les divers sens qu’a pris le mot canadien à diverses époques, nous allons employer canayen pour parler des 70 000 Français du Canada et leurs descendants sous le régime anglais. Nous employerons canadien-français pour nommer les Canayens qui se sont vendus aux Anglais, qui ont collaboré avec le colonisateur et ceux qui croient encore que le fédéralisme canadien a quelque chose à offrir au peuple québécois. Le Canadien-français est le Canayen qui a accepté son sort de colonisé, et qui lèche les bottes du colonisateur anglais ou américain… Le Québécois est le Canayen qui refuse le colonialisme, qui le combat, qui travaille pour que le peuple québécois se libère de la domination anglo-canado-américaine et que le Québec devienne un pays et une patrie (B.49 n. 2).» La fracture de l’intrigue nationale entre le syndrome du Chouayen (c’était le nom méprisant que les Patriotes de 1837 donnaient aux «collaborateurs» du gouvernement colonial anglais) et l’impérative cohésion serrée de la petite collectivité frileuse le long du Saint-Laurent même au prix de l’assimilation anglo-saxonne reste une épreuve pour tout Québécois. Avec la haine de l’Anglais, la haine de l’Amérindien, la fracture provient d’une historicité fuyante entre plusieurs identités souvent antithétiques. D’irrépressibles angoisses surgissent devant les défis historiques, les prises de décisions qui engagent pour la continuité. Durée et territoire peuvent bien se perdre dans la conscience historique, mais que le peuple lui-même se perde de vue, comme l’énonce Bouthillette, se déchire notre synthèse organique, et c’est la mort qui triomphe.
Plus qu’une défaite aux mains des Anglais, plus qu’une trahison de l’Amérindien, plus que
 l’avortement
du Bâtard québécois, c’est l’éclatement de l’unité dans la conscience
collective que rappellent les récits des Rébellions de 1837-38. Combien
de Canadiens, instruits ou ignares, riches ou pauvres, commerçants ou
ouvriers, habitants ou censitaires se sont rangés aux côtés du
gouvernement colonial et de l’inflexible Colborne pour réprimer, par le
feu et dans le sang, le soulèvement des Patriotes? Ces Chouayens
– le mot est devenu tabou, on les appelait aussi les Bureaucrates! –,
ne sont-ils pas ces Canadiens français que mentionne la nomenclature de
Léandre Bergeron? Et si «la vieille explication généalogique, rabattue
et fallacieuse, liée à la notion d’héritage» dont parlait le docteur
Ferron, était aussi l’angoisse de soi, notre incertitude vis-à-vis de
nos réactions propres, notre incapacité de nous consolider et de nous
constituer en communauté sur un plan homogène qui serait, pour une fois,
autre chose que l’inhibition de l’action? Le Canadien français empêche
le Québécois d’émerger comme le Chouayen dénonçait le Patriote auprès
des autorités britanniques, tel est ce syndrome, typiquement français,
dont nous aurions «hérité» par nos racines généalogiques. La voici,
l’«explication généalogique»: Capétiens contre Albigeois? Armagnacs
contre Bourguignons? Ligueurs contre Huguenots? Révolutionnaires contre
Fédéralistes? Prolétaires contre paysans et bourgeois réunis?
Commu-nards contre Versaillais? Dreyfusards contre Anti-Dreyfusards?
Communistes contre Socialistes et les deux ensemble contre les
Anarcho-syndicalistes? Vichy contre le Front Populaire? Les partisans de
l’Algérie libre contre les «para»? Et nous? Chouayens contre Patriotes?
Rielistes contre Anti-Rielistes? Conscriptionnistes contre
Anti-Conscriptionnistes? Fédéralistes contre Souverainistes? Ce syndrome
du Chouayen, l’historiographie cléricalo-nationaliste l’exorcisait en
remontant dans un temps d’avant le syndrome, la Nouvelle-France.
l’avortement
du Bâtard québécois, c’est l’éclatement de l’unité dans la conscience
collective que rappellent les récits des Rébellions de 1837-38. Combien
de Canadiens, instruits ou ignares, riches ou pauvres, commerçants ou
ouvriers, habitants ou censitaires se sont rangés aux côtés du
gouvernement colonial et de l’inflexible Colborne pour réprimer, par le
feu et dans le sang, le soulèvement des Patriotes? Ces Chouayens
– le mot est devenu tabou, on les appelait aussi les Bureaucrates! –,
ne sont-ils pas ces Canadiens français que mentionne la nomenclature de
Léandre Bergeron? Et si «la vieille explication généalogique, rabattue
et fallacieuse, liée à la notion d’héritage» dont parlait le docteur
Ferron, était aussi l’angoisse de soi, notre incertitude vis-à-vis de
nos réactions propres, notre incapacité de nous consolider et de nous
constituer en communauté sur un plan homogène qui serait, pour une fois,
autre chose que l’inhibition de l’action? Le Canadien français empêche
le Québécois d’émerger comme le Chouayen dénonçait le Patriote auprès
des autorités britanniques, tel est ce syndrome, typiquement français,
dont nous aurions «hérité» par nos racines généalogiques. La voici,
l’«explication généalogique»: Capétiens contre Albigeois? Armagnacs
contre Bourguignons? Ligueurs contre Huguenots? Révolutionnaires contre
Fédéralistes? Prolétaires contre paysans et bourgeois réunis?
Commu-nards contre Versaillais? Dreyfusards contre Anti-Dreyfusards?
Communistes contre Socialistes et les deux ensemble contre les
Anarcho-syndicalistes? Vichy contre le Front Populaire? Les partisans de
l’Algérie libre contre les «para»? Et nous? Chouayens contre Patriotes?
Rielistes contre Anti-Rielistes? Conscriptionnistes contre
Anti-Conscriptionnistes? Fédéralistes contre Souverainistes? Ce syndrome
du Chouayen, l’historiographie cléricalo-nationaliste l’exorcisait en
remontant dans un temps d’avant le syndrome, la Nouvelle-France. La Conquête exerçait un rôle qu’on lui attribue rarement, c’est-à-dire
qu’elle intervenait juste à temps pour nous éviter ces «révolutions»
nationales dont Bougainville soupçonnait déjà les prémisses. Dans ce
contexte, ce que Ferron n’a pas vu dans l’anecdote de Dollard, et qui
revient comme un leitmotiv dans les exposés de Groulx et les
brochurettes des «Gloires nationales» de Guy Laviolette,11 c’est moins
la haine de l’Iroquois que le ralliement spontané des combattants à la
cause de la défense nationale. La lâcheté (les Hurons) et la fourberie
(les Iroquois) deviennent l’apanage des Amérindiens et s’opposent au
sacrifice des valeureux qui se sont joints à Dollard, le Patriote.
Jamais Ferron n’a soupçonné que, derrière l’anecdote du Long-Sault, sur
laquelle nous savons si peu de choses, c’est toute l’histoire de la Rébellion manquée
de 1837-38 qui se disait, qui se racontait. Censurée, l’Histoire
réinvestissait l’historiographie sous l’angle mythique d’un affrontement
livré au hasard.
La Conquête exerçait un rôle qu’on lui attribue rarement, c’est-à-dire
qu’elle intervenait juste à temps pour nous éviter ces «révolutions»
nationales dont Bougainville soupçonnait déjà les prémisses. Dans ce
contexte, ce que Ferron n’a pas vu dans l’anecdote de Dollard, et qui
revient comme un leitmotiv dans les exposés de Groulx et les
brochurettes des «Gloires nationales» de Guy Laviolette,11 c’est moins
la haine de l’Iroquois que le ralliement spontané des combattants à la
cause de la défense nationale. La lâcheté (les Hurons) et la fourberie
(les Iroquois) deviennent l’apanage des Amérindiens et s’opposent au
sacrifice des valeureux qui se sont joints à Dollard, le Patriote.
Jamais Ferron n’a soupçonné que, derrière l’anecdote du Long-Sault, sur
laquelle nous savons si peu de choses, c’est toute l’histoire de la Rébellion manquée
de 1837-38 qui se disait, qui se racontait. Censurée, l’Histoire
réinvestissait l’historiographie sous l’angle mythique d’un affrontement
livré au hasard.Jugeons de ce qu’il en est. La résurrection de Dollard date de 1910-1920. Elle est contemporaine d’un besoin de ralliement collectif qui s’impose entre la crise de la conscription de 1917 et la crise des Écoles françaises de l’Ontario (le Règlement XVII) qui opposent une partie des Québécois à l’autre, et de façon à susciter des animosités toujours plus vives. Ce n’est pas pour rien que le Ministre fédéral de la Milice, le très anti-francophone Sam Hugues, fait distribuer des affiches de propagande avec l’illustration de Dollard repoussant l’assaut au Long-Sault:
 Canadiens!
Canadiens!Suivez l’exemple de Dollard des Ormeaux.
N’attendez pas l’ennemi au coin du feu,
mais allez au devant de lui.
En Avant! Canadiens-Français
Enrôlez-vous dans les Régiments Canadiens-Français.
 De
même, la brochure de Guy Laviolette paraît en 1944, au moment où la
seconde crise de la conscription déchire le consensus national
québécois. Un poème miteux du cardinal Villeneuve termine la brochure
appelant les jeunes Québécois à imiter Dollard et à se montrer courageux
en ces temps pleins d’adversité.12 L’angoisse de la guerre civile se
manifeste toujours dans les moments critiques où les Québécois doivent
se prononcer sur leur autonomie face aux contraintes fédérales. Il est
difficile de dire si le syndrome du Chouayen est structurel à notre
«préhistoire» française, ou acquis suite à un traumatisme qu’il serait
possible de surmonter par des moyens politiques et idéologiques capables
de restaurer la psychologie collective des Québécois. Entre un
affrontement civil toujours possible qui, compte tenu de notre fragilité
démographique pourrait s’avérer suicidaire, et une stratégie de
l’inhibition de l’action qui entretient le syndrome au risque de
l’insignifiance historique et de la pétrification mentale et sociale (le
«repos cadavérique»), nous nous refusons à la bâtardise. …et nous
divaguons entre l’Enfant trouvé et l’avorton.13
De
même, la brochure de Guy Laviolette paraît en 1944, au moment où la
seconde crise de la conscription déchire le consensus national
québécois. Un poème miteux du cardinal Villeneuve termine la brochure
appelant les jeunes Québécois à imiter Dollard et à se montrer courageux
en ces temps pleins d’adversité.12 L’angoisse de la guerre civile se
manifeste toujours dans les moments critiques où les Québécois doivent
se prononcer sur leur autonomie face aux contraintes fédérales. Il est
difficile de dire si le syndrome du Chouayen est structurel à notre
«préhistoire» française, ou acquis suite à un traumatisme qu’il serait
possible de surmonter par des moyens politiques et idéologiques capables
de restaurer la psychologie collective des Québécois. Entre un
affrontement civil toujours possible qui, compte tenu de notre fragilité
démographique pourrait s’avérer suicidaire, et une stratégie de
l’inhibition de l’action qui entretient le syndrome au risque de
l’insignifiance historique et de la pétrification mentale et sociale (le
«repos cadavérique»), nous nous refusons à la bâtardise. …et nous
divaguons entre l’Enfant trouvé et l’avorton.13Nous devons conclure maintenant et résumer les causes profondes de la démoralisation tranquille des années soixante qui pèse toujours de son poids sourd sur la psyché collective des Québécois. Les livres de Ferron, de Bergeron et de Beaulieu nous ont permis de remonter aux sources profondes de notre conscience historique. D’une part, l’évolution historique, la modernisation de la société québécoise, d’autre part, la décrépitude des valeurs traditionnelles, l’état d’anomie morale, les déchirements des symboles affectifs. Sauvegarder l’unité collective, ce que parvenait à faire relativement bien les valeurs de l’historiographie cléricalo-nationalistes, et accorder la conscience nationale avec la progression événementielle du Québec moderne; c’est-à-dire, mettre à jour le sentiment d’appartenance des Québécois au Québec seul, ce qu’exigeait impérativement la poursuite de la modernisation et le rattrapage des retards de la conscience collective, c’était un pari énorme à relever, compte tenu, précisément, de tous nos antécédants.
Pressentant plus l’imminence d’un kairos historique qu’ils ne comprennent, avec une lucidité que seul Jean Bouthillette semble avoir atteinte, la crise morale de l’époque, Ferron, Bergeron et Beaulieu se sont démenés comme des diables dans l’eau bénite entre les contradictions de leur temps. Et avec eux, c’est toute la société qui avoue l’urgence de la mise à jour. L’échec du «Oui» aux deux référendums (1980 et 1995) de même que l’issue sordide des Accords du Lac Meech montrent que le travail n’a pas été accompli comme il le fallait. L’écart entre la nature des problèmes posés et la faiblesse des explications et des solutions proposées était trop vaste. Ce n’est pas seulement l’échec de nos auteurs que nous mesurons, mais bien l’échec de toute une génération, une génération trop vite installée aux leviers de commande et séduite par le «confort et l’indifférence» de la modernité consommatrice. Perfide Capua!Mais n’est-ce pas une explication un peu trop facile que celle de l’embourgeoisement rapide des têtes fortes des années soixante? Inutile de suivre tous les séminaires de Lacan pour
 comprendre
que la conscience du manque est l’expression d’un désir. Beaulieu, pas
plus que Ferron ou Bergeron, ne dénonce les colons, les clercs,
l’intempérance, le sanatorium ou les petits martyrs. C’est la misère, et
encore plus, le misérabilisme qu’ils dénoncent. Paradoxalement, c’est
lorsque les terres de colonisation
se ferment que Beaulieu écrit sur la misère réelle de la vie du colon;
ce n’est que lorsque la pratique religieuse tombe drastiquement qu’il
vitupère contre le clergé et la démoralisation religieuse; ce n’est que
lorsque la lutte contre l’alcoolisme cède la place à la lutte contre
l’usage des drogues qu’il ridiculise les campagnes de tempérance; ce
n’est que lorsque la tuberculose n’est plus une menace sérieuse qu’il
conspue le sanatorium; ce n’est que lorsque les vocations et le
recrutement des missionnaires tombent à presque zéro qu’il rigole des
petits martyrs et des mystiques aux tares physiologiques et
psychologiques aberrantes. Bref, ce n’est que lorsque les Québécois
tendent à devenir de francs pragmatiques qu’on rappelle leurs fantasmes
infantiles. Entre la société des vocations et la société de
consommation, Victor-Lévy Beaulieu ne peut honnêtement faire le deuil
des idéaux nobles et élevés et des beaux souvenirs d’enfance qu’il
regrette de voir disparaître face à un nouveau monde préjugé déjà comme
impitoyable, superficiel; où la technologie et la richesse uniformisent
et avilissent les rêves. Comment condamner sans rejeter une grandeur
morale qui avait fait vivre tant de générations de Québécois où se
recrutaient aussi de beaux spécimens de noblesse humaine? Et comment le
faire, et surtout, pour laisser entrer quoi? toutes ces pacotilles et
ces gadgets à l’américaine? Beaulieu n’est pas fou tout de même!
comprendre
que la conscience du manque est l’expression d’un désir. Beaulieu, pas
plus que Ferron ou Bergeron, ne dénonce les colons, les clercs,
l’intempérance, le sanatorium ou les petits martyrs. C’est la misère, et
encore plus, le misérabilisme qu’ils dénoncent. Paradoxalement, c’est
lorsque les terres de colonisation
se ferment que Beaulieu écrit sur la misère réelle de la vie du colon;
ce n’est que lorsque la pratique religieuse tombe drastiquement qu’il
vitupère contre le clergé et la démoralisation religieuse; ce n’est que
lorsque la lutte contre l’alcoolisme cède la place à la lutte contre
l’usage des drogues qu’il ridiculise les campagnes de tempérance; ce
n’est que lorsque la tuberculose n’est plus une menace sérieuse qu’il
conspue le sanatorium; ce n’est que lorsque les vocations et le
recrutement des missionnaires tombent à presque zéro qu’il rigole des
petits martyrs et des mystiques aux tares physiologiques et
psychologiques aberrantes. Bref, ce n’est que lorsque les Québécois
tendent à devenir de francs pragmatiques qu’on rappelle leurs fantasmes
infantiles. Entre la société des vocations et la société de
consommation, Victor-Lévy Beaulieu ne peut honnêtement faire le deuil
des idéaux nobles et élevés et des beaux souvenirs d’enfance qu’il
regrette de voir disparaître face à un nouveau monde préjugé déjà comme
impitoyable, superficiel; où la technologie et la richesse uniformisent
et avilissent les rêves. Comment condamner sans rejeter une grandeur
morale qui avait fait vivre tant de générations de Québécois où se
recrutaient aussi de beaux spécimens de noblesse humaine? Et comment le
faire, et surtout, pour laisser entrer quoi? toutes ces pacotilles et
ces gadgets à l’américaine? Beaulieu n’est pas fou tout de même!Il y a lieu de se demander comment une telle génération, aussi inconsciente des motivations profondes qui l’animaient, aurait pu gagner le référendum de mai 1980. L’imprécision même de la question ne dénote-t-elle pas tout ce que nous devons au syndrome du Chouayen? Comment une telle génération, partant déjà si démoralisée, aurait-elle pu continuer à entre-tenir un État-Providence juste et socialement équitable devant le déferlement du capitalisme spéculatif des corporations bancaires mondiales? Ou encore, comment pourrait-elle faire du Québec une société bourgeoise et capitaliste entreprenante et prospère mais rapace et sauvage comme celle des États-Unis ou des cinq dragons asiatiques? Chimères que tout ça! Dès 1970, elle commençait déjà à regretter d’avoir osé risquer le bout de l’ombre de l’ongle du gros orteil dans l’Histoire. Elle se prenait à désavouer, mais à regretter tout de même, ses colons miséreux, ses bedeaux de clochers, ses tuberculeux
 ensanatoriumisés
et ses petits mystiques d’églises de poupées. Elle n’a pas attendu
l’arrivée du CRACK pour mettre en place de nouvelles ligues de tempérance
ni l’afflux du SIDA pour cultiver de nouvelles thérapies du «repos
cadavérique». C’est toute la société maintenant qui est mise au «repos
cadavérique», dans ce grand sanatorium qu’est le Québec, qu’est son
Québec, supposément moderne et éclairé comme jamais! Il n’y a plus qu’un
clocher sous lequel les bedeaux se perdent en chicanes de juridictions.
La génération des années soixante n’a pas purgé les Québécois du
sado-masochisme issu de la haine de soi et géré alors névrotiquement par
le clergé (maintenant par les fonctionnaires d’État), parce qu’elle n’a
pas su circons-crire comme il le fallait ses «bibittes» de souterrain.
Elle l’a laïcisé, étatisé et capitalisé, mais elle n’a pas su régler ce
pro-blème de la haine de soi. Elle a élargi la petitesse à la grandeur
de tout le Québec qui est devenu ce grand sanatorium pour chômeurs et
assistés sociaux sans avenir, vieillards prématurés et adolescents
passés date, tous nouveaux atteints d’une maladie mortelle pire que la
tuberculose ou la poliomyélite, comme si c’était imaginable! Tout un
clergé de hauts-fonctionnaires remplace désormais l’épiscopat, les
cols-blancs ont pris la place des collets romains des noires
«corneilles» et des «pisseuses à cornettes». Seuls les professionnels
(médecins, avocats, professeurs) continuent de jouer le même rôle
qu’avant 1960, bien que leur prestige se porte plutôt assez mal merci!
Ce tiers-ordre laïc critique à la fois la concentration de la richesse
dans les mains de quelques-uns et la protection sociale que l’État
accorde (parcimonieusement) aux plus démunis. Comme au XIXe siècle, on
voit encore où frappe le syndrome du Chouayen.
ensanatoriumisés
et ses petits mystiques d’églises de poupées. Elle n’a pas attendu
l’arrivée du CRACK pour mettre en place de nouvelles ligues de tempérance
ni l’afflux du SIDA pour cultiver de nouvelles thérapies du «repos
cadavérique». C’est toute la société maintenant qui est mise au «repos
cadavérique», dans ce grand sanatorium qu’est le Québec, qu’est son
Québec, supposément moderne et éclairé comme jamais! Il n’y a plus qu’un
clocher sous lequel les bedeaux se perdent en chicanes de juridictions.
La génération des années soixante n’a pas purgé les Québécois du
sado-masochisme issu de la haine de soi et géré alors névrotiquement par
le clergé (maintenant par les fonctionnaires d’État), parce qu’elle n’a
pas su circons-crire comme il le fallait ses «bibittes» de souterrain.
Elle l’a laïcisé, étatisé et capitalisé, mais elle n’a pas su régler ce
pro-blème de la haine de soi. Elle a élargi la petitesse à la grandeur
de tout le Québec qui est devenu ce grand sanatorium pour chômeurs et
assistés sociaux sans avenir, vieillards prématurés et adolescents
passés date, tous nouveaux atteints d’une maladie mortelle pire que la
tuberculose ou la poliomyélite, comme si c’était imaginable! Tout un
clergé de hauts-fonctionnaires remplace désormais l’épiscopat, les
cols-blancs ont pris la place des collets romains des noires
«corneilles» et des «pisseuses à cornettes». Seuls les professionnels
(médecins, avocats, professeurs) continuent de jouer le même rôle
qu’avant 1960, bien que leur prestige se porte plutôt assez mal merci!
Ce tiers-ordre laïc critique à la fois la concentration de la richesse
dans les mains de quelques-uns et la protection sociale que l’État
accorde (parcimonieusement) aux plus démunis. Comme au XIXe siècle, on
voit encore où frappe le syndrome du Chouayen.Aussi, ne faut-il pas s’étonner outre mesure si, en cette fin de siècle et de millénaire, le poids des mentalités traditionnelles et des structures psychiques traumatisées refait surface tout en s’adaptant aux idéologies actuelles avec la plasticité et la malléabilité de la glaise. Lorsque Victor-Lévy Beaulieu parle du docteur Gendron, médecin de Marie-Rose Ferron de Woonsocket, qui invente un dentier aux dents avant amovibles pour permettre à la paralysée de communier – «un Ecce Homo dans toute sa gloire apparut dans le palais du dentier» (VLB.179-180) –, il raconte une anecdote qui se situe à égale distance entre les crises de possession endurée par madame Calixte Brault, la mystique montréalaise du début du siècle 14 et la Catudal, cette charimatique qui voyait encore, il y a peu, Notre-Seigneur lui apparaître sur le hood de son char. La distance établie entre ces «délires» se compare à celle comprise entre la grande chasse aux sorcières du XVIe siècle, les séances de tables tournantes du XIXe siècle et les horoscopes de nos quotidiens actuels. On peut voir dans cette comparaison une rémission possible de nos tendances morbides. À moins que la nécrose soit déjà suffisamment engagée et que le Québec de-vienne cette terre d’asile(s) où fleuriront ses deux vocations historiques relevées par Victor-Lévy Beaulieu: terre d’accueil de nouvelles populations immigrantes (les Néo-Québécois); et centre hospitalier pour déficients mentaux (Québécois de souche). Oui, bien sûr, tout cela, ce n’est que de la littérature, j’en conviens.
Mais, écrivait Ferron, «qu’est-ce que la littérature d’un pays sinon le procès de sa civilisation (F.48)?»⌛
Notes
- Cité in C. Berger. The Writing of Canadian History, oronto, Oxford University Press, 1976, p. 183.
- L. Groulx. Dollard est-il un mythe? Montréal, Fides, 1960, p. 8.
- L. Groulx. ibid. p. 57.
- J. Bouthillette. Le Canadien français et son double, Montréal, L'Hexagone, 196, p. 13.
- Cf. F. Dumont. Genèse de la société québécoise, Montréal, Boréal, 1993, 398 p.
- J. Bouthillette. op. cit. p. 55.
- E. Poe. Nouvelles histoires extraordinaires, Paris, Gallimard/Livre de poche, Col. Classiques # 1055, 1963, p. 12.
- J. Bouthillette. op. cit. p. 37. Et ce rétrécissement pourrait ne pas être fini! Au moment où je revise ce texte pour l'édition, j'entends le nouveau ministre fédéral, le «potologue» Stéphane Dion, parler de la «partition» du Québec avec plus de légèreté que les Péquistes parlent de celle du Canada. Cet autre universitaire opportuniste, qui a bénéficié des coups de pouce de «papa» et du maquillage de la poudreuse en chef du Point, à Radio-Canada, se prend désormais pour un second Trudeau. Devrait-on lui rappeler comment Victor Hugo qualifiait Napoléon III de «Petit», par rapport à Napoléon Ier, le Grand? Devrait-on lui rappeler aussi le méchant mot de Marx, dans son «Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte» selon qui les personnages historiques se répètent deux fois: «la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce»? Puis, il y a ce hargneux et mégalomane Guy Bertrand, jamais assouvi de son dépit d'avoir été vaincu à la chefferie du P.Q. et qui entend régler ses comptes personnels sur le dos du Québec tout entier. Le voici annonçant la partition du Québec et la fondation de la «province de Maisonneuve» - vraiment! après ce qui a été dit sur son compte par Ferron, quel hommage à rendre aux couillons! Et pour terminer ce sottisier, mentionnons ce comté de la Gatineau qui, advenant l'indépendance du Québec, réclamerait un statut de «duché» - comme si les ducs poussaient dans les arbres. Quelle réminiscence du «roman familial» de l'Enfant trouvé! Est-ce pathétique d'aliénation? Pitoyable de lâcheté? Mais de quel bord résident les vrais idéaux?
- J. Bouthillette. ibid. pp. 45-46.
- G. Laviolette. Dollard des Ormeaux, Québec, Éd. de l'A.B., 1944.
- Sur le poème du cardinal Villeneuve, cf. G. Laviolette. ibid. p. 32. On peut voir une reproduction de l'affiche dans J. Lacoursière et H.-A. Bizier (éd.) Nos Racines, vol. 11, # 122, 1982, p. 2432 et dans J. Hamelin (éd.) Histoire du Québec, Toulouse/Saint-Hyacinthe, Privat/Édisem, 1976, pl. XXV. L'attribution de l'affiche en 1942 est une erreur.
- …entre Lucien Bouchard et Stéphane Dion! (Janvier 1996).
- Ce titre, bien sûr, est une parodie du célèbre manuel de puériculture autorisé avant les années soixante: La mère canadienne et son enfant.
- Sur la mystique Calixte Brault, lire de L. Bouhier. Une mystique canadienne, vie extraordinaire de Madame Brault, Montréal, Beauchemin, 1942. Je remercie mon ami l'écrivain Georges Raby de m'avoir fait connaître cet hirsute personnage digne de ses nouvelles, ou encore de l'historiographie cléricalo-nationaliste qui se pâmait devant les crises de possession de Mère Catherine de Saint-Augustin. Il semble que la biographie et le personnage de Mme Brault aient échappé à la vigilance de Victor-Lévy Beaulieu.




























































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire