http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_19.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/lage-de-croissance.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_17.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_16.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur_15.html
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2014/12/une-histoire-de-saint-jean-sur.html
Bibliographie et Table des Matières
http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2011/05/une-histoire-de-saint-jean-sur-richelieu.html
 première
succursale de vente Singer au Canada est ouverte à Toronto en 1857 et en
1883 la Singer commençait à manufacturer dans son usine de Montréal. Son
succès contraignit la maison-mère à trouver un nouvel endroit où produire ses
machines à coudre destinées à l’exportation en Amérique du Sud. En 1903,
toujours sur sa lancée, Singer poussa son regard vers Saint-Jean, située
au cœur des voies de communications fluviales et ferroviaires. La compagnie
fait promesse à la Ville d’employer 2 000 personnes dès ses débuts et près d’un
millier juste pour la construction de l’usine, appelée à devenir la plus grosse
du Canada. Le Conseil municipal pense aux retombées qu’une telle entreprise
peut générer. En retour, la compagnie se protège en faisant inscrire dans le
contrat l’octroi de terrains et de privilèges, ainsi que l’exemption de taxes
et la concession de droits que la Ville lui fait.[1]
Il y a bien quelques réticences au début, mais Le Courrier de Saint-Jean, journal
de Jacques-Émery Molleur, se charge de faire la propagande pour faire accepter
la venue de la Singer. Cette propagande ira au-delà de toutes
espérances. On discute beaucoup des concessions qu’exige la compagnie :
première
succursale de vente Singer au Canada est ouverte à Toronto en 1857 et en
1883 la Singer commençait à manufacturer dans son usine de Montréal. Son
succès contraignit la maison-mère à trouver un nouvel endroit où produire ses
machines à coudre destinées à l’exportation en Amérique du Sud. En 1903,
toujours sur sa lancée, Singer poussa son regard vers Saint-Jean, située
au cœur des voies de communications fluviales et ferroviaires. La compagnie
fait promesse à la Ville d’employer 2 000 personnes dès ses débuts et près d’un
millier juste pour la construction de l’usine, appelée à devenir la plus grosse
du Canada. Le Conseil municipal pense aux retombées qu’une telle entreprise
peut générer. En retour, la compagnie se protège en faisant inscrire dans le
contrat l’octroi de terrains et de privilèges, ainsi que l’exemption de taxes
et la concession de droits que la Ville lui fait.[1]
Il y a bien quelques réticences au début, mais Le Courrier de Saint-Jean, journal
de Jacques-Émery Molleur, se charge de faire la propagande pour faire accepter
la venue de la Singer. Cette propagande ira au-delà de toutes
espérances. On discute beaucoup des concessions qu’exige la compagnie :«Or, ces concessions : c’était la livraison franche et nette de toute charge d’un terrain de 26 acres, une exemption de taxes et de contribution foncières pour une période de 20 ans, la ville s’engageait de plus à fournir et à ses frais pour l’usage exclusif de la compagnie une voie ferrée pour relier le terrain de l’usine à celui du Grand-Tronc; un quai sur le bord de la rivière Richelieu avec des hangars appropriés, lequel sera relié à l’usine par un tramway construit par la municipalité sur la rue Saint-Paul, enfin fournir toute la quantité d’eau dont la compagnie aura besoin. Mais cette dernière mesure allait coûter cher à la corporation de la Ville de Saint-Jean».[2]
«Le Courrier de Saint-Jean reprochera les dépenses occasionnées pour la construction de ce canal en 1909, lorsque la situation à Saint-Jean sera critique (crise économique) et qu’on s’apercevra que la Singer ne remplit pas ses promesses, n’employant que 500 hommes. Le journal profitera de la tenue d’élections municipales pour remettre en question le rôle du conseiller Alphonse Gervais, qui se présentait maintenant comment maire, et qui avait agi comme président du comité des finances lors du règlement 92…»[3]
«Rien qu’en surface de planchers, la nouvelle manufacture était 25 fois plus grande que l’usine originale de Montréal. Outre la machinerie, de production ordinaire, elle possédait sa propre fonderie et sa centrale de force motrice ainsi qu’un réseau étendu de voies ferrées. Au cours de sa première année d’opérations, elle produisait plus de 50 000 machines à coudre. Aujourd’hui, elle est capable de produire plusieurs fois ce nombre annuellement».[5]
«Les ouvriers de Saint-Jean furent les premiers à se plaindre des mauvaises conditions de travail et de l’exploitation dont ils se sentaient les victimes par la firme de New York. Il faut cependant ajouter que les ouvriers johannais recevaient des gages inférieurs à ceux de Montréal et des environs; et inférieurs à ce que l’union ouvrière de Saint-Jean recommandait pour les employés de la construction.C’est ainsi que les travailleurs de Saint-Jean déclencheront une grève spontanée afin d’obtenir justice; c’est-à-dire une augmentation de salaire et le même nombre d’heures que les autres employés. La compagnie américaine se montrera intransigeante face à ses employés inorganisés, elle se mit tout simplement en lockout.
Lors de cette grève on essaiera de dénigrer le mouvement ouvrier en mettant sur le dos de l’Union ouvrière de Saint-Jean la responsabilité du conflit.Les leaders ouvriers locaux : Dionne, Lamoureux et Lasnier durent apporter un démenti formel dans les journaux locaux…Les leaders syndicaux condamnaient les petits entrepreneurs mais en même temps l’action des grévistes, ces derniers non syndiqués, se voyaient abandonnés à leur sort.On peut se demander si ce manque d’appui de l’Union ouvrière de Saint-Jean n’a pas contribué à étouffer le mouvement de protestation spontanée des ouvriers johannais? Toujours est-il qu’on entendit plus parler de ce conflit dans les journaux locaux. Il est difficile de parler ici de victoire patronale ou ouvrière car les sources se font discrètes à ce sujet».[6]
 moulins à coudre. En décembre 1906, la production quotidienne s’élève à
1 200 machines. Les dimensions de l’usine font qu’à ses débuts, Singer apparaît
véritablement comme une ville dans une ville, fonctionnant de manière autonome.
Sa voie ferrée occupe le centre de la rue Saint-Paul et s'étire sur une
distance de 8 kilomètres. La locomotive Singer, aussi surnommée le «p'tit char», est alimentée par un courant de 240 volts. En fonction depuis les
débuts de l'usine, il semblerait que le «p'tit char» aurait cessé de
fonctionner à l'hiver 1918. Selon les souvenirs, le «p'tit char», de
couleur rouge, était conduit par un employé qui faisait sonner la cloche pour
avertir les gens de son passage :
moulins à coudre. En décembre 1906, la production quotidienne s’élève à
1 200 machines. Les dimensions de l’usine font qu’à ses débuts, Singer apparaît
véritablement comme une ville dans une ville, fonctionnant de manière autonome.
Sa voie ferrée occupe le centre de la rue Saint-Paul et s'étire sur une
distance de 8 kilomètres. La locomotive Singer, aussi surnommée le «p'tit char», est alimentée par un courant de 240 volts. En fonction depuis les
débuts de l'usine, il semblerait que le «p'tit char» aurait cessé de
fonctionner à l'hiver 1918. Selon les souvenirs, le «p'tit char», de
couleur rouge, était conduit par un employé qui faisait sonner la cloche pour
avertir les gens de son passage :«Son "petit train" faisait la navette du quai à l’usine, transportant la glaise, le sable et la fonte en gueuse dont on se servait dans la fonderie. La compagnie générait sa propre force motrice et possédait son réseau ferroviaire ainsi que sa brigade de pompiers. Les pompiers étaient des volontaires, travaillant dans la sous-division du département de l’entretien de l’usine…
Elle pensait même construire des logements pour ses ouvriers sur son terrain étant donné la pénurie qui subsistait en la matière à Saint-Jean, au début du siècle. Ce projet n’aura pas de suite car sinon on aurait pu dire que Singer formait véritablement une petite ville».[7]
 petite ville comme
s’il avait été parachuté des airs. En 2 ans, sa construction avait soulevé une
poussière qui mit du temps à retomber. Avec elle, de nouvelles usines
étrangères vinrent s’établir à Saint-Jean. Le 1er avril 1906, lorsque le
sifflet bien connu des usines appela ses employés au travail, répétant à tous
les jours, pendant des décennies, le même sifflement, et surtout à tous les 11
novembre, à 11 heures (rappel de l'armistice de 1918), cette voix du
progrès, comme l’appelait Le Canada-Français rythmait comme le
battement d’un cœur la petite ville qui était soudainement devenue grande.
petite ville comme
s’il avait été parachuté des airs. En 2 ans, sa construction avait soulevé une
poussière qui mit du temps à retomber. Avec elle, de nouvelles usines
étrangères vinrent s’établir à Saint-Jean. Le 1er avril 1906, lorsque le
sifflet bien connu des usines appela ses employés au travail, répétant à tous
les jours, pendant des décennies, le même sifflement, et surtout à tous les 11
novembre, à 11 heures (rappel de l'armistice de 1918), cette voix du
progrès, comme l’appelait Le Canada-Français rythmait comme le
battement d’un cœur la petite ville qui était soudainement devenue grande. D’abord, au tournant du siècle, s’établit la manufacture de la Vandeweghe
Limited, compagnie anglaise employant 150 ouvriers et dont la spécialisation
est le nettoyage et la teinture des peaux de phoques canadiens (Canadian
Seal). Elle occupe un terrain de 5 acres (50 000 pieds² de planchers) situé à l’angle des actuelles
rues Saint-Jacques et le Boulevard du Séminaire :
D’abord, au tournant du siècle, s’établit la manufacture de la Vandeweghe
Limited, compagnie anglaise employant 150 ouvriers et dont la spécialisation
est le nettoyage et la teinture des peaux de phoques canadiens (Canadian
Seal). Elle occupe un terrain de 5 acres (50 000 pieds² de planchers) situé à l’angle des actuelles
rues Saint-Jacques et le Boulevard du Séminaire :«Jusqu’à l’incendie qui détruisit ses édifices en 1927, la manufacture de Saint-Jean de la Vandeweghe Limited était la plus vaste "dans son genre" de tout l’Empire britannique. Le siège social et l’entrepôt de distribution, de la rue Saint-Paul à Montréal, approvisionnait les salles de montre et entrepôts de la Vandeweghe Limited à Londres (Angleterre), Toronto et Winnipeg (Canada)».[8]
 par 80 et suffisamment équipé pour fournir de l’emploi à 1 000 travailleurs.
L’édifice subsiste toujours. Après avoir abrité la compagnie Mantex, il est
devenu un édifice à condos. Cette même année 1911, des industriels locaux,
Armand et Édouard Ménard ouvrent une distillerie à Iberville spécialisée dans
la production des boisseaux gazeuses Ménard, distribuées en bouteille et dont
le format suggère l’étiquette commerciale la pochette à Ménard. En 1921,
la technique est renouvelée et l’entreprise emménage sur le site de l’ancienne
poterie des Industriels Farrar, à Saint-Jean. En 1924, la franchise d’embouteillage
et de distribution des produits Coca-Cola lui est acquise. La compagnie
porte le nom de Monarch Bottling Works au cours des années 30 et
deviendra plus tard Les Breuvages Ménard. À la fin des années 1970, elle
fournissait encore 850 postes de vente dans la région.
par 80 et suffisamment équipé pour fournir de l’emploi à 1 000 travailleurs.
L’édifice subsiste toujours. Après avoir abrité la compagnie Mantex, il est
devenu un édifice à condos. Cette même année 1911, des industriels locaux,
Armand et Édouard Ménard ouvrent une distillerie à Iberville spécialisée dans
la production des boisseaux gazeuses Ménard, distribuées en bouteille et dont
le format suggère l’étiquette commerciale la pochette à Ménard. En 1921,
la technique est renouvelée et l’entreprise emménage sur le site de l’ancienne
poterie des Industriels Farrar, à Saint-Jean. En 1924, la franchise d’embouteillage
et de distribution des produits Coca-Cola lui est acquise. La compagnie
porte le nom de Monarch Bottling Works au cours des années 30 et
deviendra plus tard Les Breuvages Ménard. À la fin des années 1970, elle
fournissait encore 850 postes de vente dans la région. Une entreprise éphémère
dirigée par Henderson Black père, la Richelieu Cordage fabrique des
cordes, mais bientôt elle est éliminée par la concurrence. En 1917 est fondée
la Dominion Blank Book par George Arthur Savoy (1873-1951). La Compagnie offre le service de papeterie commerciale de haute
qualité aujourd’hui connue sous le nom de Blue Line. Plus tard, une
filiale se détache, les Formules Commerciales Savoy Limitée, spécialisée
dans la production de papeterie destinée au commerce et à l’industrie.
Une entreprise éphémère
dirigée par Henderson Black père, la Richelieu Cordage fabrique des
cordes, mais bientôt elle est éliminée par la concurrence. En 1917 est fondée
la Dominion Blank Book par George Arthur Savoy (1873-1951). La Compagnie offre le service de papeterie commerciale de haute
qualité aujourd’hui connue sous le nom de Blue Line. Plus tard, une
filiale se détache, les Formules Commerciales Savoy Limitée, spécialisée
dans la production de papeterie destinée au commerce et à l’industrie.«La St. Jeau Forsyth Co. Limitée fut fondée par Hervé Gaudette en 1928 dans des circonstances bien particulières à une époque où la situation économique affichait des signes avant-coureurs de la crise.
M. Hervé Gaudette travaillait à la Cluett Peabody, usine spécialisée dans la confection des chemises pour hommes et enfants depuis 15 ans, quand la Cluett Peabody dont le bureau-chef était en Ontario, décida de centraliser sa production à Kitchener et du coup, fermer les portes de sa succursale de Saint-Jean.M. Gaudette résolu donc d’étudier la situation avec un compagnon de travail F.-L. Pratt. Assisté d’un noyau d’une trentaine d’employés de milieux qualifiés, ils fondèrent la St. John’s Shirt Manufacturing (1928) qui se prolonge aujourd’hui dans la Saint-Jean Forsyth Co. Ltd. et dont le président actuel, M. Gilles Gaudette est le fils du fondateur.Cette entreprise locale engagea plusieurs milliers d’ouvriers et d’ouvrières de la région depuis sa fondation, soit ici même à Saint-Jean ou dans sa succursale de Napierville. Elle embauche actuellement plus de 200 travailleurs [1978]».
«L’outillage se compose d’un assortiment complet : 12 machines à carder, 6 à filer et 10 métiers à tisser; en outre tout l’appareil nécessaire pour laver, dégraisser, teindre, fouler et finir la flanelle. Une machine à vapeur, puissante et économique, fournit toute l’énergie voulue.Le nombre des employés s’élève déjà à 45 et bientôt montera à 60. La somme des salaires payés par la Compagnie se monte à $ 850 par mois. Il se livrera cette année 400 000 verges de flanelle. Les bâtisses et machineries ont coûté $ 31 000; elles sont louées à la Compagnie par M. Coote, elles lui seront vendues, bientôt à raison de $ 80 000».[9]
«C’est aux environs de 1893, que la première pièce de céramique sanitaire jamais utilisée au Canada, fut importée par Thomas Robertson & Co. Limited, de Montréal, de leurs associés à Glasgow. Cette pièce de faïence était appelée bol à couronne et elle était simplement un bol rond, avec un rebord de submersion ouvert, qui pouvait être raccordé à une trappe sinueuse visible, soit en grès, soit en métal. Feu monsieur J. M. Wilson, gérant de la Maison Thomas Robertson & Cie se mit en rapports avec feu M. Henderson Black qui s’était toujours intéressé aux diverses poteries de St-Jean, en ce qui concernait les possibilités d’y manufacturer ces bols à couronne. Le résultat de leurs pourparlers fut que la fabrication de la céramique sanitaire commença à St-Jean et la vaste entreprise moderne actuelle se développa de ce modeste départ.Il était normal que plus d’un individu se soit rendu compte des possibilités relatives à cette industrie, et en 1898, il existait trois manufactures de céramique sanitaire à St-Jean. Entre temps, M. Bowler était mort et M. Knight avait réorganisé son entreprise sous la raison sociale: The Dominion Pottery Company. La Canada Stone China Ware Company Limited avait cessé son exploitation; mais une partie de sa poterie, à l’angle des rues Longueuil et St-Georges, était exploitée sous le nom : The Richelieu Pottery. Feu monsieur W. A. Campbell qui, pendant sa jeunessse avait émigré d’Écosse à Philadelphie, était parvenu à St-Jean dans la suite et avait été employé par le Canada Stone China Ware Company, s’était associé avec feu M. Purvis; ils exploitaient une poterie qui leur appartenait, sur la rue St-Pierre ouest, sous la raison sociale: Caledonia Pottery. Vers cette époque, ces trois poteries s’entendirent avec M. Henderson Black, à l’effet qu’il devait être chargé exclusivement de faire leurs ventes pendant un certain nombre d’années à venir, sous le nom de: The Potters Manufacturing Association. Cette entente était sage et elle eut du succès; il en résulta que les affaires se développèrent très rapidement.
Cependant, pendant cette période, on s’aperçut que la manufacture de la céramique sanitaire avait fait de tels progrès aux États-Unis, que les méthodes canadiennes devenaient désuètes et afin de se maintenir au niveau des derniers progrès, on procéda à une réorganisation en 1905, lorsque la Trenton Potteres Co., de Trenton, N. J., qui était alors la plus importante manufacture de céramique sanitaire au monde, s’assura d’un intérêt prédominant dans une compagnie qui fut fondée sous le nom de Canadian Trenton Potteries Company Limited. Cette compagnie acquit la Richelieu Pottery comme manufacture active et simultanément l’exploitation de la Caledonia cessa. La Dominion Sanitary Pottery Company continue à fonctionner comme entreprise indépendante; dans la suite, elle fut réorganisée sur la base d’une capitalisation en actions, limitée, et elle fonctionne encore avec succès, comme unité spécialisée dans une catégorie d’accessoires sanitaires types.De 1905 à 1910, la Canadian Trenton Potteries Company Limited se développa continuellement et fit des progrès incessants; de la catégorie limitée de produits qu’elle fabriquait à ses débuts, elle passa rapidement à la série beaucoup plus étendue des articles reconnus comme types aux États-Unis et depuis ce moment, elle s’est maintenue intégralement au niveau des derniers progrès de l’hygiène qui ont été accomplis sur ce continent.En 1909, feu Mr Henderson Black acquit de la Trenton Potteries Limited, la part prédominante qu’elle avait dans la Canadian Trenton Poteries Company Limited. L’année suivante, il céda sa part à la Maison Crane Limited, qui en 1914 avait été organisée comme branche canadienne de la Crane Company de Chicago.Ce transfert de parts a permis à la Canadian Potteries Limited de s’agrandir suivant les meilleures méthodes de progrès. En 1910, elle acquit une étendue de terrain de deux acres dans la partie nord ouest de la ville et sur ce terrain, on construisit une usine de fabrication très moderne, qui est reconnue posséder le matériel le plus récent et appliquer les plus nouvelles méthodes d’exploitation si essentielles à la production de la plus belle céramique sanitaire en quantité suffisante pour répondre aux besoins du pays.
Depuis qu’elle a pris possession de sa nouvelle usine, la compagnie a augmenté continuellement le nombre des articles particuliers qu’elle fabriquait précédemment; de plus, elle a remodelé une grande quantité de ses produits types, de telle façon que le cachet artistique est venu s’ajouter à la qualité pour obtenir des produits de la meilleure qualité.La céramique fabriquée par la Canadian Potteries Limited est exclusivement en porcelaine vitrifiée massive et comprend actuellement une série complète de bois pour vespasiennes, de lavabos, d’urinoirs, de cloisons d’urinoires, d’éviers de laboratoires, d’accessoires de salles de bain et autres spécialités diverses pour l’aménagement complet des hôtels, des appartements, des résidences, des écoles, hôpitaux, des prisons, des wagons de chemin de fer, ou des navires».[10]
 Il demeure significatif que l’industrie de la poterie, celle où le
capital régional fut le plus actif à la fin du siècle, passe aux mains
d’intérêts multinationaux. Crane est la seule de toutes ces entreprises
à avoir subsisté jusqu’à nos jours. Durant tous le XIXe siècles, les
industriels de la poterie de Saint-Jean avaient cherché à se distinguer par la
qualité, la finesse, les particularités dans le dessin ou l’estampille; avec la
poterie sanitaire succédait la standardisation des produits et de l’art de la
porcelaine. C’est à ce prix, on le constate, que les vieilles usines
centenaires de poteries ont dû de périr ou de survivre. La conversion à la
standardisation tuait l’originalité, et c’est là un mal qui appartient en
propre à l’industrie capitaliste de masse. Lorsque la crise majeure de 1929
frappera la plupart des petites entreprises industrielles locales, ce sont aux
capitaux étrangers que nous devrons l’organisation de l’économie régionale et
permettre au prestige de la ville de subsister encore quelques temps.
Il demeure significatif que l’industrie de la poterie, celle où le
capital régional fut le plus actif à la fin du siècle, passe aux mains
d’intérêts multinationaux. Crane est la seule de toutes ces entreprises
à avoir subsisté jusqu’à nos jours. Durant tous le XIXe siècles, les
industriels de la poterie de Saint-Jean avaient cherché à se distinguer par la
qualité, la finesse, les particularités dans le dessin ou l’estampille; avec la
poterie sanitaire succédait la standardisation des produits et de l’art de la
porcelaine. C’est à ce prix, on le constate, que les vieilles usines
centenaires de poteries ont dû de périr ou de survivre. La conversion à la
standardisation tuait l’originalité, et c’est là un mal qui appartient en
propre à l’industrie capitaliste de masse. Lorsque la crise majeure de 1929
frappera la plupart des petites entreprises industrielles locales, ce sont aux
capitaux étrangers que nous devrons l’organisation de l’économie régionale et
permettre au prestige de la ville de subsister encore quelques temps. dise : une manufacture - un plant
- s'élève de terre en 2 ans et d'une dimension jamais rencontrée dans la région
devant les regards à la fois émerveillés et inquiets des Johannais. Comment ces
hommes d'affaires auraient-ils pu penser qu'avec leurs finances défaillantes
malgré leurs activités, ils auraient pu donner naissance à un projet semblable?
Toutes les entreprises qui s'étaient établies dans la région depuis un siècle
et demi vivaient essentiellement des ressources de la région : le goudron de
Sabrevois de Bleury venait de la résine des conifères; le commerce maritime
s'activait sur le Richelieu et le lac Champlain; les hôtels profitaient du site
pivot entre Montréal et New York; l'industrie de la poterie du grès et du
gravier déposés jadis par les alluvions de la Mer de Champlain; il n'y a pas
même jusqu'à la Banque de Saint-Jean qui spéculait sur les terres agricoles et
le besoin des voies ferrées pour les cultivateurs de la région. Bref,
Saint-Jean prospérait parce qu'elle s'auto-déterminait - pour le meilleur comme
pour le pire -, mais puisait son énergie, ses forces, de ses ressources
naturelles et humaines.
dise : une manufacture - un plant
- s'élève de terre en 2 ans et d'une dimension jamais rencontrée dans la région
devant les regards à la fois émerveillés et inquiets des Johannais. Comment ces
hommes d'affaires auraient-ils pu penser qu'avec leurs finances défaillantes
malgré leurs activités, ils auraient pu donner naissance à un projet semblable?
Toutes les entreprises qui s'étaient établies dans la région depuis un siècle
et demi vivaient essentiellement des ressources de la région : le goudron de
Sabrevois de Bleury venait de la résine des conifères; le commerce maritime
s'activait sur le Richelieu et le lac Champlain; les hôtels profitaient du site
pivot entre Montréal et New York; l'industrie de la poterie du grès et du
gravier déposés jadis par les alluvions de la Mer de Champlain; il n'y a pas
même jusqu'à la Banque de Saint-Jean qui spéculait sur les terres agricoles et
le besoin des voies ferrées pour les cultivateurs de la région. Bref,
Saint-Jean prospérait parce qu'elle s'auto-déterminait - pour le meilleur comme
pour le pire -, mais puisait son énergie, ses forces, de ses ressources
naturelles et humaines. Voilà pourquoi le prestige
du dernier tiers du Siècle d'Or de Saint-Jean; de son Âge de Prestige
est un prestige factice. Le passage du développement régional est manqué. La
région se développera, mais sous la tutelle d'entreprises extérieures. Et,
pourquoi blâmerait-on les Johannais puisqu'en ce début de XXIe siècle les
gouvernements du Canada et du Québec ne pensent pas mieux qu'à régresser au
stade du staple system reposant quasi-exclusivement sur le prélèvement
des ressources naturelles? Il ne faut donc pas hésiter à constater que
l'intrusion étrangère, avec la Singer, appelle l'intrusion étrangère
dans les services de finances de la Ville et dans les prêts aux entreprises
commerciales. Des boutiquiers indépendants accepteront bientôt des franchises
pour une marque dont le rayonnement est provincial, sinon international dans
le but précisément de sauver leur commerce.
Voilà pourquoi le prestige
du dernier tiers du Siècle d'Or de Saint-Jean; de son Âge de Prestige
est un prestige factice. Le passage du développement régional est manqué. La
région se développera, mais sous la tutelle d'entreprises extérieures. Et,
pourquoi blâmerait-on les Johannais puisqu'en ce début de XXIe siècle les
gouvernements du Canada et du Québec ne pensent pas mieux qu'à régresser au
stade du staple system reposant quasi-exclusivement sur le prélèvement
des ressources naturelles? Il ne faut donc pas hésiter à constater que
l'intrusion étrangère, avec la Singer, appelle l'intrusion étrangère
dans les services de finances de la Ville et dans les prêts aux entreprises
commerciales. Des boutiquiers indépendants accepteront bientôt des franchises
pour une marque dont le rayonnement est provincial, sinon international dans
le but précisément de sauver leur commerce. Honoré Roy, qui était également député
provincial du comté, fut soumis à une enquête, puis un procès, condamné et
emprisonné. Au bout du compte, une fois les créanciers privilégiés remboursés,
il restait peu d’argent à répartir entre les petits épargnants. Au-delà de la
faillite financière, le procès causa un choc sans précédent parmi la
population. Était-il possible que le successeur du probe Félix-Gabriel
Marchand; que l’ancien Président de l’Assemblée législative, soit arrêté puis
condamné avec deux fripouilles? Il y avait eu d’autres faillites bancaires au
Québec, telle celle de la Banque Ville-Marie, mais l’ampleur des circonstances
qui entouraient la fermeture de la Banque de Saint-Jean donna naissance à des
rumeurs exceptionnelles sur la probité douteuse des institutions financières
québécoises. «Le 11 juin 1908, a eu lieu l’appréhension (note de Grand
Québec : ce terme a été utilisé à l’époque au sens d’arrestation) de
l’honorable P.-H. Roy, président de la banque défunte, de maître P.-L.
L’Heureux, gérant général de la Banque de Saint-Jean et de Philibert Beaudoin,
son assistent. C’est à l’intervention du ministre de la Justice lui-même que
cette arrestation est due. La plainte avait été faite au ministre par l’Association
des Banques. L’honorable P. H. Roy, l’ex-président de l’Assemblée législative
et ses deux collègues ont reçu signification des mandats d’arrestation à leur
domicile respectif. Malgré le mandat d’amener, ils ne furent pas conduits en
prison, mais gardés à vue jusqu’à ce matin, alors qu’ils ont comparu devant le
magistrat».
Honoré Roy, qui était également député
provincial du comté, fut soumis à une enquête, puis un procès, condamné et
emprisonné. Au bout du compte, une fois les créanciers privilégiés remboursés,
il restait peu d’argent à répartir entre les petits épargnants. Au-delà de la
faillite financière, le procès causa un choc sans précédent parmi la
population. Était-il possible que le successeur du probe Félix-Gabriel
Marchand; que l’ancien Président de l’Assemblée législative, soit arrêté puis
condamné avec deux fripouilles? Il y avait eu d’autres faillites bancaires au
Québec, telle celle de la Banque Ville-Marie, mais l’ampleur des circonstances
qui entouraient la fermeture de la Banque de Saint-Jean donna naissance à des
rumeurs exceptionnelles sur la probité douteuse des institutions financières
québécoises. «Le 11 juin 1908, a eu lieu l’appréhension (note de Grand
Québec : ce terme a été utilisé à l’époque au sens d’arrestation) de
l’honorable P.-H. Roy, président de la banque défunte, de maître P.-L.
L’Heureux, gérant général de la Banque de Saint-Jean et de Philibert Beaudoin,
son assistent. C’est à l’intervention du ministre de la Justice lui-même que
cette arrestation est due. La plainte avait été faite au ministre par l’Association
des Banques. L’honorable P. H. Roy, l’ex-président de l’Assemblée législative
et ses deux collègues ont reçu signification des mandats d’arrestation à leur
domicile respectif. Malgré le mandat d’amener, ils ne furent pas conduits en
prison, mais gardés à vue jusqu’à ce matin, alors qu’ils ont comparu devant le
magistrat». direction d’Élisée Gervais. À cette époque, Gervais n’est pas
seulement une quincaillerie, c’est également une épicerie et une mercerie.
Durant le temps de la crise, les employés travaillent des semaines de 80 heures
payés au prix de $ 7.00/semaine. La Place du Marché verra s'agrandir l'Hôtel National
en 1906 pour répondre à la forte demande créée principalement par
l’implantation des usines Singer. Avec le siècle, la fréquentation du
marché aura tendance à diminuer pour ne reprendre qu’à la fin, avec un regain
pour les produits frais et biologiques de la terre.
direction d’Élisée Gervais. À cette époque, Gervais n’est pas
seulement une quincaillerie, c’est également une épicerie et une mercerie.
Durant le temps de la crise, les employés travaillent des semaines de 80 heures
payés au prix de $ 7.00/semaine. La Place du Marché verra s'agrandir l'Hôtel National
en 1906 pour répondre à la forte demande créée principalement par
l’implantation des usines Singer. Avec le siècle, la fréquentation du
marché aura tendance à diminuer pour ne reprendre qu’à la fin, avec un regain
pour les produits frais et biologiques de la terre. Une autre entreprise
familiale croît sans cesse : la boulangerie Bissonnette, située sur la rue
Champlain. Durant cette période, c’est Oswald Bissonnette qui a hérité de
l’entreprise de son père, axée sur le commerce de fabrication et de
distribution du pain. La livraison se fait d’abord par une petite voiture tirée
par un cheval, puis par 3 voitures plus stylisées, tirées toujours par
des chevaux et une petite camionnette Mercury. À la fin des années 1970,
12 voitures-camions assureront la distribution quotidienne du pain Bissonnette
sur 5 parcours indépendants dans la région.
Une autre entreprise
familiale croît sans cesse : la boulangerie Bissonnette, située sur la rue
Champlain. Durant cette période, c’est Oswald Bissonnette qui a hérité de
l’entreprise de son père, axée sur le commerce de fabrication et de
distribution du pain. La livraison se fait d’abord par une petite voiture tirée
par un cheval, puis par 3 voitures plus stylisées, tirées toujours par
des chevaux et une petite camionnette Mercury. À la fin des années 1970,
12 voitures-camions assureront la distribution quotidienne du pain Bissonnette
sur 5 parcours indépendants dans la région. propagandiste de la Société de colonisation dans l’Ouest, ouvre sa laiterie en
1921. Il achète la run de lait et les 6 vaches de Léandre Brault pour $
150.00. Vingt-huit laitiers desservent les 4 000 habitants de Saint-Jean en
1920. L’entreprise ne cesse de prendre de l’expansion, vend la crème, le beurre
et est la première de la région à pasteuriser le lait. Granger établit sa
laiterie sur l’actuelle rue Bouthillier. Il pourvoit ses employés d’une
assurance-salaire dont patron et employés paient chacun 50% de la prime. En
1935 est fondée une autre entreprise laitière, Samoisette, fondée par Georges
Samoisette. Elle a été acquise depuis par Granger.
propagandiste de la Société de colonisation dans l’Ouest, ouvre sa laiterie en
1921. Il achète la run de lait et les 6 vaches de Léandre Brault pour $
150.00. Vingt-huit laitiers desservent les 4 000 habitants de Saint-Jean en
1920. L’entreprise ne cesse de prendre de l’expansion, vend la crème, le beurre
et est la première de la région à pasteuriser le lait. Granger établit sa
laiterie sur l’actuelle rue Bouthillier. Il pourvoit ses employés d’une
assurance-salaire dont patron et employés paient chacun 50% de la prime. En
1935 est fondée une autre entreprise laitière, Samoisette, fondée par Georges
Samoisette. Elle a été acquise depuis par Granger. Ancien vendeur d’assurances,
marchand de bois, Charles LeSieur (1884-1964) et son frère Maurice se lancent,
en juillet 1920, dans la vente de meubles et des services funéraires,
concurrençant ainsi Ovila Langlois en affaires depuis 1880 et dont le magasin fut
longtemps situé angle nord-est du carrefour Saint-Jacques et Richelieu dans
l’édifice que la raison commerciale Greenberg’s tiendra pendant
longtemps. Charles LeSieur achètera un salon funéraire à Grandby en 1944 pour
l'administrer avec son fils, laissant à Maurice le salon de la rue
Saint-Jacques.
Ancien vendeur d’assurances,
marchand de bois, Charles LeSieur (1884-1964) et son frère Maurice se lancent,
en juillet 1920, dans la vente de meubles et des services funéraires,
concurrençant ainsi Ovila Langlois en affaires depuis 1880 et dont le magasin fut
longtemps situé angle nord-est du carrefour Saint-Jacques et Richelieu dans
l’édifice que la raison commerciale Greenberg’s tiendra pendant
longtemps. Charles LeSieur achètera un salon funéraire à Grandby en 1944 pour
l'administrer avec son fils, laissant à Maurice le salon de la rue
Saint-Jacques. demandant
d'électrifier le Palais de Justice, ce qui se fit dès l'été suivant. Mais on
était encore loin d'une distribution domestique de la Fée Électricité. C'est en
1922 que la compagnie d'électricité Southern Canada Power fit un blitz
publicitaire pour vanter les avantages de l'électricité au détriment de
l'éclairage au pétrole : «Pressez un bouton et à l'instant votre maison a un
éclat radieux. Que c'est commode! Que c'est propre et hygiénique!».
Pourtant, dès 1889, deux entreprises d'électricité concurrentes s'installaient à
Saint-Jean, la compagnie Beauchemin qui mettait en place le système Thomson
& Houston de «la compagnie de lumière électrique La «Royale» de Montréal, et
la Craig et Fils, aussi de Montréal, qui possédait son propre système
d'éclairage :
demandant
d'électrifier le Palais de Justice, ce qui se fit dès l'été suivant. Mais on
était encore loin d'une distribution domestique de la Fée Électricité. C'est en
1922 que la compagnie d'électricité Southern Canada Power fit un blitz
publicitaire pour vanter les avantages de l'électricité au détriment de
l'éclairage au pétrole : «Pressez un bouton et à l'instant votre maison a un
éclat radieux. Que c'est commode! Que c'est propre et hygiénique!».
Pourtant, dès 1889, deux entreprises d'électricité concurrentes s'installaient à
Saint-Jean, la compagnie Beauchemin qui mettait en place le système Thomson
& Houston de «la compagnie de lumière électrique La «Royale» de Montréal, et
la Craig et Fils, aussi de Montréal, qui possédait son propre système
d'éclairage :«Le conseil de ville de Saint-Jean accorde à la compagnie Royal Electric le privilège de fournir, pour une période de 5 ans, de l’électricité à la ville. Il approuve en même temps le transfert du privilège de la Royal Electric à la compagnie Beauchemin.
Le contrat contient les clauses suivantes : la lumière sera fournie à la ville aux prix indiqués. À savoir pour tous les soirs de l’année, une lampe de la capacité de 20 chandelles coûtera $ 9.00, une de 40 chandelles $ 20 00, une de 125 chandelles $ 60 00. Le renouvellement des lampes se fera aux frais de la ville. quant aux lampes à arc, pour les utiliser la ville paiera $ 0.25 par soir. Ces lampes seront d’une force de 1 200 chandelles. Les charbons seront remplacés par la compagnie.
La compagnie jouit aussi du privilège de vendre de l’électricité aux particuliers. Ceux-ci paieront par année, pour une lampe de 16 chandelles, la somme de $ 9 00. Pour une de 32 chandelles $ 20 00 et pour une de 125 chandelles $ 60 00.La ville se réserve la faculté d’acheter l’usine électrique de la compagnie à l’expiration du contrat, qui a une durée de 5 ans. Enfin la compagnie s’engage à fournir de l’électricité en quantité et qualité voulues».[12]
«Elle doit fournir l'éclairage de la voie publique du crépuscule jusqu'à au moins cinq heures du matin. Il ne semble pas que les habitations aient bénéficié du service d'électricité avant l'automne de 1893, car c'est alors que la compagnie publie l'annonce suivante : "Lumière électrique. La compagnie de Lumière Électrique de St-Jean, ayant fait l'achat d'un des célèbres dynamos Thomson & Houston, de la capacité de 1 000 lampes, est maintenant en état de fournir la lumière électrique dans les maisons privées tant à St-Jean qu'à Iberville". Les machines de la compagnie ne tournaient que le soir et la nuit, produisant de l'électricité à courant continu à seule fin d'éclairage. À ses débuts, l'entreprise n'était pas tenue d'éclairer les rues lorsque la lune offrait une clarté suffisante. Les prix sont d'abord fixés selon le nombre et la puissance des lampes utilisées, mais, dès l'automne 1894, "la compagnie de lumière électrique de cette ville a décidé d'établir des compteurs à ses lampes incandescentes…»[13]
 Light Heat & Power, il sera démoli en
1963 pour être remplacé par un nouveau barrage. Un concurrent de petite taille,
la Pouvoir hydraulique de Saint-Césaire, alimentée par la Yamaska, s’établit à
Saint-Jean. Elle s’implante en 1903 avec bâtiment sur la rue principale,
machine à vapeur, génératrice, poteaux et fils. Elle charge au taux de 7½ ¢ par
1 000 Watts, ce qui équivaut à ⅜ ¢ par heure pour une lampe de 16 chandelles.
Cette compagnie déclarera faillite à l’automne 1907 et sera absorbée par sa
rivale qui détient maintenant le monopole et peut augmenter fortement ses prix.
C’est la Saint Johns Electric Light Company qui sera finalement racheté
par la Southern Canada Power, de sorte qu’en 1922 elle dessert
l’ensemble de la Rive-Sud, de Saint-Jean à Drummondville.
Light Heat & Power, il sera démoli en
1963 pour être remplacé par un nouveau barrage. Un concurrent de petite taille,
la Pouvoir hydraulique de Saint-Césaire, alimentée par la Yamaska, s’établit à
Saint-Jean. Elle s’implante en 1903 avec bâtiment sur la rue principale,
machine à vapeur, génératrice, poteaux et fils. Elle charge au taux de 7½ ¢ par
1 000 Watts, ce qui équivaut à ⅜ ¢ par heure pour une lampe de 16 chandelles.
Cette compagnie déclarera faillite à l’automne 1907 et sera absorbée par sa
rivale qui détient maintenant le monopole et peut augmenter fortement ses prix.
C’est la Saint Johns Electric Light Company qui sera finalement racheté
par la Southern Canada Power, de sorte qu’en 1922 elle dessert
l’ensemble de la Rive-Sud, de Saint-Jean à Drummondville.«Dans les journaux de Saint-Jean, on trouve en l’année 1908 une première mention claire de réfrigération artificielle par un appareil électrique. Elle concerne la beurrerie Copping, située sur la rue Saint-Charles : "Dorénavant tout fonctionne à l’électricité et on emmagasinera le beurre […] dans une immense glacière au moyen d’un procédé électrique nouveau". Mais la réfrigération domestique ne commencera à se répandre - timidement - que vers la fin des années 1920. Le 29 janvier 1929, une foule d’environ cinq cents personnes se réunit dans une salle de Saint-Jean pour entendre un conférencier présenter d’abord le nouveau "char" Chevrolet, puis expliquer les avantages du "Frigidaire, cette invention moderne, économique et sanitaire". Fini l’achat de blocs de glace du vendeur ambulant! Finie la vidange du récipient d’eau de fonte des anciennes glacières! On peut maintenant produire sa propre glace (pour rafraîchir les boissons, etc.) avec de l’eau potable; "Avec un réfrigérateur électrique, vous passerez un été bien plus agréable. Plus à s’inquiéter de la fraîcheur des aliments - ils restent sains et délicieux pendant longtemps. Vous économiserez par les gros achats de provisions à des prix spéciaux […] il y aura toujours des cubes de glace […]. Les surplus se conservent frais».[14]
«Un soir de septembre 1896, Cyrille Patenaude, éclusier du canal de Chambly, tomba par accident dans l’écluse. Son compagnon accourut pour lui lancer une bouée de sauvetage, mais, "au moment où M. Patenaude tombait à l’eau, la lumière électrique qui éclairait l’écluse jusque là s’éteignit tout à coup". Du fond du sas on pouvait entendre le remuement de l’eau et les appels à l’aide du malheureux, mais l’obscurité empêcha qu’on lui porte un secours effectif. On repêcha son corps quelques heures plus tard. Le coroner conclut à une mort accidentelle, mais en jetant un blâme sur la compagnie d’éclairage électrique, car les charbons de la lampe (à arc) étaient entièrement consumés. D’un point de vue plus général, une voie publique bien éclairée s’avère évidemment plus sécuritaire. Elle favorise une diminution du nombre d’accidents de toutes sortes et une meilleure protection contre la criminalité, les malfaiteurs préférant agir dans l’ombre. Aucun visiteur arrivant dans une ville à la nuit tombée n’ira chercher un gîte dans une rue sombre, et le citadin qui doit aller faire des courses le soir préférera fréquenter les magasins situés sur les rues bien éclairés».[15]
 Communément appelés les Barracks, nous avons vu les différents sorts qui
atteignirent ce qui restait du Fort Saint-Jean. Accompagnés d'un édifice plus
récent, trois d'entre eux forment le quadrilatère historique. Placés à angle
droit, ces monuments délimitent un square ouvert aux quatre coins. De plan
allongé, ils comportent deux étages de briques de couleur ocre posées sur un soubassement
de pierre de taille et sont couverts d'un toit à croupes percé de cheminées
placées à intervalles réguliers. Le bâtiment qui fait dos à la rivière,
aujourd'hui le mess des officiers, est le plus imposant. Il se distingue par
deux avancées latérales plus basses et par un porche central. Les autres
constructions lui ressemblent par leur gabarit et leurs matériaux; toutefois,
leur composition et la distribution des trois portes au rez-de-chaussée
rappellent leur fonction première de casernes. Lorsqu'en 1952, les casernes
serviront de lieu à l'édification du nouveau Collège militaire royal de
Saint-Jean, ces édifices seront récupérés afin de servir à leurs nouvelles
fonctions de formation civile et militaire.
Communément appelés les Barracks, nous avons vu les différents sorts qui
atteignirent ce qui restait du Fort Saint-Jean. Accompagnés d'un édifice plus
récent, trois d'entre eux forment le quadrilatère historique. Placés à angle
droit, ces monuments délimitent un square ouvert aux quatre coins. De plan
allongé, ils comportent deux étages de briques de couleur ocre posées sur un soubassement
de pierre de taille et sont couverts d'un toit à croupes percé de cheminées
placées à intervalles réguliers. Le bâtiment qui fait dos à la rivière,
aujourd'hui le mess des officiers, est le plus imposant. Il se distingue par
deux avancées latérales plus basses et par un porche central. Les autres
constructions lui ressemblent par leur gabarit et leurs matériaux; toutefois,
leur composition et la distribution des trois portes au rez-de-chaussée
rappellent leur fonction première de casernes. Lorsqu'en 1952, les casernes
serviront de lieu à l'édification du nouveau Collège militaire royal de
Saint-Jean, ces édifices seront récupérés afin de servir à leurs nouvelles
fonctions de formation civile et militaire. des voies publiques. Saint-Jean, qui possède
déjà un système d’éclairage de rues, dispose à remplacer les files de madriers de
bois pour des trottoirs de ciment. Des pressions sont exercées de part et
d’autres, surtout de la part du Canada-Français, pour que le Conseil
municipal commence à couler ses premiers trottoirs de ciment sur la rue
Richelieu à partir de Saint-Georges. Des querelles s’élèvent entre les
partisans des trottoirs de ciment et ceux des trottoirs de pierres pour des
raisons de coûts. Le Canada-Français publie dans son numéro du 1er
juillet les calculs établis à propos du tronçon de trottoir qui mène de
l’actuelle Banque Canadienne Nationale au coin de la rue Saint-Jacques jusqu’à
la rue Saint-Georges : $ 1.48, soit 0.18 ¢ de plus que la pierre.
des voies publiques. Saint-Jean, qui possède
déjà un système d’éclairage de rues, dispose à remplacer les files de madriers de
bois pour des trottoirs de ciment. Des pressions sont exercées de part et
d’autres, surtout de la part du Canada-Français, pour que le Conseil
municipal commence à couler ses premiers trottoirs de ciment sur la rue
Richelieu à partir de Saint-Georges. Des querelles s’élèvent entre les
partisans des trottoirs de ciment et ceux des trottoirs de pierres pour des
raisons de coûts. Le Canada-Français publie dans son numéro du 1er
juillet les calculs établis à propos du tronçon de trottoir qui mène de
l’actuelle Banque Canadienne Nationale au coin de la rue Saint-Jacques jusqu’à
la rue Saint-Georges : $ 1.48, soit 0.18 ¢ de plus que la pierre.«L’amélioration de la voirie contenterait les Johannais, mais, "quand St-Jean aura des rues bien entretenues, des trottoirs convenables, son coquet aspect charmera davantage l’œil de l’étranger et l’invitera à venir s’établir au milieu de nous. C’est ainsi que nous attirerons les capitalistes qui fonderont ici de nouvelles industries dont tout le monde bénéficiera".[…] En attendant le pavage permanent de la voie publique, la ville achète, en juin 1907, de l’Austin Sprinkler Compagny de Montréal, une nouvelle arroseuses (qu’on appelait "arrosoir"), d’une capacité de 600 gallons et tirée par deux chevaux, dans le but de rabattre la poussière des rues. De plus, en octobre 1910, elle acquiert, de l’entreprise Moody & Sons de Terrebonne, une dameuse hippomobile, sous la forme d’un rouleau de cinq pieds de diamètre, pour l’entretien hivernal des rues».[16]
 postes s'installe en
1909 dans un édifice neuf à l’angle des rues Jacques-Cartier et Saint-Jacques.
Conçu par l'architecte J.E.H. Benoit de Saint-Jean, l'édifice d'inspiration
néo-romane caractérisé par ses arcs cintrés, est surmonté d'une tour carrée qui
affiche une horloge monumentale : «En brique pressée avec corniche, balustrade
et ornementations en pierre, de style classique dans la composition, l’édifice
mesure 45 pieds 7 pouces de largeur et 66 pieds de longueur surmonté de 2
tours; l’une avec cadrans, mesurant 75 pieds de hauteur, et l’autre 55 pieds.
Le maître de poste devait occuper le haut du bureau».[17]
L’édifice ne sera terminé qu’en automne 1908. Lorsque le bureau de poste sera
déménagé rue Champlain, dans l’édifice Côté, du nom du député de Saint-Jean et
Ministre des postes dans le cabinet Saint-Laurent, l'immeuble sera converti en
bibliothèque municipale en 1963. Malheureusement, un incendie détruit le 3
janvier 1968 l'étage supérieur de l'édifice qui ne sera pas
postes s'installe en
1909 dans un édifice neuf à l’angle des rues Jacques-Cartier et Saint-Jacques.
Conçu par l'architecte J.E.H. Benoit de Saint-Jean, l'édifice d'inspiration
néo-romane caractérisé par ses arcs cintrés, est surmonté d'une tour carrée qui
affiche une horloge monumentale : «En brique pressée avec corniche, balustrade
et ornementations en pierre, de style classique dans la composition, l’édifice
mesure 45 pieds 7 pouces de largeur et 66 pieds de longueur surmonté de 2
tours; l’une avec cadrans, mesurant 75 pieds de hauteur, et l’autre 55 pieds.
Le maître de poste devait occuper le haut du bureau».[17]
L’édifice ne sera terminé qu’en automne 1908. Lorsque le bureau de poste sera
déménagé rue Champlain, dans l’édifice Côté, du nom du député de Saint-Jean et
Ministre des postes dans le cabinet Saint-Laurent, l'immeuble sera converti en
bibliothèque municipale en 1963. Malheureusement, un incendie détruit le 3
janvier 1968 l'étage supérieur de l'édifice qui ne sera pas  reconstruit. La
bibliothèque ira s'établir dans des locaux plus modernes, rue Laurier, tandis
que l'édifice servira à loger la Société historique. Notons qu'en face de
l'ancien bureau de poste, subsiste toujours la façade de la première église
Saint-Jean-l'Evangéliste qui date de 1828 (à l’arrière de l’église
cathédrale).Alphonse F. Gervais succède à Messier en février 1909. Il est un
ardent artisan de la venue de la Singer à Saint-Jean. Puis c’est au tour
de Luc Papineau élu maire en février 1913 et Joseph Pinsonneault en février 1916
jusqu’en février 1917. Sous ces mandats a lieu l’inauguration du pont Gouin, le
14 septembre 1916 et la Ville devient la Cité de Saint-Jean le 22 décembre
suivant. Le puissant homme d’affaires Henderson Black est maire à son tour de
février 1917 à février 1919, une photo-montage publiée sur la première page du
journal La Presse annonce son élection. Il devait être le dernier maire
anglophone de Saint-Jean.
reconstruit. La
bibliothèque ira s'établir dans des locaux plus modernes, rue Laurier, tandis
que l'édifice servira à loger la Société historique. Notons qu'en face de
l'ancien bureau de poste, subsiste toujours la façade de la première église
Saint-Jean-l'Evangéliste qui date de 1828 (à l’arrière de l’église
cathédrale).Alphonse F. Gervais succède à Messier en février 1909. Il est un
ardent artisan de la venue de la Singer à Saint-Jean. Puis c’est au tour
de Luc Papineau élu maire en février 1913 et Joseph Pinsonneault en février 1916
jusqu’en février 1917. Sous ces mandats a lieu l’inauguration du pont Gouin, le
14 septembre 1916 et la Ville devient la Cité de Saint-Jean le 22 décembre
suivant. Le puissant homme d’affaires Henderson Black est maire à son tour de
février 1917 à février 1919, une photo-montage publiée sur la première page du
journal La Presse annonce son élection. Il devait être le dernier maire
anglophone de Saint-Jean.«En effet, sur la berge, au sud et au nord du pont, près de l'endroit où l'on puise l'eau, des commerçants, artisans, entrepreneurs, particuliers… ont pris l’habitude de venir déposer des déchets qui contiennent beaucoup de matières organiques d’origine animale et végétale, et dont l’amas se prolonge sous l’eau sur une grande distance. De plus, les barges, attendant leur tour de s’engager dans le canal de Chambly, peuvent rester stationnées des heures, parfois un jour entier, notamment le dimanche, vis-à-vis de cet endroit; l’eau est alors souillée par les différentes ordures et déjections que les mariniers jettent par-dessus bord. Finalement, les casernes de l’école militaire et leurs égouts sont situés en amont du site de la prise d’eau. La meilleure solution serait donc de déplacer la prise d’eau en haut des casernes».[18]
«En mars 1914, on installe temporairement, à l’usine de l’aqueduc un appareil pour traiter l’eau à l’hypochlorite de chaux, appareil qui, plus ou moins bien utilisé, s’avérera peu efficace. À cette époque, le Dr Charles F. Dalton de Burlington, au Vermont, secrétaire du State Board of Health de cet État, rencontre le Dr Narcisse-A. Sabourin, président du comité d’hygiène de la ville de Saint-Jean, et lui affirme que le consulat américain de Saint-Jean a reçu instruction de tenir les autorités de Washington au courant de la situation sanitaire de Saint-Jean et que si, à l’ouverture de la navigation, cette situation ne s’est pas améliorée d’une façon satisfaisante, le port de Saint-Jean sera mis en quarantaine pour les navigateurs américains". Le journaliste ajoute : "On exagère évidemment, en certains milieux, la gravité de la situation, cependant cette situation est assez sérieuse pour que nos autorités municipale […] prennent toutes les mesures possibles pour faire cesser cet état de choses qui, non seulement menace la santé et la vie des citoyens, mais encore fait du tort au commerce et à la réputation de la ville de Saint-Jean à l’étranger».[19]
«En mai, la Ville prend possession des installations de l’aqueduc et demande en même temps des soumissions pour la construction d’un nouveau système de distribution d’eau, comprenant une nouvelle station de pompage et de filtration, de nouvelles canalisations sous les rues et un château d’eau, le tout selon les plans préparés par l’ingénieur Royal Lepage de Montréal. La firme Laurin & Leitch, aussi de Montréal, obtient le contrat de construction pour la somme de 109 775 $. Notons que ce montant s’ajoutait au dédommagement de 112 750 $ que la Ville avait dû payer aux propriétaires de l’aqueduc, le total devant se financer par l’émission d’obligations municipales. Les travauxdébutent en août 1917 sur une portion du terrain du parc Laurier située près de la rivière. Le gouvernement fédéral, propriétaire de ce terrain, et qui le garde comme réserve militaire à côté des casernes, accorde à la Ville un bail de 90 ans pour un dollar de loyer par année. En 1918, la construction d’une tour d’eau de 110 pieds de hauteur est terminée en retrait de la rue Longueuil, sur le site le plus élevé de la ville, afin de profiter au maximum de la gravité, et juste en arrière de l’endroit où se trouvait le bureau et le réservoir (d’un type moins élevé) de l’ancien aqueduc. Il s’agit donc d’un énorme réservoir, de la forme d’un cylindre vertical couvert d’un toit conique, monté sur un pylône, et pouvant contenir 250 000 gallons d’eau. Son rôle est d’assurer une pression d’eau suffisante et uniforme dans les canalisations, et il sera aussi utile en cas d’incendie ou de panne d’aqueduc. On pourra voir sa silhouette se découper dans le ciel de Saint-Jean pendant une soixantaine d’années, soit jusqu’à son démantèlement au printemps de 1979».[20]
 Joseph P. Maynard succède au maire Saint-Germain en février 1939.
Durant toute cette période, le siège de l’Hôtel de Ville est situé dans un
édifice sis à l’angle nord-ouest des rues Jacques-Cartier et Place du Marché.
Beaucoup plus modeste que l’actuel Hôtel de Ville, c’est un édifice de 2 étages
plus une mansarde. Un grand mur de pierres longe la rue de la Place du Marché,
à l’arrière de l’Hôtel de Ville. L’édifice sera démoli en 1955. Le service des pompiers réside toujours à l’édifice de la pompe, derrière la Place du Marché.
Le personnel est toujours aussi nombreux. En 1906, 22 hommes assurent la
protection contre les
Joseph P. Maynard succède au maire Saint-Germain en février 1939.
Durant toute cette période, le siège de l’Hôtel de Ville est situé dans un
édifice sis à l’angle nord-ouest des rues Jacques-Cartier et Place du Marché.
Beaucoup plus modeste que l’actuel Hôtel de Ville, c’est un édifice de 2 étages
plus une mansarde. Un grand mur de pierres longe la rue de la Place du Marché,
à l’arrière de l’Hôtel de Ville. L’édifice sera démoli en 1955. Le service des pompiers réside toujours à l’édifice de la pompe, derrière la Place du Marché.
Le personnel est toujours aussi nombreux. En 1906, 22 hommes assurent la
protection contre les  incendies et 3 voitures tirées par les chevaux le
déplacement du matériel et le transport des hommes. Les incendies, pour leur
part, demeurent un fléau craint par tous. En 1925, un incendie ravage tout
l’édifice situé à l’angle nord-ouest des rues Champlain et Place du Marché. Les
pompiers n’eurent pas loin à faire pour se rendre, de sorte que les fondations
sont à peu près restées intactes, grâce à la vigilance du chef de la police et
des pompiers de l’époque, M. Philias Meunier.
incendies et 3 voitures tirées par les chevaux le
déplacement du matériel et le transport des hommes. Les incendies, pour leur
part, demeurent un fléau craint par tous. En 1925, un incendie ravage tout
l’édifice situé à l’angle nord-ouest des rues Champlain et Place du Marché. Les
pompiers n’eurent pas loin à faire pour se rendre, de sorte que les fondations
sont à peu près restées intactes, grâce à la vigilance du chef de la police et
des pompiers de l’époque, M. Philias Meunier.En février 1939, Georges Fortin est élu maire de la Cité de Saint-Jean, c’est lui qui accompagne Maurice LeSieur lors de la célèbre visite guidée du Parlement fédéral par le député Martial Rhéaume afin d’obtenir l’École d’Aviation à Saint-Jean dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Moïse Lebeau lui succède en mai 1942 jusqu’en février 1945. C’est l’époque cruciale de la guerre pendant laquelle Louis-O. Régnier est président régional pour les différentes campagnes d’emprunt pour la victoire. Le 18 octobre 1943, le maire Lebeau lui donne la souscription de la Cité :
 d’appel - de le limiter aux tribunaux de la province -, en matière de droits
civils et de propriété. Louis-Philippe Demers présente un bill analogue aux
Communes afin de limiter la juridiction de la Cour Suprême aux causes fédérales
et interprovinciales. Toutes ces mesures contribuent au mouvement anti-impérialiste
qui déchire la politique fédérale. Demers participe également à une cabale
contre son prédécesseur, Israël Tarte, qui est redevenu candidat conservateur
et tente de se faire élire dans le comté de Sainte-Marie à Montréal.
L’animosité envers le transfuge est particulièrement féroce. Le 28 mars 1905,
Demers prononce un discours aux Communes, en anglais, en faveur des Écoles du
Nord-Ouest, après Rodolphe Lemieux et Henri Bourassa… avant Armand Lavergne,
nationaliste et gendre de Roy. En 1905, Louis-Philippe Demers est nommé juge à
la Cour Supérieure du district de Saint-François, ce qui lui laisse quand même
le temps de participer à la fameuse campagne du comté de Drummond-Athabaska où
se présente un candidat du Parti Nationaliste d’Henri Bourassa, définitivement
séparé du Parti Libéral. Son candidat est élu. Les Libéraux décident de prendre
leur revanche dans l’élection provinciale du comté de Saint-Jean à la mort de
Gabriel Marchand. Cette campagne, qui verra l’élection de Marcellin Robert,
permet à Demers, le 26 novembre 1910, libéral respecté de son parti, de prendre
la parole dans son propre comté, entouré des plus grandes figures du parti,
dont Raoul Dandurand et Ernest Lapointe. L’élection de Robert est assurée et
l’affront de Drummond-Arthabaska vengé.
d’appel - de le limiter aux tribunaux de la province -, en matière de droits
civils et de propriété. Louis-Philippe Demers présente un bill analogue aux
Communes afin de limiter la juridiction de la Cour Suprême aux causes fédérales
et interprovinciales. Toutes ces mesures contribuent au mouvement anti-impérialiste
qui déchire la politique fédérale. Demers participe également à une cabale
contre son prédécesseur, Israël Tarte, qui est redevenu candidat conservateur
et tente de se faire élire dans le comté de Sainte-Marie à Montréal.
L’animosité envers le transfuge est particulièrement féroce. Le 28 mars 1905,
Demers prononce un discours aux Communes, en anglais, en faveur des Écoles du
Nord-Ouest, après Rodolphe Lemieux et Henri Bourassa… avant Armand Lavergne,
nationaliste et gendre de Roy. En 1905, Louis-Philippe Demers est nommé juge à
la Cour Supérieure du district de Saint-François, ce qui lui laisse quand même
le temps de participer à la fameuse campagne du comté de Drummond-Athabaska où
se présente un candidat du Parti Nationaliste d’Henri Bourassa, définitivement
séparé du Parti Libéral. Son candidat est élu. Les Libéraux décident de prendre
leur revanche dans l’élection provinciale du comté de Saint-Jean à la mort de
Gabriel Marchand. Cette campagne, qui verra l’élection de Marcellin Robert,
permet à Demers, le 26 novembre 1910, libéral respecté de son parti, de prendre
la parole dans son propre comté, entouré des plus grandes figures du parti,
dont Raoul Dandurand et Ernest Lapointe. L’élection de Robert est assurée et
l’affront de Drummond-Arthabaska vengé.«La Province de Québec ne lâchait pas. En Cour Supérieure de Montréal, dans une affaire entre plaideurs anglais, un témoin demanda s’il pouvait déposer en français. - "Certes, monsieur, dit le juge Demers, ce n,est pas au moment où nos voisins d’Ontario contestent les droits de notre langue que nous en abandonnerons une parcelle chez nous". Et il dut réprimer les applaudissements. Le juge Louis-Philippe Demers était l’ancien député de Saint-Jean et Iberville, qu’il avait en quelque sorte concédé à son frère en montant sur le banc. Érudit et très distingué, il enseignait le droit à l’Université. À son cours suivant, les étudiants lui firent une ovation»[22]
 À partir de 1906, en effet,
Marie-Joseph Demers avait remplacé son frère comme député libéral du comté aux
Communes. Il participe donc aux frictions opposant impérialistes et
nationalistes canadiens-français, Parti Libéral et Parti Conservateur. La
division du Parti Libéral est la cause de la défaite de Laurier devant le
Conservateur Borden. Le problème des Écoles du Keewatin prolonge la crise des
Écoles du Manitoba, et Marie-Joseph Demers vote dans le même sens que ses pairs
libéraux. Aux Communes, il ne cesse d’attaquer les ministres conservateurs
alors que nous sommes en pleine guerre mondiale. Marie-Joseph Demers est réélu
en 1911 puis en 1917. De plus, il participe à la défense de la langue française
ouvertement attaquée par les Ontariens qui refusent son expansion dans leur
province (l’affaire du Règlement XVII).
À partir de 1906, en effet,
Marie-Joseph Demers avait remplacé son frère comme député libéral du comté aux
Communes. Il participe donc aux frictions opposant impérialistes et
nationalistes canadiens-français, Parti Libéral et Parti Conservateur. La
division du Parti Libéral est la cause de la défaite de Laurier devant le
Conservateur Borden. Le problème des Écoles du Keewatin prolonge la crise des
Écoles du Manitoba, et Marie-Joseph Demers vote dans le même sens que ses pairs
libéraux. Aux Communes, il ne cesse d’attaquer les ministres conservateurs
alors que nous sommes en pleine guerre mondiale. Marie-Joseph Demers est réélu
en 1911 puis en 1917. De plus, il participe à la défense de la langue française
ouvertement attaquée par les Ontariens qui refusent son expansion dans leur
province (l’affaire du Règlement XVII). ne se représente pas aux
élections fédérales de 1930 et cède la candidature à Martial Rhéaume «boucher et dépeceur de viandes» qui, jeune, faisait partie de l’équipe de hockey Les Canadiens de
Saint-Jean alors que Paul Beaulieu en était le capitaine durant la saison
d’hiver 1923-1924! qui est assuré de son siège aux Communes pour les 15
prochaines années. Le mandat de Rhéaume, coincé entre le gouvernement King, la
Seconde Guerre mondiale et la crise de la conscription. Le gouvernement King
s’était fait réélire avec la promesse faite aux Canadiens-Français du Québec
qu’il ne proclamerait pas la conscription. Mais les pressions du Canada-Anglais
sont trop fortes et King pense soulager sa conscience en portant la question en
référendum : «Consentez-vous à libérer le gouvernement de toute obligation
résultant d’engagement antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation
pour le service militaire». À la question ainsi posée, le comté fédéral de
Saint-Jean-Iberville-Napierville, sur les 20 510 électeurs inscrits, 16 328
vont voter dans 92 bureaux de votation. Sur ce nombre, 164 votes sont rejetés,
2 362 répondent OUI mais 13 802 votent NON. Dans la Province de Québec, 376 188
répondent OUI et 993 633 répondent NON. Mais c’est le vote canadien qui
finalement est appelé à décider : 2 943 5143 sont en faveur du référendum
fédéral et 1 643 006 répondent non. La majorité des OUI est aussi écrasante au
Canada que celle des NON l’est au Québec. Aux élections de 1945, les Libéraux
fédéraux ne peuvent être certains de garder le comté avec Martial Rhéaume comme
candidat, il est donc remplacé par J. Alcide Côté.
ne se représente pas aux
élections fédérales de 1930 et cède la candidature à Martial Rhéaume «boucher et dépeceur de viandes» qui, jeune, faisait partie de l’équipe de hockey Les Canadiens de
Saint-Jean alors que Paul Beaulieu en était le capitaine durant la saison
d’hiver 1923-1924! qui est assuré de son siège aux Communes pour les 15
prochaines années. Le mandat de Rhéaume, coincé entre le gouvernement King, la
Seconde Guerre mondiale et la crise de la conscription. Le gouvernement King
s’était fait réélire avec la promesse faite aux Canadiens-Français du Québec
qu’il ne proclamerait pas la conscription. Mais les pressions du Canada-Anglais
sont trop fortes et King pense soulager sa conscience en portant la question en
référendum : «Consentez-vous à libérer le gouvernement de toute obligation
résultant d’engagement antérieurs restreignant les méthodes de mobilisation
pour le service militaire». À la question ainsi posée, le comté fédéral de
Saint-Jean-Iberville-Napierville, sur les 20 510 électeurs inscrits, 16 328
vont voter dans 92 bureaux de votation. Sur ce nombre, 164 votes sont rejetés,
2 362 répondent OUI mais 13 802 votent NON. Dans la Province de Québec, 376 188
répondent OUI et 993 633 répondent NON. Mais c’est le vote canadien qui
finalement est appelé à décider : 2 943 5143 sont en faveur du référendum
fédéral et 1 643 006 répondent non. La majorité des OUI est aussi écrasante au
Canada que celle des NON l’est au Québec. Aux élections de 1945, les Libéraux
fédéraux ne peuvent être certains de garder le comté avec Martial Rhéaume comme
candidat, il est donc remplacé par J. Alcide Côté.Marie-Joseph Demers (1906-1922)
 secrétaire de l’Association
Saint-Jean-Baptiste. Il invitait les sociétaires à fréquenter les basars
organisés le jour de la fête de la Saint-Jean par un comité de dames
patronesses dirigé par madame Béique, épouse du député libéral de
Saint-Hyacinthe et conseiller de Laurier. La collecte avait pour but de «contribuer
au parachèvement d’un édifice destiné à la gloire et la forteresse de notre
nationalité canadienne-française», c’est-à-dire le Monument National, à
Montréal. À l’époque, Roy n’était pas encore inscrit au Parti Libéral. Comme
Tarte, il se fit transfuge du Parti Conservateur le soir du 24 avril 1896,
lorsque Laurier lança sa campagne électorale au Parc Sohmer, à Montréal, dans
une atmosphère de kermesse avec défilés patriotiques et feux d’artifices. Roy
se précipita alors, comme un nouveau Claudel politique, vers les bureaux du
journal Le Soir afin de répudier ouvertement le Parti Conservateur. À la
mort de Marchand, il sauta directement dans l’arène politique. Au cours des
élections du 25 novembre 1904, il est réélu contre ses adversaires, Me Antonin
D. Girard, avocat conservateur et James O’Cain, marchand de charbon et ancien
président du Parti Libéral du comté de Saint-Jean. La candidature de Roy ne
fait donc pas l’unanimité parmi les militants libéraux. C’est au moment où Roy
tient à lui seul les rennes de la Banque de Saint-Jean. Le Premier ministre
Simon-Napoléon Parent doit lui aussi affronter la tourmente : beaucoup de ses
stratèges, dont le plus important est Lomer Gouin, s’opposent à sa politique
entachée d’irrégularités. Roy se lie avec Gouin. Le 15 janvier 1907, à
l’ouverture de la session, Philippe-Honoré Roy est élu Orateur de l’Assemblée.
Réputé pour sa courtoisie, il devient en 1908 l’homme lige du puissant Trust
électrique Montreal Light, Heat and Power Company au moment même où il
décide de se porter candidat à la mairie de Montréal. L’électrification urbaine
est une excellente occasion de faire de l’argent et, on le sait, Roy n’a jamais
assez de sous en poche. Il apparaît donc comme le candidat du Trust. La
Presse et La Patrie lui opposent l’échevin Louis Paquette, important
entrepreneur de Montréal. Paquette est élu par 14 710 voix contre 11 914 pour
Roy.
secrétaire de l’Association
Saint-Jean-Baptiste. Il invitait les sociétaires à fréquenter les basars
organisés le jour de la fête de la Saint-Jean par un comité de dames
patronesses dirigé par madame Béique, épouse du député libéral de
Saint-Hyacinthe et conseiller de Laurier. La collecte avait pour but de «contribuer
au parachèvement d’un édifice destiné à la gloire et la forteresse de notre
nationalité canadienne-française», c’est-à-dire le Monument National, à
Montréal. À l’époque, Roy n’était pas encore inscrit au Parti Libéral. Comme
Tarte, il se fit transfuge du Parti Conservateur le soir du 24 avril 1896,
lorsque Laurier lança sa campagne électorale au Parc Sohmer, à Montréal, dans
une atmosphère de kermesse avec défilés patriotiques et feux d’artifices. Roy
se précipita alors, comme un nouveau Claudel politique, vers les bureaux du
journal Le Soir afin de répudier ouvertement le Parti Conservateur. À la
mort de Marchand, il sauta directement dans l’arène politique. Au cours des
élections du 25 novembre 1904, il est réélu contre ses adversaires, Me Antonin
D. Girard, avocat conservateur et James O’Cain, marchand de charbon et ancien
président du Parti Libéral du comté de Saint-Jean. La candidature de Roy ne
fait donc pas l’unanimité parmi les militants libéraux. C’est au moment où Roy
tient à lui seul les rennes de la Banque de Saint-Jean. Le Premier ministre
Simon-Napoléon Parent doit lui aussi affronter la tourmente : beaucoup de ses
stratèges, dont le plus important est Lomer Gouin, s’opposent à sa politique
entachée d’irrégularités. Roy se lie avec Gouin. Le 15 janvier 1907, à
l’ouverture de la session, Philippe-Honoré Roy est élu Orateur de l’Assemblée.
Réputé pour sa courtoisie, il devient en 1908 l’homme lige du puissant Trust
électrique Montreal Light, Heat and Power Company au moment même où il
décide de se porter candidat à la mairie de Montréal. L’électrification urbaine
est une excellente occasion de faire de l’argent et, on le sait, Roy n’a jamais
assez de sous en poche. Il apparaît donc comme le candidat du Trust. La
Presse et La Patrie lui opposent l’échevin Louis Paquette, important
entrepreneur de Montréal. Paquette est élu par 14 710 voix contre 11 914 pour
Roy. Les élections à la mairie de Montréal ont lieu en février 1908, le 8
juin suivant, Roy abandonne son poste de député de Saint-Jean pour laisser la
place à Gabriel Marchand. Il n’a d’ailleurs pas le choix. Le scandale de la
Banque de Saint-Jean vient d’éclater et la fermeture décrétée. Le procès
s’ensuit et Roy est reconnu coupable. Il décède le 17 décembre 1910 dans sa
cellule à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Une telle disgrâce n’est pas
courante. Avoir brigué de si hautes fonctions (le Président est le personnage
le plus important de l’Assemblée législative) et manipulé tant d’argent, la
Fortune s’était retournée contre lui d’une manière impitoyable qu’on n’ose plus
imaginer aujourd’hui. Pour le comté, ce n’était là que la première d’une série
d’impromptus.
Les élections à la mairie de Montréal ont lieu en février 1908, le 8
juin suivant, Roy abandonne son poste de député de Saint-Jean pour laisser la
place à Gabriel Marchand. Il n’a d’ailleurs pas le choix. Le scandale de la
Banque de Saint-Jean vient d’éclater et la fermeture décrétée. Le procès
s’ensuit et Roy est reconnu coupable. Il décède le 17 décembre 1910 dans sa
cellule à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Une telle disgrâce n’est pas
courante. Avoir brigué de si hautes fonctions (le Président est le personnage
le plus important de l’Assemblée législative) et manipulé tant d’argent, la
Fortune s’était retournée contre lui d’une manière impitoyable qu’on n’ose plus
imaginer aujourd’hui. Pour le comté, ce n’était là que la première d’une série
d’impromptus. il était
devenu rédacteur en chef du Canada-Français. Tout aussi intéressé à la
politique que son père, il fut son secrétaire alors qu’il était Président de
l’Assemblée. Ce travail fut toutefois de courte durée puisque Gabriel Marchand
fut nommé protonotaire à la Cour Supérieure pour le district d’iberville en
novembre 1887. Le 8 juin 1908, Gabriel Marchand se présente pour succéder à Roy
et rassurer ainsi les électeurs après un mandat qui a laissé beaucoup
d’amertume parmi les citoyens. Cet homme, dont l’éducation fut suivie de près
par son père, touchait lui aussi à la littérature et on lui doit la composition
d’une pièce de théâtre qui semble assez bien le refléter : Le Timide, qu’il
fait représenter, avec grand succès, au Théâtre des Nouveautés à Montréal.
Durant cette période troublée, la présence de Marchand dans le comté de
Saint-Jean est un atout certain pour le Parti Libéral, et ce jusqu’à ce que la
mort le saisisse subitement, le 16 septembre 1910, à sa résidence de
Saint-Jean.
il était
devenu rédacteur en chef du Canada-Français. Tout aussi intéressé à la
politique que son père, il fut son secrétaire alors qu’il était Président de
l’Assemblée. Ce travail fut toutefois de courte durée puisque Gabriel Marchand
fut nommé protonotaire à la Cour Supérieure pour le district d’iberville en
novembre 1887. Le 8 juin 1908, Gabriel Marchand se présente pour succéder à Roy
et rassurer ainsi les électeurs après un mandat qui a laissé beaucoup
d’amertume parmi les citoyens. Cet homme, dont l’éducation fut suivie de près
par son père, touchait lui aussi à la littérature et on lui doit la composition
d’une pièce de théâtre qui semble assez bien le refléter : Le Timide, qu’il
fait représenter, avec grand succès, au Théâtre des Nouveautés à Montréal.
Durant cette période troublée, la présence de Marchand dans le comté de
Saint-Jean est un atout certain pour le Parti Libéral, et ce jusqu’à ce que la
mort le saisisse subitement, le 16 septembre 1910, à sa résidence de
Saint-Jean. L’absence de Bourassa cause un sérieux handicap à l’organisation des
Nationalistes provinciaux. Le chef est en effet parti mener sa propre
enquête sur la situation internationale en Europe. Les Libéraux, de leur
côté, décident de ne pas renouveler l’erreur de la campagne fédérale de
Drummond-Arthabaska en ne négligeant pas la propagande dans le comté. Ainsi,
ils envoient leurs meilleurs orateurs supporter le candidat Robert - qui
disparaît bien vite derrière les grandes figures du parti -, tandis que les
Nationalistes ne trouvent aucun orateur qui puisse faire aussi bien que
Bourassa lui-même. Les résultats ne se font pas attendre et le 29 décembre, le
candidat du gouvernement l’emporte par une majorité de 600 voix, sensiblement
plus forte que celle de Gabriel Marchand en 1908.[23]
Marcellin Robert est ainsi élu quatrième député du comté de Saint-Jean et
complète le mandat de Gabriel Marchand (1910-1912).
L’absence de Bourassa cause un sérieux handicap à l’organisation des
Nationalistes provinciaux. Le chef est en effet parti mener sa propre
enquête sur la situation internationale en Europe. Les Libéraux, de leur
côté, décident de ne pas renouveler l’erreur de la campagne fédérale de
Drummond-Arthabaska en ne négligeant pas la propagande dans le comté. Ainsi,
ils envoient leurs meilleurs orateurs supporter le candidat Robert - qui
disparaît bien vite derrière les grandes figures du parti -, tandis que les
Nationalistes ne trouvent aucun orateur qui puisse faire aussi bien que
Bourassa lui-même. Les résultats ne se font pas attendre et le 29 décembre, le
candidat du gouvernement l’emporte par une majorité de 600 voix, sensiblement
plus forte que celle de Gabriel Marchand en 1908.[23]
Marcellin Robert est ainsi élu quatrième député du comté de Saint-Jean et
complète le mandat de Gabriel Marchand (1910-1912).  venger le coup de
Drummond-Arthabaska? Pis encore. À la convention libérale pour l’élection de
1912, la candidature de Robert est contestée! Cette fois-ci, c’est le comté qui
vit un schisme et non le Parti. En effet, le Parti Libéral du comté est divisé
par la fameuse querelle qui oppose alors le Collège Sainte-Marie-de-Monnoir au
nouveau Collège de Saint-Jean, sous la direction de l’abbé Papineau et consacré
par l’archevêque, Mgr Bruchési. Aux grands maux, les grands remèdes pour sauver
le comté du schisme : c’est Lomer Gouin lui-même qui se portera candidat dans
Saint-Jean. Gouin est allié à Mgr Bruchési dans la querelle du Collège et un
interdit romain vient confirmer la décision de l’Archevêque de Montréal. Le
Collège Sainte-Marie-de-Monnoir sera obligé de fermer ses portes et de
disperser ses frères enseignants. Devant cette décision, l’opinion publique est
montée à la fois contre Bruchési et Gouin. Qu’importe, il faut obstruer la
césure qui menace de faire passer le conservateur :
venger le coup de
Drummond-Arthabaska? Pis encore. À la convention libérale pour l’élection de
1912, la candidature de Robert est contestée! Cette fois-ci, c’est le comté qui
vit un schisme et non le Parti. En effet, le Parti Libéral du comté est divisé
par la fameuse querelle qui oppose alors le Collège Sainte-Marie-de-Monnoir au
nouveau Collège de Saint-Jean, sous la direction de l’abbé Papineau et consacré
par l’archevêque, Mgr Bruchési. Aux grands maux, les grands remèdes pour sauver
le comté du schisme : c’est Lomer Gouin lui-même qui se portera candidat dans
Saint-Jean. Gouin est allié à Mgr Bruchési dans la querelle du Collège et un
interdit romain vient confirmer la décision de l’Archevêque de Montréal. Le
Collège Sainte-Marie-de-Monnoir sera obligé de fermer ses portes et de
disperser ses frères enseignants. Devant cette décision, l’opinion publique est
montée à la fois contre Bruchési et Gouin. Qu’importe, il faut obstruer la
césure qui menace de faire passer le conservateur :«… aux élections du 15 mai, le Premier ministre s’était fait élire à la fois dans Portneuf et dans Saint-Jean, fief libéral. Bien qu’il eût l’intention d’opter pour Portneuf, son comté natal, il n’en restait pas moins, jusqu’à nouvel ordre, député de Saint-Jean à la Législative. Et l’opinion était assez montée pour que Sir Lomer Gouin et le député fédéral Joseph Demers fissent une démarche auprès de Mgr Bruchési le priant d’autoriser les prêtres à rouvrir le collège (Sainte-Marie-de-Monnoir) après leur soumission. L’archevêque, courtois mais inflexible, se retranche derrière la décision romaine».[24]
 Une fois la tempête passée, Gouin peut démissionner du siège de
Saint-Jean pour déclencher des élections partielles où Marcellin Robert pourra
se présenter à nouveau. Il est élu le 10 novembre 1913. C’est sous son second
mandat que sera construit, entre 1914 et 1916, en pleine guerre, le pont Gouin,
prétexte à de somptueuses cérémonies où les 2 alliés de la veille dans
l’affaire du Collège de Saint-Jean, Sir Lomer Gouin et Mgr Bruchési, sont
rassemblés. Marcellin Robert reste député jusqu’en 1919.
Une fois la tempête passée, Gouin peut démissionner du siège de
Saint-Jean pour déclencher des élections partielles où Marcellin Robert pourra
se présenter à nouveau. Il est élu le 10 novembre 1913. C’est sous son second
mandat que sera construit, entre 1914 et 1916, en pleine guerre, le pont Gouin,
prétexte à de somptueuses cérémonies où les 2 alliés de la veille dans
l’affaire du Collège de Saint-Jean, Sir Lomer Gouin et Mgr Bruchési, sont
rassemblés. Marcellin Robert reste député jusqu’en 1919. important qu’on puisse lui attribuer serait sa mort tragique! Cela tient sans
doute à sa personnalité. Âme généreuse disponible pour soigner les pauvres
gratuitement, il n’en demeure pas moins un homme doté d’une humeur acariâtre.
Il n’hésite pas à blasphémer en présence des religieuses qui administrent
l’hôpital de Saint-Jean. L’engagement politique est pour lui un moyen
d’améliorer les soins de santé dans la Province et surtout son comté. Ainsi,
obtient-il du gouvernement provincial $ 250 000 pour l’agrandissement de
l’hôpital de Saint-Jean. Il obtient un montant identique pour le réaménagement
du pont Gouin, dont le tablier est déjà trop étroit pour les automobiles qui
circulent maintenant dessus. C’est d’ailleurs la quote part du gouvernement
provincial sur une somme de $ 500 000 attribuée pour ce pont. De nombreux
travaux routiers sont entrepris, surtout sur les routes Saint-Jean-Montréal et
Saint-Jean-Rouse’s Point. Après l’incendie du Collège de Saint-Jean, il faudra
contribuer à la construction du nouveau Séminaire. Pendant les heures sombres
de la Grande Crise de 1929, le Dr Bouthillier réussira à obtenir de Québec la
somme de $ 234 385 en octroi pour travaux de chômage et une somme de $ 37 000
en secours direct.
important qu’on puisse lui attribuer serait sa mort tragique! Cela tient sans
doute à sa personnalité. Âme généreuse disponible pour soigner les pauvres
gratuitement, il n’en demeure pas moins un homme doté d’une humeur acariâtre.
Il n’hésite pas à blasphémer en présence des religieuses qui administrent
l’hôpital de Saint-Jean. L’engagement politique est pour lui un moyen
d’améliorer les soins de santé dans la Province et surtout son comté. Ainsi,
obtient-il du gouvernement provincial $ 250 000 pour l’agrandissement de
l’hôpital de Saint-Jean. Il obtient un montant identique pour le réaménagement
du pont Gouin, dont le tablier est déjà trop étroit pour les automobiles qui
circulent maintenant dessus. C’est d’ailleurs la quote part du gouvernement
provincial sur une somme de $ 500 000 attribuée pour ce pont. De nombreux
travaux routiers sont entrepris, surtout sur les routes Saint-Jean-Montréal et
Saint-Jean-Rouse’s Point. Après l’incendie du Collège de Saint-Jean, il faudra
contribuer à la construction du nouveau Séminaire. Pendant les heures sombres
de la Grande Crise de 1929, le Dr Bouthillier réussira à obtenir de Québec la
somme de $ 234 385 en octroi pour travaux de chômage et une somme de $ 37 000
en secours direct. Sœurs Grises. Les religieuses s’en servent
alors pour donner des cours et y loger les infirmières de l’hôpital voisin. Le
prix de vente est de $ 19 300. Le Dr Bouthillier déménage dans sa splendide
demeure de Saint-Blaise, le Château Beau Castel. Sa réputation est telle
qu’il pourra soustraire le comté à la vague bleue de 1936 qui porte,
pour un premier mandat Maurice Duplessis de l’Union Nationale au pouvoir. Les
choses auraient sans doute continué ainsi si le destin n'avait frappé une nouvelle
fois un député de Saint-Jean à la Législative.
Sœurs Grises. Les religieuses s’en servent
alors pour donner des cours et y loger les infirmières de l’hôpital voisin. Le
prix de vente est de $ 19 300. Le Dr Bouthillier déménage dans sa splendide
demeure de Saint-Blaise, le Château Beau Castel. Sa réputation est telle
qu’il pourra soustraire le comté à la vague bleue de 1936 qui porte,
pour un premier mandat Maurice Duplessis de l’Union Nationale au pouvoir. Les
choses auraient sans doute continué ainsi si le destin n'avait frappé une nouvelle
fois un député de Saint-Jean à la Législative. L'année suivante, et jusqu'en 1924, l'église aménage dans une chapelle
dont la pierre angulaire est bénite le 28 avril 1907 par Mgr Armand Racicot,
évêque-auxiliaire de Montréal. Il s'agit d'une construction de brique dotée
d'une double volée d'escaliers et 2 rangées de lucarnes au toit. Cette chapelle
sert également d'école et de presbytère. Une façade de l'édifice donnait du
côté de la rue Salaberry et servait de résidence aux religieuses de la
congrégation de Notre-Dame qui enseignaient dans la paroisse. Cette bâtisse
s'élevait au milieu de l'actuelle cour de l'école J.-Amédée-Bélanger. La
bénédiction de la paroisse est prononcée par Mgr Paul Bruchési, le 15 décembre
1907.
L'année suivante, et jusqu'en 1924, l'église aménage dans une chapelle
dont la pierre angulaire est bénite le 28 avril 1907 par Mgr Armand Racicot,
évêque-auxiliaire de Montréal. Il s'agit d'une construction de brique dotée
d'une double volée d'escaliers et 2 rangées de lucarnes au toit. Cette chapelle
sert également d'école et de presbytère. Une façade de l'édifice donnait du
côté de la rue Salaberry et servait de résidence aux religieuses de la
congrégation de Notre-Dame qui enseignaient dans la paroisse. Cette bâtisse
s'élevait au milieu de l'actuelle cour de l'école J.-Amédée-Bélanger. La
bénédiction de la paroisse est prononcée par Mgr Paul Bruchési, le 15 décembre
1907. église. Le 8 décembre suivant, on inaugure l'église par un grand concert et à
Noël, on y célèbre la messe. Depuis, ont succédé au chanoine Labrèche, décédé
en mars 1940, le chanoine Wilfrid Fernet (1940-1947), le chanoine J. Alcide
Gareau (1947), le curé Jean Lequin et puis Mgr Bernard Courville (1977).
L'église est fermée depuis le début du nouveau siècle. Cette église était faite
pour desservir une paroisse pauvre. L'intérieur de la nef est sombre et, même
si elle a conservé l'idée du banc seigneurial, l’ambiance intérieure est une
véritable métaphore de la shop qui était le lieu quotidien de ses
paroissiens.
église. Le 8 décembre suivant, on inaugure l'église par un grand concert et à
Noël, on y célèbre la messe. Depuis, ont succédé au chanoine Labrèche, décédé
en mars 1940, le chanoine Wilfrid Fernet (1940-1947), le chanoine J. Alcide
Gareau (1947), le curé Jean Lequin et puis Mgr Bernard Courville (1977).
L'église est fermée depuis le début du nouveau siècle. Cette église était faite
pour desservir une paroisse pauvre. L'intérieur de la nef est sombre et, même
si elle a conservé l'idée du banc seigneurial, l’ambiance intérieure est une
véritable métaphore de la shop qui était le lieu quotidien de ses
paroissiens. Le dernier dimanche d’août de la même année, le curé Forget bénit la
pierre angulaire en présence d’un grand nombre de paroissiens, et le 25
décembre 1930 le curé Forget peut célébrer la première messe solennelle dans
l’église. Le curé Forget demeure alors dans un logis privé, non loin de là. Le
presbytère est construit par Pierre Trahan, entrepreneur et maire de la ville
et terminé pour le mois de février 1931. En 1930, une résidence privée sert
d’école et accueille 75 élèves. En 1933, un ouragan emporte le toit du
presbytère et il faut en refaire un nouveau. Le curé Forget meurt en 1950 et
est remplacé par Damase Roy, puis se succèdent les curés Jean-Louis Bourdon et
André Guillet.
Le dernier dimanche d’août de la même année, le curé Forget bénit la
pierre angulaire en présence d’un grand nombre de paroissiens, et le 25
décembre 1930 le curé Forget peut célébrer la première messe solennelle dans
l’église. Le curé Forget demeure alors dans un logis privé, non loin de là. Le
presbytère est construit par Pierre Trahan, entrepreneur et maire de la ville
et terminé pour le mois de février 1931. En 1930, une résidence privée sert
d’école et accueille 75 élèves. En 1933, un ouragan emporte le toit du
presbytère et il faut en refaire un nouveau. Le curé Forget meurt en 1950 et
est remplacé par Damase Roy, puis se succèdent les curés Jean-Louis Bourdon et
André Guillet.Harmonie de la vie religieuse à la paroisse de Saint-Jean. Le curé Charles Collin aura été curé de la
 paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste de 1894 à 1917. Quand en 1906
se sépare la paroisse Notre-Dame-Auxiliatrice, le langage populaire distingue la
petite de la grande paroisse. C’est vers 1910 qu’on effectue
l’exhumation des corps de l’ancien cimetière de la rue Laurier, le charnier
causant des problèmes désagréables au voisinage habité, les dépouilles purent
être transportées au Nouveau cimetière. Le 11 août 1911, le Conseil de Ville
adresse au gouvernement du Québec une demande d’abolition des rentes
seigneuriales. Cette résolution est appuyée par les marguilliers de la paroisse,
mais il faudra attendre 1916 pour voir s’accomplir le dernier paiement
d’arrérages des rentes au baron de Longueuil ($ 111.71). Charles-Antonelli Lamarche sera curé de la paroisse-mère de 1917 à 1922, alors qu’il est consacré
évêque de Chicoutimi. J.-Edmond Coursol lui succède et participe à la relève
économique de la paroisse.
paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste de 1894 à 1917. Quand en 1906
se sépare la paroisse Notre-Dame-Auxiliatrice, le langage populaire distingue la
petite de la grande paroisse. C’est vers 1910 qu’on effectue
l’exhumation des corps de l’ancien cimetière de la rue Laurier, le charnier
causant des problèmes désagréables au voisinage habité, les dépouilles purent
être transportées au Nouveau cimetière. Le 11 août 1911, le Conseil de Ville
adresse au gouvernement du Québec une demande d’abolition des rentes
seigneuriales. Cette résolution est appuyée par les marguilliers de la paroisse,
mais il faudra attendre 1916 pour voir s’accomplir le dernier paiement
d’arrérages des rentes au baron de Longueuil ($ 111.71). Charles-Antonelli Lamarche sera curé de la paroisse-mère de 1917 à 1922, alors qu’il est consacré
évêque de Chicoutimi. J.-Edmond Coursol lui succède et participe à la relève
économique de la paroisse. des
confessions catholiques et réformées. Ainsi, le curé Coursol, au premier tiers
du siècle, maintient cette vieille tradition de se faire un devoir, avant la
messe de minuit, de sortir sur le parvis de l'église pour aller serrer la main
des deux ministres protestants et de les conduire à des prie-Dieu d'honneur à
l'avant de l'allée centrale, un pour l'anglican et l'autre pour le pasteur
méthodiste. Lors
des
confessions catholiques et réformées. Ainsi, le curé Coursol, au premier tiers
du siècle, maintient cette vieille tradition de se faire un devoir, avant la
messe de minuit, de sortir sur le parvis de l'église pour aller serrer la main
des deux ministres protestants et de les conduire à des prie-Dieu d'honneur à
l'avant de l'allée centrale, un pour l'anglican et l'autre pour le pasteur
méthodiste. Lors 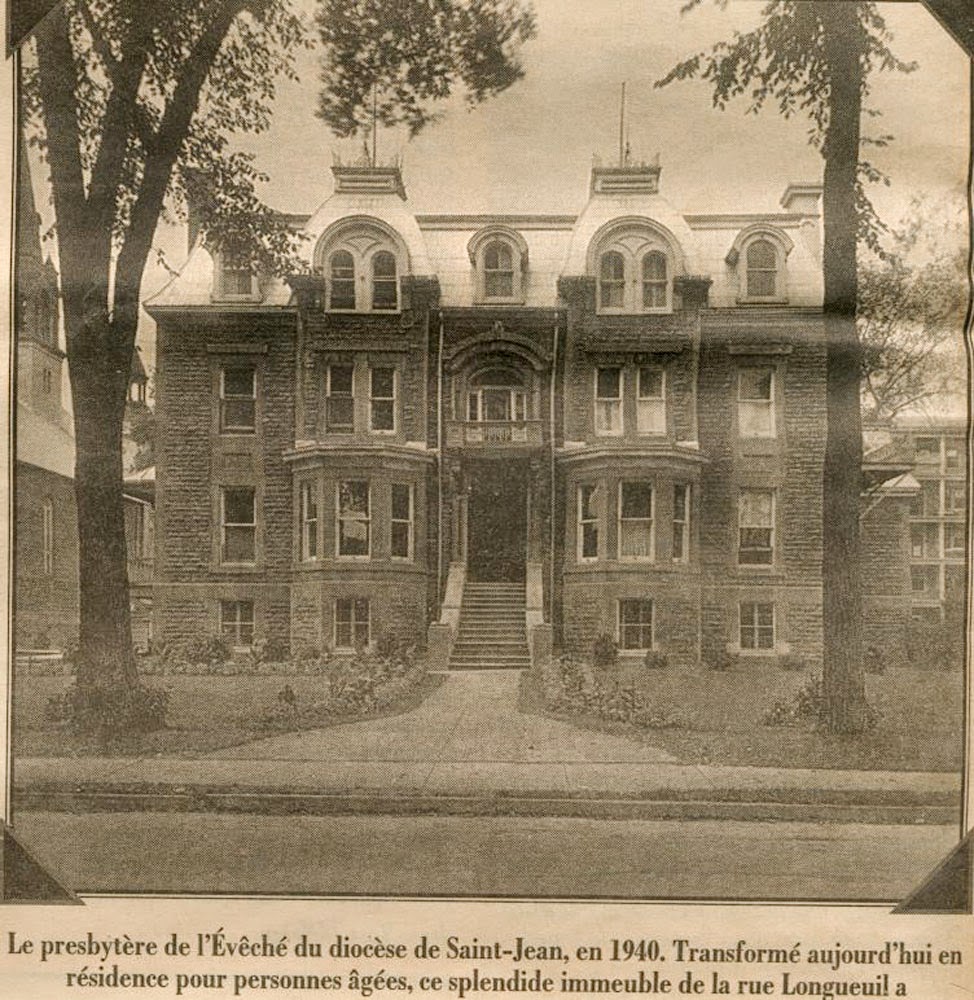 de la proclamation de l'évêché (qui réside dans l'ancien presbytère) cette tradition sera
abandonnée. Seule exception : lors d’un incident passé durant les années de
guerre, un avion école s'écrase près de la ville, les deux élèves-pilotes, bien
que de croyances différentes, ont des funérailles communes à la cathédrale.
de la proclamation de l'évêché (qui réside dans l'ancien presbytère) cette tradition sera
abandonnée. Seule exception : lors d’un incident passé durant les années de
guerre, un avion école s'écrase près de la ville, les deux élèves-pilotes, bien
que de croyances différentes, ont des funérailles communes à la cathédrale. considérable donnent de nouvelles couleurs à l’intérieur de la nef. Le Délégué
Apostolique, Mgr Pietro di Maria, inaugure la bâtisse rénovée et le 23 novembre
1924 a lieu la bénédiction de 5 nouvelles cloches qui sonnent toujours les
offices du dimanche et les grandes cérémonies. Auparavant, le 18 décembre 1853
avaient été béni un carillon formé des deux premières cloches de l’église. Puis
une troisième s’était rajoutée en 1867. Le curé Coursol offre la plus petite
des cloches du vieux carillon au St-John’s High School, situé en face de
l’église Saint-James. Il y eut bien quelques murmures, mais le curé Coursol,
comme le curé LaRocque jadis, ne s’en laisse pas imposer.
considérable donnent de nouvelles couleurs à l’intérieur de la nef. Le Délégué
Apostolique, Mgr Pietro di Maria, inaugure la bâtisse rénovée et le 23 novembre
1924 a lieu la bénédiction de 5 nouvelles cloches qui sonnent toujours les
offices du dimanche et les grandes cérémonies. Auparavant, le 18 décembre 1853
avaient été béni un carillon formé des deux premières cloches de l’église. Puis
une troisième s’était rajoutée en 1867. Le curé Coursol offre la plus petite
des cloches du vieux carillon au St-John’s High School, situé en face de
l’église Saint-James. Il y eut bien quelques murmures, mais le curé Coursol,
comme le curé LaRocque jadis, ne s’en laisse pas imposer.LA dièse - 3 795 kgs (8 385 lbs), Saint-Jean (évangéliste). Les Armes de Mgr Gauthier (alors évêque du diocèse de Montréal), le Sacré-Cœur, une Croix, le pape Pie XI, George V Roi, Mgr Georges Gauthier, Archevêque et Messire Jos. Ed. Coursol, Curé. Sa devise est prise hors de l’évangile de Jean : Aimez-vous les uns les autres A.D. 1924.RÉ dièse 1 589 kgs (3 508 lbs). Saint-Paul. Effigie de l’apôtre Paul, de l’Immaculée Conception, les Armes de Mgr Bruchési, une Croix et les noms des marguilliers de 1923-1924 : Isaïe Hevey, Paul Labelle, Willie Bourgeois et F.-X. Archambault, N.P.. Sa devise est J’ai combattu le bon combat. A.D. 1924.FA 1 145 (2 528 lbs). Joseph-Edmond. Effigie de Saint-Joseph et de Jeanne d’Arc (récemment canonisée), ainsi que des anciens curés de la Paroisse : Mgr M. Gaulin (1828), J.-F. Morisset 1831, Mgr Chas Larocque 1844, F. Aubry 1866, Chs Collin 1894, Chs Lamarche 1917 et J.-E. Coursol 1922. Sa devise : Allez à Joseph A.D. 1924.SOL 779 kgs (1 720 lbs) Saint Jean-Baptiste. Effigie du Précurseur, de Pierre Trahan (maire), de A.-J. Benoît (député fédéral) et du Dr Alexis Bouthillier (député provincial). Sa devise : Tu es le prophète du Très Haut A. D. 1924.LA dièse 473 kgs (1 044 lbs) Sainte-Anne. Effigie Sainte-Anne et Saint-François. Sa devise : Bonne Sainte-Anne, priez pour nous A.D. 1924.
 l’édifice des Chevaliers de Colomb,
rue Richelieu. Les groupes sociaux à caractères religieux se développent
surtout durant cette période : Chevaliers de Colomb, Dames de Saint-Anne,
Filles d’Isabelle, Enfants de Marie, nous les retrouvons à la grandeur de la
Province, aussi est-il normal qu’ils s’établissent à Saint-Jean. Leurs membres
se dévouent, souvent bénévolement, à la préparation des célébrations
paroissiales, organisant tombolas et bingos dans le but de rapporter du
financement à la Fabrique et aux œuvres pies.
l’édifice des Chevaliers de Colomb,
rue Richelieu. Les groupes sociaux à caractères religieux se développent
surtout durant cette période : Chevaliers de Colomb, Dames de Saint-Anne,
Filles d’Isabelle, Enfants de Marie, nous les retrouvons à la grandeur de la
Province, aussi est-il normal qu’ils s’établissent à Saint-Jean. Leurs membres
se dévouent, souvent bénévolement, à la préparation des célébrations
paroissiales, organisant tombolas et bingos dans le but de rapporter du
financement à la Fabrique et aux œuvres pies.«Elle fut prise, cette décision, par le Pape Pie XI, le 9 juin 1933, déterminant ainsi : que le diocèse de Saint-Jean serait limité, à l’ouest, par le fleuve Saint-Laurent; au nord et à l’est, par les limites adjacentes du diocèse de Saint-Hyacinthe; au Sud, par les frontières entre la Puissance du Canada et les États-Unis d’Amérique du Nord; enfin, au sud-ouest, par les limites du diocèse de Valleyfield».[25]
«Puis le Saint-Siège écrige le diocèse de Saint-Jean, demandé depuis longtemps - depuis l’époque où les prêtres de Sainte-Marie-de-Monnoir transportèrent leur institution dans cette ville, avec l’espoir d’en faire un séminaire diocésain - et recommandé par Mgr Gauthier depuis 1925. Le Saint-Siège avait attendu l’apaisement de l’affaire. Le nouveau diocèse comptait un collège, 41 paroisses et plus de 65 000 catholiques. Son premier évêque est Mgr Anastase Forget, un an plus tôt Supérieur du Collège de l’Assomption, devenu vicaire général du diocèse de Montréal».[26]
 Le diocèse paie les
matériaux et le gouvernement les salaires. Cet édifice, rue Laurier, fait face
à la maison du futur Ministre des postes, Alcide Côté. C'est un centre
d'activités de loisirs, un centre culturel ouvert aux représentations
théâtrales, aux concerts des Jeunesses musicales, à des réunions syndicales.
Patronnée par le chanoine Armand Racicot, les abbés Laurent Brault et Yves
Tremblay et pour les syndicats catholiques, l'abbé Léopold Gauthier, la Centrale
sert surtout aux réunions des mouvements de jeunesse : la J.O.C. (Jeunesse
Ouvrière Catholique) (fondée en 1938), la J.E.C. (Jeunesse Étudiante
Catholique) (fondée en 1937), la J.I.C. (Jeunesse Indépendante Catholique)
(fondée en 1941), les Scouts catholiques et une coop d'habitation. En 1935, Mgr
Forget fonde le mouvement des Guides dans le diocèse de même que l’Œuvre des
Terrains de Jeux (O.T.J.) où allait s’illustrer le chanoine Armand Racicot. La
même année est fondée la maison de retraite Sainte-Bernadette à Saint-Jean, de
même qu’une société de colonisation pour venir en aide aux victimes de la crise
économique. En 1936, c’est le tour de la fondation de l’École Normale de
Saint-Jean, ainsi que de la Jeunesse Agricole Catholique (J.A.C.) (fondée en
1936). Un an plus tard, le journal Le Richelieu, essentiellement
conservateur, est déclaré l’organe officiel de l’Action Catholique diocésaine.
Parallèlement, Mgr Forget établit les bases du syndicalisme catholique dans le
diocèse. Les années de la Seconde Guerre mondiale ne ralentissent pas les
activités diocésaines. En 1940, c’est l’inauguration de la Centrale catholique
à Saint-Jean ainsi que des premières cellules de la LOC qui promeuvent les
coopératives d’habitation et de consommation. En 1941, c’est la fondation de la
fédération diocésaine du Cercle des Fermières du diocèse. En 1945, c’est la
fondation des Cercles Lacordaire et Jeanne-d’Arc, cercles de tempérance pour
lutter contre l’alcoolisme. C’est cette même année qu’arrivent les premières vagues
d’immigration sur la rive sud du fleuve, qui vont faire balancer la population
du diocèse de la ville de Saint-Jean vers Longueuil. En 1946 est fondé le
Centre Mgr Forget pour délinquants.
Le diocèse paie les
matériaux et le gouvernement les salaires. Cet édifice, rue Laurier, fait face
à la maison du futur Ministre des postes, Alcide Côté. C'est un centre
d'activités de loisirs, un centre culturel ouvert aux représentations
théâtrales, aux concerts des Jeunesses musicales, à des réunions syndicales.
Patronnée par le chanoine Armand Racicot, les abbés Laurent Brault et Yves
Tremblay et pour les syndicats catholiques, l'abbé Léopold Gauthier, la Centrale
sert surtout aux réunions des mouvements de jeunesse : la J.O.C. (Jeunesse
Ouvrière Catholique) (fondée en 1938), la J.E.C. (Jeunesse Étudiante
Catholique) (fondée en 1937), la J.I.C. (Jeunesse Indépendante Catholique)
(fondée en 1941), les Scouts catholiques et une coop d'habitation. En 1935, Mgr
Forget fonde le mouvement des Guides dans le diocèse de même que l’Œuvre des
Terrains de Jeux (O.T.J.) où allait s’illustrer le chanoine Armand Racicot. La
même année est fondée la maison de retraite Sainte-Bernadette à Saint-Jean, de
même qu’une société de colonisation pour venir en aide aux victimes de la crise
économique. En 1936, c’est le tour de la fondation de l’École Normale de
Saint-Jean, ainsi que de la Jeunesse Agricole Catholique (J.A.C.) (fondée en
1936). Un an plus tard, le journal Le Richelieu, essentiellement
conservateur, est déclaré l’organe officiel de l’Action Catholique diocésaine.
Parallèlement, Mgr Forget établit les bases du syndicalisme catholique dans le
diocèse. Les années de la Seconde Guerre mondiale ne ralentissent pas les
activités diocésaines. En 1940, c’est l’inauguration de la Centrale catholique
à Saint-Jean ainsi que des premières cellules de la LOC qui promeuvent les
coopératives d’habitation et de consommation. En 1941, c’est la fondation de la
fédération diocésaine du Cercle des Fermières du diocèse. En 1945, c’est la
fondation des Cercles Lacordaire et Jeanne-d’Arc, cercles de tempérance pour
lutter contre l’alcoolisme. C’est cette même année qu’arrivent les premières vagues
d’immigration sur la rive sud du fleuve, qui vont faire balancer la population
du diocèse de la ville de Saint-Jean vers Longueuil. En 1946 est fondé le
Centre Mgr Forget pour délinquants. de la fièvre typhoïde qui attaquent
régulièrement l’institution, la Supérieure fait installer un filtre, mais ce
procédé s’avère malheureusement insuffisant. La même année, les religieuses
inaugurent les cours d’enseignement ménager à la demande de l’abbé J.-A.
Papineau, Supérieur du Collège de Saint-Jean mais aussi aumônier au Couvent,
ainsi que des commissaires. Les élèves, pour les remercier, offrent un souper
en leur honneur. En 1922, le Surintendant de l’Instruction publique, le notaire
Cyrille Delâge de Québec, rend visite au Couvent où il est dignement reçu.
de la fièvre typhoïde qui attaquent
régulièrement l’institution, la Supérieure fait installer un filtre, mais ce
procédé s’avère malheureusement insuffisant. La même année, les religieuses
inaugurent les cours d’enseignement ménager à la demande de l’abbé J.-A.
Papineau, Supérieur du Collège de Saint-Jean mais aussi aumônier au Couvent,
ainsi que des commissaires. Les élèves, pour les remercier, offrent un souper
en leur honneur. En 1922, le Surintendant de l’Instruction publique, le notaire
Cyrille Delâge de Québec, rend visite au Couvent où il est dignement reçu. coudre chaque mois pour les
enfants. Le 9 décembre, l’Orphéon de Saint-Jean, sous la direction de L.-O.
Perrier, présente une comédie-musicale au profit de l’orphelinat. C’est
la première organisation charitable au profit de l’établissement. Le 17 mai
1926, l’orphelinat ou Centre des Œuvres Saint-Thérèse, déménage au 170 rue Longueuil, le curé Coursol y célèbre la
première messe. Les classes de l’Orphelinat ouvrent leurs portes le 6 septembre
1926. Il y a 61 inscriptions, y compris 14 externes. De mai 1927 à 1950, les
dames patronnesses organisent chaque année des fêtes champêtres, des parties de
cartes, des tirages et une quête annuelle de légumes à l’automne, une quête des
œufs à l’occasion de Pâques. Chaque année des excursons et des fêtes sont
organisées soit par les Chevaliers de Colomb, soit par la Chambre de Commerce,
soit les clubs sociaux ou même le Collège militaire. L’orphelinat profite
également des largesses de certaines maisons de commerce qui souscrivent pour
éteindre les dettes de l’institution.
coudre chaque mois pour les
enfants. Le 9 décembre, l’Orphéon de Saint-Jean, sous la direction de L.-O.
Perrier, présente une comédie-musicale au profit de l’orphelinat. C’est
la première organisation charitable au profit de l’établissement. Le 17 mai
1926, l’orphelinat ou Centre des Œuvres Saint-Thérèse, déménage au 170 rue Longueuil, le curé Coursol y célèbre la
première messe. Les classes de l’Orphelinat ouvrent leurs portes le 6 septembre
1926. Il y a 61 inscriptions, y compris 14 externes. De mai 1927 à 1950, les
dames patronnesses organisent chaque année des fêtes champêtres, des parties de
cartes, des tirages et une quête annuelle de légumes à l’automne, une quête des
œufs à l’occasion de Pâques. Chaque année des excursons et des fêtes sont
organisées soit par les Chevaliers de Colomb, soit par la Chambre de Commerce,
soit les clubs sociaux ou même le Collège militaire. L’orphelinat profite
également des largesses de certaines maisons de commerce qui souscrivent pour
éteindre les dettes de l’institution.«La conversation s’est poursuivie durant de longs moments, les anecdotes se succédant les unes aux autres : par exemple les 5 enfants d’une même famille, abandonnés par leurs parents et que la police avait conduits au Service Social. Comme il arrivait dans ces cas-là, en désespoir de cause, on allait frapper à la porte de l’orphelinat pour demander un placement de "quelques jours" qui s’étirait quelquefois sur plusieurs mois, comme ce fut le cas pour ces 5 enfants…»[27]
 études dans cette institution. Pourtant, Mgr Bernard, évêque
de Saint-Hyacinthe, anticipait la création d’un collège diocésain et écartait
Monnoir de ses faveurs. En 1907, un incendie détruit le Collège et, comme il se
trouvait mal situé à Marieville, les prêtres songèrent à l’installer ailleurs.
Ils reçurent des invitations des citoyens de Sorel qui ambitionnaient, eux
aussi, le statut de diocèse et posséder un collège de grande réputation.
Malheureusement pour eux, la requête des Johannais les avait devancés. Les
professeurs de Marieville savaient que tôt ou tard, en restant dans cette
localité, ils seraient étouffés par deux collèges rivaux. Un à Saint-Jean, à 12
milles de distance, et celui de Saint-Hyacinthe à 22 milles. Pendant les
vacances de 1908, ils tentèrent un déménagement subreptice à Saint-Jean. Rome d’ailleurs était intervenu pour fermer le collège en 1908-1909. À l’été
1909, les prêtres aménagèrent à Saint-Jean mais perdirent leur juridiction et
même le droit de célébrer la messe durant cent jours. Le Collège rouvrit
néanmoins ses classes de 1909 à 1911.[28]
études dans cette institution. Pourtant, Mgr Bernard, évêque
de Saint-Hyacinthe, anticipait la création d’un collège diocésain et écartait
Monnoir de ses faveurs. En 1907, un incendie détruit le Collège et, comme il se
trouvait mal situé à Marieville, les prêtres songèrent à l’installer ailleurs.
Ils reçurent des invitations des citoyens de Sorel qui ambitionnaient, eux
aussi, le statut de diocèse et posséder un collège de grande réputation.
Malheureusement pour eux, la requête des Johannais les avait devancés. Les
professeurs de Marieville savaient que tôt ou tard, en restant dans cette
localité, ils seraient étouffés par deux collèges rivaux. Un à Saint-Jean, à 12
milles de distance, et celui de Saint-Hyacinthe à 22 milles. Pendant les
vacances de 1908, ils tentèrent un déménagement subreptice à Saint-Jean. Rome d’ailleurs était intervenu pour fermer le collège en 1908-1909. À l’été
1909, les prêtres aménagèrent à Saint-Jean mais perdirent leur juridiction et
même le droit de célébrer la messe durant cent jours. Le Collège rouvrit
néanmoins ses classes de 1909 à 1911.[28] diocèse
de Montréal. Lors de l’incendie de 1907, Mgr Bruchési, bien avant Mgr Bernard,
en visite de condoléances, laisse échapper une phrase troublante : «Je n’ai
pas la clef pour vous faire sortir du diocèse de Saint-Hyacinthe, mais j’ai la
clef pour vous ouvrir le diocèse de Montréal, où je vous recevrais volontiers».
Le Supérieur de Monnoir, l’abbé J.-A. Lemieux, y entend l’invitation de venir
s’établir dans le diocèse de Montréal! Voici donc le nouveau Collège situé sur
la rue De Salaberry sans avoir reçu l’exeat de Mgr Bernard. Celui-ci rappelle
les religieux. L’abbé Lemieux se rend à Saint-Hyacinthe pour s’expliquer avec
l’évêque. Ce dernier ne veut rien entendre et impose son autorité. Mgr
Bruchési, pour sa part, désavoue l’interprétation faite par l’abbé Lemieux, et
ce dernier accuse l’archevêque de Montréal de renier sa parole et menace
d’ouvrir définitivement son collège à Saint-Jean. D’où l’interdit, les prêtres
de Monnoir ne peuvent célébrer la messe et doivent se contenter d’y assister
comme de simples fidèles, le missel sous le bras. Ils sont considérés comme des
rebelles à l’autorité diocésaine.
diocèse
de Montréal. Lors de l’incendie de 1907, Mgr Bruchési, bien avant Mgr Bernard,
en visite de condoléances, laisse échapper une phrase troublante : «Je n’ai
pas la clef pour vous faire sortir du diocèse de Saint-Hyacinthe, mais j’ai la
clef pour vous ouvrir le diocèse de Montréal, où je vous recevrais volontiers».
Le Supérieur de Monnoir, l’abbé J.-A. Lemieux, y entend l’invitation de venir
s’établir dans le diocèse de Montréal! Voici donc le nouveau Collège situé sur
la rue De Salaberry sans avoir reçu l’exeat de Mgr Bernard. Celui-ci rappelle
les religieux. L’abbé Lemieux se rend à Saint-Hyacinthe pour s’expliquer avec
l’évêque. Ce dernier ne veut rien entendre et impose son autorité. Mgr
Bruchési, pour sa part, désavoue l’interprétation faite par l’abbé Lemieux, et
ce dernier accuse l’archevêque de Montréal de renier sa parole et menace
d’ouvrir définitivement son collège à Saint-Jean. D’où l’interdit, les prêtres
de Monnoir ne peuvent célébrer la messe et doivent se contenter d’y assister
comme de simples fidèles, le missel sous le bras. Ils sont considérés comme des
rebelles à l’autorité diocésaine.«Les prêtres ouvrent leur collège à Saint-Jean. Mgr Bernard, conformément à des instructions reçues de Rome, destitue le Supérieur et l’économe, et envoie un nouveau Supérieur - l’abbé Houle - et un nouvel économe. Ceux-ci sont proprement éconduits. Les prêtres répondent qu’ils ont fait appel "au Pape mieux informé". La population les soutient. L’ancien député Monet, devenu protonotaire à Montréal, puis juge de la Cour Supérieure pour le district d’Iberville, prend leur cause en main…»[30]
 De ces anciens élèves, la plupart appuient l’abbé Lemieux. Un créancier
anglo-canadien du Collège intente un procès devant la Cour Supérieure de
Montréal pour empêcher l’exécution des décisions romaines et épiscopales
susceptibles de léser ses droits. Derrière cette tactique, on retrouve des
membres du Parti Libéral : «Les prêtres pourront, à la rigueur, dire à leur
évêque : "Nous sommes prêts à exécuter le décret de dissolution, mais les
tribunaux civils nous en empêchent».[31]
Les prêtres de Monnoir supplient le juge Mathieu, ultramontain, de plaider leur
cause à Rome. Vaine démarche. Rome s’est prononcée. Entre temps, Mgr Bruchési,
qui se conforme aux directives romaines, ordonne la fondation d’un Collège
indépendant à Saint-Jean. Le préfet des études au Séminaire de Sainte-Thérèse,
originaire lui-même de Saint-Jean où réside toujours sa famille, l’abbé
Joseph-Arthur Papineau, se voit nommé premier Supérieur du Collège de
Saint-Jean.
De ces anciens élèves, la plupart appuient l’abbé Lemieux. Un créancier
anglo-canadien du Collège intente un procès devant la Cour Supérieure de
Montréal pour empêcher l’exécution des décisions romaines et épiscopales
susceptibles de léser ses droits. Derrière cette tactique, on retrouve des
membres du Parti Libéral : «Les prêtres pourront, à la rigueur, dire à leur
évêque : "Nous sommes prêts à exécuter le décret de dissolution, mais les
tribunaux civils nous en empêchent».[31]
Les prêtres de Monnoir supplient le juge Mathieu, ultramontain, de plaider leur
cause à Rome. Vaine démarche. Rome s’est prononcée. Entre temps, Mgr Bruchési,
qui se conforme aux directives romaines, ordonne la fondation d’un Collège
indépendant à Saint-Jean. Le préfet des études au Séminaire de Sainte-Thérèse,
originaire lui-même de Saint-Jean où réside toujours sa famille, l’abbé
Joseph-Arthur Papineau, se voit nommé premier Supérieur du Collège de
Saint-Jean. «Dès la première semaine d’août, les travaux commencent: démolition d’une haute bouteille de brique à l’entrée de la cour, et surtout transformation prestigieuse d’une poterie en maison d’éducation. M. le procureur dirige la besogne avec entrain et diligence : une porte centrale est percée, une longue galerie est ajoutée… Le 13 août, il salue l’arrivée de son “compagnon d’infortune”: M. l’abbé Armand Chaussé; mais lejeune et enthousiaste collaborateur doit aussitôt retourner à Montréal, pour endosser une soutane de “surveillant de construction”. Entre deux visites au “collège”, M. l’abbé Papineau élabore des plans d’avenir, dans sa chambre de presbytère. Car toute l’organisation morale, intellectuelle et même matérielle repose sur lui, et il faut, en peu de temps, préparer à l’œuvre une impulsion forte et durable. Au début de septembre, la maison peut recevoir ses premiers professeurs. Sans doute, les ouvriers continuent leur tintamarre; de plus, les portes manquent aux chambres, et les couvertures aux lits. Mais on ne fonde pas sans héroïsme, et d’ailleurs, nos pionniers savent sourire aux difficultés. Les petites Sœurs de la Sainte-Famille durent d’abord loger à l’Hôpital, en attendant leur couvent neuf, auquel fut bientôt ajouté un étage-dortoir. Enfin, le 6 septembre, première rentrée! Une pluie abondante et des incidents variés rendirent la journée plus émouvante. Mgr l’Archevêque s’empressa de téléphoner : “Combien d’élèves? - 90, Monseigneur - Deo gratias”! Peu après, ce nombre s’éleva à 100, et dès cette première année, le Collège reçut 137 enfants. Fait presque unique dans l’histoire de nos collèges: les cours classique et commercial sont déjà complets».[32]
«L’abbé Papineau ouvrira le collège dans une poterie désaffectée, sans assistance, au milieu d’une population hostile. Deux amis laïcs de l’abbé Papineau, le député Joseph Demers et le magistrat Saint-Cyr, l’avertissent de l’état des esprits et des difficultés énormes - peut-être insurmontables - qui l’attendent. "J’agis par obéissance", répond l’abbé Papineau, très attaché à Sainte-Thérèse. Demers et Saint-Cyr décident alors de l’aider et lui envoient leurs enfants, pour donner l’exemple. Mais Monet reste hostile, violent; la majorité de la population le suit; et Léonide Perron, avocat de Sainte-Marie-de-Monnoir, tentera d’empêcher l’octroi d’une charte provinciale au nouveau collège».[33]
«Entre les élèves des deux maisons, les relations étaient loin d’être harmonieuses, pour ne pas dire plus. À cette époque-là, les étudiants, les jours de congé, faisaient des promenades en groupe à travers les rues de la ville sous la surveillance d’un ou deux professeurs pour éviter les fugues de leurs jeunes protégés. Ces sages précautions n’empêchaient pas cependant les élèves des deux institutions d’en venir à des coups, alors que les deux bataillons se croisaient à l’occasion de ces sages sorties.Alos que le surveillant du Collège regardait bien calmement les deux camps s’échanger des coups, au grand scandale de son vis-à-vis. Probablement que les gens de Monnoir avaient le meilleur dans la bagare».[34]
«Le juge Monet, toujours rouge et patriote à la mode de 37, convoque une grande assemblée à Saint-Jean, le 16 juillet, et prononce des paroles violentes visiblement goûtées par la foule. On trouverait pas cent, peut-être pas cinquante partisans de la soumission (des prêtres de Monnoir à l'intégrité romaine) dans toute la ville de Saint-Jean. Le collège officiel est boycotté, malgré l'urbanité de l'abbé Papineau et l'appui d'un ou deux notables. Des volontaires s'offrent à monter la garde, s'il le faut, devant Sainte-Marie-de-Monnir. Ainsi, de temps à autre, sur quelque point de la province, en raison d'une situation locale ou d'intérêts particuliers, l'épiscopat subissait une résistance, étendue, non pas aux seuls anticléricaux, mais à une fraction importante de la population.Tandis que Monet haranguait les citoyens de Saint-Jean, la Sacrée Congrégation Consistoriale rejetait le recours des professeurs. Lecture du document romain, daté du 18 juillet, fut donnée le 11 août dans les églises des diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe. Interdits par l'archevêque, les prêtres durent céder. Ils fermèrent leur collège… Les prêtres condamnés se dispersèrent; le Supérieur Lemieux alla mourir en Floride, le bréviaire à la main. L’abbé Papineau, bon administrateur et enfant de Saint-Jean, apprivoisa peu à peu ces farouches concitoyens».[35]
«Pendant ce temps, le nombre des élèves suivait le rythme des événements extérieurs. Monté à 246 en 1914, il devait subir une légère régression pendant la Grande-Guerre et les terribles épidémies de 1917 et 1918. En 1919, 266 élèves; en 1922, 288; de 1926 à 1931, au delà de 300! Mais ensuite la crise le ramène à 275, puis à 250 et même moins… Cependant, le Collège a reçu plus de 2 300 enfants, venus de notre région, de la métropole ou d’ailleurs. À l’Église, il a fourni une centaine de prêtres, religieux ou séminaristes; dans toutes les classes de la société, de nombreux Anciens exercent une salutaire influence, et l’avenir s’ouvre à plusieurs, pleins de promesses».[36]
«Les cours devaient effectivement reprendre le 7 novembre à 8 heures. Deux cents élèves sont présents, dont une centaine de pensionnaires logés dans les familles de la ville. Tout le jour c’était un và et vient continuel; la messe a lieu à la salle de l’Académie du Sacré-Cœur, rue Laurier, c’est là aussi que se prennent les récréations pour les classes, les élèves se rendent les uns à l’ancienne "université", sur Saint-Jacques, les autres à la vieille Centrale Catholique, à l’édifice du journal Le Richelieu, où à la maison Henderon Black à l’emplacement du nouveau bureau de poste. C’était le genre université».[37]
 nues sur les tables… en 1920! C’est de Dixon que Mgr Forget, afin d’en
finir avec le scandale probablement, décide d’acheter l’édifice. La
construction de la Villa est financée par la Maison Provinciale des Jésuites et
de certains particuliers désirant souscrire au financement, de sorte que le 1er
juillet 1933, après avoir pressé les dernières filles à sortir par la porte
arrière du Towers Hotel, les premiers Pères Jésuites entraient par la
porte avant de leur nouvelle maison de retraites fermées. Ils aménagent une
salle et une chapelle au premier étage et 50 chambres au deuxième et au
troisième étage. Ils font construire également 4 garages aux deux extrémités de
la bâtisse. Ils érigent une plaque au-dessus de la grande porte avec
l’inscription : Retraite fermée. Le 13 janvier 1936, la Villa Saint-Jean
ouvre ses portes pour le premier exercice de retraite fermée. Bientôt, tous les
laïcs - surtout parmi les notables de la ville - pourront venir au
recueillement avec les Pères Jésuites ou suivre une désincure d’alcoolisme.
nues sur les tables… en 1920! C’est de Dixon que Mgr Forget, afin d’en
finir avec le scandale probablement, décide d’acheter l’édifice. La
construction de la Villa est financée par la Maison Provinciale des Jésuites et
de certains particuliers désirant souscrire au financement, de sorte que le 1er
juillet 1933, après avoir pressé les dernières filles à sortir par la porte
arrière du Towers Hotel, les premiers Pères Jésuites entraient par la
porte avant de leur nouvelle maison de retraites fermées. Ils aménagent une
salle et une chapelle au premier étage et 50 chambres au deuxième et au
troisième étage. Ils font construire également 4 garages aux deux extrémités de
la bâtisse. Ils érigent une plaque au-dessus de la grande porte avec
l’inscription : Retraite fermée. Le 13 janvier 1936, la Villa Saint-Jean
ouvre ses portes pour le premier exercice de retraite fermée. Bientôt, tous les
laïcs - surtout parmi les notables de la ville - pourront venir au
recueillement avec les Pères Jésuites ou suivre une désincure d’alcoolisme. de groupes
sociaux viennent installer leurs bureaux dans la Villa désaffectée. L’endroit
est enchanteur, un des plus beaux espaces verts de Saint-Jean. Mais
bientôt, une société provinciale, la Société d’Habitation du Québec lorgne le
vieil édifice et propose au Conseil municipal de l’acheter. L’opinion des
conseillers est partagée. Il y a ceux qui espèrent conserver la Villa qui
pensent convaincre la S.H.Q. de se porter sur un terrain plus au nord, et ceux
qui ne peuvent résister à l’offre de $ 2 000 000 offert par l’organisme
provincial comprenant la Villa et son terrain. Les choses en sont ainsi
lorsque, dans la nuit du 31 décembre 1974, à l’heure du Réveillon du Jour de
l’An, un violent incendie ravage, miraculeusement, la Villa. Devant le
désastre, le Conseil s’incline et vend les 75 000 pieds carrés à la S.H.Q.
L’édifice est rasé et une imense construction de logements pour personnes âgées
s’élève aujourd’hui sur l’emplacement paradisiaque de la Villa Saint-Jean.
de groupes
sociaux viennent installer leurs bureaux dans la Villa désaffectée. L’endroit
est enchanteur, un des plus beaux espaces verts de Saint-Jean. Mais
bientôt, une société provinciale, la Société d’Habitation du Québec lorgne le
vieil édifice et propose au Conseil municipal de l’acheter. L’opinion des
conseillers est partagée. Il y a ceux qui espèrent conserver la Villa qui
pensent convaincre la S.H.Q. de se porter sur un terrain plus au nord, et ceux
qui ne peuvent résister à l’offre de $ 2 000 000 offert par l’organisme
provincial comprenant la Villa et son terrain. Les choses en sont ainsi
lorsque, dans la nuit du 31 décembre 1974, à l’heure du Réveillon du Jour de
l’An, un violent incendie ravage, miraculeusement, la Villa. Devant le
désastre, le Conseil s’incline et vend les 75 000 pieds carrés à la S.H.Q.
L’édifice est rasé et une imense construction de logements pour personnes âgées
s’élève aujourd’hui sur l’emplacement paradisiaque de la Villa Saint-Jean.«Il faisait souvent du bureau tard la nuit, parfois jusqu’à 2 heures du matin. Il rentrait chez lui épuisé et à peine était-il couché et endormi que, quelquefois, le téléphone sonnait, et il devait repartir à nouveau pour aller soigner des malades, malgré sa fatigue. Il lui arriva à maintes occasions de dispenser ses soins tout en sachant que ses patients ne pouvaient le payer.
Cette bonté que le docteur manifesta toujours envers les défavorisés lui valut d’être appelé "le médecin des pauvres" ou mieux encore, "l’ami du peuple"».[38]
 de gardes-malades sont ouverts le 10 mars 1923 et en octobre 1925, Mlles
Louise Guillet, Yvonne Couillard et Amanda Forgues sont les premières graduées.
Mais les
bâtiments de l'hôpital ne cessent d'apparaître inhospitalier! Une première
amélioration du bâtiment, inauguré le 27 mai 1923, compte 50 lits pour les malades,
au lieu des 20 précédents. Le nombre des malades admis
annuellement, lui, ne cesse de croître. La même année, on en reçoit 237, nombre
qui passe à 780 en 1926. Il faut donc, à nouveau, agrandir l’hôpital. On y a ajouté des services :
la chirurgie (inaugurée par le Dr Georges Phaneuf en 1924) et pathologie
interne, la gynécologie et l'obstétrique, les maladies des enfants, les
maladies des yeux, des oreilles et du nez, l'électricité et la radiographie
enfin un laboratoire de chimie et biologie. Toujours sous l'administration des
Sœurs Grises, le taux d’occupation des lits déborde les
capacités, même renouvelées :
de gardes-malades sont ouverts le 10 mars 1923 et en octobre 1925, Mlles
Louise Guillet, Yvonne Couillard et Amanda Forgues sont les premières graduées.
Mais les
bâtiments de l'hôpital ne cessent d'apparaître inhospitalier! Une première
amélioration du bâtiment, inauguré le 27 mai 1923, compte 50 lits pour les malades,
au lieu des 20 précédents. Le nombre des malades admis
annuellement, lui, ne cesse de croître. La même année, on en reçoit 237, nombre
qui passe à 780 en 1926. Il faut donc, à nouveau, agrandir l’hôpital. On y a ajouté des services :
la chirurgie (inaugurée par le Dr Georges Phaneuf en 1924) et pathologie
interne, la gynécologie et l'obstétrique, les maladies des enfants, les
maladies des yeux, des oreilles et du nez, l'électricité et la radiographie
enfin un laboratoire de chimie et biologie. Toujours sous l'administration des
Sœurs Grises, le taux d’occupation des lits déborde les
capacités, même renouvelées : «Les activités de l’hôpital s’intensifient rapidement : de 232 patients hospitalisés et de 136 opérations chirurgicales pratiquées au cours de l’année terminée le 1er juillet 1923, on passe, trois ans plus tard, à 649 patients hospitalisés et à 384 opérations. On se sent déjà à l’étroit et l’on recommence à parler d’agrandissement, par une construction nouvelle cette fois, à côté du bâtiment de 1889, qui lui-même prolonge celui qui était occupé depuis 1868. […] La construction d’un nouveau bâtiment débute en 1931, legouvernement de Québec y ayant consenti une subvention de 200 000 $, une véritable manne pour les ouvriers en chômage en cette période de crise économique. Le projet est d’une ampleur telle qu’on pourra se permettre de démolir la partie occupée depuis 1868, tout en augmentant le nombre total de lits disponibles. La disparition de ce bâtiment permettra l’aménagement d’un îlot de verdure à côté de l’église. Quant à l’édifice de 1889, il sera entièrement consacré à l’hébergement des personnes âgées, offrant une capacité de 75 lits après les rénovations, alors que l’immeuble nouvellement construit à côté du précédent mettera, lui, 100 lits à la disposition des malades. Terminé en 1933, le nouvel édifice, à l’aspect monumental, va répondre aux besoins de la population pendant une quarantaine d’années, jusqu’à l’ouverture, en 1972, de l’hôpital actuel sur le boulevard du Séminaire».[39]
«En 1931, on convint de construire un hôpital moderne sur le terrain s’étendant de la rue Longueil à la rue Jacques-Cartier, d’améliorer l’hospice et de démolir la vieille maison de pierre, moyennant la contribution de $ 25 000 versée par la Fabrique.Le gouvernement provincial s’engagea à fournir $ 200 000 et le public souscrivit à $ 6 153. Avec des emprunts et d’autres contributions, on commença les travaux de construction (qui dépassèrent de beaucoup les privisions). En avril 1933, on peut recevoir les premiers malades dans la nouvelle construction…».[40]
 McGinnis. Son architecture nous donne l'aspect
des plus vieux bâtiments de Saint-Jean, avant le Grand Feu de 1876.
Construite entre 1828 et 1841, elle appartenait alors aux deux sœurs Sarah et Elisabeth McGinnis qui n’y résidèrent pas. Leurs frères,
Richard (pour le baron Grant) et William (pour le seigneur Christie) jouèrent
le rôle de chiens de garde des propriétés durant les Troubles de 37-38. Depuis,
cette maison portait le nom de Thibodeau. Des transformations majeures en 1920 ont
considérablement modifié son apparence. Cette maison a logé le Centre des
œuvres Sainte-Thérèse de 1926 à 1965 puis l'Unité sanitaire.
McGinnis. Son architecture nous donne l'aspect
des plus vieux bâtiments de Saint-Jean, avant le Grand Feu de 1876.
Construite entre 1828 et 1841, elle appartenait alors aux deux sœurs Sarah et Elisabeth McGinnis qui n’y résidèrent pas. Leurs frères,
Richard (pour le baron Grant) et William (pour le seigneur Christie) jouèrent
le rôle de chiens de garde des propriétés durant les Troubles de 37-38. Depuis,
cette maison portait le nom de Thibodeau. Des transformations majeures en 1920 ont
considérablement modifié son apparence. Cette maison a logé le Centre des
œuvres Sainte-Thérèse de 1926 à 1965 puis l'Unité sanitaire.  restée longtemps
après sa mort. Grâce au journal, de jeunes auteurs ont pu transiter du
journalisme au roman ou à la poésie. Yvonne Labelle, la future auteure de la Monographie
d’Iberville y fit ses débuts. Le jeune Arsène Bessette (1873-1921),
journaliste au Canada-Français, publia à la Compagnie de Publications
«Le Canada-Français», en 1914, son «roman de mœurs du journalisme et de
la politique dans la province de Québec», Le Débutant (1914). Cette
Compagnie de Publications avait obtenu ses lettres patentes du Gouvernement
fédéral le 29 mai 1908 suite aux démarches de Gabriel Marchand. Le 19 août suivant, elle devenait
propriétaire de l'hebdomadaire, des droits d'imprimerie, des machines à
composer, des presses et des accessoires. Louis Aldeï Gosselin et Gabriel
Marchand assument respectivement la présidence et la gérence de la Compagnie.
Le 13 décembre 1910, la Compagnie se porte acquéreur du terrain et de l'édifice
situé au numéro civique 16 rue Richelieu. Le bureau et l'imprimerie du Canada-Français
y élisent domicile en janvier 1911. C'est à cette époque que Bessette en
est rédacteur en chef.
restée longtemps
après sa mort. Grâce au journal, de jeunes auteurs ont pu transiter du
journalisme au roman ou à la poésie. Yvonne Labelle, la future auteure de la Monographie
d’Iberville y fit ses débuts. Le jeune Arsène Bessette (1873-1921),
journaliste au Canada-Français, publia à la Compagnie de Publications
«Le Canada-Français», en 1914, son «roman de mœurs du journalisme et de
la politique dans la province de Québec», Le Débutant (1914). Cette
Compagnie de Publications avait obtenu ses lettres patentes du Gouvernement
fédéral le 29 mai 1908 suite aux démarches de Gabriel Marchand. Le 19 août suivant, elle devenait
propriétaire de l'hebdomadaire, des droits d'imprimerie, des machines à
composer, des presses et des accessoires. Louis Aldeï Gosselin et Gabriel
Marchand assument respectivement la présidence et la gérence de la Compagnie.
Le 13 décembre 1910, la Compagnie se porte acquéreur du terrain et de l'édifice
situé au numéro civique 16 rue Richelieu. Le bureau et l'imprimerie du Canada-Français
y élisent domicile en janvier 1911. C'est à cette époque que Bessette en
est rédacteur en chef.«Né à Saint-Hilaire, comté de Rouville, le 20 décembre 1873, Arsène Bessette avait fréquenté le Collège Sainte-Marie-de-Monnoir. Ses études terminées il se dirigea vers le journalisme. Il fut courrieriste parlementaire à Québec, deux ans rédacteur à La Patrie et au Canada de Montréal. En 1900, il devenait rédacteur en chef du journal Le Canada-Français de Saint-Jean. Il le sera jusqu'en 1917. Arsène Bessette signait ses articles sous différents pseudonymes : Grain d'orge, Billet public, Muscadin, Causerie. Son épouse collabora également à ses écrits sous la signature de Berthe d'Iberville, Patronette, Margot, Luce.Arsène Bessette fut l'auteur d'un roman Le Débutant, imprimé en 1914 par la Compagnie de Publication Le Canada-Français à Saint-Jean. Ce roman fut subséquemment mis à l'index par le clergé à cause de ses idées avant-gardistes. Bessette y faisait "souvent allusion à la vie simple et saine dans nos campagnes; la vie dure et truquée dans le journalisme, la vie rusée et paternaliste dans la politique où l’intérêt du parti dominait tout. Il fait allusion à l'influence du clergé sur les politiciens, croyant que la vie spirituelle aurait dû occuper tout leur temps.
"Il désirait que dans nos maisons d'enseignement l'on apprit moins le latin et le grec mais plus d'anglais, de mathématiques. Il voulait voir les siens dans le génie, les affaires et l'industrie. Il a souvent servi de forts avertisments à ses compatriotes qui, à cause de leur manque de préparation et leur indifférence voient passer nos industries et notre commerce entre les mains étrangères"."Il a fait œuvre de précurseur. On dit qu’il était 50 ans avant son temps. Son avertissement et préssentiment nous en ressentons les effets aujourd’hui"."Arsène Bessette a voulu rendre service aux siens. S’il a appartenu à la loge l’Émancipation des Francs-Maçons de Montréal comme tant d’autres canadiens-français importants, c’était pour mieux nous avertir de ne pas vouloir lutter efficacement pour notre survie et jouer le rôle qui nous appartient comme premiers colonisateurs en ce pays".
Arsène Bessette mourut subitement à Montréal le 21 juin 1921 âgé de 48 ans».[41]
 Ce roman commence par un épigrame : «Ce livre n’a
pas été écrit pour les petites filles», ceci servant un peu comme servent
aujourd’hui les cartons de surveillance parentale affichés au début d’un film,
comme un clin-d’œil ironique sur ce qui y est raconté des mœurs, plutôt
douteuses, du monde politico-journalistique. Illustré de vignettes tracées par
le jeune français Théophile Busnel - le livre est dédié à sa mémoire après
qu’une maladie l’eut terrassé -, le roman se veut appartenir à l’univers
réaliste des Zola et des Mirbeau, mais sans l’aspect tragique ou trop sordide.
À la fin, le jeune héros, désabusé par ce dont il a été témoin dans les
coulisses du grand monde, s’achète un billet et part en exil aux États-Unis. Dans
le train qui l’emmène vers New York, il s’arrête à Saint-Jean :
Ce roman commence par un épigrame : «Ce livre n’a
pas été écrit pour les petites filles», ceci servant un peu comme servent
aujourd’hui les cartons de surveillance parentale affichés au début d’un film,
comme un clin-d’œil ironique sur ce qui y est raconté des mœurs, plutôt
douteuses, du monde politico-journalistique. Illustré de vignettes tracées par
le jeune français Théophile Busnel - le livre est dédié à sa mémoire après
qu’une maladie l’eut terrassé -, le roman se veut appartenir à l’univers
réaliste des Zola et des Mirbeau, mais sans l’aspect tragique ou trop sordide.
À la fin, le jeune héros, désabusé par ce dont il a été témoin dans les
coulisses du grand monde, s’achète un billet et part en exil aux États-Unis. Dans
le train qui l’emmène vers New York, il s’arrête à Saint-Jean : «Mais le train filait toujours et, après avoir passé Brosseau et Lacadie, on arriva à Saint-Jean. Un arrêt de cinq minutes. Il eut envie de descendre, mais il n’en fit rien, redoutant une défaillance de sa volonté, sous le coup d’une émotion qu’il avait peine à contenir. Devant la gare, des officiers de cavaleriemêlaient dans le soir tombant, le rouge de leurs uniformes aux robes blanches des femmes. Il y avait là toute une joyeuse jeunesse, venue à la rencontre de quelques amis, qui, tantôt, irait valser au Yacht Club dont on apercevait la façade illuminée, sur le bord de la rivière, entre les arbres du parc public, voisin de l’école militaire. Cette petite ville où il n’était jamais venu, avait l’air d’un immense bosquet mystérieux, troué seulement par des clochers d’églises et quelques cheminées d’usines, qui seuls enlevaient l’illusion que ce ne fut un véritable paradis terrestre. Le train reparti, le jeune homme ne vit plus rien».[42]
«À la fin de 1917, la situation ne sera plus tenable pour Arsène Bessette, au Canada Français et à Saint-Jean. Depuis la mort de Gabriel Marchand qui soutenait Arsène Bessette, les tirages du Canada Français avaient baissé : de 4,579 en 1900, ils étaient tombés à 4 200 en 1913, malgré l’organisation en 1901, d’un grand concours littéraire, et des offres, à plusieurs reprises, d’abonnements-prime qui rapportaient à ceux qui les souscrivaient des reproductions d’œuvres d’art (peintures, sculptures). Les idées et la personnalité du rédacteur en chef sont de plus en plus contestées; Le Débutant a marqué d’infamie son auteur. Arsène Bessette quitte Saint-Jean définitivement. À Montréal, il se trouve un petit emploi de journaliste à La Presse où il ne signera pas - comme c’était la règle dans ce journal - les échos qu’il y rapportera. En 1920, pour améliorer ses revenus, il accepte une place d’inspecteur à la Compagnie des Tramways de Montréal». [44]
 ses écrits et qui le rattachent à un
libéralisme authentique et sain qui se retourne même contre ses amis du Parti
Libéral, d’où ces descriptions de la corruption journalistique par la
politique, la vie dégentée parmi les artistes et les prostituées d’une
petite-bourgeoisie de professionnels peu scrupuleuse. Tous ces sujets tabous
font frissonner d’horreur les esprits bien-pensants. Le Clergé le premier en
interdit la lecture à ses ouailles. Bessette, dont le nom figurait déjà sur une
liste des membres de la loge maçonnique L’Émancipation, volée et publiée
dans Le Devoir en 1910, est mis au ban de l’Église. Sans doute pour
cette raison, l’ostracisme frappe l'auteur dont Roger Le Moine dit que le roman
est la «seule œuvre romanesque d’inspiration maçonnique de la littérature
québécoise», ce qui est plutôt insignifiant. Bessette, qui vit en plus une
relation amoureuse hors mariage, n’a donc rien pour s’attirer des sympathies.
Une véritable «conspiration du silence» enveloppe le roman qui sera pilonné
avant d’être réédité soixante ans plus tard. Après Marie Calumet de
Rodolphe Girard (1904) et Les Foins d’Albert Laberge (1909), Le
Débutant d’Arsène Bessette subit à son tour les foudres de la censure.[45]
ses écrits et qui le rattachent à un
libéralisme authentique et sain qui se retourne même contre ses amis du Parti
Libéral, d’où ces descriptions de la corruption journalistique par la
politique, la vie dégentée parmi les artistes et les prostituées d’une
petite-bourgeoisie de professionnels peu scrupuleuse. Tous ces sujets tabous
font frissonner d’horreur les esprits bien-pensants. Le Clergé le premier en
interdit la lecture à ses ouailles. Bessette, dont le nom figurait déjà sur une
liste des membres de la loge maçonnique L’Émancipation, volée et publiée
dans Le Devoir en 1910, est mis au ban de l’Église. Sans doute pour
cette raison, l’ostracisme frappe l'auteur dont Roger Le Moine dit que le roman
est la «seule œuvre romanesque d’inspiration maçonnique de la littérature
québécoise», ce qui est plutôt insignifiant. Bessette, qui vit en plus une
relation amoureuse hors mariage, n’a donc rien pour s’attirer des sympathies.
Une véritable «conspiration du silence» enveloppe le roman qui sera pilonné
avant d’être réédité soixante ans plus tard. Après Marie Calumet de
Rodolphe Girard (1904) et Les Foins d’Albert Laberge (1909), Le
Débutant d’Arsène Bessette subit à son tour les foudres de la censure.[45]«Le 21 juin 1921, s’étant rendu rue Clark, chez Monsieur Fournier (que l’on a dit tantôtnotaire, tantôt manufacturier de matelots), Arsène Bessette meurt subitement, dans sa quarante-huitième année, n’ayant pas accompli l’œuvre littéraire qu’il aurait dû écrire. Mais il en avait eu la prémonition. Lui, qui aimait si peu à parler de sa vie privée, avait répondu en 1902 à un ami qui lui disait "Il faut que vous soyez célèbre un jour, il faut que vous accomplissiez des œuvres immortelles" : "Je me sens trop petit pour exécuter ce commandement, je sens que l’hiver de ma vie viendra trop tôt pour me permettre de réaliser l’espérance qu’on a mise en moi". Il est parti - sans plainte et sans murmure - comme il le désirait mais injustement méconnu. Le Canada Français se contenta de signaler son décès dans un bref entrefilet en page 5».[46]
«Monsieur Arsène Bessette, ancien journaliste, domicilié au n° 80, rue Clark, Montréal, est mort subitement à 10 h.30, mardi matin, chez Monsieur Édouard Fournier, manufacturier de matelots à Montréal. Il était allé régler certaines affaires quand tout à coup il s’affaissa. On manda immédiatement l’ambulance, mais on constata sa mort. Il était âgé de quarante-huit ans. Il fut pendant dix-sept ans rédacteur au Canada français. - Et l’article ajoutait que l’enquête ouverte au sujet de ce décès subit avait conclu à une mort naturelle. (Cet article nécrologique, inspiré de très près de celui paru dans La Patrie, quarante-huit heures plus tôt, contient une erreur : Arsène Bessette n’habitait pas rue Clark, mais s’était rendu chez Monsieur Fournier, qui habitait au 80 de cette rue)»[47]
 Bessette suit son personnage de journaliste de ses débuts marqués par l’innocence et la sincérité d’un Tintin jusqu’à ce que la réalité se révèle à lui et brise, l’une après l’autre, ses illusions : le journalisme, la politique, les femmes, tout le mène à une déconvenue blasée, Paul Mirot,
n'exprimait que la pensée profonde de l’auteur que l’expérience du journalisme lui avait
apportée, et il avait bien raison : Saint-Jean n’était pas ce paradis qu’elle
semblait être à première vue.
Bessette suit son personnage de journaliste de ses débuts marqués par l’innocence et la sincérité d’un Tintin jusqu’à ce que la réalité se révèle à lui et brise, l’une après l’autre, ses illusions : le journalisme, la politique, les femmes, tout le mène à une déconvenue blasée, Paul Mirot,
n'exprimait que la pensée profonde de l’auteur que l’expérience du journalisme lui avait
apportée, et il avait bien raison : Saint-Jean n’était pas ce paradis qu’elle
semblait être à première vue.«Au moment où il devint propriétaire, le journal comptait 8 pages et il en coûtait $ 1.50 par année pour s’y abonner. Quant au contenu, il avait très peu évolué. Trois pages étaient consacrées aux nouvelles nationales et internationales, une autre traitait de problèmes tels que l’agriculture ou le commerce, tandis que seulement 2 pages étaient consacrées aux nouvelles locales. Notons cependant que l’on réservait 2 pages entières aux annonces».[48]
 traverser la Grande Dépression. Dès le début de son
administration, Le Canada Français commence à paraître le jeudi au lieu
de vendredi. Il sera publié cette journée de la semaine jusqu’en 1968. Son coût
: 5 cents la copie. Maï Robert, qui le distribue dans les rues de la ville,
attelle son chien berger allemand qui s'annonce au son d'une grosse cloche. En
1935, le nombre de pages a doublé, passant de huit à seize. Au décès de
Perrier, en 1958, le volume du journal atteindra 48 pages. Le journal change
peu d’apparence durant l’administration de Perrier. Le 25 novembre 1937, un
nouveau bandeau de page frontispice fait son apparition, remplaçant le bandeau
de 1895. Ce nouveau bandeau restera inchangé jusqu’en 1964. Changement à
caractère plus fondamental en cette année 1937, le journal s’affranchit de son
allégeance libérale. Désormais, affirme Perrier, Le Canada-Français est «un
hebdomadaire dévoué aux intérêts de toute la région». Mais il ne faut pas
prendre tout cela à la lettre. Perrier sera l’adversaire de Paul Beaulieu aux
élections contestées de 1941 (Élu député provincial, le soir du 6 octobre 1941,
à la faveur d’une élection partielle à la mort du Dr Bouthillier, il doit céder
sa place à Paul Beaulieu après un recomptage judiciaire), il siègera au Conseil
municipal de la ville et restera organisateur libéral. Ce que cela signifiait?
Que Le Canada-Français ne serait plus tant un journal d’opinions mais un
journal d’informations locales.
traverser la Grande Dépression. Dès le début de son
administration, Le Canada Français commence à paraître le jeudi au lieu
de vendredi. Il sera publié cette journée de la semaine jusqu’en 1968. Son coût
: 5 cents la copie. Maï Robert, qui le distribue dans les rues de la ville,
attelle son chien berger allemand qui s'annonce au son d'une grosse cloche. En
1935, le nombre de pages a doublé, passant de huit à seize. Au décès de
Perrier, en 1958, le volume du journal atteindra 48 pages. Le journal change
peu d’apparence durant l’administration de Perrier. Le 25 novembre 1937, un
nouveau bandeau de page frontispice fait son apparition, remplaçant le bandeau
de 1895. Ce nouveau bandeau restera inchangé jusqu’en 1964. Changement à
caractère plus fondamental en cette année 1937, le journal s’affranchit de son
allégeance libérale. Désormais, affirme Perrier, Le Canada-Français est «un
hebdomadaire dévoué aux intérêts de toute la région». Mais il ne faut pas
prendre tout cela à la lettre. Perrier sera l’adversaire de Paul Beaulieu aux
élections contestées de 1941 (Élu député provincial, le soir du 6 octobre 1941,
à la faveur d’une élection partielle à la mort du Dr Bouthillier, il doit céder
sa place à Paul Beaulieu après un recomptage judiciaire), il siègera au Conseil
municipal de la ville et restera organisateur libéral. Ce que cela signifiait?
Que Le Canada-Français ne serait plus tant un journal d’opinions mais un
journal d’informations locales.«Contrairement à la croyance populaire, le soutien financier du journal n’était pas automatiquement et encore moins "grassement" assuré par le diocèse. Malgré la grande confusion qui règne autour de cette question, il semble que l’apport de plusieurs citoyens de la ville ait été prépondérant. Signalons notamment la contribution de l’imprimeur Georges Payette. En effet, celui-ci aurait largement contribué à la survie du journal par le biais de son entreprise (au début à tout le moins)».[50]
«Elle songe à étudier la médecine, mais une assez longue maladie modifie ses projets : elle suit des cours de littérature française à la faculté des Lettres de l’Université de Montréal.
Après avoir fait un peu de journalisme au Canada-Français et au Richelieu, elle s’inscrit aux cours de bibliothéconomie; elle rédige une thèse bio-bibliographique sur M. Victor Barbeau. Ce dernier jouera ensuite auprès de Rina Lasnier le rôle d’un clairvoyant Mécène; sur ses instances, elle refusera un poste important dans le fonctionnarisme pour se lancer dans la carrière des Lettres…Rina Lasnier est membre fondateur de l’Académie canadienne-française. Elle a reçu plusieurs prix littéraires : le prix David, en 1943; le prix Duvernay, en 1957».[51]
«Les débuts de Rina Lasnier sont didactiques, voués aux vierges indiennes, aux voyagères et autres madones. L’inspiration biblique du Chant de la montée (1947), la nostalgie d’Escales sont déjà mieux incarnées. Avec Présence de l’absence (1956) et Mémoires sans jours, titres-duels, le poète arrive à l’essentiel. Un obscurcissement se manifeste, mais aussi une exigence, une passion, comme dans cette grande ode qui est moins un cnatique qu’un art poétique : La Malemer. Poésie marine, a-t-on dit de ces vastes courbes, de ce mouvement maîtrisé et soumis. Mais la mer est souvent tempête, paroxysme; la paix est armée. Poésie lapidaire et savante dans Les Gisants (1963), où la mort est comme saisie au piège des mots. Poésie arborescente et neigeuse dans L’arbre blanc, où "la parole, friable comme la mort, se désagrège et retombe tandis que l’élément spirituel poursuit son sascension" (N. Audet). Partout, et récemment dans La Salle des rêves, Rina Lasnier cherche à composer le nocturne et le diurne, la hauteur et la profondeur, dans une sorte de "combustion poreuse", d’ouverture du temps».[52]
 service de
voirie n’est pas encore organisé devient un casse-tête supplémentaire pour les
conseillers municipaux. En 1925, la compagnie funéraire Langlois conduit encore
les dépouilles dans un corbillard monté sur des traineaux tirés par 2 chevaux.
Tous ne se modernisent donc pas au même rythme. D’autres appareils motorisés -
dont les fameux ski-doo de Bombardier -, ne tardent pas à se moquer de
l’hiver. Ainsi, durant les hivers de 1930, Léopold Ménard peut effectuer ses
livraisons de liqueurs douces Coca Cola à travers toute la région, monté
dans une auto-chenille!
service de
voirie n’est pas encore organisé devient un casse-tête supplémentaire pour les
conseillers municipaux. En 1925, la compagnie funéraire Langlois conduit encore
les dépouilles dans un corbillard monté sur des traineaux tirés par 2 chevaux.
Tous ne se modernisent donc pas au même rythme. D’autres appareils motorisés -
dont les fameux ski-doo de Bombardier -, ne tardent pas à se moquer de
l’hiver. Ainsi, durant les hivers de 1930, Léopold Ménard peut effectuer ses
livraisons de liqueurs douces Coca Cola à travers toute la région, monté
dans une auto-chenille! courants : «On n’y mettait pas un gros volume de cargaison, mais les
chauffeurs, toujours coiffés de la casquette, en étaient très fiers. C’était
l’époque où les roues doubles à l’arrière faisaient leurs premières apparitions.
À remarquer que le chauffeur portait des guêtres de cuir pour éviter de
s’accrocher dans les pédales».[54]
Une photographie d’époque nous montre le camion de la Cables, Conduits and
Fittings Limited qui fait la navette entre Montréal et Saint-Jean. Ce camion
fait partie de l’écurie de la Compagnie C. Lemaire Express, toujours en service
à la fin du siècle. Le numéro de téléphone du temps est le 867 et la compagnie
à pignon rue Saint-Jacques.
courants : «On n’y mettait pas un gros volume de cargaison, mais les
chauffeurs, toujours coiffés de la casquette, en étaient très fiers. C’était
l’époque où les roues doubles à l’arrière faisaient leurs premières apparitions.
À remarquer que le chauffeur portait des guêtres de cuir pour éviter de
s’accrocher dans les pédales».[54]
Une photographie d’époque nous montre le camion de la Cables, Conduits and
Fittings Limited qui fait la navette entre Montréal et Saint-Jean. Ce camion
fait partie de l’écurie de la Compagnie C. Lemaire Express, toujours en service
à la fin du siècle. Le numéro de téléphone du temps est le 867 et la compagnie
à pignon rue Saint-Jacques.«Mais l’emplacement le plus utilisé se situait aux abords du pont ferroviaire du Vermont Central, juste au nord de l’actuelle marina, pont qui enjamba la rivière de 1859 jusqu’à sa démolition en 1967 : "[…] tout le long du rivage sur une distance d’environ 600 pieds en haut du pont du chemin de fer et sur une distance de près de 400 pieds en bas de ce pont, on a fait un dépotoir de vidanges de toutes espèces". Située à quelques centaines de pieds seulement des maisons de l’extrémité sud de la rue Richelieu, cette accumulation de déchets se trouve également près de la prise d’eau de l’aqueduc, et en bordure d’un espace vert censément plaisant et sain, le parc Richelieu (Laurier); "On y voit un amoncellement de déchets de toutes sortes d’où se dégagent, sous les rayons du soleil, des émanations qui ne sentent pas la rose […]. Lors de la débâcle de la semaine dernière, quantité de déchets de même espèce apparaissaient sur les "bordages" pour disparaître peu à peu à mesure que la glace se brisait". En avril 1907, les "autorités sanitaires" de la Ville donnent avis "qu’elles poursuivront quiconque ira déverser des vidanges en haut du pont du Central Vermont. La Corporation a un terrain spécial pour recevoir les vidanges et le public est requis de n’en charroyer qu’à cet endroit". Ces menaces ne feront pas disparaître l’habitude bien ancrée du déversement d’ordures en ce lieu. En mai 1910, des rôdeurs mettent le feu dans ce dépotoir illégal, que les employés de l’aqueduc, situé tout près, parviennent heureusement à éteindre. Ce problème fut enfin réglé en 1911, quand la Ville fit dresser une clôture de "broche" pour empêcher physiquement l’accès au terrain, et l’on menaça d’amende et même de prison les malfaiteurs tenaces qui s’aviseraient d’y percer une brèche».[56]
 défendu de le faire sur le pont Blanc. Ceux qui ne respectent pas cet avis
l’apprennent à leurs dépens et plusieurs personnes sont arrêtées pour avoir
trotté sur le pont Gouin! La ville de Saint-Jean paye la somme de $ 16
666.67 - Iberville ne paie qu’un tiers, $ 8 333.33 -, alors que les coûts ne
doivent pas excéder $ 125 000. La valeur des ouvrages exécutés jusqu’au 8 mai
1915 s’élevait à la somme de $ 65 220, le 5 août 1915 à $ 54 920, et en
septembre à $ 26 768… Le total aboutira à $ 146 908 : $ 20 000 de plus que le
montant prévu initialement. Tout au long des prochaines années, il faudra sans
cesse ajouter de l’argent pour les modifications nécessaires à adapter la
structure métallique à la circulation automobile. En 1917-1918, on procéde à la
démolition du pont Jones.
défendu de le faire sur le pont Blanc. Ceux qui ne respectent pas cet avis
l’apprennent à leurs dépens et plusieurs personnes sont arrêtées pour avoir
trotté sur le pont Gouin! La ville de Saint-Jean paye la somme de $ 16
666.67 - Iberville ne paie qu’un tiers, $ 8 333.33 -, alors que les coûts ne
doivent pas excéder $ 125 000. La valeur des ouvrages exécutés jusqu’au 8 mai
1915 s’élevait à la somme de $ 65 220, le 5 août 1915 à $ 54 920, et en
septembre à $ 26 768… Le total aboutira à $ 146 908 : $ 20 000 de plus que le
montant prévu initialement. Tout au long des prochaines années, il faudra sans
cesse ajouter de l’argent pour les modifications nécessaires à adapter la
structure métallique à la circulation automobile. En 1917-1918, on procéde à la
démolition du pont Jones. étroit pour la circulation automobile
à 2 travées. Car chevaux et automobiles doivent se partager la voie, ce qui
crée souvent des embouteillages quand les chevaux se mettent à paniquer devant
l'automobile. Un massif bloc de ciment sert de contre-poids permettant à une
partie du tablier de lever afin de laisser passer les bateaux sur le canal de
Chambly. C'est un fait avéré que les ingénieurs du pont Gouin l'avaient
construit en fonction de la circulation chevalière propre au transport des
produits agricoles. Il perfectionnait le pont Jones jusqu’à oublier d’innover
vers le futur.
étroit pour la circulation automobile
à 2 travées. Car chevaux et automobiles doivent se partager la voie, ce qui
crée souvent des embouteillages quand les chevaux se mettent à paniquer devant
l'automobile. Un massif bloc de ciment sert de contre-poids permettant à une
partie du tablier de lever afin de laisser passer les bateaux sur le canal de
Chambly. C'est un fait avéré que les ingénieurs du pont Gouin l'avaient
construit en fonction de la circulation chevalière propre au transport des
produits agricoles. Il perfectionnait le pont Jones jusqu’à oublier d’innover
vers le futur. chargées
de charbon. Leur aspect est celui des drakkars vikings. C’est en 1908 qu’on
dresse la bande du canal, parallèle à la rive gauche du Richelieu.
Celle-ci n’a pas du tout l’aspect du parc de villégiature qu’on lui connaît.
Laissée en friches, des cabanes de bois construites sur l’eau de la rivière
jalonnent la bande, de vieux poteaux portant l’éclairage, la nuit jettent un
aspect lugubre. Ces cabanes sont construites sur pilotis pour la plupart bien
que quelques-unes soient plus solidement implantées en terres. Officiellement,
elles servent de remises à bateaux et s’échelonnent entre les 2 ponts, celui du
chemin de fer Canadien Pacifique et le nouveau pont Gouin. Là s’y implantent
également des barbottes (des parties de cartes avec paris illégaux) et
de la contre-bande (surtout lors de la prohibition américaine). Ces hangars de
bois disparaîtront à la fin des années 1960.
chargées
de charbon. Leur aspect est celui des drakkars vikings. C’est en 1908 qu’on
dresse la bande du canal, parallèle à la rive gauche du Richelieu.
Celle-ci n’a pas du tout l’aspect du parc de villégiature qu’on lui connaît.
Laissée en friches, des cabanes de bois construites sur l’eau de la rivière
jalonnent la bande, de vieux poteaux portant l’éclairage, la nuit jettent un
aspect lugubre. Ces cabanes sont construites sur pilotis pour la plupart bien
que quelques-unes soient plus solidement implantées en terres. Officiellement,
elles servent de remises à bateaux et s’échelonnent entre les 2 ponts, celui du
chemin de fer Canadien Pacifique et le nouveau pont Gouin. Là s’y implantent
également des barbottes (des parties de cartes avec paris illégaux) et
de la contre-bande (surtout lors de la prohibition américaine). Ces hangars de
bois disparaîtront à la fin des années 1960. Le 14 mai 1917, en pleine Grande Guerre, le Maréchal Joffre, vainqueur
de la bataille de La Marne, passe par notre ville. Se rendant à New York au
moment où les Américains s’apprêtent à s’engager aux côtés des Alliés, Joffre
s’arrête à la gare du Canadien Pacifique et, devant les soldats fusils à
l’épaule, le Maréchal est chaudement acclamé par les notables de la ville. Une
volée de chapeaux le salut, et le maréchal rembarque dans son wagon qui le
conduira jusqu’à la prochaine station. Le Maréchal Foch vient également
s’arrêter à la gare du Canadien Pacifique en 1918. À l’occasion, la rue
Saint-Thomas sera rebaptisée en son honneur.
Le 14 mai 1917, en pleine Grande Guerre, le Maréchal Joffre, vainqueur
de la bataille de La Marne, passe par notre ville. Se rendant à New York au
moment où les Américains s’apprêtent à s’engager aux côtés des Alliés, Joffre
s’arrête à la gare du Canadien Pacifique et, devant les soldats fusils à
l’épaule, le Maréchal est chaudement acclamé par les notables de la ville. Une
volée de chapeaux le salut, et le maréchal rembarque dans son wagon qui le
conduira jusqu’à la prochaine station. Le Maréchal Foch vient également
s’arrêter à la gare du Canadien Pacifique en 1918. À l’occasion, la rue
Saint-Thomas sera rebaptisée en son honneur. Quelques jours plus tôt, Le Canada Français, en première page,
invitait la population de toute la région à venir accueillir le roi et la reine
avec enthousiasme. Les employeurs avaient été priés de permettre à leurs
salariés de se rendre sur les lieux de l'événement. Les commissions scolaires
étaient appelées à mobiliser 3 000 élèves : «…il convient que la
manifestation avec laquelle nous recevrons nos souverains en terre canadienne
soit la plus chaleureuse qui soit. C'est par la densité de la foule, la vigueur
de son enthousiasme qu'il nous sera donné de témoigner concrètement de notre
loyalisme», écrivait le journal libéral. Ce même journal célèbre le
patriotisme des Johannais :
Quelques jours plus tôt, Le Canada Français, en première page,
invitait la population de toute la région à venir accueillir le roi et la reine
avec enthousiasme. Les employeurs avaient été priés de permettre à leurs
salariés de se rendre sur les lieux de l'événement. Les commissions scolaires
étaient appelées à mobiliser 3 000 élèves : «…il convient que la
manifestation avec laquelle nous recevrons nos souverains en terre canadienne
soit la plus chaleureuse qui soit. C'est par la densité de la foule, la vigueur
de son enthousiasme qu'il nous sera donné de témoigner concrètement de notre
loyalisme», écrivait le journal libéral. Ce même journal célèbre le
patriotisme des Johannais : «"Contenue de chaque côté des voies par un cordon de militaires des casernes et par une filée de scouts et de guides […], la foule présentait un coup d'œil vraiment typique. Cette double haie humaine égayée par les toilettes féminines et nettement délimitée par les lignes kaki des militaires s'animait des milliers de petits drapeaux qui claquaient au vent; tandis qu'au centre, la fanfare de la ville et celle du Collège, quelques hauts officiers en tenue de gala et le corps échevinal (sic) en jaquette et haut-de-forme, donnaient la note décorative". Le couple royal est reçu par tout le gratin de la ville : le maire, Georges Fortin; l'évêque, Mgr Forget; le vicaire général Mgr J.-F. Coursol et les députés locaux, le docteur Alexis Bouthiller (M.P.P.) et Martial Rhéaume (M.P.) et même le Premier ministre du Canada, Mackenzie King. Le couple royal apparaît sur le quai, reçoivent une gerbe de fleurs apportée par une enfant. Le roi sert la main des vétérans de 14-18 qui constituent une garde d'honneur. La reine sourit et salut de la main les milliers d'hôtes enthousiastes. Des enfants entonnent, en français, le "Dieu protège le roi" et le "Ô Canada". Dix-sept minutes après leur arrivée, les souverains saluent une dernière fois et retournent dans leur train bleu royal. Trois mois plus tard, le Canada suivait l'Angleterre dans sa déclaration de guerre au Troisième Reich».[58]
«D'une distance de 12 milles le départ s'était effectué de l'hôtel Saint-Paul pour se terminer à l'hôtel Poutré à Saint-Jean. Maurice Lupien l'avait emporté en 30 minutes 33 secondes, suivi de près par Guillaume Bernard en 30 minutes et 36 secondes. M. Bernard, un sympathique Breton décédé depuis quelques années, a exploité un commerce de bicycles sur la rue Saint-Charles.
De 1935 à 1938, les deux frères Poutré ont organisé 3 autres courses, dont deux de 25 milles. La première entre Saint-Jean, Chambly et Richelieu avec retour à Saint-Jean, et une autre entre Saint-Jean, Napierville, Saint-Valentin et Saint-Paul, l'arrivée se faisant toujours à Saint-Jean».[59]
 populaire, Yvon Robert, mais
la ville a également ses bons lutteurs : Willie Thériault, également excellent
plongeur et nageur, se pratiquant au Yacht Club, et Arthur Jauniaux. Durant
l'été 1930, 4 équipes de jeunes athlètes de Saint-Jean participent à un field
day sur la piste du terrain d'Exposition de Saint-Jean : les soldats des
casernes de Saint-Jean, l'équipe de Pat Nicholson, le Salon Littéraire et
Sportif de Saint-Jean et la Salle de quilles et billards Sam Langlois. C'est
dire toute l'étendue et la diversité des sports pratiqués à Saint-Jean durant
cette époque.
populaire, Yvon Robert, mais
la ville a également ses bons lutteurs : Willie Thériault, également excellent
plongeur et nageur, se pratiquant au Yacht Club, et Arthur Jauniaux. Durant
l'été 1930, 4 équipes de jeunes athlètes de Saint-Jean participent à un field
day sur la piste du terrain d'Exposition de Saint-Jean : les soldats des
casernes de Saint-Jean, l'équipe de Pat Nicholson, le Salon Littéraire et
Sportif de Saint-Jean et la Salle de quilles et billards Sam Langlois. C'est
dire toute l'étendue et la diversité des sports pratiqués à Saint-Jean durant
cette époque. commercial dit des Gaietées Françaises, appartenant à un français,
Édouard Wagnart, pouvait les recevoir en prestation. L'actuelle salle du cinéma
Capitol offrait sa scène aux troupes de comédiens et de bel canto, aux
pièces de théâtre et comédies musicales, opéras et opérettes, présentées au
public de Saint-Jean. Cette salle prend la relève du Saint-John's Opera
House appelé parfois Black's Opera House, parce que propriété de
John Black, et où on y présentait des vaudevilles et du burlesque. À la mort
de John Black, l'opéra ferme ses portes pour les ouvrir en tant que salle de
cinéma liée à la chaîne des Ouimetoscopes, salle qui défiait les suspicions du
clergé. Ce transfert de vocation d’une même salle montrait combien les classes
sociales se succédaient dans la hiérarchie. L’opéra allait aux bourgeois
prospères de Saint-Jean, contemporains de Félix-Gabriel Marchand et de Louis
Molleur; mais la poussée du prolétariat ouvrier, avec les nouvelles
mégamanufactures, accroissaît la ville d’une nouvelle quantité et d’une
nouvelle qualité d’individus. Pour ceux-ci, les divertissements qu’offrait le
cinéma convenaient mieux que les grands arias.
commercial dit des Gaietées Françaises, appartenant à un français,
Édouard Wagnart, pouvait les recevoir en prestation. L'actuelle salle du cinéma
Capitol offrait sa scène aux troupes de comédiens et de bel canto, aux
pièces de théâtre et comédies musicales, opéras et opérettes, présentées au
public de Saint-Jean. Cette salle prend la relève du Saint-John's Opera
House appelé parfois Black's Opera House, parce que propriété de
John Black, et où on y présentait des vaudevilles et du burlesque. À la mort
de John Black, l'opéra ferme ses portes pour les ouvrir en tant que salle de
cinéma liée à la chaîne des Ouimetoscopes, salle qui défiait les suspicions du
clergé. Ce transfert de vocation d’une même salle montrait combien les classes
sociales se succédaient dans la hiérarchie. L’opéra allait aux bourgeois
prospères de Saint-Jean, contemporains de Félix-Gabriel Marchand et de Louis
Molleur; mais la poussée du prolétariat ouvrier, avec les nouvelles
mégamanufactures, accroissaît la ville d’une nouvelle quantité et d’une
nouvelle qualité d’individus. Pour ceux-ci, les divertissements qu’offrait le
cinéma convenaient mieux que les grands arias. dans une concurrence et une rivalité sauvage qui les opposent mutuellement. Dès
lors, un essaim de truands - grands et petits - bourdonne le long des routes
qui mènent à la frontière américaine par le lac Champlain en vue d’échanger,
pour une bonne somme, le nectar défendu qui se rendra dans les Speekeasy
de New York et de Boston. L’un d’entre eux, Conrad Labelle, s’est fait une
renommée tapageuse comme bootlegger local. Sans doute petit truand qui
aime se faire voir, il se vante d’avoir rencontré le Président Harding et Al
Capone, avec lequel il aurait conclu une affaire de routine profitable surtout…
pour Labelle. D’autres, par contre, se souviennent de lui sous un jour moins
flatteur. Sa sœur, Yvonne, historienne, en a tracé la biographie dont le récit
est loin d’atteindre la qualité de sa Monographie d’Iberville.
dans une concurrence et une rivalité sauvage qui les opposent mutuellement. Dès
lors, un essaim de truands - grands et petits - bourdonne le long des routes
qui mènent à la frontière américaine par le lac Champlain en vue d’échanger,
pour une bonne somme, le nectar défendu qui se rendra dans les Speekeasy
de New York et de Boston. L’un d’entre eux, Conrad Labelle, s’est fait une
renommée tapageuse comme bootlegger local. Sans doute petit truand qui
aime se faire voir, il se vante d’avoir rencontré le Président Harding et Al
Capone, avec lequel il aurait conclu une affaire de routine profitable surtout…
pour Labelle. D’autres, par contre, se souviennent de lui sous un jour moins
flatteur. Sa sœur, Yvonne, historienne, en a tracé la biographie dont le récit
est loin d’atteindre la qualité de sa Monographie d’Iberville.«Pendant que le glas funèbre sonnera à l’église paroissiale de Saint-Jean, le cortège sortira de la prison, dans l’ordre suivant : en tête le shérif en son uniforme officiel; puis le geôlier de la prison; le major Séguin de la prison de Bordeaux, deux gardes et ensuite le condamné, accompagné de l’aumônier récitant des prières. Un détachement des Dragons Royaux montera la garde autour de la prison.L’exécuteur Ellis est arrivé hier, et procédera en présence de 6 jurés assermentés. Après la pendaison, le médecin de la prison, et quelques confrères constateront la mort. Alors le shérif hissera le drapeau noir à mi-mat sur la prison. Ce lugubre cérémonial terminé, le corps du condamné sera enterré dans le cimetière de Saint-Jean, grâce aux soins pieux du curé C.-A. Lamarche, l’aviseur spirituel et le consolateur de Frazer depuis sa condamnation».[60]
«Établissons d'abord quelques faits. À Saint-Jean, le 31 décembre 1925, une dénommée Gratia Marcil, âgée de 36 ans, mourait presque subitement, mais dans d'atroces souffrances, alors qu'elle était aux prépartifs de la fête du jour de l'An. Ses funérailles eurent lieu le 4 janvier suivant en l'église Saint-Jean-l'Évangéliste. Outre son époux, Charles Desranleau, contremaître à l'emploi de la Ville, elle laissait, "pour pleurer sa perte", trois filles et un fils. Dans le Canada Français du 14 janvier 1926, Charles Desranleau et Alexis Marcil (père de la défunte) font paraître un message dans lequel ils "remercient sincèrement toutes les personnes qui […] ont donné des marques de sympathie dans la cruelle épreuve qu’ils ont subie par la perte de Mme Charles Desranleau". Le 11 février suivant, le même journal publia une copie de la lettre que Desranleau a fait parvenir à la compagnie d’assurance Great West pour la remercier de la promptitude avec laquelle elle lui a versé une indemnité de 5 000 $, conformément au contrat d’assurance qu’il détenait sur la vie de son "épouse regrettée". Dans les lignes qui suivent, nous pourrons constater toute l’hypocrisie, dans le contexte de cette affaire, d’expressions telles que "épouse regrettée", "cruelle épreuve" et "pleurer sa perte".Un an plus tard, en mars 1927, deux charrettes se rendent à une sablonnière située au pied du mont Johnson (Saint-Grégoire) pour aller prendre un chargement de sable. En creusant, ils heurtent de leurs pioches deux "poches à patates", qu’ils dégagent complètement. En les ouvrant, ils découvrent avec horreur, dans l’une, deux jambes humaines, et, dans l’autre, le corps et la tête d’une femme, le tout dans un état de décomposition avancée.L’autopsie révèle que cette femme est morte de causes naturelles. Elle était âgée d’environ 45 ans, portait les cheveux longs, avait une dent en or et avait eu plusieurs enfants. Après sa mort elle avait été embaumée et revêtue d’une robe mortuaire comme en vendent les entreprises de pompes funèbres. De sorte qu’elle avait dû être exposée en chapelle ardente, puis enlevée de son cercueil, avant ou après l’enterrement (ou le dépôt dans un charnier). On ne voyait aucun motif de vol plausible. Le corps n’avait pas été pris par des étudiants en médecine, car il n’avait pas été disséqué. La présence de la dent en or attestait qu’il ne s’agissait pas d’un vol dans un but de lucre. Était-ce un cas de nécrophilie?Le chef de la Police provinciale demanda aux gardiens de cimetière et aux curés de la province de communiquer avec lui s’ils avaient constaté la disparition du cadavre d’une femme correspondant à la description donnée.Une analyse plus poussée des viscères, effectuée par des médecins légistes du laboratoire médico-légal de la province, démontra que la défunte n’était pas décédée de mort naturelle, mais empoisonnée, après avoir absorbé une quantité de strychnine assez puissante pour tuer quatre personnes. En envisageant diverses explications, on en vint à émettre l’hypothèse que ce corps pourrait être celui de Gratia Marcil; quelques vérifications simples suffirent à la confirmer. D’abord le dentiste Wilfrid Monet attesta que la dentition du cadavre correspondait exactement à la fiche dentaire de son ex-cliente Gratia Marcil. Ensuite la belle-sœur de cette dernière reconnut la robe mortuaire, dont le cadavre était vêtu, pour l’avoir elle-même confectionnée. Test final, on fit creuser la tombe de Gratia Marcil au cimetière : le cercueil était vide… L’enquête montra aussi que, la veille du décès de sa femme, Desranleau avait signé un contrat d’assurance de 5 000 $ sur la vie de celle-ci.
L’histoire est donc la suivante. Charles Desranleau voulait éliminer sa femme pour deux raisons, toucher l’indemnité de 5 000 $ d’assurance-vie, puis épouser sa maîtresse. Il empoisonna donc sa femme à la strychnine. On crut à une mort naturelle et, après les funérailles, on enterra la dépouille. Mais Desranleau craignait que les autorités policières et judiciaires n’aient des doutes sur la cause de la mort de son épouse et n’ordonnent l’exhumation et une autopsie. Il décida donc de faire disparaître le corps. Par un soir de janvier 1926, il se rendit au cimetière, en compagnie d’un ouvrier municipal travaillant sous ses ordres, Amédée Charest, pour excaver la tombe et retirer le corps du cercueil. Ils comblèrent ensuite soigneusement la fosse et la recouvrirent de neige, puis ils trasnportèrent le corps en automobile jusqu’à la sablonnière de Saint-Grégoire, où, après l’avoir sectionné, ils enfouirent dans le sable les deux sacs qui en contenaient les parties. Comme nous l’avons vu, Desranleau empoche l’indemnité d’assurance peu après le décès de sa femme, puis après environ un an de veuvage, soit le 11 janvier 1927, il épouse une nommée Yvonne Girard en l’église Saint-Jacques de Montréal.Le 21 mai 1927, à la suite de l’audition des témoins, le jury de six personnes dans l’enquête du coroner Chevalier tient Charles Desranleau criminellement responsable de la mort de sa femme. On n’a pas le temps de l’appréhender pour le traduire en cour criminelle, car peu après on trouve son cadavre flottant sur les eaux du canal de Chambly : il s’était suicidé par noyade».[61]
 Missisquoi ou
au Mont Saint-Grégoire. La Fête du travail, fête chômée, est l'occasion de
parades à l'exemple de la Saint-Jean-Baptiste. Chaque année, à cette occasion,
il est possible de voir défiler, rue Saint-jacques, de magnifiques chars
allégoriques de l'entrepreneur Pierre Trahan obtenir les prix de
distinction. Avec la crise, il est possible de voir également le clergé et le
Diocèse mettre tout en œuvre pour mettre ouvriers,
cultivateurs et étudiants sous la coupe des organisations catholiques.
L’économie coopérative prospère en temps de crise. En 1934, une seule caisse pospulaire existe à Saint-Jean. Mgr Forget entend cultiver l’esprit coopératif
:
Missisquoi ou
au Mont Saint-Grégoire. La Fête du travail, fête chômée, est l'occasion de
parades à l'exemple de la Saint-Jean-Baptiste. Chaque année, à cette occasion,
il est possible de voir défiler, rue Saint-jacques, de magnifiques chars
allégoriques de l'entrepreneur Pierre Trahan obtenir les prix de
distinction. Avec la crise, il est possible de voir également le clergé et le
Diocèse mettre tout en œuvre pour mettre ouvriers,
cultivateurs et étudiants sous la coupe des organisations catholiques.
L’économie coopérative prospère en temps de crise. En 1934, une seule caisse pospulaire existe à Saint-Jean. Mgr Forget entend cultiver l’esprit coopératif
:«Dans le domaine de la coopération, l’Évêque invita l’aumônier de la L.O.C. (Ligue ouvrière catholique), à tenter, à titre d’expérience, la promotion de coopératives de consommation et d’habitation dans la cité de Saint-Jean. La coopérative de consommation, comme toutes les autres dans la Province, n’a pu survivre à la concurrence, mais la coopérative d’habitation La Cité Ouvrière a été à l’origine du développement de la paroisse actuelle de Saint-Gérard…»[62]
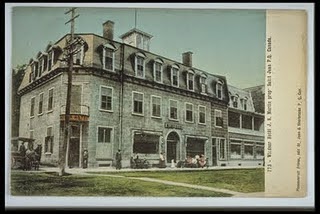 vivre du début du XXe siècle, où les hôtels
étaient encore remplis de visiteurs et de voyageurs de passage. Mais le temps
des grands hôtels est passé. Les nouveaux bâtiments hôteliers prennent un
aspect moins luxueux. Des tavernes y sont incorporées, comme à l'Hôtel Windsor.
Plus tard, ce sera au tour de l'Hôtel Richelieu. Une nouvelle clientèle,
associée sans doute à la prolétarisation de Saint-Jean, y trouve son intérêt.
vivre du début du XXe siècle, où les hôtels
étaient encore remplis de visiteurs et de voyageurs de passage. Mais le temps
des grands hôtels est passé. Les nouveaux bâtiments hôteliers prennent un
aspect moins luxueux. Des tavernes y sont incorporées, comme à l'Hôtel Windsor.
Plus tard, ce sera au tour de l'Hôtel Richelieu. Une nouvelle clientèle,
associée sans doute à la prolétarisation de Saint-Jean, y trouve son intérêt. prohibition américaine qui entraîna une activité interlope à la frontière avec
le commerce clandestin des bootleggers et les nouvelles confrontations
européennes, les esprits ne savaient plus quoi penser. La poussée de l’automobile, des poteaux
soutenant les câbles électriques et téléphoniques, le nouveau pavé en ciment ou
en macadam, entraînent le remplacement de la verdure, des arbres et de ce qui
restait de nature dans la ville. Les tempêtes de neige perdent de leur blancheur
avec les abrasifs sableux que l'on disperse sur les rues afin d'empêcher les
roues des autos de déraper. Pourtant, on continue à traverser la rivière à pied
sur la glace ou à y scier de gros morceaux de glace pour approvisionnier les
glacières domestiques. C’était avant l’arrivée de la réfrigération électrique.
prohibition américaine qui entraîna une activité interlope à la frontière avec
le commerce clandestin des bootleggers et les nouvelles confrontations
européennes, les esprits ne savaient plus quoi penser. La poussée de l’automobile, des poteaux
soutenant les câbles électriques et téléphoniques, le nouveau pavé en ciment ou
en macadam, entraînent le remplacement de la verdure, des arbres et de ce qui
restait de nature dans la ville. Les tempêtes de neige perdent de leur blancheur
avec les abrasifs sableux que l'on disperse sur les rues afin d'empêcher les
roues des autos de déraper. Pourtant, on continue à traverser la rivière à pied
sur la glace ou à y scier de gros morceaux de glace pour approvisionnier les
glacières domestiques. C’était avant l’arrivée de la réfrigération électrique. le plan
urbain nord-américain que la ville se développe. Les rues Champlain et
Saint-Jacques deviennent de plus en plus commerciales : des merceries, des
épiceries, même une buanderie chinoise dans une petite maisonnette grise de la
rue Saint-Jacques qu'on pouvait encore voir dans les années 1970, et bien
d'autres… Des quartiers se spécialisaient - quartier ouvrier dans l'est et le
nord; quartier de plus en plus huppé dans le sud, vers le Boulevard Gouin et le
Boulevard Montcalm. Aux deux parcs, Marchand et Laurier, la ville ajoute un
terre-plein en 1911 afin de faire un (petit) boulevard sur la rue Grant
(Laurier), entre les rues Saint-Thomas et Saint-Paul. Avec la commotion subie
par la Grande Guerre, la Ville fait passer le nom de Saint-Thomas à celui du
Maréchal Foch, venu faire son tour à Saint-Jean en se rendant des États-Unis au
Canada, et le «parc» est nommé Boulevard Courcelette, pour commémorer les
batailles de la Somme, livrées en 1916. Là, on y érige un monument à la mémoire
des soldats de la guerre. Bien vite, toutefois, on oubliera ce nom de
Courcelette pour donner à la rue Grant le nom de Laurier. L'élargissement des
deux
le plan
urbain nord-américain que la ville se développe. Les rues Champlain et
Saint-Jacques deviennent de plus en plus commerciales : des merceries, des
épiceries, même une buanderie chinoise dans une petite maisonnette grise de la
rue Saint-Jacques qu'on pouvait encore voir dans les années 1970, et bien
d'autres… Des quartiers se spécialisaient - quartier ouvrier dans l'est et le
nord; quartier de plus en plus huppé dans le sud, vers le Boulevard Gouin et le
Boulevard Montcalm. Aux deux parcs, Marchand et Laurier, la ville ajoute un
terre-plein en 1911 afin de faire un (petit) boulevard sur la rue Grant
(Laurier), entre les rues Saint-Thomas et Saint-Paul. Avec la commotion subie
par la Grande Guerre, la Ville fait passer le nom de Saint-Thomas à celui du
Maréchal Foch, venu faire son tour à Saint-Jean en se rendant des États-Unis au
Canada, et le «parc» est nommé Boulevard Courcelette, pour commémorer les
batailles de la Somme, livrées en 1916. Là, on y érige un monument à la mémoire
des soldats de la guerre. Bien vite, toutefois, on oubliera ce nom de
Courcelette pour donner à la rue Grant le nom de Laurier. L'élargissement des
deux  voies rongea le terre-plein qui finit par ne plus être un parc, mais on y
installa l'une de ces statues du Sacré-Cœur les bras en croix (qui s'ouvraient
dans les années 60 devant la vitrine d'un marché Métro), modèle que l'on
vendait en série à l'époque, et un canon, une pièce d'artillerie de la guerre
14-18. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Le mouvement des Braves a été relocalisé
au parc Alcide-Côté. Ce terre-plein était situé en plein dans le quartier de
développement industriel, où logeaient les travailleurs de la Singer et
autres nouvelles usines du nord de la ville. Car, bientôt, l'expansion de la
ville débordera le triangle formé de part et d'autre de l'axe de la rue
Saint-Jacques et limité par les deux voies ferrées.
voies rongea le terre-plein qui finit par ne plus être un parc, mais on y
installa l'une de ces statues du Sacré-Cœur les bras en croix (qui s'ouvraient
dans les années 60 devant la vitrine d'un marché Métro), modèle que l'on
vendait en série à l'époque, et un canon, une pièce d'artillerie de la guerre
14-18. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Le mouvement des Braves a été relocalisé
au parc Alcide-Côté. Ce terre-plein était situé en plein dans le quartier de
développement industriel, où logeaient les travailleurs de la Singer et
autres nouvelles usines du nord de la ville. Car, bientôt, l'expansion de la
ville débordera le triangle formé de part et d'autre de l'axe de la rue
Saint-Jacques et limité par les deux voies ferrées. avec
mépris et dédain du nom d’étranger les nouveaux habitants de la ville, qui
viennent nous aider à nous sortir du pétrin, on devrait les remercier"».[63] Ce que nous
dit ce journaliste, aux lendemains de la Grande Guerre, c’est que la dynamique
de l’auto-détermination de la région de Saint-Jean ne se trouve plus ni dans
ses ressources ni dans son dynamisme humain, et qu’elle doit maintenant se fier
sur le capital étranger pour se développer. Là où ce correspondant voit que les
étrangers viennent nous sortir du pétrin, il ne voit pas dans quel
pétrin ils viennent nous plonger. Constat du trauma de la Singer et
l’avortement de l’imagination créatrice qui n’avait jamais fait défaut aux
Johannais avant ce temps.
avec
mépris et dédain du nom d’étranger les nouveaux habitants de la ville, qui
viennent nous aider à nous sortir du pétrin, on devrait les remercier"».[63] Ce que nous
dit ce journaliste, aux lendemains de la Grande Guerre, c’est que la dynamique
de l’auto-détermination de la région de Saint-Jean ne se trouve plus ni dans
ses ressources ni dans son dynamisme humain, et qu’elle doit maintenant se fier
sur le capital étranger pour se développer. Là où ce correspondant voit que les
étrangers viennent nous sortir du pétrin, il ne voit pas dans quel
pétrin ils viennent nous plonger. Constat du trauma de la Singer et
l’avortement de l’imagination créatrice qui n’avait jamais fait défaut aux
Johannais avant ce temps. 




















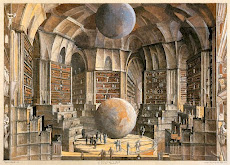
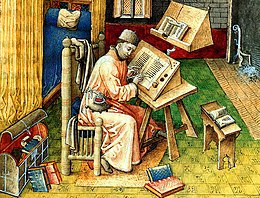







































































Bonjour,
RépondreSupprimerQuand vous parlez du Collège de Saint-Jean, existe-t-il encore aujourd'hui? Si oui, a-t-il changé de nom depuis?
Merci beaucoup d'avance,
Maryse
Le Collège de Saint-Jean était situé dans une ancienne poterie Macdonald sise au coin des rues Saint-Georges et Laurier. Il fut détruit au cours d'un incendie en 1939. En 1940, on construisit, un peu plus à l'écart du centre-ville le Séminaire de Saint-Jean tenu par des prêtres réguliers chargé de le rejmplace. L'édifice est devenue depuis le CEGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'architecture religieuse (les fenêtres triangulaires pour rappeler la Trinité), reste la seule marque du caractère confessionnel de l'édifice.
SupprimerBonjour,
RépondreSupprimerJe cherche ou était situé la compagnie Conduit, Cable & Fitting ltd.
Merci.
** Belle page de notre histoire et très instructif.
Je rappellerai ce paragraphe : «
SupprimerEn 1913, Vernon Longtin (1896-1986) fonde l’Insuladuct Manufacturing Company Ltd qui devient en 1920 la L & N Company Ltd. Le seul article qui y est produit s’appelle Loonduct. Fabriquants de boîtes de sortie, de câbles et fils électriques ainsi que des garnitures pour conduits, Bill Northy et Vernon Longtin, en 1929, entrent en pourparler avec Jack McAuliffe afin de fusionner la L & N avec la Cables Conduits and Fittings Ltd, établie depuis 1912 dans l’ancien édifice des pompes de l’Aqueduc de Saint-Jean. L’entente échoue. En 1953, la multinationale italienne Pirelli se porte acquéreur de la Cable Conduits and Fittings tandis que Longtin s’occupe de la production des articles restants sous le nom d’Iberville Fittings Ltd.» L'Iberville Fittings était située sur la rue Saint-Pierre. L'édifice était remarquable car il était surmonté d'un château d'eau, moins élevé que le château d'eau au centre-ville (vieux Saint-Jean). Pour la Pirelli, c'était située sur la rue Richelieu sud, à la croisée des voies ferrées du Canadien national où il y avait un viaduc qui surplombait la rue. À proximité du Yacht Club.
Où pouvons-nous avoir accès au photo d'époque en qualité imprimable? Celle-ci m'intéresse particulièrement http://1.bp.blogspot.com/-d-rjJwALv2U/VI5ws6S71UI/AAAAAAAAiE0/BbzxZ3B_z8o/s1600/28.jpg
RépondreSupprimerMerci!
"Le Canada-Français" a publié beaucoup de photos historiques de Saint-Jean au cours des années 70-80. Il faudrait vérifier si l'hebdomadaire peut te donner accès à ses archives. Sinon, la bibliothèque municipale de St-Jean possède également des exemplaires du journal. Mais, pour la photocopieuse, c'est coûteux et les qualités douteuses.
SupprimerCeci dit, il est possible de faire des copier/coller des images du site et d'en tirer des copies que tu peux imprimer. Ce serait le meilleur moyen d'avoir des images de bonnes qualités selon le type d'imprimante utilisée.
Merci pour votre intérêt.
Je cherche une photo des anciennes piscines en bois construites à l'OTJ dans la rivière Richelieu
RépondreSupprimerJe ne sais pas.
SupprimerÉtant johannais depuis toujours, je me suis instruit véritablement sur l'ensemble de l'histoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'avais déjà lu sur l'historique avec les principaux personnages qui laissèrent en mémoire leurs noms aux rues et aux sites avoisinants de la St. Johns Dorchester. Je me souvenais d'un plan de la localité avec les anciens noms de rues majoritairement anglophones et vous m'avez rappelé cette toponymie en précisant le nom remplaçé présentement. Votre oeuvre devrait se trouver dans un musée de la région sérieusement. Son contenu est fabuleux et enrichi non seulement pour les historiens mais également pour les passionnés de l'histoire de sa région. Merci et bonne continuation car vous êtes une perle pour la connaissance de notre site historique. Bravo!
RépondreSupprimerMalheureusement, ça n'intéresse pas les édiles de Saint-Jean, qui préfèrent financer une murale décorative pour empêcher des graffitistes d'aller faire des barbots sur les bâtiments mal entretenus de la ville. Pour ma part, je l'ai fait en guise d'adieu à une ville aujourd'hui disparue; une ville laide, qui s'est négligée comme une pauvresse. Il ne reste plus aux Johannais qu'à pirater tout ça avant que le blogue s'efface. Merci pour vos bons mots.
Supprimer