LES SOUS-HOMMES
 aujourd’hui oublié, Le
Voleur, (1889),
Georges Darien, l’auteur, écrivait : «Le
monde actuel est l’abjection même».1
Ce faisant, il reprenait une catégorie ontologique de la religion
chrétienne : l’abjection. Il semblerait que ce fut-là une
constance de l’Anus
Mundi,
reprenant les mots de Roger Caillois qui en fut le contemporain, que
«dans les
questions de vie et de mort, on passe sans degré de l’héroïsme à
l’abjection».2
Les grands
hommes, ou
ceux que la société reconnaissait tels, le savaient qui pouvaient
très vite tomber de leur piédestal à la voirie. Il ne s’agissait
pas seulement d’être refoulé au ban de la société, ni même
monter sur l’échafaud, mais accéder à un état ontologique
situé proche du Néant : les fameuses poubelles
de l'histoire de
Trotsky.
Rien n’illustre mieux cette tombée dans le Néant qu’une fois
dégradé, on expédia le capitaine Dreyfus à l’île du Diable, en
Guyane : île particulièrement connue pour sa situation
malsaine. Pétain y échappa qui fut dégradé et expédié finir ses
jours à l’île d’Yeu.
aujourd’hui oublié, Le
Voleur, (1889),
Georges Darien, l’auteur, écrivait : «Le
monde actuel est l’abjection même».1
Ce faisant, il reprenait une catégorie ontologique de la religion
chrétienne : l’abjection. Il semblerait que ce fut-là une
constance de l’Anus
Mundi,
reprenant les mots de Roger Caillois qui en fut le contemporain, que
«dans les
questions de vie et de mort, on passe sans degré de l’héroïsme à
l’abjection».2
Les grands
hommes, ou
ceux que la société reconnaissait tels, le savaient qui pouvaient
très vite tomber de leur piédestal à la voirie. Il ne s’agissait
pas seulement d’être refoulé au ban de la société, ni même
monter sur l’échafaud, mais accéder à un état ontologique
situé proche du Néant : les fameuses poubelles
de l'histoire de
Trotsky.
Rien n’illustre mieux cette tombée dans le Néant qu’une fois
dégradé, on expédia le capitaine Dreyfus à l’île du Diable, en
Guyane : île particulièrement connue pour sa situation
malsaine. Pétain y échappa qui fut dégradé et expédié finir ses
jours à l’île d’Yeu.  manière à reconstituer
sur un plan laïque l’ontologie de l’abject. La mise à mort
d’Alain de Monéys, à Hautefaye, le 16 août 1870, au début de la
guerre franco-prussienne en est une illustration symptomatique. Au
cours d’une foire de village, un noble est pris pour un espion
prussien, ce qui a entraîné son lynchage. Le corps est finalement
brûlé. Des rumeurs circulent disant que des paysans ont commis des
actes de cannibalisme. Quatre des principaux responsables seront
condamnés à mort et d’autres aux travaux forcés à perpétuité.
Alain Corbin parle de l’effet fantasmatique qu’a causé ce fait
divers : «Le
massacre, son spectacle, son récit permettent à l’âme sensible
de ressentir plus fortement que naguère les clivages sociaux. La
révolte qu’il inspire s’imprègne de dégoût à l’égard
d’une humanité qui atteste, par son geste, sa proximité animale.
Il aide au dessin d’une tourbe sanglante, d’un vil marais humain.
Le massacre suggère l’assimilation de ceux qui l’accomplissent à
la charogne et à l’excrément qu’il produit».3
La chose est encore plus vraie lorsque moins d’un an plus tard, à
Paris cette fois, la répression finale de la Commune de Paris
s’achève dans un flot d’hémoglobines et de cadavres propre à
banaliser la Saint-Barthélemy. L’auteur du larmoyant mélodrame
d’une prostituée tuberculeuse et d’un jeune étourdi par la
passion, La
Dame aux camélias, «Dumas
fils qui n’était ni un terroriste ni un politique écrivait après
l’extermination des Communards : “Nous ne dirons rien de leurs
femelles, par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand
elles sont mortes.” Phrase odieuse, mais
manière à reconstituer
sur un plan laïque l’ontologie de l’abject. La mise à mort
d’Alain de Monéys, à Hautefaye, le 16 août 1870, au début de la
guerre franco-prussienne en est une illustration symptomatique. Au
cours d’une foire de village, un noble est pris pour un espion
prussien, ce qui a entraîné son lynchage. Le corps est finalement
brûlé. Des rumeurs circulent disant que des paysans ont commis des
actes de cannibalisme. Quatre des principaux responsables seront
condamnés à mort et d’autres aux travaux forcés à perpétuité.
Alain Corbin parle de l’effet fantasmatique qu’a causé ce fait
divers : «Le
massacre, son spectacle, son récit permettent à l’âme sensible
de ressentir plus fortement que naguère les clivages sociaux. La
révolte qu’il inspire s’imprègne de dégoût à l’égard
d’une humanité qui atteste, par son geste, sa proximité animale.
Il aide au dessin d’une tourbe sanglante, d’un vil marais humain.
Le massacre suggère l’assimilation de ceux qui l’accomplissent à
la charogne et à l’excrément qu’il produit».3
La chose est encore plus vraie lorsque moins d’un an plus tard, à
Paris cette fois, la répression finale de la Commune de Paris
s’achève dans un flot d’hémoglobines et de cadavres propre à
banaliser la Saint-Barthélemy. L’auteur du larmoyant mélodrame
d’une prostituée tuberculeuse et d’un jeune étourdi par la
passion, La
Dame aux camélias, «Dumas
fils qui n’était ni un terroriste ni un politique écrivait après
l’extermination des Communards : “Nous ne dirons rien de leurs
femelles, par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand
elles sont mortes.” Phrase odieuse, mais  significative! On raye de
l’espèce humaine ses adversaires, pour les mieux condamner».4
Pourtant, parmi ces femelles,
combien
de Marie Duplessis*? Enfin, la littérature finira par gaver son
public de scènes scatologiques dites abjectes qui feront la
réputation sulfureuse de Zola : «Comme
dans la plupart des romans de Zola, L’Assommoir
contient des pages assez répugnantes : par exemple, telle dispute
d’ivrognerie, surtout la description d’un formidable vomissement
de Coupeau. Zola, dans cette description, n’en a-t-il pas remis,
comme disent les braves gens, en nous montrant sa femme Gervaise -
avant sa déchéance crapuleuse - voulant se coucher dans le lit
ignoblement sali par l’indigestion monstrueuse de l’ivrogne?
[…] “Voilà
une bien grande œuvre, écrivait [Mallarmé]
à Zola en 1877, après avoir lu l’Assommoir;
et digne d’une époque où la vérité devient la forme populaire
de la beauté”».5
Comme dit justement Julia Kristeva : «le
sujet de l’abjection est éminemment productif de culture».6
Le temps était venu de prendre, de manière scientifique, cette
émotion humaine : l'abject.
significative! On raye de
l’espèce humaine ses adversaires, pour les mieux condamner».4
Pourtant, parmi ces femelles,
combien
de Marie Duplessis*? Enfin, la littérature finira par gaver son
public de scènes scatologiques dites abjectes qui feront la
réputation sulfureuse de Zola : «Comme
dans la plupart des romans de Zola, L’Assommoir
contient des pages assez répugnantes : par exemple, telle dispute
d’ivrognerie, surtout la description d’un formidable vomissement
de Coupeau. Zola, dans cette description, n’en a-t-il pas remis,
comme disent les braves gens, en nous montrant sa femme Gervaise -
avant sa déchéance crapuleuse - voulant se coucher dans le lit
ignoblement sali par l’indigestion monstrueuse de l’ivrogne?
[…] “Voilà
une bien grande œuvre, écrivait [Mallarmé]
à Zola en 1877, après avoir lu l’Assommoir;
et digne d’une époque où la vérité devient la forme populaire
de la beauté”».5
Comme dit justement Julia Kristeva : «le
sujet de l’abjection est éminemment productif de culture».6
Le temps était venu de prendre, de manière scientifique, cette
émotion humaine : l'abject. grand expert du temps en études comparées des
religions énonçait une théorie : «Pour
Frazer, la magie, phase primordiale des mentalités humaines, “sœur
bâtarde des sciences”, à laquelle les primitifs sont encore
attachés, applique incorrectement les mêmes principes associatifs
qui, bien appliqués, conduisent au savoir fondé sur les relations
de causalité. Les sauvages se servent en effet de deux principes :
“[…] le premier, c’est que tout semblable appelle son
semblable, ou qu’un effet ressemble à sa cause; le second, c’est
que deux choses qui ont été en contact à un certain moment
continuent d’agir l’une sur l’autre, même lorsque ce contact a
cessé. Nous appellerons le premier principe loin de similitude, le
second loi de contact ou de contagion”».7
Ce qui voulait dire que si les semblables se rassemblent, la
semblance les spécifie, et ceux avec qui ils ont été en contact
mais qui se sont éloignés jusqu’à devenir étranger
aux
semblables, ceux-là
deviennent alors des étrangers.
Le risque de contagion du groupe par ces (auto-)exclus apparaît dès
lors comme porteurs de menaces. C’est ainsi qu’après la
déchristianisation et la montée de la tolérance religieuse se
ramenèrent, au XIXe siècle, l’exclusion et l’abjection dont
nous parlons ici : «“L’homme
vil n’existe que pour l’autre.” Ce principe est la négation
même des Droits de l’Homme et de la doctrine de Bentham, car
Bentham trouvait que tous les hommes ont droit au bonheur. Fichte
estimait que l’homme vil devrait être sacrifié. Qui doit juger
quel est l’homme vil? Sans aucun doute, le gouvernement. C’est
pourquoi toute tyrannie est justifiable, et l’anéantissement des
adversaires politiques peut se faire au nom de la noblesse
nationale».8
grand expert du temps en études comparées des
religions énonçait une théorie : «Pour
Frazer, la magie, phase primordiale des mentalités humaines, “sœur
bâtarde des sciences”, à laquelle les primitifs sont encore
attachés, applique incorrectement les mêmes principes associatifs
qui, bien appliqués, conduisent au savoir fondé sur les relations
de causalité. Les sauvages se servent en effet de deux principes :
“[…] le premier, c’est que tout semblable appelle son
semblable, ou qu’un effet ressemble à sa cause; le second, c’est
que deux choses qui ont été en contact à un certain moment
continuent d’agir l’une sur l’autre, même lorsque ce contact a
cessé. Nous appellerons le premier principe loin de similitude, le
second loi de contact ou de contagion”».7
Ce qui voulait dire que si les semblables se rassemblent, la
semblance les spécifie, et ceux avec qui ils ont été en contact
mais qui se sont éloignés jusqu’à devenir étranger
aux
semblables, ceux-là
deviennent alors des étrangers.
Le risque de contagion du groupe par ces (auto-)exclus apparaît dès
lors comme porteurs de menaces. C’est ainsi qu’après la
déchristianisation et la montée de la tolérance religieuse se
ramenèrent, au XIXe siècle, l’exclusion et l’abjection dont
nous parlons ici : «“L’homme
vil n’existe que pour l’autre.” Ce principe est la négation
même des Droits de l’Homme et de la doctrine de Bentham, car
Bentham trouvait que tous les hommes ont droit au bonheur. Fichte
estimait que l’homme vil devrait être sacrifié. Qui doit juger
quel est l’homme vil? Sans aucun doute, le gouvernement. C’est
pourquoi toute tyrannie est justifiable, et l’anéantissement des
adversaires politiques peut se faire au nom de la noblesse
nationale».8
 Aujourd’hui, Julia Kristeva reprend, dans les mots de son époque,
les conclusions de Fraser : «Celui
par lequel l’abject existe est donc un jeté qui (se) place, (se)
sépare, (se) situe et donc erre, au lieu de se reconnaître, de
désirer, d’appartenir ou de refuser. Situationniste en un sens, et
non sans rire - puisque rire est une façon de placer ou de déplacer
l’abjection. Forcément dichotomique, quelque peu manichéen, il
divise, exclut et, sans à proprement parler vouloir connaître ses
abjections, ne les ignore nullement. Souvent d’ailleurs il s’y
inclut, jetant ainsi à l’intérieur de soi le scalpel qui opère
ses séparations».9
La nature du crime commis à Hautefaye apparait tellement évidente
qu’on a peine à croire à une simple bévue due à l’annonce de
la guerre et des premiers affrontements avec l’ennemi. Corbin
montre de façon pertinente qu’il y avait une haine de classe, une
haine de la noblesse riche et parvenue de la part des paysans qui
entra en jeu dans la précipitation du massacre de Monéys. À ce
propos, Kristeva nuance : «Frontière
sans doute, l’abjection est surtout ambiguïté. Parce que, tout en
démarquant, elle ne détache pas radicalement le sujet de ce qui le
menace - au contraire, elle l’avoue en perpétuel danger. Mais
aussi parce que l’abjection elle-même est un mixte de jugement et
d’affect, de condamnation et d’effusion, de signes et de
pulsions. De l’archaïsme de la relation pré-objectale, de la
violence immémoriale avec laquelle un corps se sépare d’un autre
pour être, l’abjection conserve cette nuit où se perd le contour
de la chose signifiée et où n’agit que l’affect impondérable».10
C’est parce que l’abjection circule à la fois sur l’inconscient
et sur l’idéologique qu’elle peut envahir ainsi tout
l’Imaginaire et s’élever au niveau de l’ontologie. Il y a
l’Objet; il y a le Sujet, mais il y a aussi l’abject qui fusionne
l’Objet et le Sujet pour créer une identité nouvelle dont
l’exclusion du groupe marque la spécificité.
Aujourd’hui, Julia Kristeva reprend, dans les mots de son époque,
les conclusions de Fraser : «Celui
par lequel l’abject existe est donc un jeté qui (se) place, (se)
sépare, (se) situe et donc erre, au lieu de se reconnaître, de
désirer, d’appartenir ou de refuser. Situationniste en un sens, et
non sans rire - puisque rire est une façon de placer ou de déplacer
l’abjection. Forcément dichotomique, quelque peu manichéen, il
divise, exclut et, sans à proprement parler vouloir connaître ses
abjections, ne les ignore nullement. Souvent d’ailleurs il s’y
inclut, jetant ainsi à l’intérieur de soi le scalpel qui opère
ses séparations».9
La nature du crime commis à Hautefaye apparait tellement évidente
qu’on a peine à croire à une simple bévue due à l’annonce de
la guerre et des premiers affrontements avec l’ennemi. Corbin
montre de façon pertinente qu’il y avait une haine de classe, une
haine de la noblesse riche et parvenue de la part des paysans qui
entra en jeu dans la précipitation du massacre de Monéys. À ce
propos, Kristeva nuance : «Frontière
sans doute, l’abjection est surtout ambiguïté. Parce que, tout en
démarquant, elle ne détache pas radicalement le sujet de ce qui le
menace - au contraire, elle l’avoue en perpétuel danger. Mais
aussi parce que l’abjection elle-même est un mixte de jugement et
d’affect, de condamnation et d’effusion, de signes et de
pulsions. De l’archaïsme de la relation pré-objectale, de la
violence immémoriale avec laquelle un corps se sépare d’un autre
pour être, l’abjection conserve cette nuit où se perd le contour
de la chose signifiée et où n’agit que l’affect impondérable».10
C’est parce que l’abjection circule à la fois sur l’inconscient
et sur l’idéologique qu’elle peut envahir ainsi tout
l’Imaginaire et s’élever au niveau de l’ontologie. Il y a
l’Objet; il y a le Sujet, mais il y a aussi l’abject qui fusionne
l’Objet et le Sujet pour créer une identité nouvelle dont
l’exclusion du groupe marque la spécificité. diffère donc de
la même façon que l’érotisme anal diffère du sadisme».11
Ça reste à voir. Si l’exclu a été relayé au niveau de
l'abject, son exclusion peut être associée à une défécation
jouissive. Mais l’attitude des Sujets envers les exclus ne s’arrête
pas au plaisir de les expulser. On érotise l’humiliation, la
torture, les mises à mort physique, la crémation, comme à
Hautefaye! Comme le note Kristeva, on y retrouve «la
nécessité de traverser l’abjection dont la douleur est le côté
intime, et l’horreur le visage public».12
Car avant d’atteindre le Néant auquel il est destiné, l’exclu
doit conserver une part d’identité qui passe par-dessus le Néant
même pour le propulser encore plus loin, comme si c’était
possible. C’est le sens de la facétie militaire allemande du début
du XXe siècle : «le
prestige de l’officier est considérable et l’on connaît
l’anecdote :
“Nach Gott dein Vater kommt der Offizier der Kavallerie, dann sein
Pferd, dann nichts, dann nichts, und dann der Offizier der
Infanterie.”
(Après Dieu le Père, vient l’officier de cavalerie, ensuite son
cheval, ensuite rien, enfin l’officier d’infanterie)».13
Comprenons bien le sens de la plaisanterie. Après Dieu, vient la
cavalerie, la caste des seigneurs de la guerre; ensuite l’infanterie,
les soldats de terrains, ceux qui s’embourbent dans les tranchées.
Le «rien» entre le cheval et l’officier d’infanterie dit à
quel point la hiérarchie militaire considérait la matière première
du combat, la chair à canon, comme de moins de valeur que le cheval
du cavalier. L’abjection ordinaire
n’est
pas seulement le fait du monde du travail dans les usines, mais
aussi, en Russie par exemple, le monde des paysans, des
diffère donc de
la même façon que l’érotisme anal diffère du sadisme».11
Ça reste à voir. Si l’exclu a été relayé au niveau de
l'abject, son exclusion peut être associée à une défécation
jouissive. Mais l’attitude des Sujets envers les exclus ne s’arrête
pas au plaisir de les expulser. On érotise l’humiliation, la
torture, les mises à mort physique, la crémation, comme à
Hautefaye! Comme le note Kristeva, on y retrouve «la
nécessité de traverser l’abjection dont la douleur est le côté
intime, et l’horreur le visage public».12
Car avant d’atteindre le Néant auquel il est destiné, l’exclu
doit conserver une part d’identité qui passe par-dessus le Néant
même pour le propulser encore plus loin, comme si c’était
possible. C’est le sens de la facétie militaire allemande du début
du XXe siècle : «le
prestige de l’officier est considérable et l’on connaît
l’anecdote :
“Nach Gott dein Vater kommt der Offizier der Kavallerie, dann sein
Pferd, dann nichts, dann nichts, und dann der Offizier der
Infanterie.”
(Après Dieu le Père, vient l’officier de cavalerie, ensuite son
cheval, ensuite rien, enfin l’officier d’infanterie)».13
Comprenons bien le sens de la plaisanterie. Après Dieu, vient la
cavalerie, la caste des seigneurs de la guerre; ensuite l’infanterie,
les soldats de terrains, ceux qui s’embourbent dans les tranchées.
Le «rien» entre le cheval et l’officier d’infanterie dit à
quel point la hiérarchie militaire considérait la matière première
du combat, la chair à canon, comme de moins de valeur que le cheval
du cavalier. L’abjection ordinaire
n’est
pas seulement le fait du monde du travail dans les usines, mais
aussi, en Russie par exemple, le monde des paysans, des  moujiks.
Le
système soviétique a conservé le mépris autant de l’ancienne
noblesse rurale que de la boutade des sacs de pommes de terre de
Marx : «Le
paysan n’était pas non plus un citoyen, même au sens soviétique.
En comparaison avec la période de la N.E.P., le statut social des
paysans se détériora. Sous la N.E.P., les paysans, si pauvres
fussent-ils, avaient pourtant quelque raison de se respecter. La
majorité d’entre eux avaient le sentiment d’être des
producteurs indépendants et se considéraient eux-mêmes comme des
hozjaeva
à part entière - classe qui s’était récemment libérée des
conditions dégradantes de la servitude. Mais au cours de la période
suivante, ils se virent transformés en une masse privée de droits,
entourés de pratiques et de limitations discriminatoires, et soumis
à un régime entièrement nouveau. Le système du passeport et les
restrictions à l’intérieur des kolkhozes les privèrent d’une
bonne partie de leur liberté de déplacement. Ils furent assujettis
à des corvées d’État obligatoires, comme la construction de
routes et l’abattage de bois, qui ne s’appliquaient pas aux
citadins. Ils n’avaient aucune représentation propre ni aucun
droit de s’organiser pour défendre leurs intérêts. Pour les
moyens de production et certains biens de consommation, ils devaient
acquitter des prix spéciaux supérieurs. Enfin, ils furent soumis à
un système de travail qui leur rappelait trop souvent les conditions
dont la révolution paraissait les avoir à jamais libérés. À
l’époque de Staline, les paysans étaient légalement attachés à
leur lieu de travail, soumis à un régime juridique spécial, et - à
travers le kolkhoze - à une forme de responsabilité collective en
ce qui concerne leurs devoirs envers l’État. Bref, ils se
retrouvèrent dans
moujiks.
Le
système soviétique a conservé le mépris autant de l’ancienne
noblesse rurale que de la boutade des sacs de pommes de terre de
Marx : «Le
paysan n’était pas non plus un citoyen, même au sens soviétique.
En comparaison avec la période de la N.E.P., le statut social des
paysans se détériora. Sous la N.E.P., les paysans, si pauvres
fussent-ils, avaient pourtant quelque raison de se respecter. La
majorité d’entre eux avaient le sentiment d’être des
producteurs indépendants et se considéraient eux-mêmes comme des
hozjaeva
à part entière - classe qui s’était récemment libérée des
conditions dégradantes de la servitude. Mais au cours de la période
suivante, ils se virent transformés en une masse privée de droits,
entourés de pratiques et de limitations discriminatoires, et soumis
à un régime entièrement nouveau. Le système du passeport et les
restrictions à l’intérieur des kolkhozes les privèrent d’une
bonne partie de leur liberté de déplacement. Ils furent assujettis
à des corvées d’État obligatoires, comme la construction de
routes et l’abattage de bois, qui ne s’appliquaient pas aux
citadins. Ils n’avaient aucune représentation propre ni aucun
droit de s’organiser pour défendre leurs intérêts. Pour les
moyens de production et certains biens de consommation, ils devaient
acquitter des prix spéciaux supérieurs. Enfin, ils furent soumis à
un système de travail qui leur rappelait trop souvent les conditions
dont la révolution paraissait les avoir à jamais libérés. À
l’époque de Staline, les paysans étaient légalement attachés à
leur lieu de travail, soumis à un régime juridique spécial, et - à
travers le kolkhoze - à une forme de responsabilité collective en
ce qui concerne leurs devoirs envers l’État. Bref, ils se
retrouvèrent dans  une situation assez comparable au sort qui était
le leur avant l’abolition du servage, pour former un ordre situé
tout en bas de l’échelle sociale».14
Les paysans sont ce qu’il y a de plus près des animaux. On ne peut
même pas s’en servir comme pont ou comme corde selon la métaphore
de l’homme de Nietzsche dans Zarathustra.
En
Occident, sans doute la condition paysanne s’améliorait-elle peu à
peu depuis la Révolution française et la vente des biens des
émigrés et du clergé aux petits cultivateurs qui s’enrichirent
et rallièrent la classe moyenne petite-bourgeoise, mais la promotion
était toute récente et ce furent essentiellement eux qu’on envoya
dans les tranchées tant on trouvait qu’ils étaient déjà faits
pour vivre dans la boue et la charogne.
une situation assez comparable au sort qui était
le leur avant l’abolition du servage, pour former un ordre situé
tout en bas de l’échelle sociale».14
Les paysans sont ce qu’il y a de plus près des animaux. On ne peut
même pas s’en servir comme pont ou comme corde selon la métaphore
de l’homme de Nietzsche dans Zarathustra.
En
Occident, sans doute la condition paysanne s’améliorait-elle peu à
peu depuis la Révolution française et la vente des biens des
émigrés et du clergé aux petits cultivateurs qui s’enrichirent
et rallièrent la classe moyenne petite-bourgeoise, mais la promotion
était toute récente et ce furent essentiellement eux qu’on envoya
dans les tranchées tant on trouvait qu’ils étaient déjà faits
pour vivre dans la boue et la charogne. des
Mandchous. Une fois la guerre civile prise en Occident, les ennemis
devenaient les porteurs de la Barbarie. C’est ainsi qu’on
qualifia le bombardement allemand de Louvains en 1914. C’est au nom
de la civilisation que l’Angleterre déclara la guerre à
l’Allemagne nazie le 3 septembre 1939 après le refus des armées
hitlériennes de quitter la Pologne envahie et déjà martyre :
«À
l’intention des écoliers français, le ministre Albert Sarraut
indiqua dès octobre 1914 le sens véritable de la guerre : “C’est
bien, cette fois encore, contre la bête humaine en arrêt
d’évolution, c’est contre le Hun des âges abolis, qui a changé
d’armure sans changer de conscience, oui, c’est bien contre le
Vandale resté le même après quinze siècles de progrès humain
que, comme le chevalier étincelant de jadis, la France latine a tiré
l’épée. C’est, de nouveau, le choc violent de la civilisation
et de la barbarie, la lutte de la lumière et de l’ombre.
[…] La
haine allemande pour la France est celle de la chose qui rampe contre
la chose qui éblouit, la haine du reptile pour l’étoile.” La
guerre qui
des
Mandchous. Une fois la guerre civile prise en Occident, les ennemis
devenaient les porteurs de la Barbarie. C’est ainsi qu’on
qualifia le bombardement allemand de Louvains en 1914. C’est au nom
de la civilisation que l’Angleterre déclara la guerre à
l’Allemagne nazie le 3 septembre 1939 après le refus des armées
hitlériennes de quitter la Pologne envahie et déjà martyre :
«À
l’intention des écoliers français, le ministre Albert Sarraut
indiqua dès octobre 1914 le sens véritable de la guerre : “C’est
bien, cette fois encore, contre la bête humaine en arrêt
d’évolution, c’est contre le Hun des âges abolis, qui a changé
d’armure sans changer de conscience, oui, c’est bien contre le
Vandale resté le même après quinze siècles de progrès humain
que, comme le chevalier étincelant de jadis, la France latine a tiré
l’épée. C’est, de nouveau, le choc violent de la civilisation
et de la barbarie, la lutte de la lumière et de l’ombre.
[…] La
haine allemande pour la France est celle de la chose qui rampe contre
la chose qui éblouit, la haine du reptile pour l’étoile.” La
guerre qui  commençait n’était pas, dans la culture de guerre
contemporaine, une simple guerre des patries, ni même seulement une
guerre des peuples. Elle était beaucoup plus que cela : derrière
l’affrontement des patries et des peuples, la guerre était une
guerre de civilisations. Outre-Rhin, l’appel à la défense
nécessaire de la Kultur allemande n’avait pas un sens
fondamentalement différent. Dans le cas français, il s’agit de
sauver une civilisation véritable, supérieure, incarnée par la
France, contre une non-civilisation, dévoyée, inférieure, celle de
l’Allemagne. Celle-ci incarnait désormais une barbarie moderne, ou
même une très ancienne barbarie transmise génétiquement intacte
au XXe siècle depuis les invasions du haut Moyen Âge : “Contre
notre civilisation, explique E. Toutey dans un ouvrage qui se veut
documentaire, montent à l’assaut, à quinze ou vingt siècles de
distance, tous les descendants de ceux qui ont senti la terreur lors
des grandes invasions barbares. Ce n’est point un hasard, c’est
l’instinct profond des races destructives et oppressives qui a
groupé pour la conquête brutale, pour le pillage et le massacre,
les petits-fils des Teutons et des Huns, des Suèves et des Vandales,
des Hongrois, des Bulgares et des Turcs. […]
Nous défendons le trésor de plusieurs milliers d’années de
civilisation”».15
Pourtant, ce trésor
de plusieurs milliers d’années de civilisation
était exactement le même de part et d’autres des alliances
belligérantes! Le schisme
dans l’âme de
l’Occident faisait que les semblables d’une même origine en
venaient de plus en plus à se considérer comme des exclus du
partage de ce trésor. Là reposaient bien des justifications
d’exclusions et d’abjection, justifications qu'on avait oublié
depuis le temps des terribles guerres de religion.
commençait n’était pas, dans la culture de guerre
contemporaine, une simple guerre des patries, ni même seulement une
guerre des peuples. Elle était beaucoup plus que cela : derrière
l’affrontement des patries et des peuples, la guerre était une
guerre de civilisations. Outre-Rhin, l’appel à la défense
nécessaire de la Kultur allemande n’avait pas un sens
fondamentalement différent. Dans le cas français, il s’agit de
sauver une civilisation véritable, supérieure, incarnée par la
France, contre une non-civilisation, dévoyée, inférieure, celle de
l’Allemagne. Celle-ci incarnait désormais une barbarie moderne, ou
même une très ancienne barbarie transmise génétiquement intacte
au XXe siècle depuis les invasions du haut Moyen Âge : “Contre
notre civilisation, explique E. Toutey dans un ouvrage qui se veut
documentaire, montent à l’assaut, à quinze ou vingt siècles de
distance, tous les descendants de ceux qui ont senti la terreur lors
des grandes invasions barbares. Ce n’est point un hasard, c’est
l’instinct profond des races destructives et oppressives qui a
groupé pour la conquête brutale, pour le pillage et le massacre,
les petits-fils des Teutons et des Huns, des Suèves et des Vandales,
des Hongrois, des Bulgares et des Turcs. […]
Nous défendons le trésor de plusieurs milliers d’années de
civilisation”».15
Pourtant, ce trésor
de plusieurs milliers d’années de civilisation
était exactement le même de part et d’autres des alliances
belligérantes! Le schisme
dans l’âme de
l’Occident faisait que les semblables d’une même origine en
venaient de plus en plus à se considérer comme des exclus du
partage de ce trésor. Là reposaient bien des justifications
d’exclusions et d’abjection, justifications qu'on avait oublié
depuis le temps des terribles guerres de religion. Carl Vogt écrivait, dans ses Leçons
sur l’homme :
«Les
exhalaisons de la peau ont aussi leurs caractères particuliers qui,
dans certaines races, ne disparaissent dans aucun cas, même devant
la propreté la plus scrupuleuse. Ces odeurs caractéristiques de
race ne doivent point être confondues avec ces exhalaisons qui
proviennent du genre de nourriture, et qu’on peut constater dans la
même race
[…] l’odeur
spécifique du nègre (elle) demeure la même, quelques soins de
propreté ou quelque nourriture qu’il prenne. Elle appartient à
l’espèce comme le musc au chevrotin qui le produit…».17
Nous sommes bien ici au niveau du Symbolique de l’abjection et non
pas d’un simple constat anthropologique. Susan Sontag nous dit quel
est le sens de cette répulsion olfactive : «Le
contact avec une personne atteinte d’une maladie mystérieuse
s’apparente obligatoirement à une transgression : pire, à la
violation d’un tabou. Le nom même de ces affections semble doté
d’un pouvoir magique.
[…] elle
est ressentie comme obscène au sens original du terme, c’est-à-dire
de mauvais augure, abominable, répugnante, offensante pour les
sens».18
Et en ce siècle où la médecine et la hantise des maladies dominent
tous et chacun, l’odeur blessante devient l’indice de la présence
des corps invisibles à l’œil nu mais qui propagent les fléaux
qui, depuis
Carl Vogt écrivait, dans ses Leçons
sur l’homme :
«Les
exhalaisons de la peau ont aussi leurs caractères particuliers qui,
dans certaines races, ne disparaissent dans aucun cas, même devant
la propreté la plus scrupuleuse. Ces odeurs caractéristiques de
race ne doivent point être confondues avec ces exhalaisons qui
proviennent du genre de nourriture, et qu’on peut constater dans la
même race
[…] l’odeur
spécifique du nègre (elle) demeure la même, quelques soins de
propreté ou quelque nourriture qu’il prenne. Elle appartient à
l’espèce comme le musc au chevrotin qui le produit…».17
Nous sommes bien ici au niveau du Symbolique de l’abjection et non
pas d’un simple constat anthropologique. Susan Sontag nous dit quel
est le sens de cette répulsion olfactive : «Le
contact avec une personne atteinte d’une maladie mystérieuse
s’apparente obligatoirement à une transgression : pire, à la
violation d’un tabou. Le nom même de ces affections semble doté
d’un pouvoir magique.
[…] elle
est ressentie comme obscène au sens original du terme, c’est-à-dire
de mauvais augure, abominable, répugnante, offensante pour les
sens».18
Et en ce siècle où la médecine et la hantise des maladies dominent
tous et chacun, l’odeur blessante devient l’indice de la présence
des corps invisibles à l’œil nu mais qui propagent les fléaux
qui, depuis  toujours, dispersent les populations. Les maladies
vénériennes sont moralement toujours les plus stigmatisées et
désignent des êtres vicieux avec lesquels vaut mieux se tenir loin.
Comme l’affirme Susan Sontag : «Rien
n’est plus répressif que d’attribuer une signification à une
maladie, cette signification se situant invariablement au plan moral.
Une maladie grave, dont l’origine demeure obscure et qu’aucun
traitement ne réussit à guérir sera, tôt ou tard, totalement
envahie par le sens qu’on lui donnera. Dans un premier temps, les
terreurs les plus profondément enfouies (corruption, pourriture,
pollution, anomie, débilité) sont identifiées à la maladie.
Celle-ci devient alors métaphore. Puis, au nom de cette maladie
(c’est-à-dire en l’utilisant en tant que métaphore), l’horreur
est à son tour greffée sur des éléments étrangers. La maladie
devient adjectif. On l’emploiera comme épithète pour parler de
quelque chose de répugnant ou de laid».19
Comme on l’a vu dans un ouvrage précédant, dès la Révolution
française, la syphilis de Marat suffisait pour en dire le plus de
mal possible. Qu’un Maupassant ou un Nietzsche mourussent de la
syphilis, il y avait de quoi jeter une ombre sur leur personnalité.
Ce que l’on cherche parmi les maladies – et qu’à notre époque
le SIDA ramena dans l’inconscient
toujours, dispersent les populations. Les maladies
vénériennes sont moralement toujours les plus stigmatisées et
désignent des êtres vicieux avec lesquels vaut mieux se tenir loin.
Comme l’affirme Susan Sontag : «Rien
n’est plus répressif que d’attribuer une signification à une
maladie, cette signification se situant invariablement au plan moral.
Une maladie grave, dont l’origine demeure obscure et qu’aucun
traitement ne réussit à guérir sera, tôt ou tard, totalement
envahie par le sens qu’on lui donnera. Dans un premier temps, les
terreurs les plus profondément enfouies (corruption, pourriture,
pollution, anomie, débilité) sont identifiées à la maladie.
Celle-ci devient alors métaphore. Puis, au nom de cette maladie
(c’est-à-dire en l’utilisant en tant que métaphore), l’horreur
est à son tour greffée sur des éléments étrangers. La maladie
devient adjectif. On l’emploiera comme épithète pour parler de
quelque chose de répugnant ou de laid».19
Comme on l’a vu dans un ouvrage précédant, dès la Révolution
française, la syphilis de Marat suffisait pour en dire le plus de
mal possible. Qu’un Maupassant ou un Nietzsche mourussent de la
syphilis, il y avait de quoi jeter une ombre sur leur personnalité.
Ce que l’on cherche parmi les maladies – et qu’à notre époque
le SIDA ramena dans l’inconscient  et la morale -, c’est la
spécificité abjecte des porteurs et le danger de contamination
qu’ils font peser sur l'ensemble de la société : «Nous
sommes en quête de métaphores capables d’embrasser le mal
“extrême” ou “absolu”. Mais les métaphores modernes de la
maladie sont toutes minables. Les individus réellement atteints de
la maladie en question ne sont guère aidés lorsqu’ils entendent
constamment citer le nom de celle-ci pour représenter le mal. Ce
n’est que dans son acception la plus restreinte qu’un événement
ou un problème historiques s’apparentent à une maladie. […]
Elle constitue invariablement une incitation à simplifier ce qui est
complexe, elle est un appel à la complaisance morale, quand ce n’est
pas au fanatisme».20
Les totalitarismes participaient de plain pied dans l’usage de la
maladie comme métaphore morale ou symbolique de la sous-humanité :
«Les
mouvements totalitaires modernes, de droite comme de gauche, ont
montré un goût particulier - et révélateur - pour les images
pathologiques. Pour les nazis, l’individu dont les origines
raciales étaient mélangées ressemblait à un syphilitique. Les
Juifs d’Europe étaient régulièrement comparés à la syphilis ou
à un cancer excisé. Les métaphores pathologiques parsemaient les
controverses bolcheviques, et Trotsky, le plus doué de tous les
polémistes communistes, en faisait plus qu’amplement usage, -
surtout après qu’il eut été banni d’Union soviétique en
1929».21
Le paradoxe résidait dans le fait, toutefois, que la syphilis
n’était pas la pathologie la plus menaçante, tant pour son taux
de mortalité que pour la rapidité de sa diffusion. Le fléau du
temps, c’était la tuberculose
dont la propagation frappait indistinctement les individus sans égard
pour l’âge, le sexe, le milieu ou la nationalité.
et la morale -, c’est la
spécificité abjecte des porteurs et le danger de contamination
qu’ils font peser sur l'ensemble de la société : «Nous
sommes en quête de métaphores capables d’embrasser le mal
“extrême” ou “absolu”. Mais les métaphores modernes de la
maladie sont toutes minables. Les individus réellement atteints de
la maladie en question ne sont guère aidés lorsqu’ils entendent
constamment citer le nom de celle-ci pour représenter le mal. Ce
n’est que dans son acception la plus restreinte qu’un événement
ou un problème historiques s’apparentent à une maladie. […]
Elle constitue invariablement une incitation à simplifier ce qui est
complexe, elle est un appel à la complaisance morale, quand ce n’est
pas au fanatisme».20
Les totalitarismes participaient de plain pied dans l’usage de la
maladie comme métaphore morale ou symbolique de la sous-humanité :
«Les
mouvements totalitaires modernes, de droite comme de gauche, ont
montré un goût particulier - et révélateur - pour les images
pathologiques. Pour les nazis, l’individu dont les origines
raciales étaient mélangées ressemblait à un syphilitique. Les
Juifs d’Europe étaient régulièrement comparés à la syphilis ou
à un cancer excisé. Les métaphores pathologiques parsemaient les
controverses bolcheviques, et Trotsky, le plus doué de tous les
polémistes communistes, en faisait plus qu’amplement usage, -
surtout après qu’il eut été banni d’Union soviétique en
1929».21
Le paradoxe résidait dans le fait, toutefois, que la syphilis
n’était pas la pathologie la plus menaçante, tant pour son taux
de mortalité que pour la rapidité de sa diffusion. Le fléau du
temps, c’était la tuberculose
dont la propagation frappait indistinctement les individus sans égard
pour l’âge, le sexe, le milieu ou la nationalité. personnages des tuberculeux
«inscrivent
dans les esprits la peur de la maladie, au même titre que les autres
la peur du crime».22
La Duplessis, la dame aux camélias de Dumas fils en meure, signe de son métier obscène. La tuberculose (ou phthisis) devient une
hantise et dès que les premiers symptômes apparaissent, le déni
est de rigueur : «Tandis
que jusqu’à la fin du XIXe siècle, la pression sociale, et plus
précisément familiale, jouait dans le sens d’une simple négation
de la maladie, on mourrait de la tuberculose, mais sans le dire, dans
les décennies suivantes, la société globale isole le malade, ce
qui est aussi un moyen, pour les familles, de cacher, autant que
faire se peut, la maladie. Les vieilles préoccupations
“dynastiques”, le souci de ne pas voir sa famille compromise, et
son nom souillé par le bacille, persistaient donc sous les mesures
d’hygiène publique».23
La tuberculose était vue comme signe une fatalité. Elle frappait
tout aussi bien les enfants et les jeunes filles sages qui semblaient
payer pour les fautes de leurs parents. On cherchait les fameux
miasmes
sensés
se dégager des usines, des
personnages des tuberculeux
«inscrivent
dans les esprits la peur de la maladie, au même titre que les autres
la peur du crime».22
La Duplessis, la dame aux camélias de Dumas fils en meure, signe de son métier obscène. La tuberculose (ou phthisis) devient une
hantise et dès que les premiers symptômes apparaissent, le déni
est de rigueur : «Tandis
que jusqu’à la fin du XIXe siècle, la pression sociale, et plus
précisément familiale, jouait dans le sens d’une simple négation
de la maladie, on mourrait de la tuberculose, mais sans le dire, dans
les décennies suivantes, la société globale isole le malade, ce
qui est aussi un moyen, pour les familles, de cacher, autant que
faire se peut, la maladie. Les vieilles préoccupations
“dynastiques”, le souci de ne pas voir sa famille compromise, et
son nom souillé par le bacille, persistaient donc sous les mesures
d’hygiène publique».23
La tuberculose était vue comme signe une fatalité. Elle frappait
tout aussi bien les enfants et les jeunes filles sages qui semblaient
payer pour les fautes de leurs parents. On cherchait les fameux
miasmes
sensés
se dégager des usines, des  égouts et des lieux mal famés. La
contagion pouvait même donner l’impression d’une véritable
épidémie comparable à la peste, au choléra ou au typhus, encore
bien virulents. «Jusqu’à
la Première Guerre mondiale, le tuberculeux était un condamné; il
est ensuite un survivant, dans un univers qui lui est propre. Sa vie
est scandée par les trois épisodes de l’exclusion, de
l’isolement, et d’une réinsertion qui ne lui rend jamais, ou,
dans le meilleur des cas, jamais tout à fait, la place qui était
auparavant la sienne. Le tuberculeux est atteint dans sa vie publique
comme dans sa vie privée, dans ses affections familiales comme dans
ses activités professionnelles. Il survit, certes, bien souvent,
mais comme un être à part. Il est incapable d’assumer certains
risques, de faire des efforts qui, pour les bien-portants, sont les
plus
égouts et des lieux mal famés. La
contagion pouvait même donner l’impression d’une véritable
épidémie comparable à la peste, au choléra ou au typhus, encore
bien virulents. «Jusqu’à
la Première Guerre mondiale, le tuberculeux était un condamné; il
est ensuite un survivant, dans un univers qui lui est propre. Sa vie
est scandée par les trois épisodes de l’exclusion, de
l’isolement, et d’une réinsertion qui ne lui rend jamais, ou,
dans le meilleur des cas, jamais tout à fait, la place qui était
auparavant la sienne. Le tuberculeux est atteint dans sa vie publique
comme dans sa vie privée, dans ses affections familiales comme dans
ses activités professionnelles. Il survit, certes, bien souvent,
mais comme un être à part. Il est incapable d’assumer certains
risques, de faire des efforts qui, pour les bien-portants, sont les
plus  banaux, et il est, également, marginalisé par l’attitude des
autres, largement dictée par le discours des hygiénistes, tel qu’il
a été formulé à l’aube du XXe siècle. Alors même que les
soins désormais efficaces dont il bénéficie permettraient souvent
au tuberculeux stabilisé de réintégrer son milieu, il en reste
écarté par le souvenir de ce qu’était le destin du condamné,
dangereux pour son entourage, des toutes premières décennies du
siècle. L’écart va croissant entre la réalité de la maladie, et
l’image qui persiste, et le malade, ou l’ex-malade le ressent de
plus en plus comme une injustice contre laquelle il s’insurge».24
Bref, le tuberculeux était traité pire qu’un paria qui, au moins,
pouvait conserver sa liberté de mouvement. L’exclusion frappait le
tuberculeux dès le diagnostic de la maladie et, par le fait même,
le retirait de la vie sociale et familiale avec toutes les
conséquences que cela entraînait : «L’exclusion
de la vie professionnelle est la forme de rejet la plus visible, et
la seule qui ait été codifiée. Dans les professions où le malade
a un rapport avec le public, la
banaux, et il est, également, marginalisé par l’attitude des
autres, largement dictée par le discours des hygiénistes, tel qu’il
a été formulé à l’aube du XXe siècle. Alors même que les
soins désormais efficaces dont il bénéficie permettraient souvent
au tuberculeux stabilisé de réintégrer son milieu, il en reste
écarté par le souvenir de ce qu’était le destin du condamné,
dangereux pour son entourage, des toutes premières décennies du
siècle. L’écart va croissant entre la réalité de la maladie, et
l’image qui persiste, et le malade, ou l’ex-malade le ressent de
plus en plus comme une injustice contre laquelle il s’insurge».24
Bref, le tuberculeux était traité pire qu’un paria qui, au moins,
pouvait conserver sa liberté de mouvement. L’exclusion frappait le
tuberculeux dès le diagnostic de la maladie et, par le fait même,
le retirait de la vie sociale et familiale avec toutes les
conséquences que cela entraînait : «L’exclusion
de la vie professionnelle est la forme de rejet la plus visible, et
la seule qui ait été codifiée. Dans les professions où le malade
a un rapport avec le public, la  pression répulsive de l’opinion
est particulièrement forte, et elle vise spécialement
l’instituteur, perçu comme un danger pour les enfants. En 1932,
Marcel Ribes décrit en ces termes le climat dans lequel doivent se
débattre le malade et les siens : “Alerte! notre institutrice
vient de se marier, son époux sort d’un sanatorium, il est encore
en congé. Qu’on les chasse tous les deux! l’entrée de leur
logement est la même que celle de l’école. Le crime devient
légalité et les deux coupables devront gîter et travailler
ailleurs. Si
pression répulsive de l’opinion
est particulièrement forte, et elle vise spécialement
l’instituteur, perçu comme un danger pour les enfants. En 1932,
Marcel Ribes décrit en ces termes le climat dans lequel doivent se
débattre le malade et les siens : “Alerte! notre institutrice
vient de se marier, son époux sort d’un sanatorium, il est encore
en congé. Qu’on les chasse tous les deux! l’entrée de leur
logement est la même que celle de l’école. Le crime devient
légalité et les deux coupables devront gîter et travailler
ailleurs. Si  l’administration fait mine de défendre ses
collaborateurs, alors on emploie les grands moyens : plus d’élèves
en classe, les enfants font grève. On refuse le lait et le pain aux
deux malheureux, fait, hélas, rigoureusement exact, et qui s’est
produit plus d’une fois. La calomnie s’en mêle, on trouve dans
la boîte aux lettres des écrits injurieux ou sournoisement
méprisants, le trait toujours rédigé avec une méchanceté qui
peut être inconsciente mais qui, comme on le pense, retentit
douloureusement dans des cœurs déjà tant éprouvés”».25
À la peine physique s’ajoute le rejet moral et social :
«Fauché en plein élan, le tuberculeux à qui l’on venait d’annoncer sa
maladie se sentait trahi par le destin, abandonné, misérable. Il
savait qu’il ne pourrait plus jamais être le même. En l’espace
de quelques secondes, il était passé du statut de bien-portant à
celui de mort-vivant. Le passage était brutal.
[…] Il
trouvait injustifiée la crainte du public à son égard alors que
des tuberculeux notoires, mais non avoués, continuaient à jouir
d’une relative immunité. Le malade responsable était celui qui
acceptait de se soigner. Face à l’intolérance générale, il se
sentait la victime d’une grande injustice…».26
La loi apprit vite à sévir contre ces infortunés.
l’administration fait mine de défendre ses
collaborateurs, alors on emploie les grands moyens : plus d’élèves
en classe, les enfants font grève. On refuse le lait et le pain aux
deux malheureux, fait, hélas, rigoureusement exact, et qui s’est
produit plus d’une fois. La calomnie s’en mêle, on trouve dans
la boîte aux lettres des écrits injurieux ou sournoisement
méprisants, le trait toujours rédigé avec une méchanceté qui
peut être inconsciente mais qui, comme on le pense, retentit
douloureusement dans des cœurs déjà tant éprouvés”».25
À la peine physique s’ajoute le rejet moral et social :
«Fauché en plein élan, le tuberculeux à qui l’on venait d’annoncer sa
maladie se sentait trahi par le destin, abandonné, misérable. Il
savait qu’il ne pourrait plus jamais être le même. En l’espace
de quelques secondes, il était passé du statut de bien-portant à
celui de mort-vivant. Le passage était brutal.
[…] Il
trouvait injustifiée la crainte du public à son égard alors que
des tuberculeux notoires, mais non avoués, continuaient à jouir
d’une relative immunité. Le malade responsable était celui qui
acceptait de se soigner. Face à l’intolérance générale, il se
sentait la victime d’une grande injustice…».26
La loi apprit vite à sévir contre ces infortunés. l’intéressé, soit
d’office… C’est cette dernière clause qui est importante, car
elle enlève au malade toute maîtrise de son destin.
[…] L’autre
disposition majeure du texte de 1929 est d’imposer à tout candidat
à un emploi administratif de l’État un examen préalable fait par
un médecin de l’administration. Reconnu malade, il est rejeté.
Cette disposition est d’autant plus importante qu’elle a été
adoptée par les administrations locales et par de nombreuses
entreprises privées».27
La décennie qui va suivre va s’avérer pénible. Le médecin
allemand Koch avait pu identifier la souche de la bactérie,
Mycobacterium
tuberculosis, aussi
tôt qu'en 1882,
mais les traitements restaient expérimentaux et peu sûrs. Ce n'est
qu'en 1929 que le médecin britannique, Alexander Fleming, découvrait
la pénicilline. Il faudra attendre encore plus de dix ans avant
qu’on l’utilise efficacement contre le bacille de Koch et qu’on
en confirme la validité des résultats positifs. En attendant,
«c’est
au cours des années trente que le discours médical va se modifier à
nouveau, dès lors que se font entendre non plus des observateurs
plus ou moins distants, mais les tuberculeux eux-mêmes. Il ne s’agit
plus des esprits d’élite qui, au XIXe siècle avaient exprimé
dans leurs écrits des tourments très intellectualisés, mais de
malades auparavant anonymes, qui disent leurs souffrances. Ils
refusent la culpabilisation, tout comme la vision lénifiante des
compensations. Ils se refusent comme “embrasés”, pour se
proclamer “réprouvés”. Ils avouent, proclament même leur
déchéance physique; ils dénoncent les injustices sociales dont ils
sont les victimes et dont
l’intéressé, soit
d’office… C’est cette dernière clause qui est importante, car
elle enlève au malade toute maîtrise de son destin.
[…] L’autre
disposition majeure du texte de 1929 est d’imposer à tout candidat
à un emploi administratif de l’État un examen préalable fait par
un médecin de l’administration. Reconnu malade, il est rejeté.
Cette disposition est d’autant plus importante qu’elle a été
adoptée par les administrations locales et par de nombreuses
entreprises privées».27
La décennie qui va suivre va s’avérer pénible. Le médecin
allemand Koch avait pu identifier la souche de la bactérie,
Mycobacterium
tuberculosis, aussi
tôt qu'en 1882,
mais les traitements restaient expérimentaux et peu sûrs. Ce n'est
qu'en 1929 que le médecin britannique, Alexander Fleming, découvrait
la pénicilline. Il faudra attendre encore plus de dix ans avant
qu’on l’utilise efficacement contre le bacille de Koch et qu’on
en confirme la validité des résultats positifs. En attendant,
«c’est
au cours des années trente que le discours médical va se modifier à
nouveau, dès lors que se font entendre non plus des observateurs
plus ou moins distants, mais les tuberculeux eux-mêmes. Il ne s’agit
plus des esprits d’élite qui, au XIXe siècle avaient exprimé
dans leurs écrits des tourments très intellectualisés, mais de
malades auparavant anonymes, qui disent leurs souffrances. Ils
refusent la culpabilisation, tout comme la vision lénifiante des
compensations. Ils se refusent comme “embrasés”, pour se
proclamer “réprouvés”. Ils avouent, proclament même leur
déchéance physique; ils dénoncent les injustices sociales dont ils
sont les victimes et dont  l’appareil médical est l’un des
instruments. Cette attitude neuve s’inscrit sur une revendication
nouvelle, non pas de droit à une santé refusée par le destin, mais
de droit aux soins et à la vie dans la dignité, qui est dans la
logique de l’État-Providence qui s’ébauche alors».28
Car quoi faire avec tous ces exclus qui crachaient le sang et des
corpuscules de leurs bronches? Le sanatorium, déjà, à l’image de
la prison, était un camp
de concentration des
exclus de la société dont l’abjection résidait dans leur
condition de malades qui les réduisait à la sous-humanité :
«Dans les
années 1930, le tuberculeux, selon le docteur Dufault, était devenu
pour bien des gens “un pestiféré, qu’il faut fuir à tout prix.
On souhaiterait le reléguer en dehors de la communauté et
l’obliger, comme le lépreux de la Cité d’Aoste, à sonner une
clochette à l’approche des passants”. Cette attitude, “aussi
lâche que stupide”, produisait selon Dufault des résultats
diamétralement opposés à ceux que l’on recherchait puisque le
tuberculeux, en niant sa maladie et en ne se faisant pas soigner,
infectait son entourage et contribuait encore plus à la propagation
de la maladie».29
Si la population générale avait raison de vouloir contenir la
maladie et établir un poste de quarantaine permanent pour ceux qui
risquaient de diffuser la maladie dans leur entourage, l’image
prise par la tuberculose offrait un modèle stéréotypé de la
réponse logique à l’exclusion : le sanatorium comme
métaphore
du camp d'internement.
l’appareil médical est l’un des
instruments. Cette attitude neuve s’inscrit sur une revendication
nouvelle, non pas de droit à une santé refusée par le destin, mais
de droit aux soins et à la vie dans la dignité, qui est dans la
logique de l’État-Providence qui s’ébauche alors».28
Car quoi faire avec tous ces exclus qui crachaient le sang et des
corpuscules de leurs bronches? Le sanatorium, déjà, à l’image de
la prison, était un camp
de concentration des
exclus de la société dont l’abjection résidait dans leur
condition de malades qui les réduisait à la sous-humanité :
«Dans les
années 1930, le tuberculeux, selon le docteur Dufault, était devenu
pour bien des gens “un pestiféré, qu’il faut fuir à tout prix.
On souhaiterait le reléguer en dehors de la communauté et
l’obliger, comme le lépreux de la Cité d’Aoste, à sonner une
clochette à l’approche des passants”. Cette attitude, “aussi
lâche que stupide”, produisait selon Dufault des résultats
diamétralement opposés à ceux que l’on recherchait puisque le
tuberculeux, en niant sa maladie et en ne se faisant pas soigner,
infectait son entourage et contribuait encore plus à la propagation
de la maladie».29
Si la population générale avait raison de vouloir contenir la
maladie et établir un poste de quarantaine permanent pour ceux qui
risquaient de diffuser la maladie dans leur entourage, l’image
prise par la tuberculose offrait un modèle stéréotypé de la
réponse logique à l’exclusion : le sanatorium comme
métaphore
du camp d'internement. normalement en société sans qu’elle puisse craindre
la contagion. La crise, puis la guerre mondiale obligèrent les
gouvernements à desserrer les gonds du sanatorium : «Tout
ce qui tend à briser la rigidité de l’univers sanatorial facilite
une réinsertion dont l’éventualité est de plus en plus
fréquente, d’une part parce que les cas de stabilisation se
multiplient, d’autre part parce qu’ils intéressent une
population comportant de plus en plus de salariés dont l’accès
aux soins s’élargit.
[…] Le
tuberculeux stabilisé doit, pour retrouver […]
du
travail, franchir l’obstacle que dresse devant lui le contrôle
médical instauré par la loi de 1929. Il doit être reconnu comme
non dangereux par le corps médical, mais aussi par son propre milieu
professionnel. Cela ne va pas de soi
[…]. Il
semble que certaines entreprises aient été, dans ce domaine, très
en avance sur l’État. Ainsi aux Chemins de fer de l’Est, dès le
milieu des années trente, les agents peuvent-ils passer, à la
sortie du sanatorium, par le Centre de Récupération Sociale
d’Etrembières. Ensuite, leur service est aménagé par la dispense
du travail de nuit, de l’exposition aux intempéries et des travaux
de force. Il en va de même sur le réseau des Chemins de fer de
l’État. Le service social de Michelin gère également, dès avant
la guerre, des établissements de post-cure. Des œuvres privées
montrent également la voie à l’administration.
[Évoquons] l’action
de Suzanne Fouché, qui avait créé, en 1929, la Ligue pour
l’Adaptation au Travail des Diminués Physiques.
[…] Son
association pour la Réadaptation et le Reclassement Professionnel
normalement en société sans qu’elle puisse craindre
la contagion. La crise, puis la guerre mondiale obligèrent les
gouvernements à desserrer les gonds du sanatorium : «Tout
ce qui tend à briser la rigidité de l’univers sanatorial facilite
une réinsertion dont l’éventualité est de plus en plus
fréquente, d’une part parce que les cas de stabilisation se
multiplient, d’autre part parce qu’ils intéressent une
population comportant de plus en plus de salariés dont l’accès
aux soins s’élargit.
[…] Le
tuberculeux stabilisé doit, pour retrouver […]
du
travail, franchir l’obstacle que dresse devant lui le contrôle
médical instauré par la loi de 1929. Il doit être reconnu comme
non dangereux par le corps médical, mais aussi par son propre milieu
professionnel. Cela ne va pas de soi
[…]. Il
semble que certaines entreprises aient été, dans ce domaine, très
en avance sur l’État. Ainsi aux Chemins de fer de l’Est, dès le
milieu des années trente, les agents peuvent-ils passer, à la
sortie du sanatorium, par le Centre de Récupération Sociale
d’Etrembières. Ensuite, leur service est aménagé par la dispense
du travail de nuit, de l’exposition aux intempéries et des travaux
de force. Il en va de même sur le réseau des Chemins de fer de
l’État. Le service social de Michelin gère également, dès avant
la guerre, des établissements de post-cure. Des œuvres privées
montrent également la voie à l’administration.
[Évoquons] l’action
de Suzanne Fouché, qui avait créé, en 1929, la Ligue pour
l’Adaptation au Travail des Diminués Physiques.
[…] Son
association pour la Réadaptation et le Reclassement Professionnel
 signe, en 1941, une convention avec le Commissariat de lutte contre
le chômage, qui s’engage à payer les heures de travail que ne
peuvent faire les tuberculeux».30
Car le tuberculeux était aussi un homme ou une femme qui avait une
famille à charge; et pour certains, ce retour apparaissait comme
risqué : «Le
retour à la vie professionnelle rencontre souvent une résistance du
milieu qui rend d’autant plus nécessaires les emplois réservés,
malgré leur ambiguïté : ils contribuent, certes, à isoler
l’ancien malade mais, du même coup, ils le mettent à l’abri de
bien des agressions dont l’histoire des instituteurs offrent des
exemples caractéristiques.
[…] Cette
résistance est extrêmement tenace.
[…] Ce
que livrent les documents sur les ouvriers de la grande industrie et
sur les fonctionnaires, laisse dans l’ombre les difficultés de
tous les travailleurs indépendants ou de ceux des petites
entreprises. Rien n’était prévu pour leur réinsertion et rien ne
pouvait les protéger de l’hostilité du milieu. […]
lorsqu’ils
étaient incapables d’exercer leur ancien métier, la formation
qu’on leur donnait les aiguillait souvent vers des activités sans
débouché. C’est donc sans doute dans ce vaste monde de
l’artisanat et du petit commerce que les difficultés ont été les
plus grandes».31
Les tuberculeux enseignaient, à leurs dépens, qu’une fois exclus
de la société, il devenait difficile d’y retourner. Même dans le
contexte d’après-guerre, une fois que les vaccins seront venus à
bout du mal, il faudra en appeler au processus législatif pour
normaliser le retour
signe, en 1941, une convention avec le Commissariat de lutte contre
le chômage, qui s’engage à payer les heures de travail que ne
peuvent faire les tuberculeux».30
Car le tuberculeux était aussi un homme ou une femme qui avait une
famille à charge; et pour certains, ce retour apparaissait comme
risqué : «Le
retour à la vie professionnelle rencontre souvent une résistance du
milieu qui rend d’autant plus nécessaires les emplois réservés,
malgré leur ambiguïté : ils contribuent, certes, à isoler
l’ancien malade mais, du même coup, ils le mettent à l’abri de
bien des agressions dont l’histoire des instituteurs offrent des
exemples caractéristiques.
[…] Cette
résistance est extrêmement tenace.
[…] Ce
que livrent les documents sur les ouvriers de la grande industrie et
sur les fonctionnaires, laisse dans l’ombre les difficultés de
tous les travailleurs indépendants ou de ceux des petites
entreprises. Rien n’était prévu pour leur réinsertion et rien ne
pouvait les protéger de l’hostilité du milieu. […]
lorsqu’ils
étaient incapables d’exercer leur ancien métier, la formation
qu’on leur donnait les aiguillait souvent vers des activités sans
débouché. C’est donc sans doute dans ce vaste monde de
l’artisanat et du petit commerce que les difficultés ont été les
plus grandes».31
Les tuberculeux enseignaient, à leurs dépens, qu’une fois exclus
de la société, il devenait difficile d’y retourner. Même dans le
contexte d’après-guerre, une fois que les vaccins seront venus à
bout du mal, il faudra en appeler au processus législatif pour
normaliser le retour  des tuberculeux à la vie sociale : «La
loi Cordonnier, du 2 août 1949, [visait]
à la rééducation professionnelle des grands infirmes et
incurables. Pour rationaliser des initiatives prises concurremment
dans divers ministères, avait été créée, dès mai 1948, une
commission Interministérielle pour la réadaptation professionnelle
des mutilés, invalides et diminués physiques. Ainsi s’amorce une
politique dont bénéficieront les tuberculeux et ensuite les
handicapés et qui a pour point de départ les problèmes posés par
les anciens combattants et victimes de guerre. Ce processus rappelle
celui qui s’est amorcé pendant la Première Guerre mondiale quand
s’est posé le problème des “blessés du poumon”».32
Bien d’autres exclus de la même période, pour d’autres
raisons, ne bénéficieront pas des mêmes opportunités.
des tuberculeux à la vie sociale : «La
loi Cordonnier, du 2 août 1949, [visait]
à la rééducation professionnelle des grands infirmes et
incurables. Pour rationaliser des initiatives prises concurremment
dans divers ministères, avait été créée, dès mai 1948, une
commission Interministérielle pour la réadaptation professionnelle
des mutilés, invalides et diminués physiques. Ainsi s’amorce une
politique dont bénéficieront les tuberculeux et ensuite les
handicapés et qui a pour point de départ les problèmes posés par
les anciens combattants et victimes de guerre. Ce processus rappelle
celui qui s’est amorcé pendant la Première Guerre mondiale quand
s’est posé le problème des “blessés du poumon”».32
Bien d’autres exclus de la même période, pour d’autres
raisons, ne bénéficieront pas des mêmes opportunités. Les
contagieux bénéficiaient pourtant de plus de chances que bien des
membres de cette nébuleuse d’exclus qu’on appelait les parias.
Certes,
on l’a vu avec Hannah Arendt, les Juifs furent sans doute les
parias les plus connus de l’Occident au cours des siècles, et
encore plus peut-être depuis le XIXe siècle où on leurs attribuait
la responsabilité aussi bien du capitalisme que du communisme.
Hommes d’argent ou meneurs de foules sanguinaires et destructrices,
ils rassemblaient autour d’eux une véritable cour
des miracles :
«Le
stéréotype s’est très vite trouvé retourné en “contretype”
à valeur négative : le “paria”. Il fut renforcé par
l’existence de modèles négatifs qui, non seulement ne pouvaient
atteindre la masculinité idéale, mais en étaient le repoussoir,
dans leur âme et leur corps. Les groupes écartés par la société,
les Juifs ou les Noirs, par exemple, remplirent ce rôle. On leur
attribua des traits qui montraient sans ambiguïté, à ceux qui
avaient des yeux pour voir, le mal qu’ils portaient en eux. Leur
corps malformé était le signe de leur dégénérescence».33
Cette cour
des miracles
tendit à s’élargir au fur et à mesure que le siècle
progressait : «Ces
contretypes étaient représentés par les traditionnels “parias”.
Juifs ou Gitans (il y eut longtemps très peu de Noirs en Europe),
par tous ceux qui avaient rejeté les normes sociales ou ne leur
correspondaient pas, tels les
Les
contagieux bénéficiaient pourtant de plus de chances que bien des
membres de cette nébuleuse d’exclus qu’on appelait les parias.
Certes,
on l’a vu avec Hannah Arendt, les Juifs furent sans doute les
parias les plus connus de l’Occident au cours des siècles, et
encore plus peut-être depuis le XIXe siècle où on leurs attribuait
la responsabilité aussi bien du capitalisme que du communisme.
Hommes d’argent ou meneurs de foules sanguinaires et destructrices,
ils rassemblaient autour d’eux une véritable cour
des miracles :
«Le
stéréotype s’est très vite trouvé retourné en “contretype”
à valeur négative : le “paria”. Il fut renforcé par
l’existence de modèles négatifs qui, non seulement ne pouvaient
atteindre la masculinité idéale, mais en étaient le repoussoir,
dans leur âme et leur corps. Les groupes écartés par la société,
les Juifs ou les Noirs, par exemple, remplirent ce rôle. On leur
attribua des traits qui montraient sans ambiguïté, à ceux qui
avaient des yeux pour voir, le mal qu’ils portaient en eux. Leur
corps malformé était le signe de leur dégénérescence».33
Cette cour
des miracles
tendit à s’élargir au fur et à mesure que le siècle
progressait : «Ces
contretypes étaient représentés par les traditionnels “parias”.
Juifs ou Gitans (il y eut longtemps très peu de Noirs en Europe),
par tous ceux qui avaient rejeté les normes sociales ou ne leur
correspondaient pas, tels les  vagabonds, les fous et les criminels,
et bien sûr par les hommes “qui n’étaient pas des hommes” et
les femmes “qui n’étaient pas des femmes”. Vers la fin du XIXe
siècle, les homosexuels, pédérastes et lesbiennes, osèrent se
montrer davantage et quelques-uns commencèrent à afficher leurs
différences. Tous les exclus…, étaient stéréotypés à peu près
de la même manière, puisqu’ils avaient en commun de s’opposer à
l’idéal viril.
[…]
certains parias se sont efforcés de devenir de “vrais hommes”,
[tandis] que
d’autres ont fini par fonder leur mouvement de libération pour
échapper à une symbolique qu’ils tournaient en dérision. La
virilité moderne avait besoin de ses contretypes, mais, en retour,
ceux qui se voyaient ainsi caractérisés ont tenté, soit d’imiter
le type dominant soit de se définir en opposition à lui. Nul n’a
complètement échappé à son emprise».34
Pour G. L. Mosse encore, «le
stéréotype du Juif n’est pas unique. C’est le même que le
stéréotype de tous les outsiders : déviants sexuels, Tziganes,
malades mentaux, personnes souffrant de maladies héréditaires. Tous
se ressemblent. Ils sont exactement
vagabonds, les fous et les criminels,
et bien sûr par les hommes “qui n’étaient pas des hommes” et
les femmes “qui n’étaient pas des femmes”. Vers la fin du XIXe
siècle, les homosexuels, pédérastes et lesbiennes, osèrent se
montrer davantage et quelques-uns commencèrent à afficher leurs
différences. Tous les exclus…, étaient stéréotypés à peu près
de la même manière, puisqu’ils avaient en commun de s’opposer à
l’idéal viril.
[…]
certains parias se sont efforcés de devenir de “vrais hommes”,
[tandis] que
d’autres ont fini par fonder leur mouvement de libération pour
échapper à une symbolique qu’ils tournaient en dérision. La
virilité moderne avait besoin de ses contretypes, mais, en retour,
ceux qui se voyaient ainsi caractérisés ont tenté, soit d’imiter
le type dominant soit de se définir en opposition à lui. Nul n’a
complètement échappé à son emprise».34
Pour G. L. Mosse encore, «le
stéréotype du Juif n’est pas unique. C’est le même que le
stéréotype de tous les outsiders : déviants sexuels, Tziganes,
malades mentaux, personnes souffrant de maladies héréditaires. Tous
se ressemblent. Ils sont exactement  identiques. Et tous font partie
de ceux qu’Hitler voulait exterminer et qu’il a exterminés. Tous
sont à l’opposé de la classe moyenne, de l’idée de beauté
mêlée de contrôle de soi, d’énergie, de toutes ces sortes de
choses».35
Pour la bourgeoisie occidentale, les parias étaient de la graine de
criminels, c’est-à-dire des gens qui refusaient de se soumettre
aux lois du marché et, par le fait même, aux lois civiles. Ces
criminels, d’une manière ou d’une autre, appartenaient, là
encore, au monde des malades : «On
trouve dans Erewhon
de Samuel Butler (1872) un premier aperçu de cette attitude,
aujourd’hui très controversée. Butler montrait que la criminalité
est une maladie au même titre que la tuberculose, soit héréditaire,
soit le résultat d’un milieu malsain, cela afin de souligner
l’absurdité qu’il y avait à condamner des malades. Dans
Erewhon,
ceux qui assassinent ou volent sont traités avec la compréhension
réservée aux malades, tandis que la tuberculose est punie comme
crime».36
Nous sommes ici en plein oxymoron baroque : un criminel doit
être traité comme un malade, donc un malade peut
être traité comme un criminel. Dans une lettre adressée à Lou
Andréas-Salomé, le 13 mai 1924, Sigmund Freud pourra ironiser :
identiques. Et tous font partie
de ceux qu’Hitler voulait exterminer et qu’il a exterminés. Tous
sont à l’opposé de la classe moyenne, de l’idée de beauté
mêlée de contrôle de soi, d’énergie, de toutes ces sortes de
choses».35
Pour la bourgeoisie occidentale, les parias étaient de la graine de
criminels, c’est-à-dire des gens qui refusaient de se soumettre
aux lois du marché et, par le fait même, aux lois civiles. Ces
criminels, d’une manière ou d’une autre, appartenaient, là
encore, au monde des malades : «On
trouve dans Erewhon
de Samuel Butler (1872) un premier aperçu de cette attitude,
aujourd’hui très controversée. Butler montrait que la criminalité
est une maladie au même titre que la tuberculose, soit héréditaire,
soit le résultat d’un milieu malsain, cela afin de souligner
l’absurdité qu’il y avait à condamner des malades. Dans
Erewhon,
ceux qui assassinent ou volent sont traités avec la compréhension
réservée aux malades, tandis que la tuberculose est punie comme
crime».36
Nous sommes ici en plein oxymoron baroque : un criminel doit
être traité comme un malade, donc un malade peut
être traité comme un criminel. Dans une lettre adressée à Lou
Andréas-Salomé, le 13 mai 1924, Sigmund Freud pourra ironiser :
 «Voilà
une personne qui, au lieu de travailler convenablement jusque dans
une vieillesse avancée
[…] et
ensuite de mourir tranquillement sans préliminaires, attrape durant
son âge mûr une affreuse maladie, doit être soignée et opérée,
gaspille le peu d’argent qu’elle a péniblement gagné, éprouve
du mécontentement, en distribue et, par-dessus le marché, traîne
encore pour un temps indéterminé sous l’aspect d’un invalide -
dans Erewhon,
j’espère que vous connaissez cette brillante fantaisie de Samuel
Butler, un tel individu eût été sans aucun doute puni et
enfermé…».37
En effet, que d’ironies et de paradoxes dans la condition réservée
par la société à ses parias. Pourtant, ceux-ci tendaient de plus
en plus à ébranler leurs conditions de parias et à réclamer
justice et égalité sociale. Les années
folles furent
l’occasion de voir les Juifs affirmer leur judaïté à travers le
mouvement sioniste; les femmes réclamer leur émancipation et leur
droit au travail salarié; les handicapés, en commençant par les
handicapés de guerre, ne voulant plus être abandonnés à leur
triste sort ou parqués dans des établissements miséreux
réclamaient d'honorables pensions; les homosexuels mâles et les
garçonnes s’affichaient ouvertement, scandalisant la bonne société
des grandes capitales européennes : Londres, Paris, Berlin et
même Vienne. En Amérique, Chaplin, grâce au cinéma, offrait à la
fois une étude quasi anthropologique mais aussi une «voix» au
paria avec son personnage de Charlot.
«Voilà
une personne qui, au lieu de travailler convenablement jusque dans
une vieillesse avancée
[…] et
ensuite de mourir tranquillement sans préliminaires, attrape durant
son âge mûr une affreuse maladie, doit être soignée et opérée,
gaspille le peu d’argent qu’elle a péniblement gagné, éprouve
du mécontentement, en distribue et, par-dessus le marché, traîne
encore pour un temps indéterminé sous l’aspect d’un invalide -
dans Erewhon,
j’espère que vous connaissez cette brillante fantaisie de Samuel
Butler, un tel individu eût été sans aucun doute puni et
enfermé…».37
En effet, que d’ironies et de paradoxes dans la condition réservée
par la société à ses parias. Pourtant, ceux-ci tendaient de plus
en plus à ébranler leurs conditions de parias et à réclamer
justice et égalité sociale. Les années
folles furent
l’occasion de voir les Juifs affirmer leur judaïté à travers le
mouvement sioniste; les femmes réclamer leur émancipation et leur
droit au travail salarié; les handicapés, en commençant par les
handicapés de guerre, ne voulant plus être abandonnés à leur
triste sort ou parqués dans des établissements miséreux
réclamaient d'honorables pensions; les homosexuels mâles et les
garçonnes s’affichaient ouvertement, scandalisant la bonne société
des grandes capitales européennes : Londres, Paris, Berlin et
même Vienne. En Amérique, Chaplin, grâce au cinéma, offrait à la
fois une étude quasi anthropologique mais aussi une «voix» au
paria avec son personnage de Charlot. autour du stéréotype juif :
«Tout,
dans le stéréotype du Juif, véhiculait l’image d’un parasite.
En termes darwiniens, les Juifs représentaient un arrêt de
croissance dans le cours de l’évolution, un fossile auquel
manquaient la force et les racines pour se nourrir. Le stéréotype
racial prêtait au Juif tant de caractéristiques grotesques qu’il
en était fondamentalement déshumanisé. L’œuvre de Fritsch
montre à nouveau cette évolution menaçante car, dans son
Leuchtugeln
(“Boules de feu”) de 1881, il déniait expressément toute
humanité aux Juifs. Il affirmait que Dieu avait créé le Juif comme
un intermédiaire entre l’homme et le singe. Les nazis assimilèrent
cette réflexion dans leur propre propagande lorsque, en 1931, un de
leurs orateurs affirma que l’homme non nordique occupait une
position intermédiaire entre l’homme nordique et le monde animal.
Le non-Nordique n’était pas un homme complet, car il partageait
encore certains traits avec les singes».38
Aussi, c’est en faisant des singeries
que
Charlot dévoile le plus ses antécédents génétiques : «Bien
entendu, il se venge sur les plus faibles que lui des déboires subis
auprès des forts : c’est là un aspect important de sa
personnalité […];
“ce serait une erreur de croire Charlot foncièrement bon”, dit
André Bazin avec raison. Cette résignation, ces petites lâchetés,
n’empêchent pas sa dignité naturelle de se manifester : ainsi
refuse-t-il noblement la nourriture que lui offrent ses camarades qui
viennent de recevoir des colis (Charlot soldat).
autour du stéréotype juif :
«Tout,
dans le stéréotype du Juif, véhiculait l’image d’un parasite.
En termes darwiniens, les Juifs représentaient un arrêt de
croissance dans le cours de l’évolution, un fossile auquel
manquaient la force et les racines pour se nourrir. Le stéréotype
racial prêtait au Juif tant de caractéristiques grotesques qu’il
en était fondamentalement déshumanisé. L’œuvre de Fritsch
montre à nouveau cette évolution menaçante car, dans son
Leuchtugeln
(“Boules de feu”) de 1881, il déniait expressément toute
humanité aux Juifs. Il affirmait que Dieu avait créé le Juif comme
un intermédiaire entre l’homme et le singe. Les nazis assimilèrent
cette réflexion dans leur propre propagande lorsque, en 1931, un de
leurs orateurs affirma que l’homme non nordique occupait une
position intermédiaire entre l’homme nordique et le monde animal.
Le non-Nordique n’était pas un homme complet, car il partageait
encore certains traits avec les singes».38
Aussi, c’est en faisant des singeries
que
Charlot dévoile le plus ses antécédents génétiques : «Bien
entendu, il se venge sur les plus faibles que lui des déboires subis
auprès des forts : c’est là un aspect important de sa
personnalité […];
“ce serait une erreur de croire Charlot foncièrement bon”, dit
André Bazin avec raison. Cette résignation, ces petites lâchetés,
n’empêchent pas sa dignité naturelle de se manifester : ainsi
refuse-t-il noblement la nourriture que lui offrent ses camarades qui
viennent de recevoir des colis (Charlot soldat).  Confronté à
l’hostilité du monde, il la traite, dit Élie Faure, “par
l’ironie ou la négation”. Son ironie vise à neutraliser la
violence : quand il tend ses fesses au coup de pied, il désarme
l’ennemi en lui faisant prendre conscience que sa force va
s’exercer sur un faible et peut-être sur un innocent; l’autre
démarche, la négation pure et simple, est plus risquée et plus
étonnante : découvert par un flic au moment où il sort de terre
après son évasion, il lui recouvre les pieds de sable comme pour le
faire disparaître symboliquement
(Charlot s’évade).
Ou bien, si la réalité est trop dure, il s’en évade par le rêve,
dans ces admirables séquences oniriques qui parsèment son œuvre (À
la banque, Soldat, Idylle aux champs, Le Kid, La Ruée vers l’or,
Les Temps modernes) :
et l’on notera que ce n’est jamais qu’en rêve qu’il est
habile, heureux et héroïque».39
Enfin, Chaplin se sentait à l’aise dans le cinéma muet au point
de retarder le plus longtemps possibles son premier talkie.
(Il
refusa de faire du parlant avec Modern
Times, et
depuis, on le sentira mal à l’aise dans ses autres films dès lors
qu’il s’agira de parler. Il confirmait ainsi le vilain mot de
Richard Wagner pour qui le Juif restait «celui
qui n’a pas de
Confronté à
l’hostilité du monde, il la traite, dit Élie Faure, “par
l’ironie ou la négation”. Son ironie vise à neutraliser la
violence : quand il tend ses fesses au coup de pied, il désarme
l’ennemi en lui faisant prendre conscience que sa force va
s’exercer sur un faible et peut-être sur un innocent; l’autre
démarche, la négation pure et simple, est plus risquée et plus
étonnante : découvert par un flic au moment où il sort de terre
après son évasion, il lui recouvre les pieds de sable comme pour le
faire disparaître symboliquement
(Charlot s’évade).
Ou bien, si la réalité est trop dure, il s’en évade par le rêve,
dans ces admirables séquences oniriques qui parsèment son œuvre (À
la banque, Soldat, Idylle aux champs, Le Kid, La Ruée vers l’or,
Les Temps modernes) :
et l’on notera que ce n’est jamais qu’en rêve qu’il est
habile, heureux et héroïque».39
Enfin, Chaplin se sentait à l’aise dans le cinéma muet au point
de retarder le plus longtemps possibles son premier talkie.
(Il
refusa de faire du parlant avec Modern
Times, et
depuis, on le sentira mal à l’aise dans ses autres films dès lors
qu’il s’agira de parler. Il confirmait ainsi le vilain mot de
Richard Wagner pour qui le Juif restait «celui
qui n’a pas de  langue maternelle».40
Pourtant, jamais n’a-t-on décrit avec autant de violence et de
tendresse la condition du paria dans la société. Les cinéphiles ne
voulaient voir que l’humour grinçant et la critique sociale des
Charlot,
refoulant la portée tragique de ses short
movies aussi
bien que de ses longs-métrages. Avec le dédoublement en
Charlot-Hitler et Charlot-barbier juif dans The
Great Dictator, le
doppelgänger
se
révélait, et
Monsieur
Verdoux exposera
la vérité de Charlot,
la violence et la tendresse dans ce même être qu'on tenait pour le
plus innocent des hommes. On ne lui pardonnera pas cette marche finale qui conduit cet assassin de veuves tout droit vers la
guillotine. Contre cette finale qui insistait sur la révolte du
stéréotype, on préféra se souvenir de films comme Le
gosse :
«Véritable
poème d’amour et de tendresse où les sentiments sont aiguisés,
fortifiés
langue maternelle».40
Pourtant, jamais n’a-t-on décrit avec autant de violence et de
tendresse la condition du paria dans la société. Les cinéphiles ne
voulaient voir que l’humour grinçant et la critique sociale des
Charlot,
refoulant la portée tragique de ses short
movies aussi
bien que de ses longs-métrages. Avec le dédoublement en
Charlot-Hitler et Charlot-barbier juif dans The
Great Dictator, le
doppelgänger
se
révélait, et
Monsieur
Verdoux exposera
la vérité de Charlot,
la violence et la tendresse dans ce même être qu'on tenait pour le
plus innocent des hommes. On ne lui pardonnera pas cette marche finale qui conduit cet assassin de veuves tout droit vers la
guillotine. Contre cette finale qui insistait sur la révolte du
stéréotype, on préféra se souvenir de films comme Le
gosse :
«Véritable
poème d’amour et de tendresse où les sentiments sont aiguisés,
fortifiés  par la misère et le malheur, Le Gosse
laisse voir à quel point cette misère peut donner une sensibilité
d’écorché à ceux qui la subissent. Chez ces êtres traqués et
constamment sur la défensive, les moindres petits drames prennent
aussitôt une allure, un ton de tragédie. De plus en plus, les films
de Chaplin deviennent de véritables tragédies. Le comique n’est
qu’un accident: Il n’est que dans la façon particulière dont
les situations se présentent à nos yeux, dans leur enchaînement
burlesque, dans l’innocence de Charlot. De victime du destin
celui-ci devient victime de la société; de martyrisé, il devient
martyr».41
Quoi qu’il en soit, le Juif apparaissait comme le modèle des
parias, celui dont la contamination entraînait l’Occident vers sa
perte. L’antisémite «Rosenberg
interprète ainsi la caractérisation wagnérienne : “Lorsqu’un
peuple ou plusieurs sont affectés, par une époque de sécheresse de
l’âme, d’une spiritualité stérile, […]
c’est le
Juif qui apparaît en bonne place comme symbole, pour ainsi dire, de
la décadence [Niedergang].
“Dans son Journal, en 1929, Gœbbels note : “Der Jude ist der
plastische Dámon de Verfalls”…».42
Ou, en français : «Le
Juif est le démon plasticien de la décadence».
par la misère et le malheur, Le Gosse
laisse voir à quel point cette misère peut donner une sensibilité
d’écorché à ceux qui la subissent. Chez ces êtres traqués et
constamment sur la défensive, les moindres petits drames prennent
aussitôt une allure, un ton de tragédie. De plus en plus, les films
de Chaplin deviennent de véritables tragédies. Le comique n’est
qu’un accident: Il n’est que dans la façon particulière dont
les situations se présentent à nos yeux, dans leur enchaînement
burlesque, dans l’innocence de Charlot. De victime du destin
celui-ci devient victime de la société; de martyrisé, il devient
martyr».41
Quoi qu’il en soit, le Juif apparaissait comme le modèle des
parias, celui dont la contamination entraînait l’Occident vers sa
perte. L’antisémite «Rosenberg
interprète ainsi la caractérisation wagnérienne : “Lorsqu’un
peuple ou plusieurs sont affectés, par une époque de sécheresse de
l’âme, d’une spiritualité stérile, […]
c’est le
Juif qui apparaît en bonne place comme symbole, pour ainsi dire, de
la décadence [Niedergang].
“Dans son Journal, en 1929, Gœbbels note : “Der Jude ist der
plastische Dámon de Verfalls”…».42
Ou, en français : «Le
Juif est le démon plasticien de la décadence». Le
sommet du paradoxe de l'état de paria fut que la moitié du monde se
trouvait automatiquement en faire partie, puisqu’il s’agissait
des femmes : «…les
femmes sont des sous-hommes et cela au double sens du terme, sans
aucun jeu de mots. Elles sont sous les hommes, c’est-à-dire
qu’elles leur sont perpétuellement subordonnées et que ce faisant
elles sont reléguées, et se reléguant elles-mêmes, tant qu’elles
n’ont pas enclenché un processus de lutte, dans une zone
secondaire, la quasi-humanité».43
Aucune femme n’est exempt de la sous-humanité, pas même la
bourgeoise ou l’aristocrate : «Une
femme, dans le rôle d’épouse, et plus encore dans celui de mère,
est un être “qui ne s’appartient pas”.
[…] “Une
femme peut toujours être heureuse à condition qu’elle ne soit pas
un ‘individu’, mais l’être exquis qui vit en dehors d’elle
et pour les autres” (Yvonne Sarcey)».44
Contrairement aux rôles que leurs écrivaient les dramaturges
baroques (Molière, Marivaux, Goldoni), les auteurs de vaudeville en
faisaient des êtres médiocres, inexistants, gravitant autour du
bourgeois comme des satellites. Elles sont une potiche
exposée
dans un salon pour honorer la décoration lors des soirées
mondaines : «On
aurait tort de considérer les “déshabillages” de Feydeau, ces
hommes en caleçon [long] et bretelles pendantes, ces femmes en
chemise de nuit comme de simples concessions aux exigences
traditionnelles d’un genre. Feydeau reprend à son
Le
sommet du paradoxe de l'état de paria fut que la moitié du monde se
trouvait automatiquement en faire partie, puisqu’il s’agissait
des femmes : «…les
femmes sont des sous-hommes et cela au double sens du terme, sans
aucun jeu de mots. Elles sont sous les hommes, c’est-à-dire
qu’elles leur sont perpétuellement subordonnées et que ce faisant
elles sont reléguées, et se reléguant elles-mêmes, tant qu’elles
n’ont pas enclenché un processus de lutte, dans une zone
secondaire, la quasi-humanité».43
Aucune femme n’est exempt de la sous-humanité, pas même la
bourgeoise ou l’aristocrate : «Une
femme, dans le rôle d’épouse, et plus encore dans celui de mère,
est un être “qui ne s’appartient pas”.
[…] “Une
femme peut toujours être heureuse à condition qu’elle ne soit pas
un ‘individu’, mais l’être exquis qui vit en dehors d’elle
et pour les autres” (Yvonne Sarcey)».44
Contrairement aux rôles que leurs écrivaient les dramaturges
baroques (Molière, Marivaux, Goldoni), les auteurs de vaudeville en
faisaient des êtres médiocres, inexistants, gravitant autour du
bourgeois comme des satellites. Elles sont une potiche
exposée
dans un salon pour honorer la décoration lors des soirées
mondaines : «On
aurait tort de considérer les “déshabillages” de Feydeau, ces
hommes en caleçon [long] et bretelles pendantes, ces femmes en
chemise de nuit comme de simples concessions aux exigences
traditionnelles d’un genre. Feydeau reprend à son  compte les
conventions du vaudeville, mais en les chargeant de son propre sens.
Il est évident par exemple que la situation d’un individu en
caleçon, dans des circonstances qui exigeraient la solennité…,
introduit un puissant sarcasme négateur, une invincible force de
destruction et de dérision dont l’effort de l’homme vers la
dignité sociale, l’attentat profanateur, qui révèlent le “monde
des dessous”, l’Unterwelt, aux yeux horrifiés des fantoches de
la mascarade mondaine».45
Certes, la femme n’atteint pas le degré ultime de l’abjection –
contrairement à ces femelles
de la
Commune de Paris décrites par Dumas fils -, mais elles ne sont pas
loin du statut ontologique
compte les
conventions du vaudeville, mais en les chargeant de son propre sens.
Il est évident par exemple que la situation d’un individu en
caleçon, dans des circonstances qui exigeraient la solennité…,
introduit un puissant sarcasme négateur, une invincible force de
destruction et de dérision dont l’effort de l’homme vers la
dignité sociale, l’attentat profanateur, qui révèlent le “monde
des dessous”, l’Unterwelt, aux yeux horrifiés des fantoches de
la mascarade mondaine».45
Certes, la femme n’atteint pas le degré ultime de l’abjection –
contrairement à ces femelles
de la
Commune de Paris décrites par Dumas fils -, mais elles ne sont pas
loin du statut ontologique  d’Objet : «Qu’elle
ne semble pas gênée par le poids de la réalité, ni impliquée
dans la préparation matérielle du bonheur. Pour n’être pas
gênée, le mieux consiste encore à ne plus se percevoir comme un
individu, à installer les autres en soi, à se réduire au souci
qu’on prend des autres : “Si vous avez toujours en vue le bonheur
des autres, écrit une journaliste de Mon
chez-moi,
vous en arriverez par une sorte d’hypnotisme, en quelque sorte
fatalement, à incarner votre bonheur dans celui d’autrui. Et c’est
là certainement la mission de la femme qui devient un monstre, un
monstre malfaisant, toutes les fois qu’elle substitue à l’amour
dont elle est le plus puissant mandataire ici-bas l’égoïsme et le
culte du Moi, mis à la mode par la furia d’individualisme qui
souffle aujourd’hui
[…]. Une
fois votre vie bien orientée du côté du bonheur d’autrui,
incarnant le vôtre, vous verrez que la bonne humeur est beaucoup
plus aisée qu’elle ne le parait…” (10 février 1909)».46
Les courriers du bonheur et les conseils aux bourgeoises afin de bien
tenir leur maison et figurer aux côtés de leurs époux ne cessent
de répéter qu’elle doivent s’effacer.
Et si elles n’appartiennent pas de plein droit au monde des hommes,
la surhumanité nietzschéenne leur devenait donc encore plus
impossible, sinon interdite.
d’Objet : «Qu’elle
ne semble pas gênée par le poids de la réalité, ni impliquée
dans la préparation matérielle du bonheur. Pour n’être pas
gênée, le mieux consiste encore à ne plus se percevoir comme un
individu, à installer les autres en soi, à se réduire au souci
qu’on prend des autres : “Si vous avez toujours en vue le bonheur
des autres, écrit une journaliste de Mon
chez-moi,
vous en arriverez par une sorte d’hypnotisme, en quelque sorte
fatalement, à incarner votre bonheur dans celui d’autrui. Et c’est
là certainement la mission de la femme qui devient un monstre, un
monstre malfaisant, toutes les fois qu’elle substitue à l’amour
dont elle est le plus puissant mandataire ici-bas l’égoïsme et le
culte du Moi, mis à la mode par la furia d’individualisme qui
souffle aujourd’hui
[…]. Une
fois votre vie bien orientée du côté du bonheur d’autrui,
incarnant le vôtre, vous verrez que la bonne humeur est beaucoup
plus aisée qu’elle ne le parait…” (10 février 1909)».46
Les courriers du bonheur et les conseils aux bourgeoises afin de bien
tenir leur maison et figurer aux côtés de leurs époux ne cessent
de répéter qu’elle doivent s’effacer.
Et si elles n’appartiennent pas de plein droit au monde des hommes,
la surhumanité nietzschéenne leur devenait donc encore plus
impossible, sinon interdite. et d’être humble, - la femme règne si elle
parvient à subjuguer les forts. La femme a toujours conspiré avec
les types de la décadence, avec les prêtres, contre les
“puissants”, les “forts”, les hommes. La femme met à part
les enfants pour le culte de la piété, de la compassion, de
l’amour; -
la mère
représente l’altruisme d’une façon
convaincante
[…]».47
Nietzsche restait «persuadé
de la supérieure perspicacité des femmes, mais leur intelligence
n’est pas créatrice».48
Pour cette raison impérative, il ne pouvait concevoir que la femme
puisse se hisser à la hauteur de la surhumanité, bien qu’elle
puisse échapper à une modernité abrutissante. En étant
qu’instinct, la femme restait trop prêt de l’animalité et, à
la manière de Dumas fils, il pensait qu’elle n’avait que la
forme
humaine :
«Avouons-le,
ce que les hommes aiment chez les femmes, c’est justement ce talent
et cet instinct; nous dont la vie est accablée de soucis, nous
trouvons notre délassement auprès de ces êtres dont les mains, les
regards et les tendres folies font que notre sérieux, notre gravité,
notre profondeur nous
et d’être humble, - la femme règne si elle
parvient à subjuguer les forts. La femme a toujours conspiré avec
les types de la décadence, avec les prêtres, contre les
“puissants”, les “forts”, les hommes. La femme met à part
les enfants pour le culte de la piété, de la compassion, de
l’amour; -
la mère
représente l’altruisme d’une façon
convaincante
[…]».47
Nietzsche restait «persuadé
de la supérieure perspicacité des femmes, mais leur intelligence
n’est pas créatrice».48
Pour cette raison impérative, il ne pouvait concevoir que la femme
puisse se hisser à la hauteur de la surhumanité, bien qu’elle
puisse échapper à une modernité abrutissante. En étant
qu’instinct, la femme restait trop prêt de l’animalité et, à
la manière de Dumas fils, il pensait qu’elle n’avait que la
forme
humaine :
«Avouons-le,
ce que les hommes aiment chez les femmes, c’est justement ce talent
et cet instinct; nous dont la vie est accablée de soucis, nous
trouvons notre délassement auprès de ces êtres dont les mains, les
regards et les tendres folies font que notre sérieux, notre gravité,
notre profondeur nous  apparaissent presque comme autant de folies.
Pour finir, je le demande, une femme a-t-elle jamais reconnu de la
profondeur a une intelligence féminine, de la justice à un cœur
féminin? Et n’est-il pas vrai que, somme toute, “la femme” n’a
jamais été tant méprisée que par les femmes, et non par nous? En
tant qu’hommes, nous souhaitons que la femme cesse de se
compromettre par ses déclarations…».49
Que Nietzsche ait souffert de gynophobia,
c’est
plus que possible. La fameuse photographie qui a tant fait couler
d’encre montrant Lou Andréas-Salomé dans une charrette tirée par
Paul Rhée et Friedrich Nietzsche; de même la fameuse scène fatale
à Turin, montrant un Nietzsche envahi par la folie se précipitant
sur un cocher martelant de sa cravache un cheval tombé par terre,
laisse deviner une identification de l’un à l’autre. Victime de
la syphilis à son dernier stade Nietzsche sombrait dans la démence.
Il n’est pas impossible qu’une haine refoulée des femmes se soit
développée chez lui, le menant à réinvestir dans le surhomme –
le surmâle, disait Jarry -, délivré de sa faiblesse pour le sexe
paria.
apparaissent presque comme autant de folies.
Pour finir, je le demande, une femme a-t-elle jamais reconnu de la
profondeur a une intelligence féminine, de la justice à un cœur
féminin? Et n’est-il pas vrai que, somme toute, “la femme” n’a
jamais été tant méprisée que par les femmes, et non par nous? En
tant qu’hommes, nous souhaitons que la femme cesse de se
compromettre par ses déclarations…».49
Que Nietzsche ait souffert de gynophobia,
c’est
plus que possible. La fameuse photographie qui a tant fait couler
d’encre montrant Lou Andréas-Salomé dans une charrette tirée par
Paul Rhée et Friedrich Nietzsche; de même la fameuse scène fatale
à Turin, montrant un Nietzsche envahi par la folie se précipitant
sur un cocher martelant de sa cravache un cheval tombé par terre,
laisse deviner une identification de l’un à l’autre. Victime de
la syphilis à son dernier stade Nietzsche sombrait dans la démence.
Il n’est pas impossible qu’une haine refoulée des femmes se soit
développée chez lui, le menant à réinvestir dans le surhomme –
le surmâle, disait Jarry -, délivré de sa faiblesse pour le sexe
paria. l’aventure
coloniale qui occupa la seconde moitié du XIXe siècle. Plus les
élites occidentales glosaient sur le surhomme, plus elles en
venaient à dresser le portrait de sa némésis, le sous-homme. La
sous-humanité devenait même difficile à classer entre l’homme et l’animal au point qu’on pouvait la considérer comme une espèce
animale elle-même. L’abjection jouait le rôle qui jusqu’à
présent s’était cantonné au creux du christianisme ou à la
frange des partis politiques radicaux : «Comme
les observateurs de la scène sociale le reconnurent à l’époque
(sans toutefois user du vocabulaire psychanalytique bien évidemment),
le phénomène de projection dans ses aspects les plus sauvages
réduisait l’Autre au statut de sous-homme. L’ayant privé de son
caractère humain, cette réduction autorisait alors les agressions
les plus incontrôlées à son endroit. Si Freeman estimait que les
Nègres n’étaient rien d’autre que des singes, certains
orateurs, de plus en plus ouvertement antisémites à compter des
années 1870, allèrent jusqu’à assimiler les Juifs à la
vermine».50
Ironiquement, le mordant Mark Twain pouvait-il écrire de son
personnage de Percy Northumberlan Driscoll, qu’il «était
un homme qui traitait assez humainement les esclaves et autres
l’aventure
coloniale qui occupa la seconde moitié du XIXe siècle. Plus les
élites occidentales glosaient sur le surhomme, plus elles en
venaient à dresser le portrait de sa némésis, le sous-homme. La
sous-humanité devenait même difficile à classer entre l’homme et l’animal au point qu’on pouvait la considérer comme une espèce
animale elle-même. L’abjection jouait le rôle qui jusqu’à
présent s’était cantonné au creux du christianisme ou à la
frange des partis politiques radicaux : «Comme
les observateurs de la scène sociale le reconnurent à l’époque
(sans toutefois user du vocabulaire psychanalytique bien évidemment),
le phénomène de projection dans ses aspects les plus sauvages
réduisait l’Autre au statut de sous-homme. L’ayant privé de son
caractère humain, cette réduction autorisait alors les agressions
les plus incontrôlées à son endroit. Si Freeman estimait que les
Nègres n’étaient rien d’autre que des singes, certains
orateurs, de plus en plus ouvertement antisémites à compter des
années 1870, allèrent jusqu’à assimiler les Juifs à la
vermine».50
Ironiquement, le mordant Mark Twain pouvait-il écrire de son
personnage de Percy Northumberlan Driscoll, qu’il «était
un homme qui traitait assez humainement les esclaves et autres
 animaux».51
Pour les Français, le processus d’abjection commença avec la
conquête de l’Afrique du Nord (Algérie, 1830). Après les
sanglants affrontements qui se conclurent par la soumission de l’émir
Abd-el-Kader au général Bugeaud, le processus de déshumanisation
que l’Amérique avait fait subir aux autochtones se répéta en
Algérie: «Dans
l’exotisme nord-africain s’exprima, avec quelques nuances, la
même déshumanisation du colonisé. Certes, il n’est pas question,
en ce qui concerne les Arabes, d’allusions évolutionnistes, mais
on n’en lit pas moins un nombre de métaphores zoologiques
surprenant, à leur sujet. Il y a cet “air d’oiseau de proie
féroce, avec leur grand nez recourbé”, “les grands yeux de
gazelles”, “des profils de jeunes boucs et de vieux dromadaires”,
un danseur qui jette “un long cri de hyène”, et les enfants sont
“de beaux animaux” ou des “joujoux”. Toutes ces images
concourent à fondre l’être humain dans les caractéristiques
naturelles du pays qu’il habite au même titre que la faune, il
fait partie du décor».52
La conquête de l’Algérie devenait une activité en vue de
ressourcer la virilité des Français qui semblaient végéter depuis
la défaite de 1870 : «Le
même contraste entre la noble grandeur, le désintéressement,
l’élégance
animaux».51
Pour les Français, le processus d’abjection commença avec la
conquête de l’Afrique du Nord (Algérie, 1830). Après les
sanglants affrontements qui se conclurent par la soumission de l’émir
Abd-el-Kader au général Bugeaud, le processus de déshumanisation
que l’Amérique avait fait subir aux autochtones se répéta en
Algérie: «Dans
l’exotisme nord-africain s’exprima, avec quelques nuances, la
même déshumanisation du colonisé. Certes, il n’est pas question,
en ce qui concerne les Arabes, d’allusions évolutionnistes, mais
on n’en lit pas moins un nombre de métaphores zoologiques
surprenant, à leur sujet. Il y a cet “air d’oiseau de proie
féroce, avec leur grand nez recourbé”, “les grands yeux de
gazelles”, “des profils de jeunes boucs et de vieux dromadaires”,
un danseur qui jette “un long cri de hyène”, et les enfants sont
“de beaux animaux” ou des “joujoux”. Toutes ces images
concourent à fondre l’être humain dans les caractéristiques
naturelles du pays qu’il habite au même titre que la faune, il
fait partie du décor».52
La conquête de l’Algérie devenait une activité en vue de
ressourcer la virilité des Français qui semblaient végéter depuis
la défaite de 1870 : «Le
même contraste entre la noble grandeur, le désintéressement,
l’élégance  physique et morale du héros et les préoccupations
mesquines, la médiocrité générale de l’arriviste de la
colonisation se retrouve dans l’œuvre de Randau, qui écrit de
longues diatribes contre “les Blancs à caractère faible, les
paresseux de l’intellect,
[qui] ne
se consolaient pas de la perte des horizons européens”, ceux qui,
“enfermés dans leur routine, tombaient dans l’alcoolisme et
l’érotomanie”. Par opposition, le héros colonisateur a “une
passion qui prime l’aiguillon de l’ambition personnelle : la
passion du but qu’il s’était assigné. Chacun caressait une idée
fixe, une conception particulière, plan de campagne ou projet
d’exploration, auquel il eût tout sacrifié”…».53
Les conquêtes coloniales devenaient l’occasion de découvrir ceux
qui appartiendraient à la surhumanité apte à redonner confiance en
la France. Comme l’Amérindien des prairies nord-américaines, le
Conseil supérieur de l’Algérie proclama, en 1894, que «“L’Arabe
est issu d’une race inférieure et inéducable».54
Enfin, l'Arabe offrira la métaphore ultime des prisonniers des camps
d'extermination nazi suite à «l’effort
de les briser, de les dégrader, de leur faire perdre leur dignité
d’êtres humains. Illustration de cette perversité, la figure du
“Musulman”, du détenu parvenu au stade ultime de la déchéance
somatique et psychologique».55
Le degré de dégradation confirmait ici l’état ontologique de
sous-humanité du Juif.
physique et morale du héros et les préoccupations
mesquines, la médiocrité générale de l’arriviste de la
colonisation se retrouve dans l’œuvre de Randau, qui écrit de
longues diatribes contre “les Blancs à caractère faible, les
paresseux de l’intellect,
[qui] ne
se consolaient pas de la perte des horizons européens”, ceux qui,
“enfermés dans leur routine, tombaient dans l’alcoolisme et
l’érotomanie”. Par opposition, le héros colonisateur a “une
passion qui prime l’aiguillon de l’ambition personnelle : la
passion du but qu’il s’était assigné. Chacun caressait une idée
fixe, une conception particulière, plan de campagne ou projet
d’exploration, auquel il eût tout sacrifié”…».53
Les conquêtes coloniales devenaient l’occasion de découvrir ceux
qui appartiendraient à la surhumanité apte à redonner confiance en
la France. Comme l’Amérindien des prairies nord-américaines, le
Conseil supérieur de l’Algérie proclama, en 1894, que «“L’Arabe
est issu d’une race inférieure et inéducable».54
Enfin, l'Arabe offrira la métaphore ultime des prisonniers des camps
d'extermination nazi suite à «l’effort
de les briser, de les dégrader, de leur faire perdre leur dignité
d’êtres humains. Illustration de cette perversité, la figure du
“Musulman”, du détenu parvenu au stade ultime de la déchéance
somatique et psychologique».55
Le degré de dégradation confirmait ici l’état ontologique de
sous-humanité du Juif. pour
que, de Blancs qu’ils étaient, il deviennent Noirs. Nombreux
étaient ceux qui refusaient de croire que les Blancs et les Noirs
appartenaient à la même espèce. Le grand explorateur de l’Afrique
Samuel Baker, qui soutenait avoir “une longue expérience des
sauvages d’Afrique”, concluait qu’on ne saurait ni condamner
les Noirs en général ni prétendre à les comparer, au plan de
l’intelligence, avec les Blancs. Le tort de certains était, selon
lui, de vouloir mettre à égalité ce qui ne l’était pas et
d’oublier les raisons pour lesquelles le Noir était un être
inférieur. Ce que l’Encyclopædia
Britannica,
dans son édition de 1884, résumait en ces termes : “Jamais un
nègre de souche ne s’est distingué comme homme de science, poète
ni artiste et l’égalité que réclament pour lui les philanthropes
ignorants est démentie par l’histoire des races depuis les
commencements”».56
(On se souviendra ici que ce dernier argument avait été retenu par
Nietzsche contre les femmes!) Les radicaux de la décolonisation
retiendront cette énumération lorsque Cheikh Anta Diop la
renversera afin d’attribuer toutes les grandes découvertes aux
peuples noirs d’Afrique avant les Blancs. Dans l’humeur
populaire, les métaphores et les figures de style demeuraient liées
essentiellement à l’apparence simiesque : «Un
mot revient dans ces ouvrages avec une fréquence suspecte, il s’agit
de l’adjectif “simiesque”. “C’était toujours le même
masque simiesque”, écrit
pour
que, de Blancs qu’ils étaient, il deviennent Noirs. Nombreux
étaient ceux qui refusaient de croire que les Blancs et les Noirs
appartenaient à la même espèce. Le grand explorateur de l’Afrique
Samuel Baker, qui soutenait avoir “une longue expérience des
sauvages d’Afrique”, concluait qu’on ne saurait ni condamner
les Noirs en général ni prétendre à les comparer, au plan de
l’intelligence, avec les Blancs. Le tort de certains était, selon
lui, de vouloir mettre à égalité ce qui ne l’était pas et
d’oublier les raisons pour lesquelles le Noir était un être
inférieur. Ce que l’Encyclopædia
Britannica,
dans son édition de 1884, résumait en ces termes : “Jamais un
nègre de souche ne s’est distingué comme homme de science, poète
ni artiste et l’égalité que réclament pour lui les philanthropes
ignorants est démentie par l’histoire des races depuis les
commencements”».56
(On se souviendra ici que ce dernier argument avait été retenu par
Nietzsche contre les femmes!) Les radicaux de la décolonisation
retiendront cette énumération lorsque Cheikh Anta Diop la
renversera afin d’attribuer toutes les grandes découvertes aux
peuples noirs d’Afrique avant les Blancs. Dans l’humeur
populaire, les métaphores et les figures de style demeuraient liées
essentiellement à l’apparence simiesque : «Un
mot revient dans ces ouvrages avec une fréquence suspecte, il s’agit
de l’adjectif “simiesque”. “C’était toujours le même
masque simiesque”, écrit  Loti, ailleurs décrivant une Africaine
occidentalisée, il s’amuse de la voir : “un compromis piquant
entre la miss exotique et la guenon”, la première image des
Sénégalais qu’il nous présente, c’est “des faces de
gorilles”. En Indochine, P. Bonnetain voit de “simiesques
ouvriers indigènes” et le poète A. Droin répète le vers “Petite
âme de singe en un corps de reptile”, pour décrire une jeune
Annamite. Le mot se retrouve encore sous la plume d’un émule de
Loti, F. Azal, qui, plein de compassion pour le sort des misérables
Africains, n’en écrit pas moins : “sur leurs faces simiesques se
lit une sorte d’anxiété”. On peut citer encore cette page assez
insupportable du journal de Mme Bonnetain où, après avoir décrit
une beauté noire, elle s’attarde sur “la main… petite,
effrayante un peu, noire au-dessus, blanche en dedans, simiesque
…patte de singe”, description suivie de cette déclaration sans
équivoque “en religion comme en tout, les noirs sont des singes”.
L’usage répété du mot ne peut être l’effet d’une
coïncidence, il révèle au contraire une attitude fondamentale du
colonisateur : il ne peut apprécier les traits, les mœurs et les
valeurs des autres que par rapport aux critères esthétiques et
moraux établis par la
Loti, ailleurs décrivant une Africaine
occidentalisée, il s’amuse de la voir : “un compromis piquant
entre la miss exotique et la guenon”, la première image des
Sénégalais qu’il nous présente, c’est “des faces de
gorilles”. En Indochine, P. Bonnetain voit de “simiesques
ouvriers indigènes” et le poète A. Droin répète le vers “Petite
âme de singe en un corps de reptile”, pour décrire une jeune
Annamite. Le mot se retrouve encore sous la plume d’un émule de
Loti, F. Azal, qui, plein de compassion pour le sort des misérables
Africains, n’en écrit pas moins : “sur leurs faces simiesques se
lit une sorte d’anxiété”. On peut citer encore cette page assez
insupportable du journal de Mme Bonnetain où, après avoir décrit
une beauté noire, elle s’attarde sur “la main… petite,
effrayante un peu, noire au-dessus, blanche en dedans, simiesque
…patte de singe”, description suivie de cette déclaration sans
équivoque “en religion comme en tout, les noirs sont des singes”.
L’usage répété du mot ne peut être l’effet d’une
coïncidence, il révèle au contraire une attitude fondamentale du
colonisateur : il ne peut apprécier les traits, les mœurs et les
valeurs des autres que par rapport aux critères esthétiques et
moraux établis par la  société dans laquelle il vit. Dès lors, les
traits, les gestes des autres, s’ils ne sont pas semblables aux
siens, deviennent parodiques. L’observateur européen voit dans
l’Autre une version inachevée, imparfaite, négative de lui-même
: un singe».57
Peu d’auteurs eurent pour les Noirs la sympathie qu’obtinrent
parfois les autochtones ou les esclaves noirs dans la littérature
américaine. «De
passage en Afrique noire, Jean Guehenno s’offusque de ce type de
situation : “Innombrables les Blancs, dans ce pays, qui ne
connaîtront jamais le nom d'un homme noir. Ils donnent des noms à
leurs chiens, à leurs chats, à leurs singes. Mais le Noir (…) n’a
ni nom ni prénom. Il s’appelle toujours “cook”, ou “boy”,
ou “chauffeur”, ou “motor-boy” (1952)».58
Cette même année 1952 sonnait d'ailleurs le glas de l’aventure
coloniale française.
société dans laquelle il vit. Dès lors, les
traits, les gestes des autres, s’ils ne sont pas semblables aux
siens, deviennent parodiques. L’observateur européen voit dans
l’Autre une version inachevée, imparfaite, négative de lui-même
: un singe».57
Peu d’auteurs eurent pour les Noirs la sympathie qu’obtinrent
parfois les autochtones ou les esclaves noirs dans la littérature
américaine. «De
passage en Afrique noire, Jean Guehenno s’offusque de ce type de
situation : “Innombrables les Blancs, dans ce pays, qui ne
connaîtront jamais le nom d'un homme noir. Ils donnent des noms à
leurs chiens, à leurs chats, à leurs singes. Mais le Noir (…) n’a
ni nom ni prénom. Il s’appelle toujours “cook”, ou “boy”,
ou “chauffeur”, ou “motor-boy” (1952)».58
Cette même année 1952 sonnait d'ailleurs le glas de l’aventure
coloniale française. son sommet :
«“Oh,
les bêtes inhumaines!” s’exclame Mme John Milburn quand les
nouvelles du comportement des japonais atteignent le Royaume-Uni. Les
Japonais se voyaient aussi qualifiés par les Alliés de “chacals”,
ou d’“hommes-singes”, ou encore de “sous-hommes”, le terme
que les Allemands, bien sûr, appliquaient aux Russes, Polonais et
autres Slaves, et qui justifiait amplement leur vivisection. Certains
membres du Marine Corps cherchèrent à populariser le terme
Japes (Jap
+ apes,
“grands singes”), mais l’expression ne prit jamais et les
Japonais restèrent les
Japs, ou,
de façon légèrement moins méprisante, les
Nips.
Comme Hun
pendant la Grande Guerre,
Jap -
“les Huns jaunes de l’Orient”, avait dit le général
australien Gordon Bennett - était un brusque monosyllabe, commode
pour des slogans comme
“Rap the Jap”
[“frappe le Jap”] ou
“Let’s blast the
son sommet :
«“Oh,
les bêtes inhumaines!” s’exclame Mme John Milburn quand les
nouvelles du comportement des japonais atteignent le Royaume-Uni. Les
Japonais se voyaient aussi qualifiés par les Alliés de “chacals”,
ou d’“hommes-singes”, ou encore de “sous-hommes”, le terme
que les Allemands, bien sûr, appliquaient aux Russes, Polonais et
autres Slaves, et qui justifiait amplement leur vivisection. Certains
membres du Marine Corps cherchèrent à populariser le terme
Japes (Jap
+ apes,
“grands singes”), mais l’expression ne prit jamais et les
Japonais restèrent les
Japs, ou,
de façon légèrement moins méprisante, les
Nips.
Comme Hun
pendant la Grande Guerre,
Jap -
“les Huns jaunes de l’Orient”, avait dit le général
australien Gordon Bennett - était un brusque monosyllabe, commode
pour des slogans comme
“Rap the Jap”
[“frappe le Jap”] ou
“Let’s blast the  Jap clean off the map”
[“faisons sauter le Jap hors de la carte”], ce dernier étant
pratiquement une prophétie d’Hiroshima. C’est le b-a-ba de la
propagande militaire : les ennemis monosyllabiques sont plus faciles
à mépriser que les autres».59
Dans l’ensemble, aucun peuple non-occidental ne fut considéré
comme un égal à la nature humaine des colonisateurs. Le colonisé
était le paria dans son propre pays, voire dans son propre peuple;
sa femme ne lui appartenait plus, ses enfants non plus; souvent il se
voyait déplacé par les propriétaires d’exploitations
industrielles (pétrole, caoutchouc, minerais…); parfois parqué
dans des camps dans des conditions inhumaines. Seuls les coloniaux
pouvaient se permettre – devant un auditoire
Jap clean off the map”
[“faisons sauter le Jap hors de la carte”], ce dernier étant
pratiquement une prophétie d’Hiroshima. C’est le b-a-ba de la
propagande militaire : les ennemis monosyllabiques sont plus faciles
à mépriser que les autres».59
Dans l’ensemble, aucun peuple non-occidental ne fut considéré
comme un égal à la nature humaine des colonisateurs. Le colonisé
était le paria dans son propre pays, voire dans son propre peuple;
sa femme ne lui appartenait plus, ses enfants non plus; souvent il se
voyait déplacé par les propriétaires d’exploitations
industrielles (pétrole, caoutchouc, minerais…); parfois parqué
dans des camps dans des conditions inhumaines. Seuls les coloniaux
pouvaient se permettre – devant un auditoire  européen, mais
parfois aussi devant un auditoire de colonisés – de vanter les
bienfaits apportés par la colonisation européenne : «Qu’il
fût victime ou bénéficiaire, l’habitant des colonies resta, tant
que ce fut l’homme blanc qui lui donna une voix, un colonisé,
c’est-à-dire un être artificiel qui n’existait que par rapport
à un système de rapports politiques, économiques et humains conçu
entièrement sans son concours et auquel échappait totalement l’être
réel. Toutes les tentatives ne pouvaient empêcher l’homme blanc
de se retrouver sans cesse face à lui-même. Le colonialisme avait
transformé son univers en un gigantesque domaine dont il était
l’unique habitant, où il avait la satisfaction ou l’angoisse de
ne plus entendre que l’écho de sa propre voix. Les critiques de
l’impérialisme n’ouvraient pas un dialogue, elles continuaient
un monologue, sur un ton moins triomphant».60
La condition du colonisé allait toutefois trouver son écho dans la
façon même dont les Européens traitaient leurs parias domestiques.
européen, mais
parfois aussi devant un auditoire de colonisés – de vanter les
bienfaits apportés par la colonisation européenne : «Qu’il
fût victime ou bénéficiaire, l’habitant des colonies resta, tant
que ce fut l’homme blanc qui lui donna une voix, un colonisé,
c’est-à-dire un être artificiel qui n’existait que par rapport
à un système de rapports politiques, économiques et humains conçu
entièrement sans son concours et auquel échappait totalement l’être
réel. Toutes les tentatives ne pouvaient empêcher l’homme blanc
de se retrouver sans cesse face à lui-même. Le colonialisme avait
transformé son univers en un gigantesque domaine dont il était
l’unique habitant, où il avait la satisfaction ou l’angoisse de
ne plus entendre que l’écho de sa propre voix. Les critiques de
l’impérialisme n’ouvraient pas un dialogue, elles continuaient
un monologue, sur un ton moins triomphant».60
La condition du colonisé allait toutefois trouver son écho dans la
façon même dont les Européens traitaient leurs parias domestiques. Dans
son texte sur l’avenir de la culture, Freud mesurait encore – et
pourtant nous étions au début des années 30 du XXe siècle -, le
problème de l’exclusion au rang de querelles ancrées dans le
narcissisme des petites différences : «Il
est toujours possible d’unir les uns aux autres par les liens de
l’amour une plus grande masse d’hommes, à la seule condition
qu’il en reste d’autres en dehors d’elle pour recevoir les
coups. Je me suis occupé jadis de ce phénomène que justement les
communautés voisines et même apparentées se combattent et se
raillent réciproquement; par exemple Espagnols et Portugais,
Allemands du Nord et du Sud, Anglais et Écossais, etc. Je l’ai
appelé “Narcissisme des petites différences”, nom qui ne
contribue guère à l’éclairer. Or, on y constate une satisfaction
commode et relativement inoffensive de l’instinct agressif, par
laquelle la cohésion de la communauté est rendue plus facile à ses
membres. Le peuple juif, du fait de sa dissémination en tous lieux,
a dignement servi, de ce point de vue, la civilisation des
Dans
son texte sur l’avenir de la culture, Freud mesurait encore – et
pourtant nous étions au début des années 30 du XXe siècle -, le
problème de l’exclusion au rang de querelles ancrées dans le
narcissisme des petites différences : «Il
est toujours possible d’unir les uns aux autres par les liens de
l’amour une plus grande masse d’hommes, à la seule condition
qu’il en reste d’autres en dehors d’elle pour recevoir les
coups. Je me suis occupé jadis de ce phénomène que justement les
communautés voisines et même apparentées se combattent et se
raillent réciproquement; par exemple Espagnols et Portugais,
Allemands du Nord et du Sud, Anglais et Écossais, etc. Je l’ai
appelé “Narcissisme des petites différences”, nom qui ne
contribue guère à l’éclairer. Or, on y constate une satisfaction
commode et relativement inoffensive de l’instinct agressif, par
laquelle la cohésion de la communauté est rendue plus facile à ses
membres. Le peuple juif, du fait de sa dissémination en tous lieux,
a dignement servi, de ce point de vue, la civilisation des  peuples
qui l’hébergeaient; mais hélas, tous les massacres de Juifs du
Moyen Âge n’ont suffi à rendre cette période plus paisible ni
plus sûre aux frères chrétiens».61
Au moment où l’antisémitisme avait le vent dans les voiles, il
apparaissait que le Juif était sur le point d’assister à une
mutation de son statut à l’échelle du continent. Au XIXe siècle,
illustrant le roman de Eugène Sue, «Gustave
Doré, célèbre illustrateur de la bible, fit en 1852 une gravure
sur bois du Juif errant (le front marqué d’une croix rouge, les
membres maigrelets, le nez énorme, la tignasse ébouriffée, un
bâton à la main) qui vulgarisa cette représentation. Le Juif errant fut alors repris par la propagande antisémite, alors qu’il
avait jusque-là conservé une certaine dignité.
[…] Le
paria, lui, est de l’ordre de l’informe; il se caractérise par
un état d’agitation perpétuel signalant son défaut de
modération : il est à l’opposé de l’homme d’or loué par
Schiller, qui correspondait si bien aux
peuples
qui l’hébergeaient; mais hélas, tous les massacres de Juifs du
Moyen Âge n’ont suffi à rendre cette période plus paisible ni
plus sûre aux frères chrétiens».61
Au moment où l’antisémitisme avait le vent dans les voiles, il
apparaissait que le Juif était sur le point d’assister à une
mutation de son statut à l’échelle du continent. Au XIXe siècle,
illustrant le roman de Eugène Sue, «Gustave
Doré, célèbre illustrateur de la bible, fit en 1852 une gravure
sur bois du Juif errant (le front marqué d’une croix rouge, les
membres maigrelets, le nez énorme, la tignasse ébouriffée, un
bâton à la main) qui vulgarisa cette représentation. Le Juif errant fut alors repris par la propagande antisémite, alors qu’il
avait jusque-là conservé une certaine dignité.
[…] Le
paria, lui, est de l’ordre de l’informe; il se caractérise par
un état d’agitation perpétuel signalant son défaut de
modération : il est à l’opposé de l’homme d’or loué par
Schiller, qui correspondait si bien aux  idéaux de l’époque. Loin
d’être purement physique, la laideur trahit un paysage mental; à
nouveau, nous voyons l’extérieur symboliser l’intérieur. Un
physique trouble signale un esprit incapable de maîtriser ses
passions, un lâche insensible à l’honneur, une nature malhonnête
et libidineuse. Bref, la vertu a cédé la place au vice. La
caricature du Juif errant, dont les traits répugnants signalent
l’immoralisme, se voulait un terrible avertissement pour ceux qui
seraient tentés de s’écarter du droit chemin. Le Juif errant
avait toujours recouvert un conte moral, mais sa laideur prit ainsi
une valeur symbolique exactement inverse à celle de la beauté».62
La caricature eut une portée qui s’étendit non seulement dans
l’espace, mais aussi dans le temps. Désormais, Shylock avait un
visage apte à trahir ses origines sous-humaines. Et c’est ainsi
que les nazis en firent l’Untermenschen
par
excellence.
idéaux de l’époque. Loin
d’être purement physique, la laideur trahit un paysage mental; à
nouveau, nous voyons l’extérieur symboliser l’intérieur. Un
physique trouble signale un esprit incapable de maîtriser ses
passions, un lâche insensible à l’honneur, une nature malhonnête
et libidineuse. Bref, la vertu a cédé la place au vice. La
caricature du Juif errant, dont les traits répugnants signalent
l’immoralisme, se voulait un terrible avertissement pour ceux qui
seraient tentés de s’écarter du droit chemin. Le Juif errant
avait toujours recouvert un conte moral, mais sa laideur prit ainsi
une valeur symbolique exactement inverse à celle de la beauté».62
La caricature eut une portée qui s’étendit non seulement dans
l’espace, mais aussi dans le temps. Désormais, Shylock avait un
visage apte à trahir ses origines sous-humaines. Et c’est ainsi
que les nazis en firent l’Untermenschen
par
excellence.  Mais
les Juifs ne tenaient pas la place que les Amérindiens tenaient dans
les récits épiques de Karl May. Cette place était tenue par les
Slaves : «On
peut dire que Hitler a recherché son Far West à l’Est et qu’il
a désigné les Indiens à refouler sous la forme des
Untermenschen
de l’Europe orientale, au nom de la marche de la civilisation,
toujours plus loin, au-delà de l’Oural. Il ne s’agit pas là
d’une suggestion momentanée, mais bien d’un programme longuement
médité et bien articulé dans ses détails. […]
Au fur et
à mesure que procède la conquête, il est nécessaire de repousser
toujours plus en arrière, si possible au-delà de l’Oural, les
Untermenschen
ou Indiens de l’Europe orientale, de manière à faire de la place
à l’élément germanique et à la civilisation».63
Le Far-West allait devenir le Far-East de Hitler. Mais, comme les
croisés partis faire la guerre aux Sarrasins qui détenaient les
Lieux-Saints, ils se tournèrent contre leurs arrières pour
massacrer les Juifs qu’ils tenaient pour les alliés naturels des
Infidèles. Dès la prise du pouvoir par Hitler, la sous-humanité
est une préoccupation première dans l’esprit du Führer. Le Juif,
le premier des parias, risquait de se mettre à la tête de tous les
autres : «Parce
qu’il est “sans refuge”, comme dirait Albert Cohen, il
Mais
les Juifs ne tenaient pas la place que les Amérindiens tenaient dans
les récits épiques de Karl May. Cette place était tenue par les
Slaves : «On
peut dire que Hitler a recherché son Far West à l’Est et qu’il
a désigné les Indiens à refouler sous la forme des
Untermenschen
de l’Europe orientale, au nom de la marche de la civilisation,
toujours plus loin, au-delà de l’Oural. Il ne s’agit pas là
d’une suggestion momentanée, mais bien d’un programme longuement
médité et bien articulé dans ses détails. […]
Au fur et
à mesure que procède la conquête, il est nécessaire de repousser
toujours plus en arrière, si possible au-delà de l’Oural, les
Untermenschen
ou Indiens de l’Europe orientale, de manière à faire de la place
à l’élément germanique et à la civilisation».63
Le Far-West allait devenir le Far-East de Hitler. Mais, comme les
croisés partis faire la guerre aux Sarrasins qui détenaient les
Lieux-Saints, ils se tournèrent contre leurs arrières pour
massacrer les Juifs qu’ils tenaient pour les alliés naturels des
Infidèles. Dès la prise du pouvoir par Hitler, la sous-humanité
est une préoccupation première dans l’esprit du Führer. Le Juif,
le premier des parias, risquait de se mettre à la tête de tous les
autres : «Parce
qu’il est “sans refuge”, comme dirait Albert Cohen, il  rejoint
le lot inépuisable de ceux que leur naissance parque dans le camp
des humains de seconde catégorie : les femmes contraintes à la
soumission, les invalides, les estropiés ou les tarés dont la loi
du 14 juillet 1933 prévoit la stérilisation; ces races inférieures
contre lesquelles se déploie la vindicte des “maîtres”».64
Ce besoin intime d’humilier un groupe exclu de la nation a atteint
les proportions que l’on sait que parce que les Allemands
eux-mêmes, depuis plus d’un siècle, traînaient dans leur psyché
une haine de soi particulièrement virulente. Durant la Grande
Guerre, la propagande française avait récupéré cette haine de soi
d'une manière on ne peut plus humiliante en les associant non
seulement aux Huns, mais à une sous-humanité marquée par son odeur
et ses déjections. Un célèbre criminologue, le docteur Bérillon,
publia une brochure dans laquelle il démontrait l’infériorité
ontique de la race allemande : «À
la fin de sa brochure sur
La Polychésie,
Bérillon énonce clairement qu’il s’agit d’une race de
sous-hommes : “Dans tous les cas, la polychésie est la
démonstration formelle de l’infériorité à la fois physiologique
et psychologique de la race allemande”».65
Il ne
rejoint
le lot inépuisable de ceux que leur naissance parque dans le camp
des humains de seconde catégorie : les femmes contraintes à la
soumission, les invalides, les estropiés ou les tarés dont la loi
du 14 juillet 1933 prévoit la stérilisation; ces races inférieures
contre lesquelles se déploie la vindicte des “maîtres”».64
Ce besoin intime d’humilier un groupe exclu de la nation a atteint
les proportions que l’on sait que parce que les Allemands
eux-mêmes, depuis plus d’un siècle, traînaient dans leur psyché
une haine de soi particulièrement virulente. Durant la Grande
Guerre, la propagande française avait récupéré cette haine de soi
d'une manière on ne peut plus humiliante en les associant non
seulement aux Huns, mais à une sous-humanité marquée par son odeur
et ses déjections. Un célèbre criminologue, le docteur Bérillon,
publia une brochure dans laquelle il démontrait l’infériorité
ontique de la race allemande : «À
la fin de sa brochure sur
La Polychésie,
Bérillon énonce clairement qu’il s’agit d’une race de
sous-hommes : “Dans tous les cas, la polychésie est la
démonstration formelle de l’infériorité à la fois physiologique
et psychologique de la race allemande”».65
Il ne  s’agissait rien de moins que de démontrer l’infériorité
raciale des Allemands par la qualité et la quantité de leurs
selles. Peu importe comment les Allemands prirent le contenu de cette
brochure, il était certain qu’elle causait l’une de ces
humiliations que l’armistice de 1918 (par l'absence des vaincus à
la table des négociations) aggrava. Cette haine de soi rencontra
alors celle que Théodore Lessing observait parmi la couche éduquée
des Juifs allemands. Il s’agissait maintenant de prouver que la
race allemande n’appartenait pas à une race d’Untermenschen :
«Afin
qu’aucune erreur ne soit commise dans la recherche des sujets aptes
à devenir des citoyens de la grande Allemagne, le Service de la Race
et du Peuplement de la SS prendra soin par la suite d’avertir les
hommes et les femmes chargés de la sélection : “L’homme
inférieur a une apparence biologique semblable à une créature
naturelle. Il a des pieds, des mains, des yeux, une bouche et quelque
chose qui ressemble à une cervelle; mais c’est bien une
s’agissait rien de moins que de démontrer l’infériorité
raciale des Allemands par la qualité et la quantité de leurs
selles. Peu importe comment les Allemands prirent le contenu de cette
brochure, il était certain qu’elle causait l’une de ces
humiliations que l’armistice de 1918 (par l'absence des vaincus à
la table des négociations) aggrava. Cette haine de soi rencontra
alors celle que Théodore Lessing observait parmi la couche éduquée
des Juifs allemands. Il s’agissait maintenant de prouver que la
race allemande n’appartenait pas à une race d’Untermenschen :
«Afin
qu’aucune erreur ne soit commise dans la recherche des sujets aptes
à devenir des citoyens de la grande Allemagne, le Service de la Race
et du Peuplement de la SS prendra soin par la suite d’avertir les
hommes et les femmes chargés de la sélection : “L’homme
inférieur a une apparence biologique semblable à une créature
naturelle. Il a des pieds, des mains, des yeux, une bouche et quelque
chose qui ressemble à une cervelle; mais c’est bien une  créature
différente, effroyable, très éloignée de l’homme, même si ses
traits sont semblables à ce dernier. …Moralement et
intellectuellement, cet être est inférieur à n’importe quelle
bête; il est aussi animé de passions sauvages, d’une volonté de
destruction incommensurable, d’une vulgarité indécente. Malheur à
celui qui oublie que tout ce qui ressemble à un être humain n’est
pas obligatoirement un être humain”. (Éditions Nordland : L’Être
inférieur).
Cette brochure, dont 3 860 995 exemplaires furent publiés au total
en langue allemande, fut également traduite en 14 langues (grec,
français, hollandais, danois, bulgare, hongrois, tchèque, etc.)».66
Le supposé Service
de la Race et du Peuplement multipliait
plutôt que de corriger les élucubrations de Bérillon. À partir de
ce moment, «dans
ses principes et ses finalités, l’inhumanité nazie distingue
nettement les “sous-hommes” des autres et, là, ce ne sont plus
des individus que l’on exploite et que l’on maltraite jusqu’à
la mort, mais des familles entières, hommes, femmes et enfants
confondus, que l’on pourchasse pour les anéantir, au nom de la
race, par une
créature
différente, effroyable, très éloignée de l’homme, même si ses
traits sont semblables à ce dernier. …Moralement et
intellectuellement, cet être est inférieur à n’importe quelle
bête; il est aussi animé de passions sauvages, d’une volonté de
destruction incommensurable, d’une vulgarité indécente. Malheur à
celui qui oublie que tout ce qui ressemble à un être humain n’est
pas obligatoirement un être humain”. (Éditions Nordland : L’Être
inférieur).
Cette brochure, dont 3 860 995 exemplaires furent publiés au total
en langue allemande, fut également traduite en 14 langues (grec,
français, hollandais, danois, bulgare, hongrois, tchèque, etc.)».66
Le supposé Service
de la Race et du Peuplement multipliait
plutôt que de corriger les élucubrations de Bérillon. À partir de
ce moment, «dans
ses principes et ses finalités, l’inhumanité nazie distingue
nettement les “sous-hommes” des autres et, là, ce ne sont plus
des individus que l’on exploite et que l’on maltraite jusqu’à
la mort, mais des familles entières, hommes, femmes et enfants
confondus, que l’on pourchasse pour les anéantir, au nom de la
race, par une  extermination qui se veut totale, afin que ces gens-là
n’aient pas de descendance et ne puissent plus, à jamais, avoir
droit à l’appellation d’humains».67
Déjà, en 1929, «dans
un discours prononcé devant des femmes auxiliaires (Königin Luise
Bund), on déclara que les Juifs n’étaient pas des êtres
humains».68
La déshumanisation allait loin., même si, dans les faits, c’est
seulement à partir de 1942 qu’elle se systématisa pratiquement.
On a mentionné dans la sous-section précédente cet «amusement»
des S.S. de souligner la sous-humanité des détenus des camps de
concentration en hissant les chiens au niveau humain : «À
titre d’exemple de locutions très employées: dans la plupart des
camps, il y avait des
détachements de chiens
(“Hundekommando”,
“Hundestaffel”) sanguinaires.
Le chien fut appelé
“Mensch” (homme);
les prisonniers par contre, étaient les
chiens.
D’où la scène habituelle : l’Allemand, S.S., s’adressant à
son chien et lui indiquant un prisonnier :
Homme! Déchire ce chien! (“Mensch, zerreisse diesen Hund!”) Par
ailleurs, un prisonnier était obligé de s’adresser au chien en le
vouvoyant :
Monsieur le Chien (“Herr Hund!”). On
rencontre cette coutume (avec les mêmes locutions) dans un grand
nombre d’endroits. Il est donc évident qu’il ne s’agit pas
d’improvisations, mais d’instructions…»69
On avait vu cette pratique, particulièrement au camp de Treblinka.
extermination qui se veut totale, afin que ces gens-là
n’aient pas de descendance et ne puissent plus, à jamais, avoir
droit à l’appellation d’humains».67
Déjà, en 1929, «dans
un discours prononcé devant des femmes auxiliaires (Königin Luise
Bund), on déclara que les Juifs n’étaient pas des êtres
humains».68
La déshumanisation allait loin., même si, dans les faits, c’est
seulement à partir de 1942 qu’elle se systématisa pratiquement.
On a mentionné dans la sous-section précédente cet «amusement»
des S.S. de souligner la sous-humanité des détenus des camps de
concentration en hissant les chiens au niveau humain : «À
titre d’exemple de locutions très employées: dans la plupart des
camps, il y avait des
détachements de chiens
(“Hundekommando”,
“Hundestaffel”) sanguinaires.
Le chien fut appelé
“Mensch” (homme);
les prisonniers par contre, étaient les
chiens.
D’où la scène habituelle : l’Allemand, S.S., s’adressant à
son chien et lui indiquant un prisonnier :
Homme! Déchire ce chien! (“Mensch, zerreisse diesen Hund!”) Par
ailleurs, un prisonnier était obligé de s’adresser au chien en le
vouvoyant :
Monsieur le Chien (“Herr Hund!”). On
rencontre cette coutume (avec les mêmes locutions) dans un grand
nombre d’endroits. Il est donc évident qu’il ne s’agit pas
d’improvisations, mais d’instructions…»69
On avait vu cette pratique, particulièrement au camp de Treblinka. «L’essai
le plus plat et le plus douteux pour transformer l’expérience de
cette étrangeté en une idéologie fut la brochure Le
sous-homme,
publiée en 1942 par l’Office central (Hauptamt)
de la SS. Outre la tentative aussi vile que stupide de déduire le
type du sous-homme, voire de l’Asiate, des visages épuisés de
quelques prisonniers de guerre, ce qui est agité ici, c’est tout
simplement l’épouvantail, aussi ancien que général, du
commissaire politique sanguinaire et de la pétroleuse fanatique; on
y mettait surtout en parallèle les minables cabanes en bois des
paysans et les misérables logements des ouvriers russes d’un côté,
de l’autre la richesse beaucoup plus grande et la culture
caractérisant les conditions d’existence en Europe, et ce dans un style qui, pour un observateur averti, évoquait certes les images
radieuses du réalisme socialiste mais qui, malgré sa partialité
évidente, n’était pas pour autant dépourvu de crédibilité aux
yeux
«L’essai
le plus plat et le plus douteux pour transformer l’expérience de
cette étrangeté en une idéologie fut la brochure Le
sous-homme,
publiée en 1942 par l’Office central (Hauptamt)
de la SS. Outre la tentative aussi vile que stupide de déduire le
type du sous-homme, voire de l’Asiate, des visages épuisés de
quelques prisonniers de guerre, ce qui est agité ici, c’est tout
simplement l’épouvantail, aussi ancien que général, du
commissaire politique sanguinaire et de la pétroleuse fanatique; on
y mettait surtout en parallèle les minables cabanes en bois des
paysans et les misérables logements des ouvriers russes d’un côté,
de l’autre la richesse beaucoup plus grande et la culture
caractérisant les conditions d’existence en Europe, et ce dans un style qui, pour un observateur averti, évoquait certes les images
radieuses du réalisme socialiste mais qui, malgré sa partialité
évidente, n’était pas pour autant dépourvu de crédibilité aux
yeux  des simples soldats de nombreuses nations européennes. C’est
en tout cas comme cela que voyaient les choses les simples soldats
allemands […]».70
L’abjection nazie se polarise sur le Juif. Les armées
fournissaient sans cesse des bolcheviques et des Juifs capturés sur
le front russe. «Dès
1943, l’expédient dicté par la nécessité prit force de loi :
faisaient partie intégrante de la SS ex-nordique des recrues dont
les origines ethniques auraient, quelques années plus tôt, fait
pâlir de rage les “connaisseurs de races”. Les Français de la
division Charlemagne, comme les Musulmans de la division Handschar ou
les Slaves ukrainiens de la division “Galizien” ne furent en fait
que des “sous-hommes” provisoirement promus au rang d’“êtres
supérieurs” dans le seul dessein d’alimenter la machine de
guerre allemande».71
Le 4 octobre de cette même année 1943, Himmler, le chef de la S.S.
des simples soldats de nombreuses nations européennes. C’est
en tout cas comme cela que voyaient les choses les simples soldats
allemands […]».70
L’abjection nazie se polarise sur le Juif. Les armées
fournissaient sans cesse des bolcheviques et des Juifs capturés sur
le front russe. «Dès
1943, l’expédient dicté par la nécessité prit force de loi :
faisaient partie intégrante de la SS ex-nordique des recrues dont
les origines ethniques auraient, quelques années plus tôt, fait
pâlir de rage les “connaisseurs de races”. Les Français de la
division Charlemagne, comme les Musulmans de la division Handschar ou
les Slaves ukrainiens de la division “Galizien” ne furent en fait
que des “sous-hommes” provisoirement promus au rang d’“êtres
supérieurs” dans le seul dessein d’alimenter la machine de
guerre allemande».71
Le 4 octobre de cette même année 1943, Himmler, le chef de la S.S.
 osait affirmer, le plus sérieusement du monde : «Nous
autres Allemands, qui sommes les seuls à traiter correctement les
animaux, nous traiterons correctement les animaux humains. Mais ce
serait un crime contre notre propre sang que de nous soucier d’eux
et de leur attribuer un idéal…».72
D’autre part, au fur et à mesure que se profilait la défaite,
l’ontologie de l’abject s'accroissait de parias; la nébuleuse se
coagulait dans le sang des Untermenschen :
«Si, dans
l’eschatologie nazie, le Juif occupait la place de Satan, le
non-germain en général, le “sous-homme”, démuni de tout
attribut sacré, était délibérément rangé parmi les catégories
du monde animal, et considéré tout au mieux (suivant une définition
courante) comme “une forme de transition entre l’animal et
osait affirmer, le plus sérieusement du monde : «Nous
autres Allemands, qui sommes les seuls à traiter correctement les
animaux, nous traiterons correctement les animaux humains. Mais ce
serait un crime contre notre propre sang que de nous soucier d’eux
et de leur attribuer un idéal…».72
D’autre part, au fur et à mesure que se profilait la défaite,
l’ontologie de l’abject s'accroissait de parias; la nébuleuse se
coagulait dans le sang des Untermenschen :
«Si, dans
l’eschatologie nazie, le Juif occupait la place de Satan, le
non-germain en général, le “sous-homme”, démuni de tout
attribut sacré, était délibérément rangé parmi les catégories
du monde animal, et considéré tout au mieux (suivant une définition
courante) comme “une forme de transition entre l’animal et
 l’homme nordique”. À l’égard du Polonais, du Tchèque ou du
Français, le souffle de haine paraît donc absent, qui aurait poussé
à décréter l’extermination de cette bête de somme par ailleurs
si utile, appelée à jouer son rôle dans l’édification du IIIe
Reich millénaire. Les mesures de persécution, en ce qui le concerne
sont motivées tout autrement. Il s’agit dans ce cas de
considérations économiques et démographiques qui, s’insérant
dans le cadre d’un plan impérialiste, visent à assurer la
primauté permanente et certaine de la race germanique; il est
question de courbes de natalité et d’indices de reproduction, de
la prolifération menaçante des Slaves, de la saignée occasionnée
par la guerre parmi les Allemands… Et cependant, partant d’un
point de vue apparemment plus rationnel, et faisant appel à des
techniques plus subtiles, les Nazis tendaient…, au même but :
celui de la suppression physique des autres peuples : le même terme
de génocide s’y applique, même s’il s’est parfois agi en
l’espèce d’un génocide “à retardement”, plus insidieux et
plus lent».73
Associant le judaïsme au bolchevisme, l’Imaginaire nazi créait un
être de fantaisie comparable d'un Satan juif vêtu de l'uniforme d'un Commissaire du Peuple bolchevique.
l’homme nordique”. À l’égard du Polonais, du Tchèque ou du
Français, le souffle de haine paraît donc absent, qui aurait poussé
à décréter l’extermination de cette bête de somme par ailleurs
si utile, appelée à jouer son rôle dans l’édification du IIIe
Reich millénaire. Les mesures de persécution, en ce qui le concerne
sont motivées tout autrement. Il s’agit dans ce cas de
considérations économiques et démographiques qui, s’insérant
dans le cadre d’un plan impérialiste, visent à assurer la
primauté permanente et certaine de la race germanique; il est
question de courbes de natalité et d’indices de reproduction, de
la prolifération menaçante des Slaves, de la saignée occasionnée
par la guerre parmi les Allemands… Et cependant, partant d’un
point de vue apparemment plus rationnel, et faisant appel à des
techniques plus subtiles, les Nazis tendaient…, au même but :
celui de la suppression physique des autres peuples : le même terme
de génocide s’y applique, même s’il s’est parfois agi en
l’espèce d’un génocide “à retardement”, plus insidieux et
plus lent».73
Associant le judaïsme au bolchevisme, l’Imaginaire nazi créait un
être de fantaisie comparable d'un Satan juif vêtu de l'uniforme d'un Commissaire du Peuple bolchevique. ambiguë, dans l'imagerie populaire, la façon dont se profila la
figure du sous-homme se dessina au fil des contingences. L’Untermenschen
restait
un étant semblant dénué de toute conscience. Comme le note
Carrouges : «Ce
qui est sous-humain le demeure par droit de naissance, le reste
éternellement et ne trouve point à s’exprimer, mais ce qui est
humain le demeure, malgré toute volonté de reniement, d’abjection
et de férocité».74
L’affaire, au départ, pouvait sembler purement théorique, comme
lorsque Paul Valéry lançait comme boutade qu’«un
homme qui n’a jamais tenté de se faire semblable aux dieux, c’est
moins qu’un homme»,75
(Moralités).
Pendant que la tension tchèque était au plus haut, lors de la crise
de Munich (1938), L’Éclaireur
de Nice,
journal de droite, publia en manchette coloriée : «Tous
les Tchécoslovaques du monde ne valent pas les os d’un petit
soldat français!».76
Un an plus tard, ce même type de journal en appelait à la paix à
tous prix, car aucun Français ne méritait d’aller mourir pour Dantzig. De
ambiguë, dans l'imagerie populaire, la façon dont se profila la
figure du sous-homme se dessina au fil des contingences. L’Untermenschen
restait
un étant semblant dénué de toute conscience. Comme le note
Carrouges : «Ce
qui est sous-humain le demeure par droit de naissance, le reste
éternellement et ne trouve point à s’exprimer, mais ce qui est
humain le demeure, malgré toute volonté de reniement, d’abjection
et de férocité».74
L’affaire, au départ, pouvait sembler purement théorique, comme
lorsque Paul Valéry lançait comme boutade qu’«un
homme qui n’a jamais tenté de se faire semblable aux dieux, c’est
moins qu’un homme»,75
(Moralités).
Pendant que la tension tchèque était au plus haut, lors de la crise
de Munich (1938), L’Éclaireur
de Nice,
journal de droite, publia en manchette coloriée : «Tous
les Tchécoslovaques du monde ne valent pas les os d’un petit
soldat français!».76
Un an plus tard, ce même type de journal en appelait à la paix à
tous prix, car aucun Français ne méritait d’aller mourir pour Dantzig. De
 sorte que le Zeitgeist
du temps
favorisait une rapide démonisation des ennemis, et surtout une
déshumanisation articulée sur l’abjection. Comme dans les guerres
coloniales, la propagande nazie s’employait à diffuser la haine
ontologique des adversaires, toujours de plus en plus nombreux et
féroces : «La
déshumanisation de l’ennemi, défini selon les catégories du
lexique nazi, en est l’élément distinctif, comme le montre un
bulletin diffusé aux troupes : “Tous ceux qui ont vu en face un
commissaire rouge savent à quoi ressemble un bolchevik. On n’a pas
besoin d’expressions théoriques. Ce serait insulter les animaux en
présentant ces hommes, qui sont pour la plupart des juifs, comme des
bêtes. Ils sont l’incarnation de la haine satanique contre
l’ensemble de l’humanité noble. L’aspect de ces commissaires
est le miroir de la révolte des sous-hommes contre la noblesse du
sang”».77
Devant cette simple reconnaissance à l’œil, Hitler lançait, à
propos des sous-hommes slaves, que «la
règle qui
sorte que le Zeitgeist
du temps
favorisait une rapide démonisation des ennemis, et surtout une
déshumanisation articulée sur l’abjection. Comme dans les guerres
coloniales, la propagande nazie s’employait à diffuser la haine
ontologique des adversaires, toujours de plus en plus nombreux et
féroces : «La
déshumanisation de l’ennemi, défini selon les catégories du
lexique nazi, en est l’élément distinctif, comme le montre un
bulletin diffusé aux troupes : “Tous ceux qui ont vu en face un
commissaire rouge savent à quoi ressemble un bolchevik. On n’a pas
besoin d’expressions théoriques. Ce serait insulter les animaux en
présentant ces hommes, qui sont pour la plupart des juifs, comme des
bêtes. Ils sont l’incarnation de la haine satanique contre
l’ensemble de l’humanité noble. L’aspect de ces commissaires
est le miroir de la révolte des sous-hommes contre la noblesse du
sang”».77
Devant cette simple reconnaissance à l’œil, Hitler lançait, à
propos des sous-hommes slaves, que «la
règle qui  doit nous guider est la suivante : l’existence de ces
peuples n’a qu’une seule justification - leur utilisation
économique par nous».78
Il était évident qu’on en revenait à l’esclavage, là où le
sujet est dépossédé de sa subjectivation et pour cela,
«l’Untermensch
devait être un analphabète réduit à la condition d’outil.
Hitler, Himmler, Bormann définirent cet objectif et s’employèrent
à le poursuivre avec une logique de fer et une totale absence
d’humanité. Mais, dans ce domaine comme dans les autres, il se
trouva des groupes qui, pour des raisons diverses, refusèrent
d’accepter l’orientation officielle, firent comme s’ils
l’ignoraient, la tournèrent ou la contrecarrèrent. Le programme
élaboré par les fanatiques resta lettre morte ou peu s’en faut :
les événements militaires et les conditions mêmes de l’occupation
interdirent sa réalisation».79
doit nous guider est la suivante : l’existence de ces
peuples n’a qu’une seule justification - leur utilisation
économique par nous».78
Il était évident qu’on en revenait à l’esclavage, là où le
sujet est dépossédé de sa subjectivation et pour cela,
«l’Untermensch
devait être un analphabète réduit à la condition d’outil.
Hitler, Himmler, Bormann définirent cet objectif et s’employèrent
à le poursuivre avec une logique de fer et une totale absence
d’humanité. Mais, dans ce domaine comme dans les autres, il se
trouva des groupes qui, pour des raisons diverses, refusèrent
d’accepter l’orientation officielle, firent comme s’ils
l’ignoraient, la tournèrent ou la contrecarrèrent. Le programme
élaboré par les fanatiques resta lettre morte ou peu s’en faut :
les événements militaires et les conditions mêmes de l’occupation
interdirent sa réalisation».79 comme tels».80
Après les Polonais, ce furent les Ukrainiens, qui avaient pourtant
accueillie les armées de Hitler comme libératrices de la tyrannie
stalinienne, à se trouver assimilés à la sous-humanité :
«Pour
Hitler, pour Gœring, Himmler et Erich Koch, les Ukrainiens étaient
des Untermenschen, tout comme les Russes. Gœring passe pour avoir
déclaré : “Le mieux, ce serait de tuer tous les hommes en
Ukraine, puis d’y envoyer les étalons du S.S.”».81
Cette attitude stratégiquement irréfléchie devait jouer un rôle
important dans la défaite des armées allemandes comme le rappelle
Rhodes : «Les
Russes eurent de la chance sur un point, grâce à l’extraordinaire
aveuglement psychologique des Allemands dans leur manière de traiter
les territoires occupés de l’Est. En Ukraine et en Russie blanche,
ils avaient bénéficié d’une occasion des plus prometteuse, car
bien des gens y étaient violemment anti-soviétiques et les reçurent
à bras ouverts, en libérateurs. Et, cependant, la grande machine de
propagande de Gœbbels entra à peine en action, et s’en dispensa
comme tels».80
Après les Polonais, ce furent les Ukrainiens, qui avaient pourtant
accueillie les armées de Hitler comme libératrices de la tyrannie
stalinienne, à se trouver assimilés à la sous-humanité :
«Pour
Hitler, pour Gœring, Himmler et Erich Koch, les Ukrainiens étaient
des Untermenschen, tout comme les Russes. Gœring passe pour avoir
déclaré : “Le mieux, ce serait de tuer tous les hommes en
Ukraine, puis d’y envoyer les étalons du S.S.”».81
Cette attitude stratégiquement irréfléchie devait jouer un rôle
important dans la défaite des armées allemandes comme le rappelle
Rhodes : «Les
Russes eurent de la chance sur un point, grâce à l’extraordinaire
aveuglement psychologique des Allemands dans leur manière de traiter
les territoires occupés de l’Est. En Ukraine et en Russie blanche,
ils avaient bénéficié d’une occasion des plus prometteuse, car
bien des gens y étaient violemment anti-soviétiques et les reçurent
à bras ouverts, en libérateurs. Et, cependant, la grande machine de
propagande de Gœbbels entra à peine en action, et s’en dispensa
 même entièrement dans tous les territoires russes conquis en 1941
et 1942. […]
La raison en était très simple. Les Nazis considéraient les Slaves
comme des sous-hommes illettrés, envers lesquels c’eût été du
gaspillage que d’employer la propagande : on devait les forcer à
se soumettre par la simple force brutale».82
Après le début foudroyant de l’offensive en U.R.S.S., la
propagande nazie pouvait prouver hors de tous doutes la sous-humanité
de l’adversaire : «Malgré
le renfort de Guderian, von Rundstedt ne parvint à encercler Kiev
qu’à la mi-septembre. Comme Staline n’avait aucun renfort à
envoyer aux quelque 600 000 soldats pris au piège, il se résigna :
la capitale de l’Ukraine se
même entièrement dans tous les territoires russes conquis en 1941
et 1942. […]
La raison en était très simple. Les Nazis considéraient les Slaves
comme des sous-hommes illettrés, envers lesquels c’eût été du
gaspillage que d’employer la propagande : on devait les forcer à
se soumettre par la simple force brutale».82
Après le début foudroyant de l’offensive en U.R.S.S., la
propagande nazie pouvait prouver hors de tous doutes la sous-humanité
de l’adversaire : «Malgré
le renfort de Guderian, von Rundstedt ne parvint à encercler Kiev
qu’à la mi-septembre. Comme Staline n’avait aucun renfort à
envoyer aux quelque 600 000 soldats pris au piège, il se résigna :
la capitale de l’Ukraine se  rendit. Le 19 septembre, des unités de
la VIe armée, commandées par von Reichenau, entrèrent dans la
place : une semaine plus tard, la bataille de Kiev, l’une des plus
importantes batailles de l’histoire, était enfin terminée. La
Wehrmacht avait totalement écrasé sept armées ennemies, tuant ou
blessant 350 000 hommes et faisant plus de 650 000 prisonniers, ce
qui portait à plus d’un million trois cent mille le total des
Soviétiques captifs des Allemands. La propagande nazie célébra
bruyamment la prise de Kiev. Les photographies et les actualités
filmées montraient les soldats russes au moment de leur capture,
sales et l’air égaré, image frappante de l’Untermensch slave, à
qui seule convenait la servitude. Berlin proclama bien haut qu’il
suffirait à l’Allemagne de livrer encore quelques batailles
mineures pour vaincre définitivement les Russes».83
Le corollaire que n’importe qui soumis à cette propagande pouvait
tirer consistait à tenir l'extermination du Juif comme nécessité
complémentaire
à
la
rendit. Le 19 septembre, des unités de
la VIe armée, commandées par von Reichenau, entrèrent dans la
place : une semaine plus tard, la bataille de Kiev, l’une des plus
importantes batailles de l’histoire, était enfin terminée. La
Wehrmacht avait totalement écrasé sept armées ennemies, tuant ou
blessant 350 000 hommes et faisant plus de 650 000 prisonniers, ce
qui portait à plus d’un million trois cent mille le total des
Soviétiques captifs des Allemands. La propagande nazie célébra
bruyamment la prise de Kiev. Les photographies et les actualités
filmées montraient les soldats russes au moment de leur capture,
sales et l’air égaré, image frappante de l’Untermensch slave, à
qui seule convenait la servitude. Berlin proclama bien haut qu’il
suffirait à l’Allemagne de livrer encore quelques batailles
mineures pour vaincre définitivement les Russes».83
Le corollaire que n’importe qui soumis à cette propagande pouvait
tirer consistait à tenir l'extermination du Juif comme nécessité
complémentaire
à
la  soumission slave,
«par
conséquent, les soldats du front oriental ne sont pas les
combattants d’une guerre ordinaire mais les “porteurs d’une
conception raciale inexorable et les vengeurs de toutes les
brutalités subies par les Germains”. C’est pourquoi ils doivent
comprendre clairement la “nécessité de mesures dures mais justes
contre la sous-humanité juive.
[…] C’est
ainsi que nous pourrons accomplir notre mission historique: libérer
une fois pour toutes le peuple allemand de la menace
judéo-asiatique”».84
Gœbbels pouvait noter ainsi dans son journal : «“Les
Russes ne sont pas des êtres humains, mais un conglomérat
d’animaux”. Et Hitler renchérissait dans un ordre du jour aux
forces armées : “Ces ennemis ne sont pas des soldats, mais presque
tous des bêtes brutes”. De telles convictions expliquent que loin
de faire exception, la brutalité soit devenue la norme».85
Le surhomme allemand reprenait la métaphore du chevalier abattant le
dragon pour sauver l’humanité. Il luttait contre la barbarie d'une
sous-humanité bestiale; cette alliance obsidionale entre les Juifs
de l’intérieur et les bolcheviques slaves à l’extérieur. Il
satisfaisait ainsi la structure haineuse de l’Occident établie
entre le XIIIe et le XVe siècle.86
soumission slave,
«par
conséquent, les soldats du front oriental ne sont pas les
combattants d’une guerre ordinaire mais les “porteurs d’une
conception raciale inexorable et les vengeurs de toutes les
brutalités subies par les Germains”. C’est pourquoi ils doivent
comprendre clairement la “nécessité de mesures dures mais justes
contre la sous-humanité juive.
[…] C’est
ainsi que nous pourrons accomplir notre mission historique: libérer
une fois pour toutes le peuple allemand de la menace
judéo-asiatique”».84
Gœbbels pouvait noter ainsi dans son journal : «“Les
Russes ne sont pas des êtres humains, mais un conglomérat
d’animaux”. Et Hitler renchérissait dans un ordre du jour aux
forces armées : “Ces ennemis ne sont pas des soldats, mais presque
tous des bêtes brutes”. De telles convictions expliquent que loin
de faire exception, la brutalité soit devenue la norme».85
Le surhomme allemand reprenait la métaphore du chevalier abattant le
dragon pour sauver l’humanité. Il luttait contre la barbarie d'une
sous-humanité bestiale; cette alliance obsidionale entre les Juifs
de l’intérieur et les bolcheviques slaves à l’extérieur. Il
satisfaisait ainsi la structure haineuse de l’Occident établie
entre le XIIIe et le XVe siècle.86 le
phénomène de l’abjection dépassait de beaucoup cette conception
ontologique du Untermensch.
En ce
sens, c’est ailleurs qu’il faut chercher l'étendue de la
sous-humanité chez les puissances alliées. Luttant pour la
civilisation, la paix et les droits de l’homme, ces puissances
démocratiques ne pouvaient se permettre d’afficher, même envers
les barbares teutons, le statut ontologique de l'abject, d’autant
plus que les combattants n’étaient guère mieux traités par les
dirigeants des forces armées libérales que les soldats allemands ou
italiens. Les mêmes scènes de sacrifices et de gaspillage en vies
humaines pour des symboles de victoire, qui avaient fait l'horreur de
la
le
phénomène de l’abjection dépassait de beaucoup cette conception
ontologique du Untermensch.
En ce
sens, c’est ailleurs qu’il faut chercher l'étendue de la
sous-humanité chez les puissances alliées. Luttant pour la
civilisation, la paix et les droits de l’homme, ces puissances
démocratiques ne pouvaient se permettre d’afficher, même envers
les barbares teutons, le statut ontologique de l'abject, d’autant
plus que les combattants n’étaient guère mieux traités par les
dirigeants des forces armées libérales que les soldats allemands ou
italiens. Les mêmes scènes de sacrifices et de gaspillage en vies
humaines pour des symboles de victoire, qui avaient fait l'horreur de
la  Première Guerre mondiale, se renouvelèrent lors de la Seconde.
(Dieppe répondait fort bien à Gallipoli). Plutôt qu’à un type
défini de sous-espèce humaine, il faut tourner notre regard vers la
conception libérale et mécaniste remontant au XVIIIe siècle de
l’homme-machine
pour
trouver l'ombre de la sous-humanité.
Celle-ci
était constituée par la vision de l’automatisme des comportements
entre l’ordre donné et l’exécution accomplie. On attendait des
combattants comme des civils, les qualités de l’ouvrier-automate
sur la chaîne de montage : fonctionnalité, efficacité,
productivité, déchié
lorsque devenu inopérant. Transposées dans le monde humain, les
qualités de l’automate les faisait rejoindre le statut de
l’abject. Contre l'abjection extraordinaire exploitée par les
puissances de l'Axe, la banalité de la manipulation des automates
démocrates représente une insignifiance sur laquelle personne n'ose
vraiment s'arrêter.
Première Guerre mondiale, se renouvelèrent lors de la Seconde.
(Dieppe répondait fort bien à Gallipoli). Plutôt qu’à un type
défini de sous-espèce humaine, il faut tourner notre regard vers la
conception libérale et mécaniste remontant au XVIIIe siècle de
l’homme-machine
pour
trouver l'ombre de la sous-humanité.
Celle-ci
était constituée par la vision de l’automatisme des comportements
entre l’ordre donné et l’exécution accomplie. On attendait des
combattants comme des civils, les qualités de l’ouvrier-automate
sur la chaîne de montage : fonctionnalité, efficacité,
productivité, déchié
lorsque devenu inopérant. Transposées dans le monde humain, les
qualités de l’automate les faisait rejoindre le statut de
l’abject. Contre l'abjection extraordinaire exploitée par les
puissances de l'Axe, la banalité de la manipulation des automates
démocrates représente une insignifiance sur laquelle personne n'ose
vraiment s'arrêter. Londres, Paris, Berlin ou New York ont attiré des citoyens venus des
régions, mais parce que ces grandes métropoles – et des villes
moins peuplées mais centrées autour de la production industrielle –
ont modifié les mœurs et les comportements qui se sont de plus en
plus individualisés. Toutefois, parallèlement à cette
individuation un phénomène de dissimulation s'esquissait à travers
des mouvements de foule qui finissaient par devenir autant
d’individualités temporaires. Formée par un effet centripète,
la foule se disloquait dans la dispersion, contre-effet centrifuge
qui ramenait chaque individu dans son isolement. Les comportements
automatiques des individus provenaient des nouvelles opérations de
la productivité et du milieu du travail. Des films populaires comme
À nous la
liberté (1931)
de René Clair et Modern
Times
de
Chaplin (1936), avec leurs scènes hallucinantes du taylorisme et
surtout l’invention du robot qui doit permettre au travailleur de
prendre son repas tout en
Londres, Paris, Berlin ou New York ont attiré des citoyens venus des
régions, mais parce que ces grandes métropoles – et des villes
moins peuplées mais centrées autour de la production industrielle –
ont modifié les mœurs et les comportements qui se sont de plus en
plus individualisés. Toutefois, parallèlement à cette
individuation un phénomène de dissimulation s'esquissait à travers
des mouvements de foule qui finissaient par devenir autant
d’individualités temporaires. Formée par un effet centripète,
la foule se disloquait dans la dispersion, contre-effet centrifuge
qui ramenait chaque individu dans son isolement. Les comportements
automatiques des individus provenaient des nouvelles opérations de
la productivité et du milieu du travail. Des films populaires comme
À nous la
liberté (1931)
de René Clair et Modern
Times
de
Chaplin (1936), avec leurs scènes hallucinantes du taylorisme et
surtout l’invention du robot qui doit permettre au travailleur de
prendre son repas tout en  continuant à serrer des boulons sur la
chaîne de montage, traduisaient une impression d’enfer mécanisé
qui finissait par broyer le travailleur. De tels individus
conditionnés par le travail industriel devenaient des proies faciles
pour la manipulation hypnotique, qui «se
traduit par une limitation du regard, des sensations à un très
petit nombre de stimuli. C’est une privation sensorielle qui
restreint le contact avec le monde extérieur et a pour conséquence
de faire tomber le sujet dans un état hypnoïde de rêve éveillé.
Le patient, qui dépend affectivement de l’hypnotiseur et voit son
champ de sensations et d’idées limité par celui-ci, se trouve
plongé dans une transe. Il obéit entièrement aux ordres qu’on
lui donne, exécute les actes qu’on lui demande d’exécuter,
prononce les paroles qu’on lui ordonne de prononcer, sans avoir la
moindre conscience de ce qu’il fait ou de ce qu’il dit. Entre les
mains de l’hypnotiseur, il devient une sorte d’automate qui élève le bras, marche, crie, sans se rendre compte ni savoir pourquoi».87
L’image classique de l’homme-machine prenait un sens littéral :
non seulement l’individu se comportait comme une
continuant à serrer des boulons sur la
chaîne de montage, traduisaient une impression d’enfer mécanisé
qui finissait par broyer le travailleur. De tels individus
conditionnés par le travail industriel devenaient des proies faciles
pour la manipulation hypnotique, qui «se
traduit par une limitation du regard, des sensations à un très
petit nombre de stimuli. C’est une privation sensorielle qui
restreint le contact avec le monde extérieur et a pour conséquence
de faire tomber le sujet dans un état hypnoïde de rêve éveillé.
Le patient, qui dépend affectivement de l’hypnotiseur et voit son
champ de sensations et d’idées limité par celui-ci, se trouve
plongé dans une transe. Il obéit entièrement aux ordres qu’on
lui donne, exécute les actes qu’on lui demande d’exécuter,
prononce les paroles qu’on lui ordonne de prononcer, sans avoir la
moindre conscience de ce qu’il fait ou de ce qu’il dit. Entre les
mains de l’hypnotiseur, il devient une sorte d’automate qui élève le bras, marche, crie, sans se rendre compte ni savoir pourquoi».87
L’image classique de l’homme-machine prenait un sens littéral :
non seulement l’individu se comportait comme une  machine au
travail, mais il vivait sur le mode machinal de la technique et de la
mécanique. Ainsi hypnotisé, l’individu descendait au dernier
barreau de l’échelle ontologique et n’était plus perçu
autrement qu’en automate : «L’homme
apparaît alors comme un automate psychique agissant sous une
impulsion extérieure. Il accomplit facilement ce qu’on lui ordonne
de faire, reproduit un
habitus
inscrit dans sa mémoire, sans en avoir conscience. Les psychiatres
semblent imiter dans leurs cliniques les automates fabriqués par
Vaucanson dans ses ateliers. Ils fascinent autant que ces derniers et
ont fasciné les psychologues Le Bon et Tarde, mais encore le poète
André Breton. Le rapprochement s’impose : le surréalisme
transpose sur le plan artistique les découvertes de l’hypnose
comme la psychologie des foules les exploite sur le plan social.
L’écriture automatique et les rêveries psychiques des
surréalistes doivent beaucoup plus aux maîtres de Nancy qu’au
maître de Vienne…».88
Lorsque l’homme-machine quitte son lieu de travail, il répète
inconsciemment son organisation. Horaire quotidien des tâches,
régularité chronométré
machine au
travail, mais il vivait sur le mode machinal de la technique et de la
mécanique. Ainsi hypnotisé, l’individu descendait au dernier
barreau de l’échelle ontologique et n’était plus perçu
autrement qu’en automate : «L’homme
apparaît alors comme un automate psychique agissant sous une
impulsion extérieure. Il accomplit facilement ce qu’on lui ordonne
de faire, reproduit un
habitus
inscrit dans sa mémoire, sans en avoir conscience. Les psychiatres
semblent imiter dans leurs cliniques les automates fabriqués par
Vaucanson dans ses ateliers. Ils fascinent autant que ces derniers et
ont fasciné les psychologues Le Bon et Tarde, mais encore le poète
André Breton. Le rapprochement s’impose : le surréalisme
transpose sur le plan artistique les découvertes de l’hypnose
comme la psychologie des foules les exploite sur le plan social.
L’écriture automatique et les rêveries psychiques des
surréalistes doivent beaucoup plus aux maîtres de Nancy qu’au
maître de Vienne…».88
Lorsque l’homme-machine quitte son lieu de travail, il répète
inconsciemment son organisation. Horaire quotidien des tâches,
régularité chronométré  des activités, compulsions de répétitions
dans les gestes quotidiens, ce qu’on appelle «récupération»
n’est plus qu’un sommeil stressé et épuisant : «Ici
et là, le sommeil dissout la conscience et la raison. Mis sous forme
abrupte, ceci signifie que les foules vivent en automates. Elles sont
sensibles à ce qui frappe leur mémoire et réagissent à l’aspect
visible d’une idée abstraite. Elles aiment recevoir une réponse
simple, souvent réitérée, pour trancher une question compliquée,
comme un glaive le nœud gordien. En somme, l’idéal est de leur
présenter la solution avant qu’elles aient dû prendre la peine
d’écouter le problème. Bref, la logique de la foule commence là
où celle de l’individu finie».89
En perdant l’identité de sa personnalité, l’individu cesse
d’être lui-même. Il n’a pas à se tenir en foules pour être un
homme de la foule. L’aliénation psychologique et sociale atteint
un degré de perfectionnement inusité. Comme s’en étonne
Moscovici, «ceci
ne laisse pas d’être l’énigme la plus troublante entre ciel et
terre : le petit nombre réussit toujours à gouverner le grand
nombre, et avec son consentement. Le petit nombre lui-même finit par
se condenser en un point, le chef, comme la lumière en un foyer».90
C’est ce consentement
qui cause
problème ontologique et existentiel : quel type d’humanité
peut volontairement
accepter
sa réduction au simple fonctionnement d’un robot?
La sous-humanité, va sans dire.
des activités, compulsions de répétitions
dans les gestes quotidiens, ce qu’on appelle «récupération»
n’est plus qu’un sommeil stressé et épuisant : «Ici
et là, le sommeil dissout la conscience et la raison. Mis sous forme
abrupte, ceci signifie que les foules vivent en automates. Elles sont
sensibles à ce qui frappe leur mémoire et réagissent à l’aspect
visible d’une idée abstraite. Elles aiment recevoir une réponse
simple, souvent réitérée, pour trancher une question compliquée,
comme un glaive le nœud gordien. En somme, l’idéal est de leur
présenter la solution avant qu’elles aient dû prendre la peine
d’écouter le problème. Bref, la logique de la foule commence là
où celle de l’individu finie».89
En perdant l’identité de sa personnalité, l’individu cesse
d’être lui-même. Il n’a pas à se tenir en foules pour être un
homme de la foule. L’aliénation psychologique et sociale atteint
un degré de perfectionnement inusité. Comme s’en étonne
Moscovici, «ceci
ne laisse pas d’être l’énigme la plus troublante entre ciel et
terre : le petit nombre réussit toujours à gouverner le grand
nombre, et avec son consentement. Le petit nombre lui-même finit par
se condenser en un point, le chef, comme la lumière en un foyer».90
C’est ce consentement
qui cause
problème ontologique et existentiel : quel type d’humanité
peut volontairement
accepter
sa réduction au simple fonctionnement d’un robot?
La sous-humanité, va sans dire. François-Joseph demande quelque chose, le gouvernement serbe n’a
qu’à s’incliner. Sinon il n’y a qu’à bombarder Belgrade et
à l’occuper jusqu’à ce que la volonté de Sa Majesté soit
exécutée…».91
Cette vision se distinguait toutefois de celle du futur Führer par
l’esprit. Guillaume II, bien que protestant, réagissait comme un
Jésuite : perinde ac cadaver.
Rien en soi de différent avec ce que pensait un quelconque despote
éclairé ou empereur issu du Congrès de Vienne. Les peuples étaient
faits pour obéir à leurs maîtres. Mais l’expérience
démocratique, inlassablement répétée depuis 1792, finissait par changer cette habitude d’obéir comme des cadavres à un tyran. En
retour, le salariat et la toute-puissance du patronat sur le monde
François-Joseph demande quelque chose, le gouvernement serbe n’a
qu’à s’incliner. Sinon il n’y a qu’à bombarder Belgrade et
à l’occuper jusqu’à ce que la volonté de Sa Majesté soit
exécutée…».91
Cette vision se distinguait toutefois de celle du futur Führer par
l’esprit. Guillaume II, bien que protestant, réagissait comme un
Jésuite : perinde ac cadaver.
Rien en soi de différent avec ce que pensait un quelconque despote
éclairé ou empereur issu du Congrès de Vienne. Les peuples étaient
faits pour obéir à leurs maîtres. Mais l’expérience
démocratique, inlassablement répétée depuis 1792, finissait par changer cette habitude d’obéir comme des cadavres à un tyran. En
retour, le salariat et la toute-puissance du patronat sur le monde
 ouvrier imposaient, par des contraintes
extra-économiques (la
violence), l’obéissance passive des travailleurs enchaînés à
leurs machines. Le mot robot
fut
employé par le dramaturge tchèque Karel Čapek - qui l’avait
emprunté à son frère Josef et qui signifiait travail,
torture, corvée -,
pour sa pièce R.U.R. Karel échappa à son arrestation planifiée par la Gestapo d’un
œdème pulmonaire le 25 décembre 1938; son frère Josef eut moins
de chance, qui mourut au camp de Bergen-Belsen en avril 1945. La
pièce de Karel Čapek faisait apparaître une première forme
mécanique de Golem, ce qui rappelait une permanence judéo-tchèque
remontant aux expériences alchimiques du XVIe siècle : «Aussi
bien
Homonculus
que Le
Golem
brossaient les portraits de personnages dont les traits anormaux
étaient attribués à leurs origines anormales. Mais postuler de
telles origines est en réalité un subterfuge poétique
rationalisant le fait, apparemment inexplicable, que ces héros sont,
ou se sentent, différents des autres créatures. Qu’est-ce qui les
fait si différents? Homonculus formule la raison que le Golem ne
ouvrier imposaient, par des contraintes
extra-économiques (la
violence), l’obéissance passive des travailleurs enchaînés à
leurs machines. Le mot robot
fut
employé par le dramaturge tchèque Karel Čapek - qui l’avait
emprunté à son frère Josef et qui signifiait travail,
torture, corvée -,
pour sa pièce R.U.R. Karel échappa à son arrestation planifiée par la Gestapo d’un
œdème pulmonaire le 25 décembre 1938; son frère Josef eut moins
de chance, qui mourut au camp de Bergen-Belsen en avril 1945. La
pièce de Karel Čapek faisait apparaître une première forme
mécanique de Golem, ce qui rappelait une permanence judéo-tchèque
remontant aux expériences alchimiques du XVIe siècle : «Aussi
bien
Homonculus
que Le
Golem
brossaient les portraits de personnages dont les traits anormaux
étaient attribués à leurs origines anormales. Mais postuler de
telles origines est en réalité un subterfuge poétique
rationalisant le fait, apparemment inexplicable, que ces héros sont,
ou se sentent, différents des autres créatures. Qu’est-ce qui les
fait si différents? Homonculus formule la raison que le Golem ne
 connaissait qu’obscurément : “Je suis privé de la chose la plus
grande que la vie puisse offrir!” Il pense à son incapacité de
donner ou de recevoir de l’amour - un défaut qui ne peut que lui
donner un fort sentiment d’infériorité. À peu près à l’époque
où
Homonculus
faisait son apparition sur les écrans, le philosophe allemand Max
Scheler donnait des conférences publiques sur les causes de la haine
que l’Allemagne soulevait partout dans le monde. Les Allemands
ressemblaient à Homonculus : eux-mêmes avaient un complexe
d’infériorité, en raison d’un développement historique qui
avait prouvé être destructeur pour la confiance en soi de la classe
moyenne. À la différence des Anglais et des Français, les
Allemands avaient échoué dans la réalisation de leur révolution
et, par conséquent, n’avaient jamais réussi à établir une
société véritablement démocratique».92
Les origines de ce complexe de haine de soi, qui s’étendait sur un
horizon beaucoup plus large que le supposait Scheler, entraînaient
les Allemands à regarder les Slaves comme des robots.
connaissait qu’obscurément : “Je suis privé de la chose la plus
grande que la vie puisse offrir!” Il pense à son incapacité de
donner ou de recevoir de l’amour - un défaut qui ne peut que lui
donner un fort sentiment d’infériorité. À peu près à l’époque
où
Homonculus
faisait son apparition sur les écrans, le philosophe allemand Max
Scheler donnait des conférences publiques sur les causes de la haine
que l’Allemagne soulevait partout dans le monde. Les Allemands
ressemblaient à Homonculus : eux-mêmes avaient un complexe
d’infériorité, en raison d’un développement historique qui
avait prouvé être destructeur pour la confiance en soi de la classe
moyenne. À la différence des Anglais et des Français, les
Allemands avaient échoué dans la réalisation de leur révolution
et, par conséquent, n’avaient jamais réussi à établir une
société véritablement démocratique».92
Les origines de ce complexe de haine de soi, qui s’étendait sur un
horizon beaucoup plus large que le supposait Scheler, entraînaient
les Allemands à regarder les Slaves comme des robots.  métaphysique, l’animal
rationale,
est mis en place comme bête de labeur”. Si le Travailleur n’est
pas seulement compris comme catégorie socio-économique ni comme
réalité historique, mais comme la suprême actualisation de
l’animal
rationale,
la Technique, en tant qu’elle régit le travail tel qu’il se
déploie dans notre monde moderne, devra être pensée comme
appartenant au destin de l’Achèvement de la Métaphysique, le
Travailleur, comme “fonctionnaire de la Technique” est l’animal
(la “bête”)
rationale
(“déterminée” (est-gestellt);
le monde de la Technique est la Métaphysique faite monde. “La
technique mécanisée reste jusqu’ici le prolongement le plus
visible de l’essence de la Technique moderne,
laquelle est identique à l’essence de la métaphysique moderne”.
Et encore
:
métaphysique, l’animal
rationale,
est mis en place comme bête de labeur”. Si le Travailleur n’est
pas seulement compris comme catégorie socio-économique ni comme
réalité historique, mais comme la suprême actualisation de
l’animal
rationale,
la Technique, en tant qu’elle régit le travail tel qu’il se
déploie dans notre monde moderne, devra être pensée comme
appartenant au destin de l’Achèvement de la Métaphysique, le
Travailleur, comme “fonctionnaire de la Technique” est l’animal
(la “bête”)
rationale
(“déterminée” (est-gestellt);
le monde de la Technique est la Métaphysique faite monde. “La
technique mécanisée reste jusqu’ici le prolongement le plus
visible de l’essence de la Technique moderne,
laquelle est identique à l’essence de la métaphysique moderne”.
Et encore
:  “La métaphysique achevée, qui est la base même d’un mode de
pensée “planétaire”, fournit la
charpente d’un ordre terrestre
vraisemblablement appelé à une longue durée. Cet ordre n’a plus
besoin de la philosophie parce qu’il la possède déjà à sa
base”. Dans quelle mesure l’essence de la Technique est-elle
identique à l’essence de la Métaphysique achevée, c’est-à-dire
à la Volonté de Volonté? Mais d’abord, qu’en est-il de son
essence (Wesen)?».93
Jamais l'identité
entre
l’animal et le sous-homme n’aura été aussi bien affirmée qu'à
travers ce concept d’animal
rationale de
Heidegger. La question n’est pas à savoir si Heidegger approuvait
ou condamnait cette condensation ontologique, mais qu’elle fut
parfaitement conceptualisée en dehors des catégories strictement
nazies montre que l’ensemble de la société industrielle prenait
très bien conscience de ce qu’il en coûtait de vivre sous un mode
de production capitaliste. La pratique la plus évidente de cette
condensation se produisit aussi bien sous le fordisme américain que
“La métaphysique achevée, qui est la base même d’un mode de
pensée “planétaire”, fournit la
charpente d’un ordre terrestre
vraisemblablement appelé à une longue durée. Cet ordre n’a plus
besoin de la philosophie parce qu’il la possède déjà à sa
base”. Dans quelle mesure l’essence de la Technique est-elle
identique à l’essence de la Métaphysique achevée, c’est-à-dire
à la Volonté de Volonté? Mais d’abord, qu’en est-il de son
essence (Wesen)?».93
Jamais l'identité
entre
l’animal et le sous-homme n’aura été aussi bien affirmée qu'à
travers ce concept d’animal
rationale de
Heidegger. La question n’est pas à savoir si Heidegger approuvait
ou condamnait cette condensation ontologique, mais qu’elle fut
parfaitement conceptualisée en dehors des catégories strictement
nazies montre que l’ensemble de la société industrielle prenait
très bien conscience de ce qu’il en coûtait de vivre sous un mode
de production capitaliste. La pratique la plus évidente de cette
condensation se produisit aussi bien sous le fordisme américain que
 le stakhanovisme soviétique : «“Le
prisonnier doit se mettre dans la tête le plus tôt possible”,
confirme un socialiste polonais, dans
La Face invisible de la lune,
“qu’il n’est rien d’autre qu’un objet et que personne n’a
aucune raison de se soucier particulièrement de la façon dont on le
traite”. Dans d’autres systèmes aussi, le prisonnier a été
traité en “objet”. Mais chez le communiste, la distinction entre
l’individu et l’espèce humaine n’est pas un accident dû à
l’endurcissement de la police, de l’armée ou de l’administration
coloniale. Elle est la conséquence même de sa conception
métaphysique de l’homme dans ses relations avec la réalité, et
il la justifie par la métaphysique. Pour le communiste, une personne
placée dans une situation telle qu’elle ne puisse avoir ni passé
ni avenir, par exemple les accusés des procès de Moscou, une telle
personne a littéralement perdu son identité humaine. Lorsque
Vychinsky appelle Boukharine “le maudit bâtard d’un renard et
d’un porc” et d’autres “des bêtes sous forme humaine”, et
lorsqu’il demande pour finir qu’ils “soient abattus comme des
chiens”, ce n’est pas seulement une vitupération hystérique.
L’image zoologique relève d’une tentative sérieuse pour définir
par analogie des créatures qui
le stakhanovisme soviétique : «“Le
prisonnier doit se mettre dans la tête le plus tôt possible”,
confirme un socialiste polonais, dans
La Face invisible de la lune,
“qu’il n’est rien d’autre qu’un objet et que personne n’a
aucune raison de se soucier particulièrement de la façon dont on le
traite”. Dans d’autres systèmes aussi, le prisonnier a été
traité en “objet”. Mais chez le communiste, la distinction entre
l’individu et l’espèce humaine n’est pas un accident dû à
l’endurcissement de la police, de l’armée ou de l’administration
coloniale. Elle est la conséquence même de sa conception
métaphysique de l’homme dans ses relations avec la réalité, et
il la justifie par la métaphysique. Pour le communiste, une personne
placée dans une situation telle qu’elle ne puisse avoir ni passé
ni avenir, par exemple les accusés des procès de Moscou, une telle
personne a littéralement perdu son identité humaine. Lorsque
Vychinsky appelle Boukharine “le maudit bâtard d’un renard et
d’un porc” et d’autres “des bêtes sous forme humaine”, et
lorsqu’il demande pour finir qu’ils “soient abattus comme des
chiens”, ce n’est pas seulement une vitupération hystérique.
L’image zoologique relève d’une tentative sérieuse pour définir
par analogie des créatures qui 
 sont d’une autre espèce que
l’homme».94
Ce serait donc une grave erreur d’attribuer à la seule métaphore
rhétorique des nazis le fait de réduire la sous-humanité à
l’animalité lorsqu’ils inversent le rapport homme/chien par
exemple, puisque de l’autre côté de la ligne de front, les
soviétiques employaient les mêmes métaphores animales (les vipères
lubriques de
Staline).
C’est dans la mesure où la condensation animal/sous-homme
s'opérait dans la figure de l’ouvrier, du paysan et du soldat que
l'amplification haineuse s'effectua en temps de guerre. Le S.S.,
petit-bourgeois, voyait son doppelgänger
dans le
«musulman» qu’il humiliait en le traitant de chien comme
Vychinsky voyait en Boukharine le doppelgänger
de
lui-même.
sont d’une autre espèce que
l’homme».94
Ce serait donc une grave erreur d’attribuer à la seule métaphore
rhétorique des nazis le fait de réduire la sous-humanité à
l’animalité lorsqu’ils inversent le rapport homme/chien par
exemple, puisque de l’autre côté de la ligne de front, les
soviétiques employaient les mêmes métaphores animales (les vipères
lubriques de
Staline).
C’est dans la mesure où la condensation animal/sous-homme
s'opérait dans la figure de l’ouvrier, du paysan et du soldat que
l'amplification haineuse s'effectua en temps de guerre. Le S.S.,
petit-bourgeois, voyait son doppelgänger
dans le
«musulman» qu’il humiliait en le traitant de chien comme
Vychinsky voyait en Boukharine le doppelgänger
de
lui-même. Frères
Karamazov de
Dostoïevski. Rappelons le drame : «Le
Christ est revenu sur terre; comme il traversait Séville en faisant
des miracles, il est jeté en prison par le grand Inquisiteur et dans
la nuit celui-ci vient lui parler: “Tu nous déranges : je te ferai
brûler! Tu n’as pas le droit d’ajouter à ce que tu as dit
autrefois. En apportant aux hommes la liberté, tu ne les as pas
rendus heureux, car il n’est rien qui leur soit à charge plus que
la liberté. Tu pouvais changer les pierres en pains, et tu as
répliqué que l’homme ne vit pas seulement de pain : eh bien! au
nom de ce pain on s’insurgera contre toi; on dira qu’il n’y a
pas de criminels, mais des affamés; on élèvera une nouvelle Tour
de Babel. Ce seront des milliers d’années de souffrances. Tu
promettais le pain du ciel, et à cause de lui des milliers d’âmes
te suivront; mais tu n’as pas pensé aux millions, à la multitude
innombrable qui t’aime, mais qui est faible! Alors c’est nous qui
devrons les nourrir, soi-disant en ton nom, en prenant sur nous le
poids de la liberté qui les effrayait, et cette imposture sera notre
souffrance. Tu as refusé le pouvoir, alors que le tourment des
hommes a toujours été de trouver une force à adorer en commun. Tu
as refusé de te jeter du haut du pinacle, tu n’es pas descendu de
la croix quand on t’en défiait, pour ne pas forcer la foi. Mais tu
te faisais une trop haute idée des hommes.
Frères
Karamazov de
Dostoïevski. Rappelons le drame : «Le
Christ est revenu sur terre; comme il traversait Séville en faisant
des miracles, il est jeté en prison par le grand Inquisiteur et dans
la nuit celui-ci vient lui parler: “Tu nous déranges : je te ferai
brûler! Tu n’as pas le droit d’ajouter à ce que tu as dit
autrefois. En apportant aux hommes la liberté, tu ne les as pas
rendus heureux, car il n’est rien qui leur soit à charge plus que
la liberté. Tu pouvais changer les pierres en pains, et tu as
répliqué que l’homme ne vit pas seulement de pain : eh bien! au
nom de ce pain on s’insurgera contre toi; on dira qu’il n’y a
pas de criminels, mais des affamés; on élèvera une nouvelle Tour
de Babel. Ce seront des milliers d’années de souffrances. Tu
promettais le pain du ciel, et à cause de lui des milliers d’âmes
te suivront; mais tu n’as pas pensé aux millions, à la multitude
innombrable qui t’aime, mais qui est faible! Alors c’est nous qui
devrons les nourrir, soi-disant en ton nom, en prenant sur nous le
poids de la liberté qui les effrayait, et cette imposture sera notre
souffrance. Tu as refusé le pouvoir, alors que le tourment des
hommes a toujours été de trouver une force à adorer en commun. Tu
as refusé de te jeter du haut du pinacle, tu n’es pas descendu de
la croix quand on t’en défiait, pour ne pas forcer la foi. Mais tu
te faisais une trop haute idée des hommes.  N’es-tu venu que pour
les forts? Nous avons corrigé ton œuvre en la fondant sur le
miracle, le mystère, l’autorité. Et nous donnerons ainsi le repos
non pas à des élus, mais à tous les hommes; ils auront le bonheur
qui convient à leur faiblesse : ils travailleront, et nous
organiserons pour eux des chants, des danses, des jeux; ils mourront
doucement, et nous les bercerons de l’espoir d’une récompense
éternelle. Nous seuls serons chargés de leurs péchés».95
Ce qui est insupportable du paria, comme du Christ de Dostoïevski,
c’est qu’il préfère la liberté à la sécurité qui se paie de
soumissions. Sa présence même est une insulte à la figure du
surhomme. C’est alors qu’il revêt, contre son gré, le manteau
de l’Antéchrist. Pourtant, ses qualités nietzschéennes en font
un être qui mériterait d’être classé dans la surhumanité :
«Le vieux
cardinal est une figure majestueuse et tragique. Il a consacré sa
vie entière à servir le Christ avec abnégation, à macérer sa
chair dans un ermitage et, subitement, au déclin de ses jours, il a
perdu la foi. “Est-ce qu’il ne suffit pas d’un seul homme de ce
genre pour qu’il ait tragédie?” demande Ivan. Et, de fait, la
perte de la foi est la profonde tragédie de l’Inquisiteur : sans
croire en Dieu, il se charge du mensonge et de la tromperie et il
accepte cette souffrance “par amour des hommes”. L’auteur
méprise l’arme
N’es-tu venu que pour
les forts? Nous avons corrigé ton œuvre en la fondant sur le
miracle, le mystère, l’autorité. Et nous donnerons ainsi le repos
non pas à des élus, mais à tous les hommes; ils auront le bonheur
qui convient à leur faiblesse : ils travailleront, et nous
organiserons pour eux des chants, des danses, des jeux; ils mourront
doucement, et nous les bercerons de l’espoir d’une récompense
éternelle. Nous seuls serons chargés de leurs péchés».95
Ce qui est insupportable du paria, comme du Christ de Dostoïevski,
c’est qu’il préfère la liberté à la sécurité qui se paie de
soumissions. Sa présence même est une insulte à la figure du
surhomme. C’est alors qu’il revêt, contre son gré, le manteau
de l’Antéchrist. Pourtant, ses qualités nietzschéennes en font
un être qui mériterait d’être classé dans la surhumanité :
«Le vieux
cardinal est une figure majestueuse et tragique. Il a consacré sa
vie entière à servir le Christ avec abnégation, à macérer sa
chair dans un ermitage et, subitement, au déclin de ses jours, il a
perdu la foi. “Est-ce qu’il ne suffit pas d’un seul homme de ce
genre pour qu’il ait tragédie?” demande Ivan. Et, de fait, la
perte de la foi est la profonde tragédie de l’Inquisiteur : sans
croire en Dieu, il se charge du mensonge et de la tromperie et il
accepte cette souffrance “par amour des hommes”. L’auteur
méprise l’arme  facile de la lutte contre l’athéisme : il ne
représente pas son personnage comme un scélérat et un monstre.
L’Inquisiteur est un ascète, un sage et un philanthrope. C’est
cette conception qui est une vision générale de Dostoïevski.
L’Antéchrist attaque le Christ au nom du principe chrétien de
l’amour du prochain. Il se donne comme Son disciple, comme le
continuateur de Son œuvre. L’Antéchrist est un pseudo-Christ et
non un anti-Christ. C’est ainsi que Soloviev également comprenait
l’idée de l’Antéchrist. Dans sa remarquable nouvelle Trois
entretiens,
il représente l’Antéchrist, à l’instar de Dostoïevski, comme
un philanthrope et un réformateur social. L’auteur des Karamazov
représente la lutte contre Dieu dans toute sa grandeur démoniaque :
l’Inquisiteur rejette le précepte qui ordonne d’aimer Dieu, mais
devient fanatique du précepte qui ordonne d’aimer son prochain.
Ses puissantes énergies spirituelles, autrefois consacrées à la
vénération du Christ, sont maintenant employées au service de
l’humanité. Mais l’amour de l’impie se mue inévitablement en
haine. Ayant perdu la foi en Dieu, l’Inquisiteur doit perdre aussi
la foi en l’homme, car ces deux fois sont inséparables. En niant
l’immortalité de l’âme, il rejette la
facile de la lutte contre l’athéisme : il ne
représente pas son personnage comme un scélérat et un monstre.
L’Inquisiteur est un ascète, un sage et un philanthrope. C’est
cette conception qui est une vision générale de Dostoïevski.
L’Antéchrist attaque le Christ au nom du principe chrétien de
l’amour du prochain. Il se donne comme Son disciple, comme le
continuateur de Son œuvre. L’Antéchrist est un pseudo-Christ et
non un anti-Christ. C’est ainsi que Soloviev également comprenait
l’idée de l’Antéchrist. Dans sa remarquable nouvelle Trois
entretiens,
il représente l’Antéchrist, à l’instar de Dostoïevski, comme
un philanthrope et un réformateur social. L’auteur des Karamazov
représente la lutte contre Dieu dans toute sa grandeur démoniaque :
l’Inquisiteur rejette le précepte qui ordonne d’aimer Dieu, mais
devient fanatique du précepte qui ordonne d’aimer son prochain.
Ses puissantes énergies spirituelles, autrefois consacrées à la
vénération du Christ, sont maintenant employées au service de
l’humanité. Mais l’amour de l’impie se mue inévitablement en
haine. Ayant perdu la foi en Dieu, l’Inquisiteur doit perdre aussi
la foi en l’homme, car ces deux fois sont inséparables. En niant
l’immortalité de l’âme, il rejette la  nature spirituelle de
l’homme. Et, du coup, l’homme se transforme pour lui en être
pitoyable, faible et lâche, l’histoire de l’humanité est une
accumulation insensée de malheurs, de forfaits et de souffrances. Si
l’homme n’est qu’une créature terrestre, son destin est
véritablement un “vaudeville diabolique”; si les hommes,
“outre-tombe, ne trouveront que la mort”, ils sont en vérité
“des êtres inachevés, des essais faits pour rire”. Il ne reste
alors pour le philanthrope qu’une chose à faire: faciliter à ces
malheureuses créatures leur courte vie, “organiser” sur la terre
cet indocile troupeau. Il n’a été donné à l’homme qu’un
instant de vie terrestre, qu’il le vive dans le bien-être et la
paix. Et l’Inquisiteur organise le “bonheur général”: il
nourrira les hommes (le “pain”), il les enchaînera par “le
miracle, le mystère et l’autorité”, il prendra le glaive de
César et rassemblera les débiles rebelles en un seul troupeau.
Alors s’élèvera la grande Tour de Babel et la grande prostituée
montera sur la bête, et cela pour toujours. Ivan affirmait que, sans
croire en Dieu et en l’immortalité, on ne saurait aimer
l’humanité. Le Grand Inquisiteur le prouve. Il a commencé par
l’amour des hommes et a fini par les transformer en animaux
domestiques. Pour rendre heureuse l’humanité, il lui a enlevé
tout
nature spirituelle de
l’homme. Et, du coup, l’homme se transforme pour lui en être
pitoyable, faible et lâche, l’histoire de l’humanité est une
accumulation insensée de malheurs, de forfaits et de souffrances. Si
l’homme n’est qu’une créature terrestre, son destin est
véritablement un “vaudeville diabolique”; si les hommes,
“outre-tombe, ne trouveront que la mort”, ils sont en vérité
“des êtres inachevés, des essais faits pour rire”. Il ne reste
alors pour le philanthrope qu’une chose à faire: faciliter à ces
malheureuses créatures leur courte vie, “organiser” sur la terre
cet indocile troupeau. Il n’a été donné à l’homme qu’un
instant de vie terrestre, qu’il le vive dans le bien-être et la
paix. Et l’Inquisiteur organise le “bonheur général”: il
nourrira les hommes (le “pain”), il les enchaînera par “le
miracle, le mystère et l’autorité”, il prendra le glaive de
César et rassemblera les débiles rebelles en un seul troupeau.
Alors s’élèvera la grande Tour de Babel et la grande prostituée
montera sur la bête, et cela pour toujours. Ivan affirmait que, sans
croire en Dieu et en l’immortalité, on ne saurait aimer
l’humanité. Le Grand Inquisiteur le prouve. Il a commencé par
l’amour des hommes et a fini par les transformer en animaux
domestiques. Pour rendre heureuse l’humanité, il lui a enlevé
tout  ce qu’elle a d’humain. De même que le Chigaliov des
Possédés,
le héros de la “Légende” aboutit à l’idée du “despotisme
illimité”».96
En effet, le Grand Inquisiteur démantèle la condensation
augustinienne telle qu’exposée dans La
Cité de Dieu :
Dieu et son prochain sont une seule et même entité; on ne peut
aimer l’un sans l’autre. Augustin, qui tenait à faire oublier
son manichéïsme passé en jetant une zone d’ombre entre la Cité
de Dieu et celle du Diable, voit son œuvre mise en morceaux lorsque
Dostoïevski, à la sortie du bagne, écrivait à sa protectrice,
Natalie Fon Vizine : «…si
l’on me prouvait que le Christ est hors de la vérité, et qu’il
fût réel que la vérité soit hors du Christ, je voudrais plutôt
rester avec le Christ qu’avec la vérité».97
C’était déjà le paradoxe du Grand Inquisiteur! Cette question
fut donc obsessionnelle chez l’écrivain russe. Dans une ébauche
de L’adolescent,
Dostoïevski
posait encore la question à travers l’un de ses personnages :
«Versilov
parle sérieusement, mais revient toujours à son scepticisme :
“Aimer les hommes comme ils sont est chose impossible. Il le faut
pourtant. Fais-leur du bien en te bouchant le nez… Apprends à les
mépriser, même quand ils ont l’air bon : c’est alors qu’ils
sont le plus mauvais”».98
ce qu’elle a d’humain. De même que le Chigaliov des
Possédés,
le héros de la “Légende” aboutit à l’idée du “despotisme
illimité”».96
En effet, le Grand Inquisiteur démantèle la condensation
augustinienne telle qu’exposée dans La
Cité de Dieu :
Dieu et son prochain sont une seule et même entité; on ne peut
aimer l’un sans l’autre. Augustin, qui tenait à faire oublier
son manichéïsme passé en jetant une zone d’ombre entre la Cité
de Dieu et celle du Diable, voit son œuvre mise en morceaux lorsque
Dostoïevski, à la sortie du bagne, écrivait à sa protectrice,
Natalie Fon Vizine : «…si
l’on me prouvait que le Christ est hors de la vérité, et qu’il
fût réel que la vérité soit hors du Christ, je voudrais plutôt
rester avec le Christ qu’avec la vérité».97
C’était déjà le paradoxe du Grand Inquisiteur! Cette question
fut donc obsessionnelle chez l’écrivain russe. Dans une ébauche
de L’adolescent,
Dostoïevski
posait encore la question à travers l’un de ses personnages :
«Versilov
parle sérieusement, mais revient toujours à son scepticisme :
“Aimer les hommes comme ils sont est chose impossible. Il le faut
pourtant. Fais-leur du bien en te bouchant le nez… Apprends à les
mépriser, même quand ils ont l’air bon : c’est alors qu’ils
sont le plus mauvais”».98 des chairs
à canon sans plus de conscience que les ouvriers abrutis dans les
usines, la chose ne passait plus. Vance le reconnaît pour les
soldats canadiens revenus du front en 1918 : «Aux
yeux de bien des gens, l’universalisation n’était rien d’autre
que de la diffamation : en prétendant que la guerre en avait fait
des brutes déshumanisées, ces ouvrages chargeaient les soldats
canadiens des péchés des autres. Suivant cette littérature, la
guerre effaçait l’identité et la personnalité du soldat, le
transformait en simple pion dont la souffrance et la mort n’avaient
de conséquence pour personne, pas même pour lui. À de nombreux
anciens combattants et aux amis des soldats, une telle vision était
insupportable».99
L’historien fait ici référence à ces études ou ces ouvrages de
vulgarisation qui affirmaient que la guerre déshumanisait les
combattants à cause des monstruosités de masse commises sur les
champs de bataille. Les
des chairs
à canon sans plus de conscience que les ouvriers abrutis dans les
usines, la chose ne passait plus. Vance le reconnaît pour les
soldats canadiens revenus du front en 1918 : «Aux
yeux de bien des gens, l’universalisation n’était rien d’autre
que de la diffamation : en prétendant que la guerre en avait fait
des brutes déshumanisées, ces ouvrages chargeaient les soldats
canadiens des péchés des autres. Suivant cette littérature, la
guerre effaçait l’identité et la personnalité du soldat, le
transformait en simple pion dont la souffrance et la mort n’avaient
de conséquence pour personne, pas même pour lui. À de nombreux
anciens combattants et aux amis des soldats, une telle vision était
insupportable».99
L’historien fait ici référence à ces études ou ces ouvrages de
vulgarisation qui affirmaient que la guerre déshumanisait les
combattants à cause des monstruosités de masse commises sur les
champs de bataille. Les  travailleurs qui sortaient des usines
pouvaient bien avoir le sentiment de n’être que peu de chose dans
le monde, mais les soldats refusaient carrément qu’on les
considère comme des sous-hommes régressés au stade de l’animalité.
À l’âge
des foules,
la guerre avait fait ressurgir dans le combattant son honneur et sa
dignité sans nécessairement passer par les fantasmes de la
surhumanité. Donc, la sous-humanité devenait tout aussi
inacceptable. S’il y avait l’amour des siens et de lui-même dans
son engagement (forcé ou volontaire), il y avait, à travers les
combats, une force motrice qui nourrissait l’identification à un
personnage en relation avec le collectif. Non pas le surhomme, mais
le participant à une cause qui le dépasse et dont il ignore tous
les tenants et les aboutissants. Comme le rappelle encore Moscovici :
«…l’homme total unit en lui les deux aspects d’une même force : la libido
narcissique et la libido
travailleurs qui sortaient des usines
pouvaient bien avoir le sentiment de n’être que peu de chose dans
le monde, mais les soldats refusaient carrément qu’on les
considère comme des sous-hommes régressés au stade de l’animalité.
À l’âge
des foules,
la guerre avait fait ressurgir dans le combattant son honneur et sa
dignité sans nécessairement passer par les fantasmes de la
surhumanité. Donc, la sous-humanité devenait tout aussi
inacceptable. S’il y avait l’amour des siens et de lui-même dans
son engagement (forcé ou volontaire), il y avait, à travers les
combats, une force motrice qui nourrissait l’identification à un
personnage en relation avec le collectif. Non pas le surhomme, mais
le participant à une cause qui le dépasse et dont il ignore tous
les tenants et les aboutissants. Comme le rappelle encore Moscovici :
«…l’homme total unit en lui les deux aspects d’une même force : la libido
narcissique et la libido  érotique tout comme l’attraction et la
répulsion manifestent, dans un même corps, les deux aspects de la
gravité. C’est bien dans ce sens qu’il est simple : il est fait,
pour ainsi dire, d’un seul matériau. Il obéit aux lois d’une
force unique : l’amour. L’autre force, à savoir l’identification
à un personnage, à un but collectif, exercerait sur lui une
pression modérée. De sorte que la voix de sa conscience - son
surmoi en somme - ne lui demande pas plus que son amour pour soi et
pour l’autre ne l’exige. C’est une voix clémente “pour la
personne qui lui donne asile; mais elle a le désavantage qu’elle
permet le développement d’un être très ordinaire”. N’allez
surtout pas croire que cet homme soit primaire, son esprit, simple,
ou sa vie intérieure, pauvre».100
C'est parce qu'ils se considéraient encore «homme total», que les
anciens combattants, même blessés, même traumatisés, même
amputés, se refusaient à être taxés d'aliénés mécaniques,
obéissant aveuglément aux ordres, sans conscience pour les actes
commis au combat. La vérité était toute autre et rares furent les
survivants qui ne gardèrent pas, pour le reste de leur vie, un
souvenir amer de cette expérience. On comprend qu’au déclenchement
de la Seconde Guerre mondiale, la joie des engagés de l’été 1914
n’ait pas été partagée par les engagés de l’été 1939.
érotique tout comme l’attraction et la
répulsion manifestent, dans un même corps, les deux aspects de la
gravité. C’est bien dans ce sens qu’il est simple : il est fait,
pour ainsi dire, d’un seul matériau. Il obéit aux lois d’une
force unique : l’amour. L’autre force, à savoir l’identification
à un personnage, à un but collectif, exercerait sur lui une
pression modérée. De sorte que la voix de sa conscience - son
surmoi en somme - ne lui demande pas plus que son amour pour soi et
pour l’autre ne l’exige. C’est une voix clémente “pour la
personne qui lui donne asile; mais elle a le désavantage qu’elle
permet le développement d’un être très ordinaire”. N’allez
surtout pas croire que cet homme soit primaire, son esprit, simple,
ou sa vie intérieure, pauvre».100
C'est parce qu'ils se considéraient encore «homme total», que les
anciens combattants, même blessés, même traumatisés, même
amputés, se refusaient à être taxés d'aliénés mécaniques,
obéissant aveuglément aux ordres, sans conscience pour les actes
commis au combat. La vérité était toute autre et rares furent les
survivants qui ne gardèrent pas, pour le reste de leur vie, un
souvenir amer de cette expérience. On comprend qu’au déclenchement
de la Seconde Guerre mondiale, la joie des engagés de l’été 1914
n’ait pas été partagée par les engagés de l’été 1939. subjectivité était garante du service à ses
compatriotes. Il était donc normal qu’en détruisant son identité,
on rompait le lien avec la collectivité. Le paradoxe de Dostoïevski
ne fonctionna pas plus pour les totalitarismes que pour les
chrétiens. On ne peut aimer son prochain sans aimer Dieu et vice
versa. Aussi, aimer le Duce, c’était aimer les Italiens, mais
aimer les Italiens ne voulait pas dire absolument qu’on aima le
Duce. En Union soviétique, la guerre civile atteignit le monstrueux
présage de tous les génocides quand le régime de Lénine fit
assassiner de la façon la plus bassement criminelle la famille impériale parquée dans un bled à la frontière de la Sibérie.
Passant une remarque sur les dépositions concernant l’extermination
de la famille Romanov encore sur le sol russe en 1918, le juge
Sokoloff lâcha : «Je
pense qu’ils ont été non pas enterrés, comme le croit Serguieef,
mais anéantis».101
Cette nouvelle frappa autant les imaginations qu’en leurs temps les
décapitations de Charles Ier et de Louis XVI. On avait vu, au
tournant du siècle, des têtes couronnées victimes d’attentats ou
d’assassinats : la Russie, la France, l’Italie,
l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne,
le Portugal et même les Américains avaient vu leur président
assassiné en 1901. Mais que la famille tout entière, hommes,
femmes, enfants et même les domestiques, puisse périr dans une cave
sombre d’une riche maison bourgeoise, on était passé à un
niveau différent : celui de l’extinction d’une dynastie,
mais aussi, selon les métaphores du temps, d’une race.
Une telle
subjectivité était garante du service à ses
compatriotes. Il était donc normal qu’en détruisant son identité,
on rompait le lien avec la collectivité. Le paradoxe de Dostoïevski
ne fonctionna pas plus pour les totalitarismes que pour les
chrétiens. On ne peut aimer son prochain sans aimer Dieu et vice
versa. Aussi, aimer le Duce, c’était aimer les Italiens, mais
aimer les Italiens ne voulait pas dire absolument qu’on aima le
Duce. En Union soviétique, la guerre civile atteignit le monstrueux
présage de tous les génocides quand le régime de Lénine fit
assassiner de la façon la plus bassement criminelle la famille impériale parquée dans un bled à la frontière de la Sibérie.
Passant une remarque sur les dépositions concernant l’extermination
de la famille Romanov encore sur le sol russe en 1918, le juge
Sokoloff lâcha : «Je
pense qu’ils ont été non pas enterrés, comme le croit Serguieef,
mais anéantis».101
Cette nouvelle frappa autant les imaginations qu’en leurs temps les
décapitations de Charles Ier et de Louis XVI. On avait vu, au
tournant du siècle, des têtes couronnées victimes d’attentats ou
d’assassinats : la Russie, la France, l’Italie,
l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne,
le Portugal et même les Américains avaient vu leur président
assassiné en 1901. Mais que la famille tout entière, hommes,
femmes, enfants et même les domestiques, puisse périr dans une cave
sombre d’une riche maison bourgeoise, on était passé à un
niveau différent : celui de l’extinction d’une dynastie,
mais aussi, selon les métaphores du temps, d’une race.
Une telle
 horreur s’exprima à travers une généralisation abusive qui fut
reprise et triturée par les nazis : «…l’Est
est la terre des Slaves, des Asiates et des juifs, populations
infrahumaines pour les uns et pathogènes pour les autres. Une série
d’ordres, formulés entre décembre 1940 et l’été 1941, vise à
plonger l’armée allemande dans un état de psychose : il ne faut,
à l’Est, se fier à rien. La terre du judéo-bolchevisme est une
terre maudite, où une élite juive a soumis des masses slaves,
devenus les instruments bruts et cruels de ses menées diaboliques.
Si les Slaves sont promis à l’asservissement, les juifs de l’Est,
eux, doivent disparaître, sous l’action meurtrière de commandos
spéciaux de la police et de la SS, qui tuent sur place, à proximité
des villages, ou dans des centres de mise à mort provisoire, où la
fusillade est la technique privilégiée».102
Plus on s’éloignait vers l’est de l’Europe jusqu’à la
frontière de l’Asie, plus le Far
East prenait
une dimension de terres mythiques, peuplées de barbares et de
sauvages, où l’on procédait à des mises à mort de masse. Pas
étonnant que les Allemands voulurent prendre les devant.
horreur s’exprima à travers une généralisation abusive qui fut
reprise et triturée par les nazis : «…l’Est
est la terre des Slaves, des Asiates et des juifs, populations
infrahumaines pour les uns et pathogènes pour les autres. Une série
d’ordres, formulés entre décembre 1940 et l’été 1941, vise à
plonger l’armée allemande dans un état de psychose : il ne faut,
à l’Est, se fier à rien. La terre du judéo-bolchevisme est une
terre maudite, où une élite juive a soumis des masses slaves,
devenus les instruments bruts et cruels de ses menées diaboliques.
Si les Slaves sont promis à l’asservissement, les juifs de l’Est,
eux, doivent disparaître, sous l’action meurtrière de commandos
spéciaux de la police et de la SS, qui tuent sur place, à proximité
des villages, ou dans des centres de mise à mort provisoire, où la
fusillade est la technique privilégiée».102
Plus on s’éloignait vers l’est de l’Europe jusqu’à la
frontière de l’Asie, plus le Far
East prenait
une dimension de terres mythiques, peuplées de barbares et de
sauvages, où l’on procédait à des mises à mort de masse. Pas
étonnant que les Allemands voulurent prendre les devant. attaqua et occupa la Pologne. Les nazis, eux, se
sentaient moins impliqués : «Himmler
a déclaré à ses suivants : “Ce qui arrive à un Russe ou un à
un Tchèque ne m’intéresse pas le moins du monde. Ce que les
nations peuvent nous offrir en fait de bon sang de notre type, nous
le prendrons, si cela est nécessaire en enlevant les enfants et en
les élevant ici avec nous. Que les nations vivent en prospérité,
ou meurent de faim, cela ne m’intéresse seulement que jusqu’au
point où nous avons besoin d’elles comme esclaves pour notre
Kultur;
autrement cela ne m’intéresse pas du tout…”».105
Il est douteux que ce petit-bourgeois bourré de ressentiments ait
jamais su ce qu’était la Kultur
allemande!
L’important était de s’en
attaqua et occupa la Pologne. Les nazis, eux, se
sentaient moins impliqués : «Himmler
a déclaré à ses suivants : “Ce qui arrive à un Russe ou un à
un Tchèque ne m’intéresse pas le moins du monde. Ce que les
nations peuvent nous offrir en fait de bon sang de notre type, nous
le prendrons, si cela est nécessaire en enlevant les enfants et en
les élevant ici avec nous. Que les nations vivent en prospérité,
ou meurent de faim, cela ne m’intéresse seulement que jusqu’au
point où nous avons besoin d’elles comme esclaves pour notre
Kultur;
autrement cela ne m’intéresse pas du tout…”».105
Il est douteux que ce petit-bourgeois bourré de ressentiments ait
jamais su ce qu’était la Kultur
allemande!
L’important était de s’en 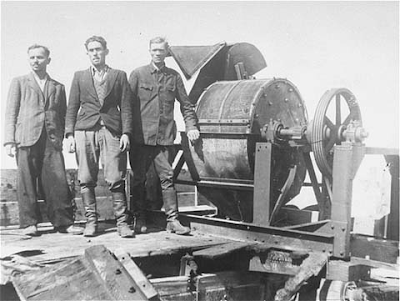 |
| Membres d'un Sonderkommando près d'une machine à broyer les os |
 Au
début de 1943 éclata l'affaire de Katyn. Commençant à exploiter
les terres conquises en Pologne, les Allemands découvrirent près du
village de Katyn, proche de Smolensk, plusieurs milliers de cadavres
enfouis sous terre de soldats polonais, essentiellement des officiers
d’active et de réserve : des étudiants, des médecins, des
ingénieurs, des enseignants, etc. Aussitôt, la propagande nazie
s’empara de la découverte, accusant la police politique russe, le
N.K.V.D., d’être les auteurs du massacre. Staline, évidemment,
s’en défendit, mais comme les Allemands avaient laissé des
observateurs étrangers enquêter sur place, il apparut assez vite
que les Russes étaient bien responsables de ce crime de masse, dans
le contexte du printemps 1940, lorsque Russes et Allemands
s’entendirent pour le quatrième partage de la Pologne. Or, en
1943, on en était aux discussions faisant entrer l’Union
soviétique parmi les alliés des démocraties libérales :
«Churchill
eut une entrevue avec l’ambassadeur
Au
début de 1943 éclata l'affaire de Katyn. Commençant à exploiter
les terres conquises en Pologne, les Allemands découvrirent près du
village de Katyn, proche de Smolensk, plusieurs milliers de cadavres
enfouis sous terre de soldats polonais, essentiellement des officiers
d’active et de réserve : des étudiants, des médecins, des
ingénieurs, des enseignants, etc. Aussitôt, la propagande nazie
s’empara de la découverte, accusant la police politique russe, le
N.K.V.D., d’être les auteurs du massacre. Staline, évidemment,
s’en défendit, mais comme les Allemands avaient laissé des
observateurs étrangers enquêter sur place, il apparut assez vite
que les Russes étaient bien responsables de ce crime de masse, dans
le contexte du printemps 1940, lorsque Russes et Allemands
s’entendirent pour le quatrième partage de la Pologne. Or, en
1943, on en était aux discussions faisant entrer l’Union
soviétique parmi les alliés des démocraties libérales :
«Churchill
eut une entrevue avec l’ambassadeur  soviétique, Maïsky, après
laquelle il déclara qu’il n’avait pas abordé le problème de
Katyn, car
“ce
qui importe, c’est de remporter la victoire sur Hitler… L’heure
n’est ni aux querelles, ni aux accusations.” “Quoi que vous
fassiez, ces hommes ne ressusciteront pas”,
avait déjà dit Churchill à Sikorski [président
du gouvernement polonais en exil]
en apprenant la nouvelle du massacre.
[…] Ce
fut également l’avis du pouvoir américain, dont l’attitude dans
cette affaire fut, de surcroît, marquée par le parti-pris
pro-soviétique personnel du président Roosevelt et de sa femme. Le
président des États-Unis avait envoyé un ami à Staline qui remit
à ce dernier une lettre dont la teneur ne fut pas révélée à
l’ambassadeur Standley lui-même, à qui il fut d’ailleurs
signifié qu’il pouvait s’abstenir d’assister à l’entrevue
discrète entre Staline et “le
vieil ami”
de Roosevelt, Joseph E. Davis…».107
Avant même les efforts des alliés pour dissimuler aux yeux du
public leurs connaissances des chambres à gaz et du génocide juif
pour ne pas nuire aux stratégies de reconquête de l’Europe,
ceux-ci s’entendirent pour ne pas ramener la question gênante de
Katyn : «Les
Trois Grands concentrèrent leurs efforts à baillonner, pour la
bonne cause, les Polonais encore désireux de faire éclater au grand
jour la véritable identité des assassins d’une grande partie du
commandement de leur armée d’avant-guerre. Si l’on voulait
vraiment introduire l’élément éthique dans la politique, on
pourrait se demander si l’amoralité de l’ordre européen et
mondial fondé
soviétique, Maïsky, après
laquelle il déclara qu’il n’avait pas abordé le problème de
Katyn, car
“ce
qui importe, c’est de remporter la victoire sur Hitler… L’heure
n’est ni aux querelles, ni aux accusations.” “Quoi que vous
fassiez, ces hommes ne ressusciteront pas”,
avait déjà dit Churchill à Sikorski [président
du gouvernement polonais en exil]
en apprenant la nouvelle du massacre.
[…] Ce
fut également l’avis du pouvoir américain, dont l’attitude dans
cette affaire fut, de surcroît, marquée par le parti-pris
pro-soviétique personnel du président Roosevelt et de sa femme. Le
président des États-Unis avait envoyé un ami à Staline qui remit
à ce dernier une lettre dont la teneur ne fut pas révélée à
l’ambassadeur Standley lui-même, à qui il fut d’ailleurs
signifié qu’il pouvait s’abstenir d’assister à l’entrevue
discrète entre Staline et “le
vieil ami”
de Roosevelt, Joseph E. Davis…».107
Avant même les efforts des alliés pour dissimuler aux yeux du
public leurs connaissances des chambres à gaz et du génocide juif
pour ne pas nuire aux stratégies de reconquête de l’Europe,
ceux-ci s’entendirent pour ne pas ramener la question gênante de
Katyn : «Les
Trois Grands concentrèrent leurs efforts à baillonner, pour la
bonne cause, les Polonais encore désireux de faire éclater au grand
jour la véritable identité des assassins d’une grande partie du
commandement de leur armée d’avant-guerre. Si l’on voulait
vraiment introduire l’élément éthique dans la politique, on
pourrait se demander si l’amoralité de l’ordre européen et
mondial fondé  après Yalta ne plonge pas ses racines dans les
charniers de Katyn».108
Il fallut attendre le procès de Nuremberg, au moment du procès de
criminels de guerre nazis pour voir ressurgir la responsabilité du
massacre de l’armée polonaise en 1940, mais là encore, la
question fut rapidement écartée : «Il
fallut d’âpres discussions avec l’avocat allemand pour décider
d’entendre à la barre trois témoins pour chaque partie. Ce qui
étonne et choque profondément, c’est que parmi les témoins il ne
se trouva aucun Polonais de l’Armée d’Anders, de celle de
Berling, de Londres ou de Varsovie. Le tribunal n’eut recours ni au
témoignage des intéressés, ni aux pièces à conviction que
ceux-ci détenaient et proposèrent en vain de produire. On les
écarta purement et simplement de Nuremberg».109
Il est vrai que devant les déluges de témoignages se
après Yalta ne plonge pas ses racines dans les
charniers de Katyn».108
Il fallut attendre le procès de Nuremberg, au moment du procès de
criminels de guerre nazis pour voir ressurgir la responsabilité du
massacre de l’armée polonaise en 1940, mais là encore, la
question fut rapidement écartée : «Il
fallut d’âpres discussions avec l’avocat allemand pour décider
d’entendre à la barre trois témoins pour chaque partie. Ce qui
étonne et choque profondément, c’est que parmi les témoins il ne
se trouva aucun Polonais de l’Armée d’Anders, de celle de
Berling, de Londres ou de Varsovie. Le tribunal n’eut recours ni au
témoignage des intéressés, ni aux pièces à conviction que
ceux-ci détenaient et proposèrent en vain de produire. On les
écarta purement et simplement de Nuremberg».109
Il est vrai que devant les déluges de témoignages se  rapportant aux
camps d’extermination nazis, le massacre de quelques milliers
d’officiers polonais passait pour peu de choses. La rhétorique de
la sous-humanité livrait des effets effroyables difficilement
croyables : «Dans
l’esprit des tueurs, les problèmes liés aux assassinats de masse,
même d’enfants orphelins, sont réduits à des questions de
logistique. À la fin septembre, la 454e division de sécurité
rapporte que “dans certains endroits, subvenir aux besoins
d’enfants et de bébés juifs qui ont perdu leurs parents présente
des difficultés; mais entre-temps, le SD y a trouvé un remède.”
[…] À
nouveau, les officiers dirigeants de la Wehrmacht contribuent à
rationaliser la liquidation systématique d’hommes, de femmes et
d’enfants désarmés et en font une composante d’une guerre
ordinaire à l’Est. Le 10 octobre, le commandant de la 6e Armée,
le maréchal von Reichenau donne son ordre tristement célèbre
concernant “le comportement des troupes à l’Est” qui exige
“l’élimination de l’influence asiatique dans la sphère de
culture européenne” et “une punition dure mais juste contre la
sous-humanité juive”. Hitler fait l’éloge de Reichenau pour son
zèle, ce qui incite d’autres commandants de l’armée à suivre
son exemple».110
rapportant aux
camps d’extermination nazis, le massacre de quelques milliers
d’officiers polonais passait pour peu de choses. La rhétorique de
la sous-humanité livrait des effets effroyables difficilement
croyables : «Dans
l’esprit des tueurs, les problèmes liés aux assassinats de masse,
même d’enfants orphelins, sont réduits à des questions de
logistique. À la fin septembre, la 454e division de sécurité
rapporte que “dans certains endroits, subvenir aux besoins
d’enfants et de bébés juifs qui ont perdu leurs parents présente
des difficultés; mais entre-temps, le SD y a trouvé un remède.”
[…] À
nouveau, les officiers dirigeants de la Wehrmacht contribuent à
rationaliser la liquidation systématique d’hommes, de femmes et
d’enfants désarmés et en font une composante d’une guerre
ordinaire à l’Est. Le 10 octobre, le commandant de la 6e Armée,
le maréchal von Reichenau donne son ordre tristement célèbre
concernant “le comportement des troupes à l’Est” qui exige
“l’élimination de l’influence asiatique dans la sphère de
culture européenne” et “une punition dure mais juste contre la
sous-humanité juive”. Hitler fait l’éloge de Reichenau pour son
zèle, ce qui incite d’autres commandants de l’armée à suivre
son exemple».110 Les
décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale verront la
mystique du surhomme changer définitivement de cap, être récupérée
par la musique pop des années 70, la bande dessinée et le cinéma
américain avec les super-héros et autres produits de consommation
de masse. Avec elles, la sous-humanité aussi sera emportée par les
articles votés par les Nations-Unies contre les crimes de masse
haineux. Le concept de sous-humanité survit à sa façon à travers
des récriminations judiciaires devant le tribunal international de
La Haye, par exemple. Des crimes commis sous la domination coloniale,
le génocide des Khmers rouges, celui du Rwanda auxquels se sont
ajoutées les récriminations amérindiennes se font toujours au nom
Les
décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale verront la
mystique du surhomme changer définitivement de cap, être récupérée
par la musique pop des années 70, la bande dessinée et le cinéma
américain avec les super-héros et autres produits de consommation
de masse. Avec elles, la sous-humanité aussi sera emportée par les
articles votés par les Nations-Unies contre les crimes de masse
haineux. Le concept de sous-humanité survit à sa façon à travers
des récriminations judiciaires devant le tribunal international de
La Haye, par exemple. Des crimes commis sous la domination coloniale,
le génocide des Khmers rouges, celui du Rwanda auxquels se sont
ajoutées les récriminations amérindiennes se font toujours au nom
 de l’abjection par laquelle les victimes ont été déracinées,
dépossédées, traumatisées ou tuées. Mais ce qui est important,
c’est que l’évolution des deux concepts ontologiques ont dévié
de leurs liens de réciprocité. Plus aucun philosophe sérieux
n’oserait traiter de surhumanité et de sous-humanité comme étant
des états ontologiques sérieux. Mais comme pour tous les mensonges,
même balayés par la vérité, il en reste toujours un peu quelque
chose dans l’Imaginaire occidental⌛
de l’abjection par laquelle les victimes ont été déracinées,
dépossédées, traumatisées ou tuées. Mais ce qui est important,
c’est que l’évolution des deux concepts ontologiques ont dévié
de leurs liens de réciprocité. Plus aucun philosophe sérieux
n’oserait traiter de surhumanité et de sous-humanité comme étant
des états ontologiques sérieux. Mais comme pour tous les mensonges,
même balayés par la vérité, il en reste toujours un peu quelque
chose dans l’Imaginaire occidental⌛


























































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire