 |
Charnier des camps d'extermination nazis
|
DE
LA CONSCIENCE HISTORIQUE À L'ÂGE DE L'ANUS MUNDI
(1860-1945)
5-IX-1942.
J’ai assisté cet après midi à une action spéciale
appliquée
à des détenues du camp féminin, des “Musulmanes”,
les
pires que j’ai jamais vues. Le docteur
Thilo
avait raison ce matin en me disant que
nous
nous trouvions dans l’anus
du monde.
Dr.
Kremer,
médecin à Auschwitz
Il est indubitable
qu'entre 1860 et 1945, les Occidentaux ont vécu avec l'obscure
certitude que leur civilisation s'était engagée sur une pente
déclinante. Les preuves du progrès général avaient beau démentir
ce pressentiment, mais la conscience occidentale s'éprouvait,
attirée par un sentiment d'attraction fatal. Tous les Occidentaux,
indépendamment de leur nationalité, acceptèrent l'idée
qu'exprimait le titre du livre d'Oswald Spengler : l'Occident était
bien en déclin.
 |
| Bataille de Gettysburd, 1er-3 juillet 1863 |
Déclin démographique
à un moment où la surpopulation européenne se déversait dans les
colonies comme sur les côtes atlantiques des Amériques; succession
de crises économiques dont le paroxysme de 1929 suivait pourtant une
longue période de croissance dans tous les secteurs de la
productivité associés à la seconde Révolution industrielle; accroissement des soulèvements populaires, idée fausse inspirée
par la violence de la Commune de Paris ou de la révolution
berlinoise. Enfin et surtout, dégénérescence et décadence morale,
thèmes qui seront abordés dans la seconde et la troisième partie
de cet ouvrage. Deux événements majeurs : la guerre de Sécession américaine et la guerre franco-allemande de 1870 donnèrent le la
à ce sentiment d'attraction fatale. Vainqueurs comme vaincus
pressentaient que l'ampleur des massacres liés aux combats ou les
conséquences civiles de la défaite ouvraient sur une pente
déclinante. Au lieu de regarder l'évolutionnisme comme un
perfectionnement des caractères physiques et moraux de l'être
humain, les romanciers cherchèrent à identifier des tares
congénitales fatidiques. Pensons à l'usage que fit Zola de
l'hérédo-syphilis dans ses Rougon-Macquart, ou comment Thomas Mann
utilisa le sanatorium de tuberculeux comme allégorie de l'Allemagne
de Weimar.
 |
Egon Schiele, autoportrait.
|
Après les expériences lumineuses des impressionnistes et
le travail sur les formes géométriques des cubistes, les artistes
s'engagèrent dans l'exploration des formes morbides avec
l'expressionnisme et le surréalisme. Si l'angoisse de la mort ne
dominait pas toutes les œuvres – pensons à la richesse des
coloris des fauvistes -, les productions que les nazis devaient
qualifier de dégénérés ne
cessaient d'ajouter des déformations visuelles chargées
d'inquiétudes et de désemparement. Les systèmes religieux
traditionnels cédaient devant la montée d'ésotérismes frôlant la
psychose. L'épistémologie n'était plus qu'une fausse garantie de
certitudes justifiées par des méthodes et des protocoles qui
plaçaient la réalité et la connaissance scientifique au pinacle de
la raison humaine. Pendant ce temps, toutes les formes de déraison
infiltraient l'anthropologie, la biologie, l'orientalisme et même la
connaissance historique. Le relativisme livrait au subjectivisme tous
les domaines de la connaissance. Les Occidentaux avaient perdu la
capacité de réconcilier leur subjectivité intime avec
l'objectivité du monde extérieur. La philosophie existentielle
véhiculait nombre de principes vitalistes, ne se refusant ni
l'illogisme (dans les paralogismes par exemple), ni l'irrationnel.
Tous ces délires entraînèrent a posteriori des
événements tragiques qui en firent reposer la responsabilité sur
les sciences, les techniques et le progrès : «Mais
est-ce vraiment Rousseau qui est responsable du Goulag, Gobineau
d’Auschwitz, Lavoisier et Boyle de la fabrication des gaz
asphyxiants, Einstein de la fabrication de la bombe H? Est-ce que les
auteurs de romans policiers sont les responsables des crimes réels
que commettent les lecteurs? On l’a dit, on l’a trop dit, et cela
suffit. Cessons d’accabler ceux dont des malfaisants, des tyrans et
des techniciens ont accaparé les idées pour en faire mauvais usage.
À ce compte-là ce serait la faute de Gutenberg, si on a imprimé et
diffusé Mein
Kampf».
 |
Félicien-Rops, Le Calvaire
|
Certes,
derrière les pressentiments se manifestaient bien des indices que
quelque chose n'allait pas dans la civilisation. Ces malaises,
comme
devait les appeler Freud, affectaient tous les domaines de l'activité
humaine au sein de la civilisation occidentale. On sentait que la loi
de l'entropie énoncée par les physiciens du XIXe siècle était
entrée en action. Que le monde s'approchait de sa fin, une mort
inéluctable et tragique. Un néo-paganisme justifiait tout cela
contre la tradition chrétienne érigée sur les trois vertus
cardinales : la foi, l'espérance et la charité. Le monde occidental
se dissolvait. Il s'altérait de lui-même, poussé jusqu'au suicide
moral avant le suicide physique, à l'exemple de bien de ses
principaux poètes, dramaturges ou penseurs. Il ne faudrait pourtant
pas se laisser étourdir par ces transgressions répétées en
matière morale, sexuelle, littéraires ou artistiques qui
préludèrent aux grands massacres du XXe siècle. L'Occident
anticipait à la divinité et non à la destruction. On peut, si on
veut, souscrire à l'enthousiasme du catholique Michel Carrouges
devant la posture magistrale du surhomme nietzschéen : «Ce
n’est donc pas l’espoir de la déification qui est faux et
mauvais, bien au contraire, mais la façon dont on l’attend. Une
immense espérance anime toute la grande poésie moderne, elle en
rend magnifiquement témoignage dans toute sa symbolique de la
déification, il lui appartient de ne pas céder à l’excès
d’impatience, de ne pas croire en ses seules forces, mais
d’attendre avec patience et amour que Dieu lui-même réalise ses
rêves ou plutôt de collaborer avec Dieu pour cette réalisation,
car s’il est vrai que l’homme seul ne peut rien, Dieu seul ne
peut rien non plus, parce qu’il a voulu lui-même s’imposer le
respect de la liberté humaine. C’est là le mystère de la vie
humaine et du destin de l’humanité toute entière».
Or quels étaient les noms derrière cette poésie
moderne?
Baudelaire? Lautréamont? Verlaine? Rimbaud? Swinburne? d'Annunzio?
Apollinaire? Ce ne furent peut-être pas tous des poètes les mieux
inspirés par l'amour chrétien, mais ils étaient tous des ténors
de la déification de l'homme. Et la preuve de cette déification
résidait précisément dans leur capacité à la transgression; de
se présenter généralement comme des êtres vaincus, perclus de
vices et adonnés au satanisme. Entre l'Imaginaire malsain et la
morale défectueuse, des médecins, parfois fous, se cachèrent
derrière les thèses de la dégénérescence – fatalité absolue!
- de Max Nordau ou du criminaliste Cesare Lombroso pour plonger
encore plus profondément dans le désespoir. Contre ces
élucubrations, Sigmund Freud tenta de ramener le thème vers la
névrose et ses thérapies. Ainsi, comme le rappelle Michel Foucault,
«la
position singulière de la psychanalyse  |
Cola di Rienzi, Marat, Louis Riel, Louise Michel, Carrier...
|
se comprendrait mal, à la
fin du XIXe siècle, si on ne voyait la rupture qu’elle a opéré
par rapport au grand système de la dégénérescence : elle a repris
le projet d’une technologie médicale propre à l’instinct
sexuel; mais elle a cherché à l’affranchir de ses corrélations
avec l’hérédité, et donc avec tous les racismes et tous les
eugénismes». Léon
Poliakov non plus, ne s'est pas montré dupe de cette démiurgie du
Mal. L'homme, incapable de se substituer ni même de vraiment
s'associer avec Dieu, ne peut passer qu'un pacte avec les démons :
«Ainsi,
on pourrait admettre qu’aussi étonnants que puissent être les
pouvoirs des démiurges modernes, certaines limites resteront
toujours posées à la perversion et à la robotisation des foules
les plus dociles. Incapables de créer “un homme nouveau”, ils
disposent toutefois, pour la destruction pure, de possibilités
presque illimitées. Ce n’est que dans une société d’hommes
voués à la mort que de nouveaux comportements à l’état pur ont
pu se développer; par une ironie sordide, ce n’est que dans
l’enfer concentrationnaire que cette ablation totale du sens moral
à laquelle rêvait le Führer a pu s’accomplir à vaste échelle.
Mais l’ombre des camps de concentration plane encore sur le monde;
et le dernier message d’Adolf Hitler semble retenir encore à
travers un monde en désarroi, faisant écho aux grondements des
haines dont les relents stagnent dans les esprits».
Autant dire que, depuis que le Mal s'est emparé de la démiurgie,
l'humanité occidentale n'aspire plus qu'à la médiocrité et à la
passivité. Sur ce point, Nietzsche a été bon prophète!
 |
Albert Daenens, L'en dehors, 1922
|
L'écrasante
subjectivité derrière ce sentiment négatif travaillait à la
faillite de l'auto-détermination de la civilisation. Ses minorités
dominantes bourgeoises
échouaient à maintenir le cap fixé par les humanistes de la
Renaissance. La fascination des philosophes du Siècle des Lumières
pour l'anthropologie confirmait le réductionnisme rationaliste du
XVIIe siècle. À l'Homme-Machine dont la physiologie avait été
exposée par La Mettrie, la réaction kantienne d'un Sujet rassuré
par un ensemble de paradigmes impératifs (la liberté, la dignité,
l'égalité (de droits), l'éducation, l'intangibilité de son corps
et de son esprit) se présentaient comme les deux opposants fracturés
par la Révolution industrielle et surtout le capitalisme et sa
morale sadienne : «”On
ne saurait trop le redire, répète Péguy. Tout le mal est venu de
la bourgeoisie. Toute l’aberration, tout le crime. C’est la
bourgeoisie capitaliste qui a infecté le peuple. Et elle l’a
précisément infecté d’esprit bourgeois et capitaliste…”».
Parallèlement
et simultanément, le monde occidental se ressentait toujours de
l'opposition dressée au sein de la Révolution française entre le
Propriétaire et le Citoyen. Plus que la simple propriété privée
des moyens de production, le terme désignant les caractères
essentialistes de l'individu, corps et esprit, sacralisés par les
nouvelles constitutions nationales (aux États-Unis, en France, voire
même en Angleterre), le Propriétaire s'établissait au faîte de la
société en formant la classe bourgeoise. Par ces mêmes propriétés,
d'autres membres de la société en appelèrent à l'égalité des
droits et à la protection des majorités dominées au nom du droit
de citoyenneté. Le Citoyen était présenté comme un sujet
ontologique, et non plus un sujet politique soumis aux aléas de
fortune des États. Cette schzie X opposant
diamétralement l'un à l'autre, Propriétaire/Citoyen et
Homme-Machine/Sujet kantien fut la double faille sous lesquelles
s'élaboraient toutes les crises psychologiques et sociales qui
minèrent l'auto-détermination de la civilisation et la précipita
dans un état d'anarchie qu'une longue guerre de Trente ans (la
deuxième en trois siècles) faillit accomplir par le suicide complet
de l'Occident : «À
la fin de cette période un problème restait sans solution : comment
les individus pouvaient-ils échapper à leurs inquiétudes
personnelles, dépasser la spécialisation exigée par
l’industrialisation et la technocratie et acquérir un certain
détachement par rapport aux pressions qui s’exerçaient sur eux?
Ils ne pourraient dominer leur environnement, comme le leur avaient
promis les savants, ni même régler leur propre destinée, en dépit
du suffrage universel qui aurait dû selon les politiciens avoir cet
effet, aussi longtemps qu’ils seraient esclaves de leur histoire,
de leurs inquiétudes. C’est en ce sens que convergent les fils
politiques, économiques, sociaux et moraux de l’histoire... :
chacun d’eux a forcé l’individu à se définir dans ses
allégeances, ses spécialisations et ses goûts. J’ai montré
comment les gens ont tourné ces inconvénients, mais aux pressions
exercées sur eux pour qu’ils soient cohérents et prévisibles,
ils n’ont trouvé que des palliatifs. La recherche de la prospérité
était nécessaire et inévitable, mais le souci qu’ils en ont eu a
permis aux gens d’oublier quels étaient leurs objectifs ou même
de ne pas se poser la question. À la fin de cette période, les
Français ne savaient toujours pas où résidaient leurs priorités».
Ceci résume assez bien ce qu'il faut entendre par faillite
occidentale de l'auto-détermination.

 |
Camp de détenus nordistes
|
Si
nous considérons l'historicité de cette période de 1860 à 1945,
comme tout historicité, la dynamique s'est engagée entre
l'articulation de deux logiques, l'une de nécessité et l'autre de
contingences. Les contingences spécifiques de cette période qui
contribuèrent à accélérer le déclin de la civilisation sont
nombreuses. Où était la nécessité de créer des lieux obsidionaux
comme les camps de concentration? Du camp d'Andersonville à ceux
d'Auschwitz, il y eut une continuité qui s'est maintenue à travers
des formes d'enfermement, tels les hôpitaux où l'on se mit à
rassembler comme jamais malades physiques et mentaux; usines ou
complexes industriels ramassant quotidiennement dans ses murs des
centaines de milliers de travailleurs; des prisons dites à sécurité
maximale; des premiers camps de prisonniers de guerre durant la
guerre hispano-américaine et celle des Boers aussi bien que durant
les guerres mondiales; des camps de prisonniers politiques, en Russie
comme en Allemagne... Le grand
renfermement,
que Michel Foucault situait au XVIIe siècle, n'était rien en
comparaison de ce qui se passa à partir du second XIXe siècle. Il
découlait d'une obsession particulière : l'hygiénisme,
qui transposait en matière sociale les données de la médecine.
Rappelons, avec Jacques Attali, que la propriété nécessite la
propreté. La machine
sociale n'est
jamais
assez propre selon ses dominants, aussi le maintien de l'ordre
représentait-il, pour la bourgeoisie, la santé sociale :
[Le]
«développement de l’hygiène publique révèle un
double visage, au tournant du siècle, deux visions de la santé
collective, différentes, presque opposées et pourtant
indissolublement liées : celle de la mobilisation autoritaire, une
défense d’autant plus pesante qu’elle se réfère à l’absolu
de la nation, à son avenir, son “sang”, sinon à sa survie.
L’hygiène publique obéit ici, assure Léon Bourgeois dans un
discours de 1889, “aux nécessités du patriotisme, car elle a pour
but et pour effet de conserver et d’accroître ce capital humain
dont la moindre parcelle ne peut être perdue, sans une atteinte à
la sécurité nationale et la grandeur de la patrie”. Cette hygiène
pèse alors comme une force extérieure, surplombant les individus,
poursuivant un sens en dehors d’eux : l’accomplissement d’un
destin collectif où dominent la nation et le sang, le “grandissement
de la patrie, de la race et de l’humanité”.
 |
Campagne d'anti-vaccination
|
L’autre
vision mêle à l’assainissement l’idée d’une participation
très particulière au collectif. Elle fait de l’État un immense
prestataire de services médiateur chargé en priorité de mieux
protéger l’individu, prolonger sa vie, prévenir ses maux. Une
façon d’engager un intérêt quasi égoïste dans la mutualité en
bornant la visée sociale au seul développement de la vie.
L’objectif de cet État redistributeur, répartiteur des avantages
et des charges, est alors la sauvegarde et l’entretien de ses
membres, l’achèvement de la santé publique devenue le “fondement
où repose le bonheur du peuple”; ambition non plus transcendante
mais immanente, celle qui légitime le social à la défense de
chacun, un sens issu des individus et non plus de quelque force
surplombante. Le mot même de “santé publique” insensiblement
substitué à celui d’“hygiène publique” au début du XXe
siècle souligne le changement : l’insistance sur le capital
physique individuel et collectif. C’est bien le destin des sociétés
démocratiques qu’illustrent ces projets de solidarité, ces
formules sociales où certains ont pu voir “la disparition
constante et progressive de la notion de souveraineté” : la santé
et la protection de chacun projetées au centre des objectifs
collectifs, à défaut d’ambition affirmées en dehors des
individus. Assurances maladie, assurances contre les accidents
dessinent à la fin du XIXe siècle des dispositifs quasi actuels,
ceux qui renouvellent le projet politique en renouvelant les attentes
de santé».
 Le
fantasme de la fécalité, en particulier, se retrouvait dans tout.
L'invention du tout-à-l'égout et la désinfection appelaient
l'usage de gaz et la crémation des corps plutôt que l'enfouissement
dans des nécropoles surpeuplées; la chasse au péril vénérien, le
confinement des tuberculeux dans des sanatoria isolés; le besoin
d'aération urbaine devant la promiscuité des foules, appelaient la
mobilisation de l'État. Il n'y eut pas jusqu'à l'usage des
barbelés, tirés des grands ranchs
américains, qui furent tricotés autour des camps, voire des usines.
Les grands abattoirs, enfin. Ces lieux où les bestiaux étaient
exterminés en masse pour nourrir les bien nantis des villes,
massacres accomplis dans une asepsie quasi complète et à l'écart
du regard des consommateurs, préparaient l'indifférence occidentale
devant ces camps où la mort d'êtres humains était administrée
d'une manière digne de la division technique du travail qui dominait
alors la production industrielle. Partout ne voyait-on
Le
fantasme de la fécalité, en particulier, se retrouvait dans tout.
L'invention du tout-à-l'égout et la désinfection appelaient
l'usage de gaz et la crémation des corps plutôt que l'enfouissement
dans des nécropoles surpeuplées; la chasse au péril vénérien, le
confinement des tuberculeux dans des sanatoria isolés; le besoin
d'aération urbaine devant la promiscuité des foules, appelaient la
mobilisation de l'État. Il n'y eut pas jusqu'à l'usage des
barbelés, tirés des grands ranchs
américains, qui furent tricotés autour des camps, voire des usines.
Les grands abattoirs, enfin. Ces lieux où les bestiaux étaient
exterminés en masse pour nourrir les bien nantis des villes,
massacres accomplis dans une asepsie quasi complète et à l'écart
du regard des consommateurs, préparaient l'indifférence occidentale
devant ces camps où la mort d'êtres humains était administrée
d'une manière digne de la division technique du travail qui dominait
alors la production industrielle. Partout ne voyait-on
 |
Buveurs de sang
|
que saleté,
partout. aussi, fit-on en sorte que la propreté régnât! «…le
danger est toujours aux encrassements. Ce qu’indiquent les
innombrables conseils formulés dans les magazines de santé pour
“épurer votre foie”, “dissoudre les graisses”, choisir des
huiles “encrassant moins les artères que d’autres”. Les
vieilles références à l’épurement du corps n’ont pas disparu,
bien au contraire. Elles sont seulement plus travaillées, sinon
euphémisées : déplaçant les mots, les images, évoquant les
graisses et non les déchets, dénonçant les “stockages” et non
les pourrissements. Dépôts divers, circuits embarrassés, demeurent
les indices intuitifs du corps malsain. C’est la graisse qui
focalise les nouveaux dégoûts, matière plus noble que les déchets,
plus insidieuse aussi, infiltrant les moindres espaces et gagnant
chaque enveloppe».
On n'en n'était pourtant pas encore à l'ère de la mal-bouffe et de
l'obésité morbide! Quoi qu'il en soit, toutes
ces avenues allaient chacune dans sa direction, mais la volonté de
pallier à un déclin menaçant les firent converger vers un
hygiénisme obsessionnel.
 |
1er mai sanglant à Fourmies, 1891
|
Ces
conjonctures coiffèrent des structures découlant de la double
schize mentionnée
plus haut. Les sociétés occidentales étaient structurées à la
guerre civile qui se prolongea en guerres internationales à partir
de la seconde décennie du XXe siècle. La guerre de Sécession
américaine; la Commune de Paris; la multiplication des grèves et
des soulèvements sociaux où s'affirmaient différentes idéologies
de combat tels le marxisme et l'anarchisme; l'apothéose marquée par
la Révolution russe en bordure de l'Occident, avec des résonances
dans tous les États d'Europe et d'Amérique du Nord, accrurent les
angoisses qui cherchèrent des réconforts dans les institutions tels
l'école, l'armée, les partis politiques, les rassemblements de
jeunesse, etc. pour contrer ces glissements vers la violence. Le
paradoxe fut que ces solutions semèrent elles-mêmes encore plus de
violence. Plus les structures usaient du rejet, de la haine, de la
ségrégation et du  contrôle absolu, plus les schizes se
creusaient : Propriétaires et Citoyens s'affrontaient dans des
révolutions politiques; Hommes Machines et Sujets kantiens dans des
luttes sociales, voire raciales ou idéologiques. Pour sortir de ce
surenchérissement de confrontations, on n'anticipa plus que l'État
universel comme solution pour écarter la civilisation du fatal
déclin. Cette solution engendra autant de palliatifs qui s'avérèrent
plus dommageables que le mal lui-même. La quête d'un État
universel capable de consolider le marché par l'impérialisme des
grandes puissances mena aux exactions coloniales et aux guerres
mondiales. Ce serait à qui parviendrait à établir un nouvel État
dominant, un État de masses populaires menées par leurs édiles
bourgeois. L'Empire britannique sur lequel, après celui de Charles
Quint, le soleil ne se couchait jamais; l'Empire colonial français
palliatif à la perte de l'Alsace-Lorraine; enfin les régimes
fascistes, concoururent à la prédominance étatique avec des
prétentions autoritaristes inégalées. Plutôt que de ramener
l'ordre social, ces empires cultivèrent le déclin même de la
civilisation tout en avilissant le reste de l'humanité.
L'enchaînement des contingences et de la nécessité – entre les
conjonctures et les structures si l'on préfère -, permet de saisir
la nature profonde de l'historicité occidentale aux yeux de ses
membres durant cette période où la régression sadique-anale marqua
la première révolution culturelle entièrement négative.
contrôle absolu, plus les schizes se
creusaient : Propriétaires et Citoyens s'affrontaient dans des
révolutions politiques; Hommes Machines et Sujets kantiens dans des
luttes sociales, voire raciales ou idéologiques. Pour sortir de ce
surenchérissement de confrontations, on n'anticipa plus que l'État
universel comme solution pour écarter la civilisation du fatal
déclin. Cette solution engendra autant de palliatifs qui s'avérèrent
plus dommageables que le mal lui-même. La quête d'un État
universel capable de consolider le marché par l'impérialisme des
grandes puissances mena aux exactions coloniales et aux guerres
mondiales. Ce serait à qui parviendrait à établir un nouvel État
dominant, un État de masses populaires menées par leurs édiles
bourgeois. L'Empire britannique sur lequel, après celui de Charles
Quint, le soleil ne se couchait jamais; l'Empire colonial français
palliatif à la perte de l'Alsace-Lorraine; enfin les régimes
fascistes, concoururent à la prédominance étatique avec des
prétentions autoritaristes inégalées. Plutôt que de ramener
l'ordre social, ces empires cultivèrent le déclin même de la
civilisation tout en avilissant le reste de l'humanité.
L'enchaînement des contingences et de la nécessité – entre les
conjonctures et les structures si l'on préfère -, permet de saisir
la nature profonde de l'historicité occidentale aux yeux de ses
membres durant cette période où la régression sadique-anale marqua
la première révolution culturelle entièrement négative.  Enfin,
cette période fut celle où le temps l'emporta sur l'espace. Alors
que les limites de la planète étaient reportées aux extrémités
du globe, le temps devenait la conquête du temps, nouvelle
préoccupation des Occidentaux. Ils partirent à la conquête du
temps comme deux siècles plus tôt ils étaient partis à la
conquête de l'espace. Quelles formes prendrait ce temps? Avec
Bergson, ils apprirent à classer en termes de durées et
d'intervalles; avec Proust, ils éprouvèrent l'expérience intimiste
de la mémoire et du rappel mental des souvenirs; avec Einstein, ils
refermèrent l'univers ouvert au temps de Copernic et de Galilée sur
la relation espace-temps; avec la génération de 1914, ils
découvrirent un phénomène humain relativement nouveau :
l'adolescence, caractérisée par un même Zeitgeist. Avec
le néo-paganisme fin-de-siècle, les
Occidentaux redécouvrirent le mythe de l'éternel-retour, moins
celui des cycles astrobiologiques des civilisations anciennes que
celui de la correspondance des temps, des durées significatives, ce
qui invitât les esprits les plus superficiels à considérer que les
temps se répétant, l'histoire ne pouvait être qu'une série de
répétitions événementielles, source d'une phénoménologie de
l'histoire.
Enfin,
cette période fut celle où le temps l'emporta sur l'espace. Alors
que les limites de la planète étaient reportées aux extrémités
du globe, le temps devenait la conquête du temps, nouvelle
préoccupation des Occidentaux. Ils partirent à la conquête du
temps comme deux siècles plus tôt ils étaient partis à la
conquête de l'espace. Quelles formes prendrait ce temps? Avec
Bergson, ils apprirent à classer en termes de durées et
d'intervalles; avec Proust, ils éprouvèrent l'expérience intimiste
de la mémoire et du rappel mental des souvenirs; avec Einstein, ils
refermèrent l'univers ouvert au temps de Copernic et de Galilée sur
la relation espace-temps; avec la génération de 1914, ils
découvrirent un phénomène humain relativement nouveau :
l'adolescence, caractérisée par un même Zeitgeist. Avec
le néo-paganisme fin-de-siècle, les
Occidentaux redécouvrirent le mythe de l'éternel-retour, moins
celui des cycles astrobiologiques des civilisations anciennes que
celui de la correspondance des temps, des durées significatives, ce
qui invitât les esprits les plus superficiels à considérer que les
temps se répétant, l'histoire ne pouvait être qu'une série de
répétitions événementielles, source d'une phénoménologie de
l'histoire.
Le
mythe de l'éternel retour ne fut que l'un des nombreux mythes que
les Occidentaux s'inventèrent durant cette époque troublée.
Georges Sorel inventa le mythe de la Grève générale, exemplum de
la violence révolutionnaire; des Juifs les nationaux récupérèrent
le mythe du Peuple-élu instaurant une véritable rivalité
d'orgueils : la Manifest Destiny des
américains; le jingoïsme britannique,
le surhomme aryen, la mission civilisatrice française, la
 |
| La vieille chapelle de Betsiamites |
vocation évangélique canadienne-française, etc. Ces mythes fondamentaux
entraînèrent la prolifération de mythistoires qui
servirent à constituer des représentations sociales nationalistes
qui, de l'école à l'État, structurèrent les grands débats du
siècle. Ces mythes suscitèrent également la floraison de
philosophies de l'histoire ou d'historiosophies qui reprenaient
l'héritage de Vico, de Herder, de Hegel auxquels s'ajoutèrent le
néo-kantisme de Max Weber et de Wilhelm Dilthey; la sociologie de
Pareto, puis le relativisme crocéen. La philosophie de l'histoire
sans doute la plus originale, la plus exceptionnelle par son
ontologie, fut l'existentialisme allemand qui l'élabora; de
Nietzsche jusqu'à Jaspers avec, chez Heidegger, un système où
l'historicité s'absorbait dans l'historialité de l'Être. Après la
correspondance des époques que l'on trouvait chez Nietzsche et chez
Spengler, l'assimilation de l'expérience historique dans le vécu du
Dasein finissait par
faire de l'histoire une expérience non plus sociale mais strictement
individuelle, ouverte chez Heidegger à la métaphysique, chez
Jaspers à la foi chrétienne,
 |
| Leopold von Ranke |
Jamais
les philosophies de l'histoire semblèrent autant s'éloigner de la
connaissance historique, elle-même en proie à des révolutions
scientifiques et dramaturgiques. Ce fut la grande époque du
positivisme inspiré des enseignements du médecin français Claude
Bernard. On en retrouva des échantillons – bien incomplets –
chez des historiens de grande audition tels Ernest Renan, Hippolyte
Taine et Numa Fustel de Coulanges. En Allemagne, le positivisme
s'était manifesté comme méthode chez von Ranke; en Angleterre chez
Buckle; aux États-Unis chez Bancroft. En face de ce positivisme qui
associait désormais le progrès à l'évolutionnisme darwinien, se
dressait une tendance relativiste qui se manifesta, de manière
pratique chez Jacob Burckhardt et théorique chez Benedetto Croce et
l'Américain Carl Becker. Dans cette veine, le fameux Déclin
de l'Occident jumelait de larges
considérations philosophiques avec des interprétations purement
subjectives de certains phénomènes historiques.
Ce qui sortit toutefois de cette crise de la pensée historienne, ce
ne fut pas ce vaste système philosophique proposé par Spengler,
mais la prolifération des histoires nationales. Issues de la
formation des nations à partir de la fin du siècle, ces histoires
nationales partaient de soucis actuels propres aux nationalités pour
remonter vers la genèse originelle, confirmant ainsi l'essentialité
des peuples contre une humanité généralisée mais artificielle.
Remontant de façon récurrente les différentes temporalités,
d'aujourd'hui aux origines des nations, le travail d'écriture, lui,
reprenait à l'inverse la démarche intellectuelle, s'accordant avec
le fil chronologique une continuité des origines à nos
jours. Non seulement obtenait-on
une théorie de
l'histoire nationale – l'essentialité de la nation -, mais aussi
une pratique à
travers la production de synthèses et surtout de manuels scolaires
chargés d'introjecter dans les esprits ce schéma né de la pensée
d'historiens et de vulgarisateurs producteurs de mythistoires
nationaux plutôt que d'un
authentique travail heuristique érigé avec les méthodes de la
connaissance historique. Ces histoires nationales eurent la vertu de
se transformer très vite en histoires nationalistes,
exclusivement idéologiques et
politiques.
de larges
considérations philosophiques avec des interprétations purement
subjectives de certains phénomènes historiques.
Ce qui sortit toutefois de cette crise de la pensée historienne, ce
ne fut pas ce vaste système philosophique proposé par Spengler,
mais la prolifération des histoires nationales. Issues de la
formation des nations à partir de la fin du siècle, ces histoires
nationales partaient de soucis actuels propres aux nationalités pour
remonter vers la genèse originelle, confirmant ainsi l'essentialité
des peuples contre une humanité généralisée mais artificielle.
Remontant de façon récurrente les différentes temporalités,
d'aujourd'hui aux origines des nations, le travail d'écriture, lui,
reprenait à l'inverse la démarche intellectuelle, s'accordant avec
le fil chronologique une continuité des origines à nos
jours. Non seulement obtenait-on
une théorie de
l'histoire nationale – l'essentialité de la nation -, mais aussi
une pratique à
travers la production de synthèses et surtout de manuels scolaires
chargés d'introjecter dans les esprits ce schéma né de la pensée
d'historiens et de vulgarisateurs producteurs de mythistoires
nationaux plutôt que d'un
authentique travail heuristique érigé avec les méthodes de la
connaissance historique. Ces histoires nationales eurent la vertu de
se transformer très vite en histoires nationalistes,
exclusivement idéologiques et
politiques.
 |
Emmanuel Mounier (1905-1950)
|
La
civilisation occidentale régressait sur ses avancées antérieures
depuis la Renaissance. Ces siècles avaient nécessité un long
travail de mesures et de projections utopiques sans doutes, mais
indispensables au raffinement de la vie et des mœurs. On a
déconsidéré ce qu'écrivait le personnaliste Emmanuel Mounier sous
l'Occupation allemande : «Si
l’enjeu de cette guerre était de revenir sans plus, toute menace
écartée, aux charmes d’un siècle proche, de refaire Vienne
dansante, Naples pouilleuse, Munich baroque et Paris étincelant,
nous aurions bien vite perdu la face. “Retourner le fascisme contre
l’Italie et l’Allemagne”, la formule reste ambiguë, mal
équilibrée. Mais retourner contre les monstruosités du fascisme
les vertus du fascisme, et ce qu’il a, dans l’aberration et
l’épouvante, accouché d’histoire vivante, oui, et il n’y aura
pas de victoire durable, adaptée au monde tel qu’il est, sans
cette intégration».
Il est vrai qu'on aurait peine à trouver des vertus au fascisme.
Comme le dit l'historien militaire canadien Desmond Morton : «La
victoire refuse aux vainqueurs la nécessité de la réflexion».
De leur côté, «les
historiens ont... rempli leur mission, avec célérité. Tournant  la
loi désuète qui protège les secrets d’État pendant cinquante
ans, ils ont exhumé avant l’heure les preuves et les documents qui
accablent Adolf Hitler et Benito Mussolini, l’ogre et le pervers,
coupables d’avoir déchaîné l’enfer. Leurs études confondent
également les timorées, les veules, les incapables qui ne surent
pas, quand ils le pouvaient encore, endiguer le désastre».
Toutefois, rappelle Todorov, «il
faut résister à la tentation d’établir une discontinuité
radicale entre “eux” et “nous”, de diaboliser les coupables,
de considérer les individus ou les groupes comme parfaitement
homogènes et cohérents».
Aussi, plutôt que s'abandonner à ces lieux communs qu'il ne s'agit
plus de contester et encore moins de nier, faut-il accepter que le
fascisme devait avoir au moins quelques vertus, sinon comment
expliquer que des esprits diserts s'y soient ralliés? Churchill
célébrant Mussolini? Le «Time»
élisant le chancelier Hitler personnalité de l'année 1938 après
la culbute de Munich? Encore
après la guerre, «en
mai 1951, un embryon d’organisation internationale fut mis sur pied
lors du congrès qui regroupa à Malmö, en Suède, une centaine de
délégués appartenant aux principaux mouvements européens : E.
Massi pour l’Italie, Mosley pour l’Angleterre, Maurice Bardèche
pour le Comité national français, etc.».
Pour certains, c'étaient les rats qui ressortaient des égouts après
s'y être cachés le temps de l'épuration, mais pour d'autres,
c'était la réhabilitation du fascisme qui était en marche, et qui
triomphe aujourd'hui à travers différentes formes de populisme.
la
loi désuète qui protège les secrets d’État pendant cinquante
ans, ils ont exhumé avant l’heure les preuves et les documents qui
accablent Adolf Hitler et Benito Mussolini, l’ogre et le pervers,
coupables d’avoir déchaîné l’enfer. Leurs études confondent
également les timorées, les veules, les incapables qui ne surent
pas, quand ils le pouvaient encore, endiguer le désastre».
Toutefois, rappelle Todorov, «il
faut résister à la tentation d’établir une discontinuité
radicale entre “eux” et “nous”, de diaboliser les coupables,
de considérer les individus ou les groupes comme parfaitement
homogènes et cohérents».
Aussi, plutôt que s'abandonner à ces lieux communs qu'il ne s'agit
plus de contester et encore moins de nier, faut-il accepter que le
fascisme devait avoir au moins quelques vertus, sinon comment
expliquer que des esprits diserts s'y soient ralliés? Churchill
célébrant Mussolini? Le «Time»
élisant le chancelier Hitler personnalité de l'année 1938 après
la culbute de Munich? Encore
après la guerre, «en
mai 1951, un embryon d’organisation internationale fut mis sur pied
lors du congrès qui regroupa à Malmö, en Suède, une centaine de
délégués appartenant aux principaux mouvements européens : E.
Massi pour l’Italie, Mosley pour l’Angleterre, Maurice Bardèche
pour le Comité national français, etc.».
Pour certains, c'étaient les rats qui ressortaient des égouts après
s'y être cachés le temps de l'épuration, mais pour d'autres,
c'était la réhabilitation du fascisme qui était en marche, et qui
triomphe aujourd'hui à travers différentes formes de populisme.
 |
Evacuations : Saïgon, 1975; Kaboul 2021
|
C'est
que les vainqueurs de 1945 se sont vite empressés de résoudre les
énigmes profondes de cette catastrophe en usant d'un manichéisme
assez simpliste qui, après avoir été projeté sur l'Allemagne
nazie et le Japon impérial, fut reporté sur la Russie soviétique
puis la Chine communiste. C'est avec raison que l'historien américain
Paul Fussell reconnaît non sans chagrin, que «les
États-Unis n’ont toujours pas compris ce qu’a été la Seconde
Guerre mondiale : ils ont donc été incapables d’user de ce savoir
pour réinterpréter et redéfinir leur réalité nationale, et
parvenir à quelque chose comme la maturité publique».
Leurs défaites militaires et diplomatiques successives au Vietnam,
en Irak puis en Afghanistan reposent sur cette incompréhension. D'un
autre côté, il faut bien reconnaître que les révolutions
communistes, de la première à la dernière en ce XXe siècle, n'ont
pas aidé la civilisation à se relever. Jean Guéhenno disait que
«les
révolutions qui comptent sont celles qui ajoutent à la dignité des
hommes».
Durant les premières années de la Révolution russe, on aurait pu
compter sur  |
Rassemblement à Harbin, 1966
|
cette élévation, mais la paranoïa des dirigeants et le
fantasme de l'État universel héritier de l'État autoritariste
tsariste renversèrent le tout en martyrologue soviétique. En Chine,
bien avant la Révolution culturelle des années 60, la révolution
avait perdue toute dignité humaine dès les commencements. Très
vite, les régimes communistes ont pétrifié leurs civilisations
respectives, ce qui faisait soupirer Curtius : «C’est
peut-être ce destin qui attend
[notre civilisation]:
un État universel, totalitaire, un despotisme planétaire avec
prolifération de la technique et dépérissement de l’esprit».
Ce pessimisme n'était plus le même que celui du pressentiment de
l'entraînement fatal du début du siècle; c'était celui du second
après-guerre; celui de Philippe Muray constatant que «sous
l’éclairage de la bombe atomique... commence une nouvelle
nomenclature du genre humain».
Bref, ce n'était plus la régression sadique-anale des XIXe-XXe,
mais celui de la régression sadique-orale des XXe-XXIe siècles. Le
Mal, en effet, s'est présenté sous son jour le plus mauvais, si on
peut dire, durant cet âge de l'Anus
Mundi. Mais
il peut aussi se présenter sous des jours heureux et prospères. Le
Mal à travers le fascisme ou le communisme; à travers le
totalitarisme et la dictature, reste le  Mal tel que nous l'ont
enseigné les religions depuis l'aube de l'humanité. Cette
caricature morale dissimule toutefois une autre interprétation du
Mal; celle de la vertu et de l'obligeance. Il peut tout aussi bien
empoisonner sous les bons que sous les mauvais sentiments. Du
politically
correctness
des années 80 du XXe siècle à la rhétorique woke
qui
s'affiche au nom des victimes de l'Histoire – des femmes, des
LGBTQ2S+,
des racisés (essentiellement des Noirs), des autochtones et autres
orphelins de la cruauté humaine -, se pratique un nouveau
totalitarisme exclusiviste de la pensée qui partage la même
structure représentationnelle que le fascisme du XXe siècle. Comme
l'écrit encore Tzvetan Todorov : «Je
ne crois pas que le mal lui-même ait changé de nature : il consiste
toujours à dénier à quelqu’un son droit d’être pleinement
humain; ni que l’espèce humaine ait subi une mutation; ni enfin
qu’un fanatisme nouveau, d’une puissance jamais vue, soit soudain
apparu. Ce qui a rendu possible ce mal immense, ce sont des traits
tout à fait communs et quotidiens de notre vie; la fragmentation du
monde, la dépersonnalisation des relations humaines. Ces traits
eux-mêmes, cependant, sont l’effet d’une transformation
progressive, non exactement de l’homme, mais de ses sociétés : la
fragmentation intérieure est l’effet de la spécialisation
croissante qui règne dans le monde du travail, donc de sa
compartimentation
Mal tel que nous l'ont
enseigné les religions depuis l'aube de l'humanité. Cette
caricature morale dissimule toutefois une autre interprétation du
Mal; celle de la vertu et de l'obligeance. Il peut tout aussi bien
empoisonner sous les bons que sous les mauvais sentiments. Du
politically
correctness
des années 80 du XXe siècle à la rhétorique woke
qui
s'affiche au nom des victimes de l'Histoire – des femmes, des
LGBTQ2S+,
des racisés (essentiellement des Noirs), des autochtones et autres
orphelins de la cruauté humaine -, se pratique un nouveau
totalitarisme exclusiviste de la pensée qui partage la même
structure représentationnelle que le fascisme du XXe siècle. Comme
l'écrit encore Tzvetan Todorov : «Je
ne crois pas que le mal lui-même ait changé de nature : il consiste
toujours à dénier à quelqu’un son droit d’être pleinement
humain; ni que l’espèce humaine ait subi une mutation; ni enfin
qu’un fanatisme nouveau, d’une puissance jamais vue, soit soudain
apparu. Ce qui a rendu possible ce mal immense, ce sont des traits
tout à fait communs et quotidiens de notre vie; la fragmentation du
monde, la dépersonnalisation des relations humaines. Ces traits
eux-mêmes, cependant, sont l’effet d’une transformation
progressive, non exactement de l’homme, mais de ses sociétés : la
fragmentation intérieure est l’effet de la spécialisation
croissante qui règne dans le monde du travail, donc de sa
compartimentation  inévitable; la dépersonnalisation provient d’un
transfert de la pensée instrumentale au domaine des relations
humaines. Autrement dit, ce qui est approprié aux activités
téléologiques (spécialisation, efficacité) s’empare aussi des
activités intersubjectives, et c’est cela qui multiplie par mille
un potentiel de mal probablement pas très différent de celui des
siècles passés».
C'est dire que le contenu idéologique pèse peu dans la balance,
tout comme les anciens programmes fascistes pesaient peu dans la
politique appliquée des régimes italien et hitlérien. Une
rhétorique de gauche exprimée sous une forme de droite finit
aujourd'hui par soulever la même répugnance que les fascismes jadis
chez les esprits critiques, il y a un siècle maintenant. Le profil
de l'historicité est le même.
inévitable; la dépersonnalisation provient d’un
transfert de la pensée instrumentale au domaine des relations
humaines. Autrement dit, ce qui est approprié aux activités
téléologiques (spécialisation, efficacité) s’empare aussi des
activités intersubjectives, et c’est cela qui multiplie par mille
un potentiel de mal probablement pas très différent de celui des
siècles passés».
C'est dire que le contenu idéologique pèse peu dans la balance,
tout comme les anciens programmes fascistes pesaient peu dans la
politique appliquée des régimes italien et hitlérien. Une
rhétorique de gauche exprimée sous une forme de droite finit
aujourd'hui par soulever la même répugnance que les fascismes jadis
chez les esprits critiques, il y a un siècle maintenant. Le profil
de l'historicité est le même.
 Le
fascisme, dans sa veine la plus totalitaire, dressait
l'interpénétration de l'espace publique et de l'espace privé. Il y
avait là une structure indéfectiblement schizophrénique. Le XXIe
siècle a commencé sur les mêmes failles que le siècle précédent,
sinon que les formes ont quelque peu évolué. L'Homme-Machine est
devenu ce robot entièrement assimilé par son équipement informatique alors que le Sujet kantien n'est plus qu'un client du
Marché et de l'État qui se réclame du droit de consommer librement
et de l'impératif de sa sécurité, en particulier de sa santé. Cet
hypocondriaque conditionné par les opérations de son instrument
numérique est l'aboutissement du prolétaire du XIXe siècle. Il
Le
fascisme, dans sa veine la plus totalitaire, dressait
l'interpénétration de l'espace publique et de l'espace privé. Il y
avait là une structure indéfectiblement schizophrénique. Le XXIe
siècle a commencé sur les mêmes failles que le siècle précédent,
sinon que les formes ont quelque peu évolué. L'Homme-Machine est
devenu ce robot entièrement assimilé par son équipement informatique alors que le Sujet kantien n'est plus qu'un client du
Marché et de l'État qui se réclame du droit de consommer librement
et de l'impératif de sa sécurité, en particulier de sa santé. Cet
hypocondriaque conditionné par les opérations de son instrument
numérique est l'aboutissement du prolétaire du XIXe siècle. Il
 s'est haussé quelque peu socialement, mais il s'est appauvri des
vertus viriles et stoïques qui l'éduquaient deux siècles plus tôt.
En lui sommeillent aussi le Propriétaire et le Citoyen. C'est par ce
dernier qu'il peut réclamer à cor et à cri son droit à la
socialisation de son individualité, aux garanties de la santé et à
sa sécurité (financière) que les États refusaient jusqu'à tout
récemment de lui concéder, mais dont la crise de surproduction en
société de consommation oblige de satisfaire. Le Propriétaire, de
son côté, devient de moins en moins une individualité humaine
qu'un consortium quelconque de grandes entreprises multinationales
aussi bien que de petites coopératives locales, s'affichant d'un
acronyme et d'un numéro quand il ne peut être plus anonyme! Dans
l'ensemble, les luttes ne sont pas moins féroces, et les
conjonctures se présentent toujours selon une suite d'enchaînements
disparates. Derrière leur apparence de grande liberté, comme des
huîtres, les sociétés occidentales se referment de plus en plus à
l'image des sociétés totalitaires de jadis. Ils entretiennent des
valeurs, non tant humanistes – c'est là que plusieurs se laissent
prendre à gauche -, qu'anthropologiques dans le sens où l'entendent
les impératifs catégoriques kantiens, aujourd'hui garantis par
différentes versions de charte de droits, tous définis à
l'intérieur de paradigmes de la mondialisation néo-libérale. Comme
Todorov, nous pourrions rendre compte ainsi de nos sociétés : «Pour
rendre compte des actions et des qualités humaines dans le cadre des
camps, mais aussi en dehors d’eux, j’ai dû recourir à une série
d’oppositions, dont je constate maintenant qu’elles s’englobent
les unes les autres. Au niveau le plus abstrait, j’ai distingué
entre activités téléologiques et intersubjectives; parmi
celles-ci, j’ai été amené à séparer sphère publique et sphère
privée, opposition conduisant à celle de la politique et de la
morale (selon le principe de la “subjectivité” de toute action
morale). Au sein même de la morale, j’ai dû opposer vertus
héroïques et vertus quotidiennes (d’après le critère de
“personnalisation”); et, pour ces dernières, j’ai eu recours à
la distinction entre morale de principes et morale de sympathie. Or,
à énumérer ainsi ces oppositions, plusieurs observations sautent
aux yeux. On pourrait formuler la première comme une double exigence
: alors qu’il s’agit de véritables oppositions qui n’admettent
pas de synthèse, les deux termes sont aussi nécessaires l’un que
l’autre à la vie de l’individu comme à celle de la société.
Il faut que le travail soit efficace et que les relations humaines ne
lui soient pas sacrifiées; il est préférable que la société soit
juste et les individus bons; que les vertus héroïques se fassent
jour dans les circonstances exceptionnelles et les vertus
quotidiennes, dans la vie de tous les jours; et l’on a vu que
l’action des sauveteurs exigeait à la fois une morale de principes
et une morale de sympathie. Est-il possible de surmonter les tensions
nées de ces couples d’exigences?».
Certes, nous ne vivons plus dans des camps, nous vivons à l'air
libre, avec notre entourage affectif et nos lieux de fréquentation.
Personne ne remarque que nos barbelés ne sont plus à l'extérieur,
mais dans nos têtes.
s'est haussé quelque peu socialement, mais il s'est appauvri des
vertus viriles et stoïques qui l'éduquaient deux siècles plus tôt.
En lui sommeillent aussi le Propriétaire et le Citoyen. C'est par ce
dernier qu'il peut réclamer à cor et à cri son droit à la
socialisation de son individualité, aux garanties de la santé et à
sa sécurité (financière) que les États refusaient jusqu'à tout
récemment de lui concéder, mais dont la crise de surproduction en
société de consommation oblige de satisfaire. Le Propriétaire, de
son côté, devient de moins en moins une individualité humaine
qu'un consortium quelconque de grandes entreprises multinationales
aussi bien que de petites coopératives locales, s'affichant d'un
acronyme et d'un numéro quand il ne peut être plus anonyme! Dans
l'ensemble, les luttes ne sont pas moins féroces, et les
conjonctures se présentent toujours selon une suite d'enchaînements
disparates. Derrière leur apparence de grande liberté, comme des
huîtres, les sociétés occidentales se referment de plus en plus à
l'image des sociétés totalitaires de jadis. Ils entretiennent des
valeurs, non tant humanistes – c'est là que plusieurs se laissent
prendre à gauche -, qu'anthropologiques dans le sens où l'entendent
les impératifs catégoriques kantiens, aujourd'hui garantis par
différentes versions de charte de droits, tous définis à
l'intérieur de paradigmes de la mondialisation néo-libérale. Comme
Todorov, nous pourrions rendre compte ainsi de nos sociétés : «Pour
rendre compte des actions et des qualités humaines dans le cadre des
camps, mais aussi en dehors d’eux, j’ai dû recourir à une série
d’oppositions, dont je constate maintenant qu’elles s’englobent
les unes les autres. Au niveau le plus abstrait, j’ai distingué
entre activités téléologiques et intersubjectives; parmi
celles-ci, j’ai été amené à séparer sphère publique et sphère
privée, opposition conduisant à celle de la politique et de la
morale (selon le principe de la “subjectivité” de toute action
morale). Au sein même de la morale, j’ai dû opposer vertus
héroïques et vertus quotidiennes (d’après le critère de
“personnalisation”); et, pour ces dernières, j’ai eu recours à
la distinction entre morale de principes et morale de sympathie. Or,
à énumérer ainsi ces oppositions, plusieurs observations sautent
aux yeux. On pourrait formuler la première comme une double exigence
: alors qu’il s’agit de véritables oppositions qui n’admettent
pas de synthèse, les deux termes sont aussi nécessaires l’un que
l’autre à la vie de l’individu comme à celle de la société.
Il faut que le travail soit efficace et que les relations humaines ne
lui soient pas sacrifiées; il est préférable que la société soit
juste et les individus bons; que les vertus héroïques se fassent
jour dans les circonstances exceptionnelles et les vertus
quotidiennes, dans la vie de tous les jours; et l’on a vu que
l’action des sauveteurs exigeait à la fois une morale de principes
et une morale de sympathie. Est-il possible de surmonter les tensions
nées de ces couples d’exigences?».
Certes, nous ne vivons plus dans des camps, nous vivons à l'air
libre, avec notre entourage affectif et nos lieux de fréquentation.
Personne ne remarque que nos barbelés ne sont plus à l'extérieur,
mais dans nos têtes.
À
l'âge de l'Anus
Mundi, les
guerres contribuèrent à confondre pleinement sphère privée et
sphère publique. Ernst Jünger, qui s'y connaissait pour avoir vu du
côté allemand les deux guerres mondiales, écrivait dans les années
60 du XXe siècle : «Dans
ces guerres mondiales, la chose nouvelle à vrai dire n'est pas
l'ampleur, mais cette qualité sans précédent qui fait d'elles  des
opérations de la population terrestre et oblige par là à se
demander si juridiquement, politiquement, éthiquement, on peut
encore les concevoir comme des guerres au sens ancien. S'il n'y avait
pas changement de qualité, seulement d'ampleur, de telles questions
ne surgiraient même pas».
Désormais, l'administration publique; la propagande; le
conditionnement médiatique; la tyrannie
de la majorité
à son paroxysme, nous font payer le prix fort de la sécurité
sociale et médicale en introduisant la sphère publique dans nos
vies privées; d'un autre côté, par les réseaux sociaux et
l'inventaire innombrable de ses
des
opérations de la population terrestre et oblige par là à se
demander si juridiquement, politiquement, éthiquement, on peut
encore les concevoir comme des guerres au sens ancien. S'il n'y avait
pas changement de qualité, seulement d'ampleur, de telles questions
ne surgiraient même pas».
Désormais, l'administration publique; la propagande; le
conditionnement médiatique; la tyrannie
de la majorité
à son paroxysme, nous font payer le prix fort de la sécurité
sociale et médicale en introduisant la sphère publique dans nos
vies privées; d'un autre côté, par les réseaux sociaux et
l'inventaire innombrable de ses  modélisations, nous assistons à
l'intrusion dans la vie publique de la sphère privée d'individus
souvent pire que médiocres. Les ressentiments ponctués
d'éructations obscènes se substituent progressivement à la
démocratie et deviennent le socle de nos actuels populistes qui
n'hésiteront pas à bouffer du woke
pour
récupérer l'entièreté de la pensée et de la forme de droite.
Nous prenons à peine conscience de ce danger, et comme il ne
reproduit pas le schéma de l'entre-deux-guerres. nous voyons nos
socialistes bon teints, par leur enthousiasme écervelé, détruire
l'œuvre des gauches du dernier demi-siècle. C'est ainsi, que
reproduisant la formule (contingences/nécessité = l'historicité,
qu'il m'apparaît que la logique
de l'histoire,
à la période de l'Anus
Mundi, pourrait
s'exprimer par cette formule :
modélisations, nous assistons à
l'intrusion dans la vie publique de la sphère privée d'individus
souvent pire que médiocres. Les ressentiments ponctués
d'éructations obscènes se substituent progressivement à la
démocratie et deviennent le socle de nos actuels populistes qui
n'hésiteront pas à bouffer du woke
pour
récupérer l'entièreté de la pensée et de la forme de droite.
Nous prenons à peine conscience de ce danger, et comme il ne
reproduit pas le schéma de l'entre-deux-guerres. nous voyons nos
socialistes bon teints, par leur enthousiasme écervelé, détruire
l'œuvre des gauches du dernier demi-siècle. C'est ainsi, que
reproduisant la formule (contingences/nécessité = l'historicité,
qu'il m'apparaît que la logique
de l'histoire,
à la période de l'Anus
Mundi, pourrait
s'exprimer par cette formule :
hygiénisme
> Déclin
guerre civile⏳
Jean-Paul Coupal
Sherbrooke,
28 décembre 2021
Notes











 contrôle absolu, plus les schizes se
creusaient : Propriétaires et Citoyens s'affrontaient dans des
révolutions politiques; Hommes Machines et Sujets kantiens dans des
luttes sociales, voire raciales ou idéologiques. Pour sortir de ce
surenchérissement de confrontations, on n'anticipa plus que l'État
universel comme solution pour écarter la civilisation du fatal
déclin. Cette solution engendra autant de palliatifs qui s'avérèrent
plus dommageables que le mal lui-même. La quête d'un État
universel capable de consolider le marché par l'impérialisme des
grandes puissances mena aux exactions coloniales et aux guerres
mondiales. Ce serait à qui parviendrait à établir un nouvel État
dominant, un État de masses populaires menées par leurs édiles
bourgeois. L'Empire britannique sur lequel, après celui de Charles
Quint, le soleil ne se couchait jamais; l'Empire colonial français
palliatif à la perte de l'Alsace-Lorraine; enfin les régimes
fascistes, concoururent à la prédominance étatique avec des
prétentions autoritaristes inégalées. Plutôt que de ramener
l'ordre social, ces empires cultivèrent le déclin même de la
civilisation tout en avilissant le reste de l'humanité.
L'enchaînement des contingences et de la nécessité – entre les
conjonctures et les structures si l'on préfère -, permet de saisir
la nature profonde de l'historicité occidentale aux yeux de ses
membres durant cette période où la régression sadique-anale marqua
la première révolution culturelle entièrement négative.
contrôle absolu, plus les schizes se
creusaient : Propriétaires et Citoyens s'affrontaient dans des
révolutions politiques; Hommes Machines et Sujets kantiens dans des
luttes sociales, voire raciales ou idéologiques. Pour sortir de ce
surenchérissement de confrontations, on n'anticipa plus que l'État
universel comme solution pour écarter la civilisation du fatal
déclin. Cette solution engendra autant de palliatifs qui s'avérèrent
plus dommageables que le mal lui-même. La quête d'un État
universel capable de consolider le marché par l'impérialisme des
grandes puissances mena aux exactions coloniales et aux guerres
mondiales. Ce serait à qui parviendrait à établir un nouvel État
dominant, un État de masses populaires menées par leurs édiles
bourgeois. L'Empire britannique sur lequel, après celui de Charles
Quint, le soleil ne se couchait jamais; l'Empire colonial français
palliatif à la perte de l'Alsace-Lorraine; enfin les régimes
fascistes, concoururent à la prédominance étatique avec des
prétentions autoritaristes inégalées. Plutôt que de ramener
l'ordre social, ces empires cultivèrent le déclin même de la
civilisation tout en avilissant le reste de l'humanité.
L'enchaînement des contingences et de la nécessité – entre les
conjonctures et les structures si l'on préfère -, permet de saisir
la nature profonde de l'historicité occidentale aux yeux de ses
membres durant cette période où la régression sadique-anale marqua
la première révolution culturelle entièrement négative.


 de larges
considérations philosophiques avec des interprétations purement
subjectives de certains phénomènes historiques.
Ce qui sortit toutefois de cette crise de la pensée historienne, ce
ne fut pas ce vaste système philosophique proposé par Spengler,
mais la prolifération des histoires nationales. Issues de la
formation des nations à partir de la fin du siècle, ces histoires
nationales partaient de soucis actuels propres aux nationalités pour
remonter vers la genèse originelle, confirmant ainsi l'essentialité
des peuples contre une humanité généralisée mais artificielle.
Remontant de façon récurrente les différentes temporalités,
d'aujourd'hui aux origines des nations, le travail d'écriture, lui,
reprenait à l'inverse la démarche intellectuelle, s'accordant avec
le fil chronologique une continuité des origines à nos
jours. Non seulement obtenait-on
une théorie de
l'histoire nationale – l'essentialité de la nation -, mais aussi
une pratique à
travers la production de synthèses et surtout de manuels scolaires
chargés d'introjecter dans les esprits ce schéma né de la pensée
d'historiens et de vulgarisateurs producteurs de mythistoires
nationaux plutôt que d'un
authentique travail heuristique érigé avec les méthodes de la
connaissance historique. Ces histoires nationales eurent la vertu de
se transformer très vite en histoires nationalistes,
exclusivement idéologiques et
politiques.
de larges
considérations philosophiques avec des interprétations purement
subjectives de certains phénomènes historiques.
Ce qui sortit toutefois de cette crise de la pensée historienne, ce
ne fut pas ce vaste système philosophique proposé par Spengler,
mais la prolifération des histoires nationales. Issues de la
formation des nations à partir de la fin du siècle, ces histoires
nationales partaient de soucis actuels propres aux nationalités pour
remonter vers la genèse originelle, confirmant ainsi l'essentialité
des peuples contre une humanité généralisée mais artificielle.
Remontant de façon récurrente les différentes temporalités,
d'aujourd'hui aux origines des nations, le travail d'écriture, lui,
reprenait à l'inverse la démarche intellectuelle, s'accordant avec
le fil chronologique une continuité des origines à nos
jours. Non seulement obtenait-on
une théorie de
l'histoire nationale – l'essentialité de la nation -, mais aussi
une pratique à
travers la production de synthèses et surtout de manuels scolaires
chargés d'introjecter dans les esprits ce schéma né de la pensée
d'historiens et de vulgarisateurs producteurs de mythistoires
nationaux plutôt que d'un
authentique travail heuristique érigé avec les méthodes de la
connaissance historique. Ces histoires nationales eurent la vertu de
se transformer très vite en histoires nationalistes,
exclusivement idéologiques et
politiques.
 la
loi désuète qui protège les secrets d’État pendant cinquante
ans, ils ont exhumé avant l’heure les preuves et les documents qui
accablent Adolf Hitler et Benito Mussolini, l’ogre et le pervers,
coupables d’avoir déchaîné l’enfer. Leurs études confondent
également les timorées, les veules, les incapables qui ne surent
pas, quand ils le pouvaient encore, endiguer le désastre».11
Toutefois, rappelle Todorov, «il
faut résister à la tentation d’établir une discontinuité
radicale entre “eux” et “nous”, de diaboliser les coupables,
de considérer les individus ou les groupes comme parfaitement
homogènes et cohérents».12
Aussi, plutôt que s'abandonner à ces lieux communs qu'il ne s'agit
plus de contester et encore moins de nier, faut-il accepter que le
fascisme devait avoir au moins quelques vertus, sinon comment
expliquer que des esprits diserts s'y soient ralliés? Churchill
célébrant Mussolini? Le «Time»
élisant le chancelier Hitler personnalité de l'année 1938 après
la culbute de Munich? Encore
après la guerre, «en
mai 1951, un embryon d’organisation internationale fut mis sur pied
lors du congrès qui regroupa à Malmö, en Suède, une centaine de
délégués appartenant aux principaux mouvements européens : E.
Massi pour l’Italie, Mosley pour l’Angleterre, Maurice Bardèche
pour le Comité national français, etc.».13
Pour certains, c'étaient les rats qui ressortaient des égouts après
s'y être cachés le temps de l'épuration, mais pour d'autres,
c'était la réhabilitation du fascisme qui était en marche, et qui
triomphe aujourd'hui à travers différentes formes de populisme.
la
loi désuète qui protège les secrets d’État pendant cinquante
ans, ils ont exhumé avant l’heure les preuves et les documents qui
accablent Adolf Hitler et Benito Mussolini, l’ogre et le pervers,
coupables d’avoir déchaîné l’enfer. Leurs études confondent
également les timorées, les veules, les incapables qui ne surent
pas, quand ils le pouvaient encore, endiguer le désastre».11
Toutefois, rappelle Todorov, «il
faut résister à la tentation d’établir une discontinuité
radicale entre “eux” et “nous”, de diaboliser les coupables,
de considérer les individus ou les groupes comme parfaitement
homogènes et cohérents».12
Aussi, plutôt que s'abandonner à ces lieux communs qu'il ne s'agit
plus de contester et encore moins de nier, faut-il accepter que le
fascisme devait avoir au moins quelques vertus, sinon comment
expliquer que des esprits diserts s'y soient ralliés? Churchill
célébrant Mussolini? Le «Time»
élisant le chancelier Hitler personnalité de l'année 1938 après
la culbute de Munich? Encore
après la guerre, «en
mai 1951, un embryon d’organisation internationale fut mis sur pied
lors du congrès qui regroupa à Malmö, en Suède, une centaine de
délégués appartenant aux principaux mouvements européens : E.
Massi pour l’Italie, Mosley pour l’Angleterre, Maurice Bardèche
pour le Comité national français, etc.».13
Pour certains, c'étaient les rats qui ressortaient des égouts après
s'y être cachés le temps de l'épuration, mais pour d'autres,
c'était la réhabilitation du fascisme qui était en marche, et qui
triomphe aujourd'hui à travers différentes formes de populisme.























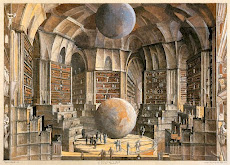
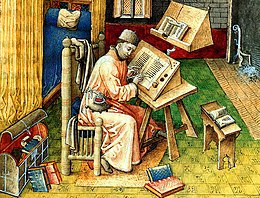







































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire