 |
| Départ du premier train canadien de Laprairie en direction de Saint-Jean |
PRÉFACE, 2017
Si
je remets aujourd'hui les textes d'Une
histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce n'est sûrement
pas pour rendre hommage à une population dont l'absence de dignité
et d'honneur est tout à mon avantage.
Ce
texte, je le remets pour les historiens, les anthropologues de
l'avenir, tous ceux qui s'intéresseront à une ville dont le nom
aurait pu (et dû) être fictif. Depuis 50 ans, les édiles de
Saint-Jean-sur-Richelieu sont le pire ramassis de corrompus
politiques qui phagocytent les budgets municipaux ou entourent les
députations, tant au provincial qu'au fédéral. Totalement vidés
de toute intelligence, de tout projet pour ressourcer leur patelin
endormi au gaz, plutôt que de faire une édition livre de ce texte,
ont gaspillé les fonds publics à une murale sans intérêt qu'ils
n'entretiendront pas plus qu'ils n'ont entretenu jusqu'ici leur
patrimoine historique.
On
pourra dire que personne ne m'a rien demandé. Et c'est vrai. Qu'on
ne m'a jamais promis ni salaire, ni emploi, ni quelques fonctions
pour profiter de mes mérites. Et c'est vrai. On pourra dire qu'on a
préféré piller ces ouvrages plutôt que de les valoriser. Et c'est
vrai. On pourra dire également que toute la population de la ville
ne doit pas souffrir de la négligence douteuse de ses édiles tant
elle a, par certains, manifester une bonne volonté aussi
ostentatoire que vaine. Et c'est encore vrai. Mais cela ne change
rien à ce que je viens d'écrire. Cinquante ans de saloperies
municipales témoignent en ma faveur.
Aussi,
restera-t-il aux historiens et aux anthropologues de l'avenir un
modèle afin de réfléchir et comprendre comment une ville
québécoise naît, se développe, dépérit et meurt. Car
Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville sans attrait, morte, vieillie
dans ses façades gelées. Les citoyens les plus riches s'amusent à
jouer aux personnages historiques en faisant des soupers fins sur le
Pont Gouin ou en faisant du radicalisme péquiste au nom d'une
identité qu'ils n'ont même pas su conserver pour leur ville et
prétendent défendre pour l'ensemble du Québec. Autant d'hypocrisie
et de mauvaise volonté me font plaindre ceux qui demeurent encore
dans ce trou noir ou pour respirer, vaut mieux s'expatrier et faire
ce que l'on a à faire en s'adaptant une identité autre qui, au
moins, aura un écho respectable.
Quoi
qu'il en soit, et je ne m'étendrai pas sur des ressentiments vains.
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu m'écoeure et à la manière de
Gide, je terminerai sur ces mots : Johannais, je vous hais.
Jean-Paul
Coupal
17
mars 2017
Sommaire:
Présentation
L’Âge du
prestige (1840-1940)
L'ÂGE DE CROISSANCE
Le fort Saint-Jean comme chantier naval. Tant que la guerre dura
entre l'Angleterre et ses colonies rebelles, il n'était pas question
d'abandonner le fort Saint-Jean. Les autorités britanniques y développèrent un
chantier naval, consacrant environ $ 100 000 à ces travaux. À partir de l'été
1776, des navires de toutes dimensions sont lancés sur le Richelieu pour porter
la guerre au lac Champlain. Même des embarcations légères y furent transportées
par voie de terre. Bref, c'était une véritable Armada qui se constituait au
«port» de Saint-Jean :  «Des chantiers de Saint-Jean, dirigés par les
capitaines Douglas et Pringle de la Royal Navy, sortirent entre autres, le Maria,
de 328 tonneaux, armé de 12 pièces de 6, l'Inflexible, de 189 tonneaux,
armé pour sa part de 18 pièces de 12 et le Thunderer, un ketch muni de
16 pièces. Un peu plus tard viendra aussi s'ajouter le Royal George, un
vaisseau qu'on arma de pas moins de 20 canons. À la fin de septembre, en plus
de ces vaisseaux, Carleton pouvait compter sur une soixantaine de bateaux à
fond plat, 34 canonnières, 6 gondoles armées (prises aux rebelles) et 25 autres
embarcations destinées au transport des troupes».
À l'exception du Royal George (terminé au début de 1777 seulement),
cette flotte commandée par le capitaine Pringle quitta Saint-Jean au début
d'octobre et alla vaincre la flotte américaine constituée pourtant d'une
quinzaine de vaisseaux armés de 94 pièces dont le Royal Savage, capturé
l'automne précédent devant le fort Saint-Jean. C'était une défaite définitive,
car plus jamais les rebelles américains ne menaceront la vallée du Richelieu.
Malgré tout, il n'y eut pas un moment où la garnison du fort Saint-Jean ne
relâcha le guêt. Le chantier naval poursuivait régulièrement sa production de vaisseaux
pour alimenter la flotte britannique du lac Champlain. Les charpentiers
travaillaient également aux ouvrages de défense du fort Saint-Jean. En 1778, le
gouverneur Haldimand assigna £ 24 000 aux constructions du fort qui se
poursuivirent jusqu'en 1783, c'est-à-dire à la signature de la paix entre
l'Angleterre et les nouveaux États-Unis d'Amérique.
«Des chantiers de Saint-Jean, dirigés par les
capitaines Douglas et Pringle de la Royal Navy, sortirent entre autres, le Maria,
de 328 tonneaux, armé de 12 pièces de 6, l'Inflexible, de 189 tonneaux,
armé pour sa part de 18 pièces de 12 et le Thunderer, un ketch muni de
16 pièces. Un peu plus tard viendra aussi s'ajouter le Royal George, un
vaisseau qu'on arma de pas moins de 20 canons. À la fin de septembre, en plus
de ces vaisseaux, Carleton pouvait compter sur une soixantaine de bateaux à
fond plat, 34 canonnières, 6 gondoles armées (prises aux rebelles) et 25 autres
embarcations destinées au transport des troupes».
À l'exception du Royal George (terminé au début de 1777 seulement),
cette flotte commandée par le capitaine Pringle quitta Saint-Jean au début
d'octobre et alla vaincre la flotte américaine constituée pourtant d'une
quinzaine de vaisseaux armés de 94 pièces dont le Royal Savage, capturé
l'automne précédent devant le fort Saint-Jean. C'était une défaite définitive,
car plus jamais les rebelles américains ne menaceront la vallée du Richelieu.
Malgré tout, il n'y eut pas un moment où la garnison du fort Saint-Jean ne
relâcha le guêt. Le chantier naval poursuivait régulièrement sa production de vaisseaux
pour alimenter la flotte britannique du lac Champlain. Les charpentiers
travaillaient également aux ouvrages de défense du fort Saint-Jean. En 1778, le
gouverneur Haldimand assigna £ 24 000 aux constructions du fort qui se
poursuivirent jusqu'en 1783, c'est-à-dire à la signature de la paix entre
l'Angleterre et les nouveaux États-Unis d'Amérique.
«C'est à cette époque, soit après le départ
des Américains en 1776, qu'on construisit également un blockhaus sur la rive
est, où se trouve aujourd'hui la ville d'Iberville. On sait aussi que ce fortin
fut attaqué à 2 reprises durant l'hiver de 1776-1777 et qu'on dut en 1778 le
protéger en abattant sur une distance de 500 yards des arbres dans le marais
qui l'entourait…
Néanmoins, à la fin de la guerre de l’Indépendance le fort Saint-Jean
n’était pas sans reproche. On avait réussi à déboiser davantage ses environs,
pour en rendre l’approche plus difficile, on avait également approfondi le
fossé qui l’entourait et les parapets avaient été surélevés. Mais les casernes,
les magasins et les dépôts de munitions étaient en assez mauvais état. Il faut
cependant souligner, à la décharge des constructeurs, que le feu ne les aida
pas. De 1776 à 1783, on enregistra pas moins de 6 incendies, dont un seul fut
plutôt léger. Les casernes furent ainsi détruites en juin 1776, en mars et
avril 1777 et de nouveau en mai 1780 alors qu’un dépôt de munitions sauta et
endommagea considérablement une redoute».
L’arrivée des Loyalistes au fort Saint-Jean. Aux premières familles établies
à la fin du Régime français vinrent s’ajouter, après la guerre de 1775, les
Loyalistes anglais qui désertèrent les colonies rebelles. Saint-Jean était le
premier poste que ces exilés rencontraient qui descendaient les rives du
Richelieu, il leur servait donc de bureau d’enregistrement et de refuge
temporaire avant de regagner Montréal. À la  population originale, ils
apportaient 213 habitants formés d'un contingent de 40 célibataires, jeunes
gens pour la plupart, et un autre de 37 familles : «L’état civil des
nouveaux immigrés pouvait se répartir à peu près comme suit : 38 journaliers, 6
marchands; et des gens de métiers au nombre de 26 dont un orfèvre et 2
bateliers. Au service public on trouve 2 maîtres d’école, 2 employés aux
Casernes et un aux Douanes».
Deux familles d’origine américaine - Charles Greshon (au lieu de Grageon) et
les deux Robinson, appelés dans l’expertise de 1770, Robertson - résidaient
déjà dans la région de Saint-Jean quand le cortège des Loyalistes vint s’y
établir. Tous étaient de bien pauvres gens, dépourvus de leur fortune par les
rebelles et figurant longtemps à la charge de l’assistance publique. Une
agglomération naissait, davantage marquée par sa physionomie anglaise bien que
le plat-pays était développé par des cultivateurs francophones : «D’ailleurs
les loyalistes disparaissent rapidement». Mais certains d’entre eux
s’établirent à demeure auprès du fort. John Richardson établit le premier
magasin général et Ephraïm Mott, le premier service de traversiers entre les
deux rives jusqu’alors non reliées.
population originale, ils
apportaient 213 habitants formés d'un contingent de 40 célibataires, jeunes
gens pour la plupart, et un autre de 37 familles : «L’état civil des
nouveaux immigrés pouvait se répartir à peu près comme suit : 38 journaliers, 6
marchands; et des gens de métiers au nombre de 26 dont un orfèvre et 2
bateliers. Au service public on trouve 2 maîtres d’école, 2 employés aux
Casernes et un aux Douanes».
Deux familles d’origine américaine - Charles Greshon (au lieu de Grageon) et
les deux Robinson, appelés dans l’expertise de 1770, Robertson - résidaient
déjà dans la région de Saint-Jean quand le cortège des Loyalistes vint s’y
établir. Tous étaient de bien pauvres gens, dépourvus de leur fortune par les
rebelles et figurant longtemps à la charge de l’assistance publique. Une
agglomération naissait, davantage marquée par sa physionomie anglaise bien que
le plat-pays était développé par des cultivateurs francophones : «D’ailleurs
les loyalistes disparaissent rapidement». Mais certains d’entre eux
s’établirent à demeure auprès du fort. John Richardson établit le premier
magasin général et Ephraïm Mott, le premier service de traversiers entre les
deux rives jusqu’alors non reliées.
Le cas de la famille Mott mérite qu'on s'y arrête. Le patriarche,
Samuel Mott, originaire d’Alburg dans l’état de New York, était agriculteur
lorsque la rébellion éclata. Il prit parti pour la cause britannique et
travailla pour les services secrets de Sa Majesté. Démasqué, emprisonné, il fut
alors obligé de s’enfuir avec toute sa famille. Ils arrivèrent en 1788, pensant refaire leur vie au Canada. Après
une décennie de vaches maigres, Samuel qui avait dû laisser ses biens aux rebelles,
reçoit, en 1799, des terres dans le township de Hinchinbrooke, dans le comté
actuel de Huntingdon. La progéniture Mott s’adonne à l’agriculture, sauf l’un
d’entre eux, Ephraim, qui s’intéresse au commerce et établit dès 1797 son
service de traversiers. Il s’allie bientôt avec une famille
canadienne-française, habile en affaires et promise à un avenir dans notre
région : les Marchand. Le jeune Ephraim - il n’a alors que 23 ans en 1797 -
restera dans notre région tandis que ses parents iront habiter les terres que
leurs a concédées le gouvernement britannique.
Avec la fin de la guerre d’Indépendance, les forts de la vallée du
Richelieu seront, à nouveau, abandonné. En juin 1785, un jeune marchand
londonien, Robert Hunter, est l’hôte du 31e Régiment commandé par le major
Cotton. Il nous a laissé une description de l’atmosphère de l’endroit, assez
lourde. Comme pour Peher Kalm, le fort de Saint-Jean reste le fort aux
Maringouins à cause de l’abondance des moustiques. L’alternance des
journées ensoleillées et humides aux journées pluvieuses et froides transforme
la terre en bourbier et donne une routine maussade à la vie quotidienne : «Tandis
que le douanier examinait les marchandises en provenance du sud, les militaires
vérifiaient l’identité des voyageurs».
Pas étonnant que le commandant du fort et le douanier en chef président les
soirées de fêtes et de réjouissances organisées par la garnison et au cours
desquelles on enfume les salles pour chasser les moustiques tout en pouvant
boire du rhum et écouter la fanfare du régiment! En 1787, il ne reste au fort
qu’un détachement, celui du 26e Régiment et quelques hommes de l’Artillerie
Royale, en tout 230 militaires. C’est quand même déjà beaucoup plus que par le
passé.
Intrigues étrangères à la frontière canado-américaine. Peu à peu, des postes de
relais furent érigés pour les voyageurs qui allaient de New York à Montréal;
des hôtels, en grand nombre, et des magasins, enfin durant la guerre, en 1815,
un premier Bureau de postes. En 1795, le village de Saint-Jean était composé
déjà d'une centaine de maisons. L’activité commerciale dont Montréal était la
plaque tournante drainait des Laurentides, de l’Outaouais et des régions de
l’Ouest canadien, les peaux, les bois d’œuvres et de pulpe que l’on faisait
cheminer par les cours d’eau, ou par des transports routiers. C’est dans ces
temps qu’on put dire que Saint-Jean était le quatrième port du Canada pour ses
activités commerciales. La croissance de ce lieu de transit ne fut perturbée
que lors des intrigues internationales qui se déroulèrent dans le contexte de
la Révolution française.
Entre 1796 et 1797, près de Saint-Jean, une intrigue encore obscure
malgré l’étude qu’en a fait Jean-Pierre Wallot se déroule à la frontière. En
France, le gouvernement du Directoire avait comme délégué plénipotentiaire aux
États-Unis un certain Pierre-Auguste Adet qui entretenait des espions au
Canada. Vers  décembre 1796, Ira Allen, du Vermont, se rendit en France sous
prétexte d’acheter une grande quantité d’armes ostensiblement destinées aux
milices volontaires. Le produit de la transaction comprenait 20 000 fusils,
plusieurs pièces d’artillerie, munitions et autres provisions de guerre, le
tout chargé à bord d’un navire appelé La branche d’Olivier (Oliver
Branch). Le navire fut capturé et la cour d’amirauté déclara la saisie
valable. Au même moment, un certain David McLane, d’origine irlandaise, aurait
servi d’agent de liaison pour Adet en vue de sonder la population francophone
du Canada. L’arrestation, puis le procès de McLane montra qu’il avait bénéficié
de la complicité de certains habitants de Saint-Jean, dont le plus important,
du nom de Charles Frichet (ou plutôt Fréchette), lui aurait servi de guide dans
ses déplacements. Ce menuisier qu’on disait illettré avait un frère curé à Belœil.
En fait, il aurait également servi d’intermédiaire afin de soudoyer un député
de Québec à l’Assemblée législative du nom de Black. Contrairement à McLane qui
fut exécuté, Fréchette échappa à la mort mais vit ses biens confisqués. Afin
d’éviter que le commerce d’armes transite par Saint-Jean ou d’autres points de
la frontière, le président américain, John Adams, qui venait de signer un
accord commercial avec l’Angleterre, cella la frontière et mit fin aux
intrigues frontalières en forçant Adet à cesser ses intrigues. Plus tard,
Jérôme Bonaparte, le frère du Premier Consul, Napoléon, arriva à New York en
1803 et se dirigea vers Albany, puis vers le lac Champlain. Aussitôt, la
paranoïa s’empara des Anglais de Montréal : «Ne vient-il pas sonder le
terrain en vue d’une tentative d’invasion?». Jérôme Bonaparte était venu se
marier, et plus tard on le retrouvera roi de Westphalie.
décembre 1796, Ira Allen, du Vermont, se rendit en France sous
prétexte d’acheter une grande quantité d’armes ostensiblement destinées aux
milices volontaires. Le produit de la transaction comprenait 20 000 fusils,
plusieurs pièces d’artillerie, munitions et autres provisions de guerre, le
tout chargé à bord d’un navire appelé La branche d’Olivier (Oliver
Branch). Le navire fut capturé et la cour d’amirauté déclara la saisie
valable. Au même moment, un certain David McLane, d’origine irlandaise, aurait
servi d’agent de liaison pour Adet en vue de sonder la population francophone
du Canada. L’arrestation, puis le procès de McLane montra qu’il avait bénéficié
de la complicité de certains habitants de Saint-Jean, dont le plus important,
du nom de Charles Frichet (ou plutôt Fréchette), lui aurait servi de guide dans
ses déplacements. Ce menuisier qu’on disait illettré avait un frère curé à Belœil.
En fait, il aurait également servi d’intermédiaire afin de soudoyer un député
de Québec à l’Assemblée législative du nom de Black. Contrairement à McLane qui
fut exécuté, Fréchette échappa à la mort mais vit ses biens confisqués. Afin
d’éviter que le commerce d’armes transite par Saint-Jean ou d’autres points de
la frontière, le président américain, John Adams, qui venait de signer un
accord commercial avec l’Angleterre, cella la frontière et mit fin aux
intrigues frontalières en forçant Adet à cesser ses intrigues. Plus tard,
Jérôme Bonaparte, le frère du Premier Consul, Napoléon, arriva à New York en
1803 et se dirigea vers Albany, puis vers le lac Champlain. Aussitôt, la
paranoïa s’empara des Anglais de Montréal : «Ne vient-il pas sonder le
terrain en vue d’une tentative d’invasion?». Jérôme Bonaparte était venu se
marier, et plus tard on le retrouvera roi de Westphalie.
Les premiers trains de bois. En 1787 est inauguré le commerce de bois avec
le Vermont. On se souvient que De Bleury y était un commerçant déjà très actif
à la fin du Régime français. Isaac Weld et le topographe Bouchette remarquent
tous deux l’ampleur du commerce de bois de construction alors que le Richelieu
sert admirablement bien de voie de circulation pour le transport des arbres. Pour
le moment, ce bois ne vient pas encore des Pays d’en-haut, c’est un
produit même de notre région, de nos forêts : les pins rouges coupés près de la
rivière et qui servent à la construction des mâts par exemple. En 1788, un
incendie ravage la forêt sur plusieurs milles de distance. Cela crée une
véritable pénurie dans l’approvisionnement du bois de chauffage et de
construction. L’incident plonge la région dans une première crise économique.
Mais, heureusement, le trajet du bois peut aussi se faire en sens inverse.
Selon Réal Fortin, c’est en 1794 que le premier convoi de billots de chênes, en
provenance du Vermont, celui de Stephen Mallet, aurait descendu le Richelieu.
On voyage beaucoup sur le Richelieu. Les grands canots de bouleau,
assemblés avec du ouatape, peuvent parcourir 15 lieues par jour en eau calme et
plus encore quand le vent souffle dans la bonne direction et frappe la voile
qu’on y a monté. De plus, ce moyen de transport rudimentaire nécessite fort peu
de matériel de réparation : un rouleau d’écorce de bouleau et une boule de
gomme d’épinette ou de sapin. Les canotiers servent de guide, car les eaux de
la rivière peuvent se montrer capricieuses et même traitresses. Le flottage
n’est pas l’unique activité commerciale du Richelieu quand on pense au
commerce à caractère purement local ou régional, mais c’est le plus
spectaculaire :
«Le bois descend le Richelieu avant de le
remonter vers les États-Unis. Vers 1806, Lambert nous décrit ces immenses
"trains de bois surmontés de petites fentes servant d’abris au 100 ou 150
rameurs", ces raftsmen ou boulés qui constituent un élément pittoresque de
notre région.
(…) Les "cages" peuvent partir
d’aussi loin que Bytown (Ottawa).
Jefferys nous donne la description du premier
radeau sur la rivière Outaouais en 1805; "en troncs d’arbres équarris,
réunis par des douilles de bois et attachés par des racines de saule, …guidés
par des avirons sur le côté, ceux d’en avant aident à contourner les rochers et
les bas-fonds". Les "cageux" descendent le Saint-Laurent et se
font tirer par des chevaux contre le courant du Richelieu.
Imaginez : ces radeaux ont environ 60 pieds de
long par 20 de large… et on en attache plusieurs ensemble. Ces processions
atteignent 100, 200 et 300 pieds de longs.
Après avoir livré le bois, il arrive qu’on
transporte des immigrants et le diable seul se doute de tous les objets de
contrebande que recèlent les innombrables racoins des cages…»
La naissance de Dorchester. La baronnie de Longueuil a été concédé le 8 juillet
1710 à Charles Le Moyne, premier baron de Longueuil (1656-1729). Son fils
Charles (1687-1755) lui succède à sa mort, puis Charles-Jacques, le troisième
baron, en 1755. L’épouse de ce dernier est devenue la baronne douairière en
1776 et s’est alliée à Guillaume Grant, d’origine écossaise. En 1791,
Chalotte-Jospeh Le Moyne, fille de Charles-Jacques, épouse David-Alexandre
Grant et devint baronne de Longueuil. Lui succéderont Charles-William Grant en
1841, Charles-Irwin Grant en 1848, Charles Colmore Grant en 1880, Réginald
d’Iberville Grant en 1898 et John de Bienville Grant en 1931. En 1790, le baron
de Longueuil, David Alexander Grant, avait acquis, grâce au droit de retrait,
les terres de Christie, situées entre les rues Saint-Georges et Foch, qui
avaient pris de la valeur avec l'installation des Loyalistes : «Le seigneur
Grant profita de la loi autorisant le retrait féodal pour racheter les terrains
qu’il avait concédés comme fermes; il les fit diviser en lots de ville par
l’arpenteur Watson. Tels furent les commencements de la ville de Dorchester,
ville frontière, ville de garnison jusqu’à ce jour, ville anglaise et ultra
royaliste, mais qui, avec les années devait reprendre le nom de son ancien fort
en même temps que les pures traditions françaises».
 Les terres loties par l'arpenteur Simon Z. Watson déterminaient le site
originel de la Ville de Saint-Jean. La première rue ouverte se nomme Front
(Richelieu). Vient ensuite le nom de la rue Mc Cumming (Champlain), qui porte
le nom d'un ancien soldat et marchand établi sur la rue Richelieu avant 1791;
la rue James (devenue Saint-Jacques, évidemment); la rue Charles
(Saint-Charles); la rue Water (la Place du Quai) et la rue Partition
(Saint-Georges). En 1804, le seigneur Grant impose à la localité le nom de
Dorchester en l’honneur du titre accordé à l’ex-gouverneur Carleton. Les
citoyens francophones continueront d'utiliser l'ancien nom de Saint-Jean.
Les terres loties par l'arpenteur Simon Z. Watson déterminaient le site
originel de la Ville de Saint-Jean. La première rue ouverte se nomme Front
(Richelieu). Vient ensuite le nom de la rue Mc Cumming (Champlain), qui porte
le nom d'un ancien soldat et marchand établi sur la rue Richelieu avant 1791;
la rue James (devenue Saint-Jacques, évidemment); la rue Charles
(Saint-Charles); la rue Water (la Place du Quai) et la rue Partition
(Saint-Georges). En 1804, le seigneur Grant impose à la localité le nom de
Dorchester en l’honneur du titre accordé à l’ex-gouverneur Carleton. Les
citoyens francophones continueront d'utiliser l'ancien nom de Saint-Jean.
En 1793, un voyageur français, Charles Fevret de Saint-Mesmin, raconte
que, au prix de quatre piastres, une voiture de Laprairie l’amène en trois
heures à Saint-Jean, par des chemins plutôt raboteux, «garnis d’arbres
couchés en  travers de la route». Les deux meilleures auberges étant
pleines, il obtient un lit dans une troisième, «encore n’y trouvâmes-nous,
écrit-il, que deux lits vaquants dans une chambre où un étranger en occupait
déjà un». Le lendemain, 11 octobre, arrive au fort le premier visiteur
royal de Saint-Jean, le prince Edward, duc de Kent, fils de George III et
futur père de la reine Victoria, qui commande alors les troupes anglaises au
Canada. Reçu par les officiers de la garnison, il invite M. de Saint-Mesmin à
dîner à son côté et fait avec lui la conversation en un français absolument
parfait.
En 1795, c’est au tour d’un voyageur anglais, Isaac Weld, de passer par chez
nous : «Le visiteur de 1795, Isaac Weld, parle de Saint-Jean en termes peu
flatteurs : un amas sans ordre d’une centaine de misérables maisons. Les
censitaires français de la Baronie de Longueuil établis le long de l’eau avaient
dû vendre leurs terres à Hazen ou Christie, pour aller s’établir vers l’ouest
ou dans les seigneuries voisines».
Ces maisons devaient être celles des Loyalistes.
travers de la route». Les deux meilleures auberges étant
pleines, il obtient un lit dans une troisième, «encore n’y trouvâmes-nous,
écrit-il, que deux lits vaquants dans une chambre où un étranger en occupait
déjà un». Le lendemain, 11 octobre, arrive au fort le premier visiteur
royal de Saint-Jean, le prince Edward, duc de Kent, fils de George III et
futur père de la reine Victoria, qui commande alors les troupes anglaises au
Canada. Reçu par les officiers de la garnison, il invite M. de Saint-Mesmin à
dîner à son côté et fait avec lui la conversation en un français absolument
parfait.
En 1795, c’est au tour d’un voyageur anglais, Isaac Weld, de passer par chez
nous : «Le visiteur de 1795, Isaac Weld, parle de Saint-Jean en termes peu
flatteurs : un amas sans ordre d’une centaine de misérables maisons. Les
censitaires français de la Baronie de Longueuil établis le long de l’eau avaient
dû vendre leurs terres à Hazen ou Christie, pour aller s’établir vers l’ouest
ou dans les seigneuries voisines».
Ces maisons devaient être celles des Loyalistes.

Le facteur démographique demeure toujours un épineux problème. Le
peuplement de la région est lent et ne s’opère que par coups successifs, comme
si on ne savait pas exactement où la population finirait par s’enraciner. En
1808, on compte 983 personnes dans la paroisse de Saint-Luc, tandis qu’à la
même époque, Saint-Jean ne compte à peine que 80 maisons, ce qui devait
représenter un maximum de 400 âmes. Dès 1801, Saint-Luc est constituée en
paroisse avec curé résident, luxe que Dorchester ne se paiera pas avant 1828!
Si l’on tient à avoir un tableau complet de la petite ville au début du XIXe
siècle, il faut rassembler tous ces témoignages épars qui pourtant concordent :
«
La ville de Saint-Jean… commençait, quoique
s’organisant péniblement, à offrir quelques distractions aux militaires. À
environ 200 verges du fort, en bordure de la rivière et des deux côtés de la
route menant à Chambly, des maisons de bois à peine équarri s’alignaient
lentement les unes après les autres. À la fin du XVIIIe siècle, Dorchester
comptait, d’après les annales de l’époque, au plus une centaine de maisons,
toutes misérables. Aucune entreprise digne de ce nom ne s’y trouvait, quoiqu’on
y voyait déjà quelques minuscules magasins, des débits de liqueurs et des
hôtels. Les Loyalistes, presque aussi pauvres les uns que les autres, étaient
partout présents. Pendant qu’on discutait des interminables procès concernant
les terres de la baronnie de Longueuil et que quelques militaires et loyalistes
assistaient aux réunions de la loge maçonnique Dorchester fondée en 1792,
plusieurs soldats faisaient vivre de leurs deniers les petits établissements de
la place. On s’y amusait souvent, s’y chamaillait quelquefois, et, à
l’occasion, on soulevait les protestations des émigrants paisibles, qui
n’avaient cependant pas les moyens de perdre leur clientèle. En fait, on était
vraiment pauvre à Saint-Jean, à l’époque. Plusieurs loyalistes recevaient même
leur pain quotidien du gouvernement. Par surcroît, un feu ayant détruit les
forêts environnantes en 1788, même le bois de chauffage et de construction
coûtait cher».
Dorchester : ville mal-famée. Tels furent donc les douleurs de croissance
de la ville actuelle. En 1811 paraîtra le Voyage au Canada en 1795
d’Isaac Weld, dont nous avons déjà relevé la piètre opinion :  «Saint-Jean
contient environ cent misérables maisons de bois, et des casernes dans
lesquelles est logée toute la garnison. Les fortifications sont en si mauvais
état qu’il en coûterait moins pour élever de nouveaux ouvrages que pour réparer
les anciens. Il y a dans ce lieu un chantier royal, rempli de bois de
construction, ou qui du moins l’était quand nous passâmes; mais dans le cours
de l’été suivant, quand le brick dont j’ai fait mention, fut désarmé, tout ce
bois fut vendu. Les vieilles carcasses de plusieurs bâtiments considérables se
trouvaient à l’opposite du chantier. La ville de Saint-Jean étant le port des Anglais
sur le lac Champlain doit s’augmenter en raison de l’accroissement du commerce
entre New York et le Canada. Le pays des environs est plat et très dégarni
d’arbres, un incendie affreux ayant en 1788 détruit les forêts, à la distance
de plusieurs milles. Le manque de bois de chauffage fait extrêmement souffrir
les habitants de quelques cantons voisins…»
En 1787, on l’a vu, un poste de douanes est établi au sein même du fort. Ville
parcourue par des voyageurs de passage, constituée de militaires et de débardeurs
du port, Dorchester devint un lieu propice aux vices et aux rixes entre mauvais
garçons.
«Saint-Jean
contient environ cent misérables maisons de bois, et des casernes dans
lesquelles est logée toute la garnison. Les fortifications sont en si mauvais
état qu’il en coûterait moins pour élever de nouveaux ouvrages que pour réparer
les anciens. Il y a dans ce lieu un chantier royal, rempli de bois de
construction, ou qui du moins l’était quand nous passâmes; mais dans le cours
de l’été suivant, quand le brick dont j’ai fait mention, fut désarmé, tout ce
bois fut vendu. Les vieilles carcasses de plusieurs bâtiments considérables se
trouvaient à l’opposite du chantier. La ville de Saint-Jean étant le port des Anglais
sur le lac Champlain doit s’augmenter en raison de l’accroissement du commerce
entre New York et le Canada. Le pays des environs est plat et très dégarni
d’arbres, un incendie affreux ayant en 1788 détruit les forêts, à la distance
de plusieurs milles. Le manque de bois de chauffage fait extrêmement souffrir
les habitants de quelques cantons voisins…»
En 1787, on l’a vu, un poste de douanes est établi au sein même du fort. Ville
parcourue par des voyageurs de passage, constituée de militaires et de débardeurs
du port, Dorchester devint un lieu propice aux vices et aux rixes entre mauvais
garçons.
«[La ville] commence à se dessiner, encore
assez vaguement, sur la limite septentrionale du fort. Sur l’emplacement de la
ville actuelle, le long du fleuve, des habitations se groupent, abritent une
population mixte : une centaine de réfugiés loyalistes et 20 familles environ,
de Canadiens français.
Au bout de l’eau, puis peu à peu vers l’ouest,
de minables logis se construisent péniblement les uns à la suite des autres,
témoignant de la médiocre aisance des premiers citadins et d’un souci peu
marqué de l’hygiène, et parfois même de la moralité au quartier des affaires où
s’agglomèrent déjà magasinets et débits de liqueurs. La garnison voisine ne
tarde pas à créer en un tel milieu une atmosphère bien marquée de licence;
désordres divers et rixes fréquentes, donnant occasion aux habitants du fort de
baptiser ce coin peu recommandable du nom de "Rookery". On appelle
aussi, en Angleterre, les bosquets de vieux arbres où se plaisent à nicher, en
troupes innombrables, les petits corbeaux noirs de ce pays (Jackdaws) bruyants,
batailleurs et malpropres.
Il est resté assez longtemps un souvenir de ce
vieux sobriquet. Quand les Canadiens français devinrent l’élément dominant de
Dorchester, on continua d’appeler ce vieux coin La Roquerie».
Un autre visiteur, américain celui-là, John Lambert,
passe par Dorchester vers 1807 et s’arrête à décrire longuement la ville
naissante et ses habitants en termes encore-là peu élogieux. Au sujet du fort,
il observe qu’«il contient un magasin à poudre, quelques pièces de canon et
un détachement de soldats, mais il est au total incapable de défense efficace.
Les fortifications consistent en une sorte de redoute, faite de terre et
renforcie de piquets de cèdre; au centre se trouvent quelques maisons et une
poudrière». La rue
Front (Richelieu), baptisée ainsi parce que longeant la rivière, attire
également son regard : «Le village de Saint-Jean ne comprend qu’une courte
rue bordée de maisons dont la plupart sont des magasins et des auberges».
Lambert dit être resté 3 jours in this miserable village. Et surtout,
commerces indispensables à l’origine de cette atmosphère mal-famée, l’ouverture
de 2 tavernes en 1807 : «En 1807, les tavernes Watson et Cheeseman, toutes
deux administrées par des étrangers venus du sud, étaient les lieux les plus
chics de l’endroit. C’est là que les plus fortunés se réunissaient autour d’une
bouteille de rhum. On pouvait obtenir un déjeuner substantiel dans les
meilleurs hôtels de St. Johns pour 25 cents. Suivant la valeur monétaire de
l’époque, une course en carriole du fort à la ville coûtait dix shillings et le
bois nécessaire pour chauffer une petite maison durant 24 heures revenait à
environ 5 shilllings. Une ration de pain pour une journée se vendait 2
shillings et 6 pences».
Un autre document témoin est la Topographie du Bas-Canada
de Joseph Bouchette (1774-1841), publiée en 1815, où l’on retrouve une
description touffue de la baronnie de Longueuil:
«C’est une
étendue de terre très unie et extrêmement fertile, bien habituée et bien
cultivée, traversée par de grandes routes, dont la principale se dirige vers le
sud; arrosée par le Richelieu, elle est commodément située pour le transport
par eau. Elle contient les paroisses de Saint-Luc et de Blairfindie,  la ville
de Dorchester et le Fort de Saint-Jean. Dorchester mérite à peine le nom de
ville, contenant tout au plus 80 maisons, dont plusieurs servent de magasins.
Mais probablement, sous peu d’années, il deviendra plus important: étant situé
assez favorablement pour devenir entre les deux pays, tant en été qu’en hiver,
l’entrepôt des marchandises qui y passent par terre ou par eau. Pendant
l’hiver, il y a une communication très active, par le moyen des traîneaux qui
voyagent sur la surface gelée des lacs et des rivières.
la ville
de Dorchester et le Fort de Saint-Jean. Dorchester mérite à peine le nom de
ville, contenant tout au plus 80 maisons, dont plusieurs servent de magasins.
Mais probablement, sous peu d’années, il deviendra plus important: étant situé
assez favorablement pour devenir entre les deux pays, tant en été qu’en hiver,
l’entrepôt des marchandises qui y passent par terre ou par eau. Pendant
l’hiver, il y a une communication très active, par le moyen des traîneaux qui
voyagent sur la surface gelée des lacs et des rivières.
Avant la guerre, on y faisait un commerce très étendu de bois de construction,
et il est probable qu’il reprendra son activité avec le retour de la paix.
Une grande
partie des habitants qui y résident sont des émigrés américains qui ont fait le
serment d’allégeance au gouvernement britannique. Quelques-uns tiennent les
meilleurs hôtels de l’endroit et sont propriétaires des voitures publiques qui
partent régulièrement pour la Prairie d’un côté et les États du Vermont et de
New York de l’autre.
Le Fort de
Saint-Jean, sur la rive occidentale du Richelieu, est de forme irrégulière :
c’est une ancienne place frontière, mais il y a peu à dire de sa construction
et de ses défenses. Ce ne sont que des ouvrages de terre fortifiés par des
palissades et des piquets. Il y a dans ce fort environ vingt maisons : y
compris les arsenaux, les magasins publics, etc. On y a entretenu dernièrement
des forces considérables : étant aussi près des frontières, c’est un poste très
important. Les ouvrages ont été mis dans un état de défense respectable.
L’officier qui y commande est chargé des postes plus avancés sur cette ligne:
il reçoit tous les rapports militaires et les transmet au général qui commande
dans le district.
La force navale
anglaise employée sur le lac Champlain a sa principale station et son arsenal à
cet endroit. On y a construit des vaisseaux qui portaient de 20 à 32 canons;
ils ont maintenu notre supériorité sur le Lac jusqu’au malheureux combat devant
Plattsburg en 1814. Notre flottille y fut détruite, mais cet événement
désastreux ne fut pas déshonorant pour le pavillon national. Si la guerre avait
continué, des efforts redoublés, joints aux moyens qu’on avait préparés, lui
aurait bientôt redonné son ascendant ordinaire».
L'arrivée des frères Marchand. «Puis arrivent les Marchand…» laisse échapper, comme en
un soupire, le Père Brosseau. Il s’agit des frères Gabriel, François et Louis
Marchand. Ces commerçants audacieux vinrent de Québec à Saint-Jean dans le but
de profiter du commerce de bois précieux. Gabriel arrive le premier, en 1802.
Il avait été gérant à Québec de la maison d'importation McNiver. Ses deux
frères viendront l'y rejoindre en 1816. En 1803, Gabriel Marchand s'associe à
John MacNider et François-Xavier Durette pour former une maison de commerce de
bois sous le nom de Gabriel Marchand & Compagnie. Il installe à
Saint-Jean la première maison de commerce et fait sur le pourtour du lac
Champlain de grands abatis de pin blanc, de chêne et autres essences propres à
la construction. Par le Richelieu, puis le Saint-Laurent, elles sont expédiées
en radeaux vers Québec et par bateaux à l’étranger. «Nos bois ont donc
commencé par descendre le Richelieu avant de le remonter vers New York»,
insiste le père Brosseau. En 1816, Gabriel passe la main à ses frères et
s’achète une terre vers le chemin de Saint-Luc, le Domaine de Beauchamp situé
dans le nord-est de la ville, domaine où sont érigés aujourd'hui l'hôpital du
Haut-Richelieu, la polyvalente Armand-Racicot, des centres d'achat et des blocs
résidentiels, et que surplombe le pont Félix-Gabriel Marchand. Cet immense
domaine est le résultat de trois achats successifs de terrains entre 1816 et
1843. Prenant sa retraite des affaires, Gabriel Marchand s'occupe donc
principalement de la culture de ses terres et prend des charges publiques,
tandis que ses frères continuent à faire prospérer la compagnie, s'associant
désormais à Ambroise et Édouard Bourgeois.
Indices d’une maturation certaine. La rue Front, devenue rue
Richelieu, traverse trois anciennes terres à ferme : la propriété des Babuty
entre Frontenac et Saint-Georges ainsi que deux terres ayant appartenu à
Gabriel Christie et Moses Hazen entre Saint-Georges et Foch, dont l'une avait
été concédée avec titres au notaire Grisé en 1764. Une loge maçonnique est
fondée en 1792, la Dorchester. Plusieurs soldats font vivre les petits
établissements de la place. Parmi ces habitants dans la partie nord de la rue
Saint-Georges, on compte le négociant Laughlin Mc Millan, le fabricant de roues
John Lay, le boulanger Alexander Fraser mort en 1791, le charpentier Silas
Pearson, le soldat et commerçant James McCumming. S'ajoutent à la liste les
marchands Alexander Shutt et Abraham Griggs, ainsi que le boulanger Andrew
Mabon décédé en 1803. Au sud de Saint-Georges, des baux à emphytéose sont
consentis par Elisabeth Stivens, l'épouse de Jacques-Christophe Babuty fils, à
diverses personnes dont Abijah Cheesman, John Steel, Patrick Conroy, Jacob Heath et plusieurs autres. Parmi les premiers commerces que l'on retrouve à
cette époque il y a des débits de liqueurs, des hôtels ainsi que diverses
boutiques. Grâce à la prospérité venant du port et des échanges avec les
États-Unis, divers nouveaux commerces s'établissent. L'entreprise de W.
Borland, fondée en 1821, fabrique des articles de cuir; le magasin-général de
Nelson Mott; des magasins de marchandises sèches sont dirigés par les frères
Louis et François Marchand; des associés Ambroise et Édouard Bourgeois participent
aux entreprises des frères Marchand. Le magasin d'Édouard Bourgeois vend des
produits alimentaires, du charbon, du sel, de la farine, du poisson et des vins
jusque dans les années 1860, à l'intersection nord-ouest des rues Saint-Charles
et Richelieu. Edward et Duncan MacDonald dirigent un magasin général après la
rébellion de 1837-1838 et ce, durant plus de 25 ans. Ces derniers seront
banquiers par la suite. Jason C. Peirce est importateur et marchand général sur
la rue Front. Tous ces commerçants vont fournier la base à l'établissement des
premières fortunes de la ville de Saint-Jean.
Dorchester au sein de l’organisation politique du Bas-Canada. En 1792 Saint-Jean
appartient au  comté de Kent et ce jusqu'en 1830, puis au comté de Huntingdon.
De 1830 à 1854, la municipalité est rattachée au comté de Chambly et, de 1854 à
1867, au nouveau comté de Saint-Jean. Au plan judiciaire, la ville fait partie
du district de Montréal entre 1760 et 1857. À l’époque, ce sont des juridictions
administratives et politiques à la fois vastes et vagues. Deux députés
représentent le comté à l’Assemblée législative du Bas-Canada : René Boileau et
Pierre Legras-Pierreville, premiers députés du comté de Kent de 1792 à 1796,
puis Antoine Mesnard Lafontaine (de 1796 à 1804), Jacques Viger (de 1796 à sa
mort en 1798), Michel Amable Berthelot d’Artigny (de 1798 à 1800), François
Viger (de 1800 à 1808), Pierre Weilbrenner (de 1804 à 1808), Joseph Planté (de
1808 à 1809), le jeune tribun Louis-Joseph Papineau (de 1814 à 1816), Noël Breux
(de 1814 à 1816), Denis-Benjamin Viger (de 1816 à 1830), Pierre Bruneau (de
comté de Kent et ce jusqu'en 1830, puis au comté de Huntingdon.
De 1830 à 1854, la municipalité est rattachée au comté de Chambly et, de 1854 à
1867, au nouveau comté de Saint-Jean. Au plan judiciaire, la ville fait partie
du district de Montréal entre 1760 et 1857. À l’époque, ce sont des juridictions
administratives et politiques à la fois vastes et vagues. Deux députés
représentent le comté à l’Assemblée législative du Bas-Canada : René Boileau et
Pierre Legras-Pierreville, premiers députés du comté de Kent de 1792 à 1796,
puis Antoine Mesnard Lafontaine (de 1796 à 1804), Jacques Viger (de 1796 à sa
mort en 1798), Michel Amable Berthelot d’Artigny (de 1798 à 1800), François
Viger (de 1800 à 1808), Pierre Weilbrenner (de 1804 à 1808), Joseph Planté (de
1808 à 1809), le jeune tribun Louis-Joseph Papineau (de 1814 à 1816), Noël Breux
(de 1814 à 1816), Denis-Benjamin Viger (de 1816 à 1830), Pierre Bruneau (de
 1816 à sa mort, 1820) et Frédéric Auguste Quesnel (de 1820 à 1830). Les petits
villages se fondent et se développent dans les environs, mais le peuplement des
régions rurales francophones, par le taux de natalité, entraîne une loi de
refonte de la carte électorale en 1829 qui crée 3 nouveaux comtés portant les
noms de L’Acadie, Chambly et Rouville. Avec la réforme de la carte électorale,
les villes de Saint-Jean, Saint-Luc et L’Acadie se trouvent désormais comprises
dans le comté de Chambly, tandis que les villages situés plus au sud-ouest se
retrouvent dans le comté de l’Acadie. Dorchester est donc située à la frontière
des deux comtés. Frédéric Auguste Quesnel est député du comté de Chambly de
1830 à 1834, Louis-Michel Viger, de 1830 à 1838 et Louis Lacoste de 1834 à
1838. Robert Hoyle et François Languedoc sont les premiers députés du comté de
L’Acadie de 1830 à 1834, suivis de Cyrille-Hector-Octave Côté et Merritt
Hotchkiss de 1834 à 1838.
1816 à sa mort, 1820) et Frédéric Auguste Quesnel (de 1820 à 1830). Les petits
villages se fondent et se développent dans les environs, mais le peuplement des
régions rurales francophones, par le taux de natalité, entraîne une loi de
refonte de la carte électorale en 1829 qui crée 3 nouveaux comtés portant les
noms de L’Acadie, Chambly et Rouville. Avec la réforme de la carte électorale,
les villes de Saint-Jean, Saint-Luc et L’Acadie se trouvent désormais comprises
dans le comté de Chambly, tandis que les villages situés plus au sud-ouest se
retrouvent dans le comté de l’Acadie. Dorchester est donc située à la frontière
des deux comtés. Frédéric Auguste Quesnel est député du comté de Chambly de
1830 à 1834, Louis-Michel Viger, de 1830 à 1838 et Louis Lacoste de 1834 à
1838. Robert Hoyle et François Languedoc sont les premiers députés du comté de
L’Acadie de 1830 à 1834, suivis de Cyrille-Hector-Octave Côté et Merritt
Hotchkiss de 1834 à 1838.
La guerre de 1812-1814. À Sait-Jean, le poste des douanes ne tarde pas à
péricliter, s’avérant trop coûteux :
«
Quelques années avant la guerre de 1812,
pendant que le douanier William Lindsay se débattait pour obtenir une indemnité
pour les dépenses trop nombreuses occasionnées par sa charge, et que le
menuisier-entrepreneur, Salomon Davis, réparait les bâtiments réservés à la
douane, le reste du fort cédait lentement aux intempéries et à l’âge. Le
capitaine Gother Mann des Royal Engineers élabora bien deux projets de
reconstruction du fort Saint-Jean, l’un en 1791, l’autre en 1804, mais ni l’un
ni l’autre ne dépassèrent le stade des recommandations. Aussi Saint-Jean ne fut
doté ni de la base navale, ni du fort de pierre imaginé par Mann. L’apparition
des premières routes carrossables entre le Canada et les États-Unis avait aux
yeux de certains diminué l’importance stratégique du Richelieu au point qu’on
hésita alors à investir les sommes qu’il aurait fallu pour redonner des
fortifications dignes de ce nom».
Un beau matin, le douanier Lindsay reçoit une lettre en date du 27 août
1812 lui ordonnant de quitter le fort Saint-Jean, le plus vite serait le mieux,
et de remettre les clefs au maître des Casernes et courir se réfugier à
Sainte-Thérèse. Il ne se fait pas prier. En effet, une nouvelle guerre entre
les États-Unis et l’Angleterre vient d’être déclarée et la garnison doit être
organisée. C’est dans ce contexte qu'est d’ailleurs fondé le premier bureau de
postes à Dorchester, en 1812. Mais ce n’est pas Saint-Jean qui sera le centre de
l’investissement militaire, mais le fort de l’île-aux-Noix. Véritable chantier
maritime et principale base navale du lac Champlain, le fort de l’île-aux-Noix
refoula le fort Saint-Jean dans son rôle d’arsenal et de point d’appui, comme
au temps où Saint-Jean servait de centre d’approvisionnement pour le fort
Saint-Frédéric. Ses casernes sont quelque peu restaurées afin de recevoir de
nombreuses troupes appelées à venir y loger. Dès octobre 1812, le 100e Régiment
y stationne 463 hommes. Les Voltigeurs de Salaberry s’illustrent dans la
 nuit du 19 au 20 novembre lorsque, installés à Lacolle avec une troupe de 300
autochtones, ils sont attaqués par surprise par une troupe de réguliers
américains, avant-garde de l'armée de Dearborn. À la faveur de la nuit, les
Américains se méprennent et tardent à s’apercevoir qu’ils s’entre-tuent. Ils
battent finalement en retraite. À son retour, de Salaberry fait embarrasser la
route de troncs d’arbres.
Les batailles navales se déroulent essentiellement au lac Champlain et ne
remontent jamais aussi bas dans le Richelieu. Au printemps de 1814, alors que
la division américaine du général Wilkinson menace d’envahir à nouveau le
Canada, 750 hommes logent aux casernes. Ils font partis du 19e Light Dragoons,
du 13 et 49e Régiments et des Voltigeurs. Ce sont ces troupes qui, le 30 mars,
se portent à Lacolle pour arrêter la marche de l’ennemi en centrant la
résistance autour du moulin de l’endroit. La dernière tentative d’envahir le
Canada par la vallée du Richelieu se solde par un échec. Le gouverneur Prevost
tentera bien d’organiser des forces réunies à Saint-Jean en vue de marcher sur
Plattsburg, mais - comme Burgoyne en 1776, «pauvre homme de guerre» -, il
échouera complètement dans son entreprise.
nuit du 19 au 20 novembre lorsque, installés à Lacolle avec une troupe de 300
autochtones, ils sont attaqués par surprise par une troupe de réguliers
américains, avant-garde de l'armée de Dearborn. À la faveur de la nuit, les
Américains se méprennent et tardent à s’apercevoir qu’ils s’entre-tuent. Ils
battent finalement en retraite. À son retour, de Salaberry fait embarrasser la
route de troncs d’arbres.
Les batailles navales se déroulent essentiellement au lac Champlain et ne
remontent jamais aussi bas dans le Richelieu. Au printemps de 1814, alors que
la division américaine du général Wilkinson menace d’envahir à nouveau le
Canada, 750 hommes logent aux casernes. Ils font partis du 19e Light Dragoons,
du 13 et 49e Régiments et des Voltigeurs. Ce sont ces troupes qui, le 30 mars,
se portent à Lacolle pour arrêter la marche de l’ennemi en centrant la
résistance autour du moulin de l’endroit. La dernière tentative d’envahir le
Canada par la vallée du Richelieu se solde par un échec. Le gouverneur Prevost
tentera bien d’organiser des forces réunies à Saint-Jean en vue de marcher sur
Plattsburg, mais - comme Burgoyne en 1776, «pauvre homme de guerre» -, il
échouera complètement dans son entreprise.
Durant cette période de guerre, un réseau de contrebande s’établit par
lequel les paysans du comté font circuler le blé et les bêtes à cornes chez nos
Voisins du Sud, alors que les soldats stationnés à Saint-Jean souffrent du
froid et ont besoin de bonnes fourrures bien chaudes. Ceci confirme encore une
fois la réputation de localité mal-famée que l'on prête à Dorchester.
Les églises protestantes. La première église anglo-protestante fut la petite
église Saint-James - la mitaine, avec son petit cimetière sur le côté
nord (aujourd'hui déplacé à l'arrière) -, le plus vieux bâtiment religieux de
la ville, érigé en 1816 sur la rue Jacques-Cartier. Au cours de cette année, un
groupe de citoyens se mit en communication avec le révérend Micaiah Townsend dans
le but de former un comité dont la tâche serait de  recueillir des fonds pour la
construction d’un temple. Le 22 juillet, après une bonne collecte, on put poser
la pierre angulaire, et le 19 janvier 1817, le révérend Townsend de
Clarenceville y célébra le premier service divin suivant le rite de l’Église
d’Angleterre. Peu après, le révérend W.-D. Baldwyn accepta le poste de
clergyman et une requête fut adressée au gouverneur afin d’obtenir un bâtiment
hors d’usage qui appartenait aux Casernes. «On ne sait si la requête fut
acceptée ou si le Rectory actuel fut alors construit et habité». Quoi qu’il
en soit, le 10 mai 1822, des lettres patentes de Sa Majesté George IV donnent
comme territoire toute l’étendue seigneuriale de Longueuil sous le vocable de «Parsonage
and Rectory of the Parish Church of St John», et le Révérend William
Devereux Baldwyn est confirmé dans son titre.
recueillir des fonds pour la
construction d’un temple. Le 22 juillet, après une bonne collecte, on put poser
la pierre angulaire, et le 19 janvier 1817, le révérend Townsend de
Clarenceville y célébra le premier service divin suivant le rite de l’Église
d’Angleterre. Peu après, le révérend W.-D. Baldwyn accepta le poste de
clergyman et une requête fut adressée au gouverneur afin d’obtenir un bâtiment
hors d’usage qui appartenait aux Casernes. «On ne sait si la requête fut
acceptée ou si le Rectory actuel fut alors construit et habité». Quoi qu’il
en soit, le 10 mai 1822, des lettres patentes de Sa Majesté George IV donnent
comme territoire toute l’étendue seigneuriale de Longueuil sous le vocable de «Parsonage
and Rectory of the Parish Church of St John», et le Révérend William
Devereux Baldwyn est confirmé dans son titre.
La bâtiment sera régulièrement aménagé tout au long du siècle (jubé
intérieur, 1825; orgue, 1840; réduction de la sacristie et installation de deux
galeries latérales, 1845; réfection du clocher et du toit détruits par la
foudre, 1846). L’Église œuvrera également dans le domaine de l’éducation :
«
D’après les mémoires paroissiaux, il semble
bien que l’éducation de la jeunesse a été de tout temps regardée comme une des
responsabilités de la paroisse et qu’une école a été confiée au clerc de la
paroisse, au moins à ses débuts. En 1860, le Rev. Chas Bancroft, avec les dons
de quelques citoyens de marque bâtit l’École supérieure bien connue, tout
auprès de l’église et sur le terrain donné par M. J.-R. Mott. Quand l’éducation
passa sous le contrôle de la Province, cette école fut louée au Bureau des
Écoles Protestantes et ce jusqu’en 1929».
Un nouveau Rectory sera construit en 1883, tandis que l’ancien
deviendra le Baldwyn Hall. Avec la Première Guerre mondiale, le Rev. A.-H.
Moore se consacrera au soin des militaires alors de passage aux Casernes. La
Croix-Rouge fera du Baldwyn Hall le centre de ses activités et le Rectory
lui-même servira d’hôpital à l’occasion. Dans le temple, et ce durant le temps
de la guerre, on placera l’Union Jack et l’entendard de l’Engineers Training
Depot :
«
Les membres de l’église anglicane sont en
majorité anglophone. Les années 1855 à 1875 semblant marquer la période la plus
prospère dans l’histoire de l’église. Durant ces années, le pourcentage de la
population anglophone est au plus haut à cause surtout de l'armée qui occupe
une place importante dans l’histoire de la population de ce temps. Le commerce
et l’industrie se développent et sont tenus en grande partie par des familles
anglophones. Après 1875, les jeunes ont commencé à émigrer et, peu à peu, la
paroisse anglicane a perdu de sa popularité».
L’église Saint-James, avec son typique cimetière qui conserve les corps
des premières familles loyalistes venues habiter notre région, demeure le site
historique le plus ancien du Vieux-Saint-Jean. Le style georgien du début du
XIXe siècle caractérise son architecture. Le fait que les réfections
ultérieures n’aient pas modifié le bâtiment est notable. C’était à une époque
où l’on considérait que restaurer rapportait plus que détruire.
Après l’église anglicane Saint-James, les méthodistes viennent ériger
le premier temple wesleyan en 1841, qui dessert ordinairement une population
davantage prolétarienne que bourgeoise. William Coote, secrétaire du conseil
d’administration, obtient du Baron Grant une concession du côté ouest de la rue
Longueuil entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges, où on érige la
chapelle. William Knight - dont la maison, sise à l’angle des rues Mercier et
Saint-Georges, servait occasionnellement à recevoir le pasteur pour l’office -,
et William Coote passent un contrat devant le notaire Démaray en 1842 pour la
location d’une nouvelle maison sise à l’angle nord-est des rues Saint-Jacques
et Grant (Laurier) pour servir de presbytère. Le temple méthodiste, aujourd'hui
occupé par l'Eglise Unie du Canada, fut construit en 1841, les plans du
bâtiment ayant été élaborés par l'architecte John Wells, également auteur, en
1846, des plans du siège social de la Banque de Montréal sur la Place d'Armes.
Avec son fronton triangulaire et ses ouvertures cintrées, le temple
s'inscrivait dans le courant architectural néo-classique populaire à l'époque.
Le temple devait subir par la suite des réaménagements sans jamais changer la
façade originale de 1841.
Fondation de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste. Confronté à l’activité des
protestants, Gabriel Marchand projeta la fondation d’une paroisse desservie par
un curé résident. La chose s'imposait car tout l'arrière-pays était déjà érigé
en paroisses. L'Acadie depuis 1784, Saint-Luc depuis 1799. Saint-Athanase avait
vu son église érigée en 1822. Les catholiques de Dorchester ne pouvaient
continuer à être desservis par le curé de Saint-Luc, rôle que tenait le curé
Magloire Blanchette en 1826.
D'autant plus qu'en érigeant une paroisse, on créait une organisation
politique de marguilliers dont les charges pouvaient s'étendre dans le domaine
scolaire et des services de charité. L’évolution politique du Bas-Canada allait
lui donner raison. Comme le souligne le chroniqueur Léon Trépanier : «L’érection
civile des paroisses ne commença… qu’en 1831, l’évêque seul y ayant pourvu
jusque-là. L’érection civile donne à la paroisse le droit de se constituer en
municipalité pour fins électorales, scolaires, judiciaires et autres».
La prospérité étant au rendez-vous, la fondation d'une paroisse demeure un
moyen de redistribuer, à bon escient, la richesse. Nous ne devons pas nous
limiter à cette aspiration dont parle le Père Brosseau dans sa monographie : «une
entreprise beaucoup plus élevée s'était emparée de son cœur», pour expliquer l’intérêt de Gabriel Marchand
à fonder une paroisse. D’ailleurs, Marchand épousera, en seconde noce, Mary
MacNider, fille de son associer, une Écossaise, qui sera la mère de
Félix-Gabriel : «Fidèle à la promesse qu’elle avait faite à son mari
d’élever ses enfants dans la foi catholique, cette méthodiste pratiquante
s’appliqua à leur enseigner le catéchisme et les prières catholiques, sans que
jamais son zèle ne fléchisse, ni, d’ailleurs, son attachement à sa propre
Église». Le couple
Marchand donne l’exemple de l’harmonie ethnique entre les «nouveaux sujets» de
Sa Majesté avec ses «anciens sujets».
Les catholiques de
Dorchester font donc parvenir une requête, le 26 juin 1826, à
l’évêque-auxiliaire de Montréal, Mgr Lartigue, dans le but d’obtenir la
création d’une paroisse. Les signataires de la requête  s’engagent à bâtir une
église avec sacristie et un presbytère avec une salle d’école. Mgr Bernard-Claude Panet, évêque de Québec, sous ces conditions, accepte d'ériger la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste. Commence alors
une longue correspondance entre Gabriel Marchand et les autorités civiles et
religieuses dans le but d’ériger la paroisse. Elle ne se terminera que le 21
décembre 1827, date de l’élection des syndics. Marchand
entreprend donc la démarche auprès de Thomas Busby, agent de la baronne,
afin d’acheter le terrain pour y ériger les bâtiments religieux. C’est par sa
fortune amassée dans le commerce du bois plutôt que par les collectes d’argent
péniblement amassées que va s’édifier la paroisse Saint-Jean l’Évangéliste.
Cette première paroisse Saint-Jean «commencera chez Louis Fréchette, où le
chemin de la Prairie laisse la Rivière Richelieu, et s’étendra jusqu’à la
Pointe-à-la-Mule, et que l’on comprendra dans la Paroisse le Rang-de-Bernier ou
Petite Acadie, ensemble formant un nombre de deux cents habitants au moins».
Gabriel Marchand obtient ainsi les lots 99, 100, 106 et 107 mesurant 144 pieds
de longueur par 288 de largeur, bornés de face par Busby Street (aujourd’hui
Jacques-Cartier), à l’arrière par une autre rue (Longueuil), au sud par James
Street (Saint-Jacques) et au nord par les lots 101 et 107, avec paiement d’un
cens de rente annuel de 3" (le signe sur le document est douteux).
s’engagent à bâtir une
église avec sacristie et un presbytère avec une salle d’école. Mgr Bernard-Claude Panet, évêque de Québec, sous ces conditions, accepte d'ériger la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste. Commence alors
une longue correspondance entre Gabriel Marchand et les autorités civiles et
religieuses dans le but d’ériger la paroisse. Elle ne se terminera que le 21
décembre 1827, date de l’élection des syndics. Marchand
entreprend donc la démarche auprès de Thomas Busby, agent de la baronne,
afin d’acheter le terrain pour y ériger les bâtiments religieux. C’est par sa
fortune amassée dans le commerce du bois plutôt que par les collectes d’argent
péniblement amassées que va s’édifier la paroisse Saint-Jean l’Évangéliste.
Cette première paroisse Saint-Jean «commencera chez Louis Fréchette, où le
chemin de la Prairie laisse la Rivière Richelieu, et s’étendra jusqu’à la
Pointe-à-la-Mule, et que l’on comprendra dans la Paroisse le Rang-de-Bernier ou
Petite Acadie, ensemble formant un nombre de deux cents habitants au moins».
Gabriel Marchand obtient ainsi les lots 99, 100, 106 et 107 mesurant 144 pieds
de longueur par 288 de largeur, bornés de face par Busby Street (aujourd’hui
Jacques-Cartier), à l’arrière par une autre rue (Longueuil), au sud par James
Street (Saint-Jacques) et au nord par les lots 101 et 107, avec paiement d’un
cens de rente annuel de 3" (le signe sur le document est douteux).
Après quelques rivalités personnelles sur l’emplacement de l’église,
les correspondances vont s’accélérant. De part et d’autres, on s’informe des
progrès des démarches civiles et cléricales en vue d’obtenir le droit
ecclésiastique de l’érection. Une lettre d’Ignace Bourget, secrétaire de l’évêque-auxiliaire,
informe de la visite de Mgr Lartigue à Dorchester et de la permission qu’il a
obtenu d’autoriser la construction de l’église avant l’érection légale de la
paroisse. Gabriel Marchand presse alors la baronne de lui livrer les titres du
terrain au plus tôt, afin de pouvoir commencer les constructions, sans quoi «nous
serions obligés de bâtir l’Église chez le Général Christie ou d’abandonner
notre projet» (21 octobre 1826). Un différent surgit avec la baronne et
retarde l’exécution du projet d’un an. Les entrepreneurs choisis pour la
construction de l’église et du presbytère sont Benjamin Holmes et Joseph Doyon
qui dressent les plans de la première église. Cet édifice doit mesurer 50 par
100 pieds et doit être en pierre des champs. Une partie existe toujours de ce
premier édifice et sert actuellement de sacristie ainsi qu’une partie du mur du
chœur. La façade donne alors sur la rue Jacques-Cartier, dont nous pouvons
encore voir les vestiges du perron, des portes et l’inscription : MDCCCXXVIII.

La baronne de Longueuil ayant concédé les terres demandées le 4 mars
1827, Mgr Lartigue informe les Marchand que les travaux peuvent commencer. Les
syndics élus le 21 décembre précédent sont les trois frères Marchand,
Louis-Henri Gauvin, Pierre Jolin, Pierre Gaboriault et Joseph Simard, tous des
gens influents dans la petite ville. Le 3 juin 1828, Mgr Plessis, en réponse à
une de leurs requêtes du 1er mai précédent, les autorise à emprunter aux frères
Gabriel et François Marchand ainsi qu’à d’autres personnes par leur entremise,
les sommes manquantes pour l’achèvement de l’église. La future Fabrique devra
rembourser ces créanciers «dès qu’elle sera munie d’ornements les plus
nécessaires au culte». Dès lors, Gabriel Marchand se met en campagne pour
ramasser l’argent. Les comptes de Louis Marchand, daté du 12 janvier 1831,
permettent de retracer les différentes contributions :
Un autre écueil pointe à l’horizon. Mgr Panet ne peut déléguer un
curé à Saint-Jean à cause du trop grand nombre de vacances dans diverses
parties du diocèse. Finalement, il repêche un curé qui indubitablement à
 la bougeotte, M. Rémi Gaulin est reconnu pour ne pas tenir à la même place plus
que 2 ou 3 années. Il prendra donc sa cure le 21 octobre 1828 et se présentera
à ses fidèles comme sachant parfaitement l’anglais et prêchant avec
grâce et dignité. Gaulin, en effet, avait été curé un peu partout, aussi
bien en Ontario qu’au Québec et dans les provinces maritimes auprès des
Acadiens. En 1822, il était curé de Saint-Luc et connaissait donc bien les
paroissiens de Saint-Jean qu’il dessert, couvrant également les deux rives du
Richelieu (à l’est jusqu’à la savane de Farnham) et au sud jusqu’à la
frontière américaine. Il restera 3 ans à la cure de la nouvelle paroisse de
Saint-Jean avant d’aller s’installer à Sainte-Scholastique, puis au
Sault-au-Récollet. Il sera nommé par après évêque-auxiliaire de Kingston en
1833 avant de redevenir simple curé à L’Assomption jusqu’à sa mort, le 8 mai
1857. À son arrivée à Saint-Jean, aucun faste ne semble l’avoir accueilli. Son
premier acte d’administration est la bénédiction de l’église, le 6 novembre
1828, sous le vocable de Saint-Jean-l’Évangéliste, ce qui donne occasion à de
vives réjouissances. Le 4 juin 1829, Mgr Lartigue vient faire sa première
visite pastorale. Il y décrète l’élection annuelle des marguilliers. Le curé Gaulin s’affaire, lui, à baptiser, à marier, à recevoir des abjurations de
protestants anglophones qui deviennent des néophytes appréciables. Puis, le
temps vient où il faut penser à construire le presbytère et ériger un cimetière
catholique
la bougeotte, M. Rémi Gaulin est reconnu pour ne pas tenir à la même place plus
que 2 ou 3 années. Il prendra donc sa cure le 21 octobre 1828 et se présentera
à ses fidèles comme sachant parfaitement l’anglais et prêchant avec
grâce et dignité. Gaulin, en effet, avait été curé un peu partout, aussi
bien en Ontario qu’au Québec et dans les provinces maritimes auprès des
Acadiens. En 1822, il était curé de Saint-Luc et connaissait donc bien les
paroissiens de Saint-Jean qu’il dessert, couvrant également les deux rives du
Richelieu (à l’est jusqu’à la savane de Farnham) et au sud jusqu’à la
frontière américaine. Il restera 3 ans à la cure de la nouvelle paroisse de
Saint-Jean avant d’aller s’installer à Sainte-Scholastique, puis au
Sault-au-Récollet. Il sera nommé par après évêque-auxiliaire de Kingston en
1833 avant de redevenir simple curé à L’Assomption jusqu’à sa mort, le 8 mai
1857. À son arrivée à Saint-Jean, aucun faste ne semble l’avoir accueilli. Son
premier acte d’administration est la bénédiction de l’église, le 6 novembre
1828, sous le vocable de Saint-Jean-l’Évangéliste, ce qui donne occasion à de
vives réjouissances. Le 4 juin 1829, Mgr Lartigue vient faire sa première
visite pastorale. Il y décrète l’élection annuelle des marguilliers. Le curé Gaulin s’affaire, lui, à baptiser, à marier, à recevoir des abjurations de
protestants anglophones qui deviennent des néophytes appréciables. Puis, le
temps vient où il faut penser à construire le presbytère et ériger un cimetière
catholique
«Au début de 1830, on pense à construire le
presbytère. En fait, on le construira à droite de l’église avec façade sur la
rue Busby, aujourd’hui Jacques-Cartier, et "faisant ligne avec le portail
de l’église". Il aura 60 pieds de longueur sur 36 pieds de largeur mais
seulement 40 pieds sur la longueur (sur 36 de large) accueilleront le
presbytère proprement dit, tandis que les salles publiques occuperont la
balance de la superficie : la salle des hommes et celle des femmes.
Dès 1831, la Fabrique achète six arpents de
terre pour un cimetière qui sera situé sur la rue Laurier actuelle, à peu près
où sera construite plus tard l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur».
Le 9 septembre 1831, l’Évêque de Québec publie le décret d’érection
canonique tandis que le 9 septembre 1835 a lieu l’érection civile de la
paroisse. Ayant quitté sa cure, M. Gaulin a été remplacé par le curé
 Joseph-Édouard Morissette qui, lui, restera jusqu’à sa mort en 1844. M.
Morrissette s’occupe des âmes tandis que M. Marchand s’occupe des finances de
la Fabrique. Les recettes de 1832 se chiffrent à £ 1 047.104½, les dépenses
sont de £ 1 371. La balance de la paroisse est donc déficitaire de £ 323. Cela
n’empêche pas de poursuivre les travaux sur le bâtiment. En 1832, on termine la
voûte passée au blanc de céruse, en décembre 1833 on construit des autels
latéraux ainsi que des armoires pour les enfants de chœur et, à la fin du mois,
on achète un poèle que l’on installe pour chauffer l’église. Un menuisier et
sculpteur du Sault-au-Récollet, Pierre Salomon Marquette, entreprend en 1834 la
construction du jubé avec retrait en gradins pour l’orgue et les chantres,
ainsi que de la chaire et du banc d’œuvre. Ce travail coûte à lui seul £ 5 000 et
ne sera entièrement payé qu’en 1840. C’était une église qui n’avait pas encore
été affectée par la grandeur monumentale des édifices néo-gothiques (Notre-Dame
de Montréal, Varennes, etc.) qui seront la marque de la mégalomanie de Mgr
Bourget lorsqu’il sera évêque du diocèse de Montréal. En 1923, la restauration
intérieure et la transformation de la façade extérieure de l'église seront
entreprises culminant, le jour de l'inauguration des travaux le 23 novembre
1924, par la bénédiction de cinq nouvelles cloches. À la fondation du diocèse,
l'église prendra le titre de cathédrale par le sacre de Mgr Anastase Forget, le
29 juin 1934, premier évêque du nouveau diocèse de Saint-Jean.
Joseph-Édouard Morissette qui, lui, restera jusqu’à sa mort en 1844. M.
Morrissette s’occupe des âmes tandis que M. Marchand s’occupe des finances de
la Fabrique. Les recettes de 1832 se chiffrent à £ 1 047.104½, les dépenses
sont de £ 1 371. La balance de la paroisse est donc déficitaire de £ 323. Cela
n’empêche pas de poursuivre les travaux sur le bâtiment. En 1832, on termine la
voûte passée au blanc de céruse, en décembre 1833 on construit des autels
latéraux ainsi que des armoires pour les enfants de chœur et, à la fin du mois,
on achète un poèle que l’on installe pour chauffer l’église. Un menuisier et
sculpteur du Sault-au-Récollet, Pierre Salomon Marquette, entreprend en 1834 la
construction du jubé avec retrait en gradins pour l’orgue et les chantres,
ainsi que de la chaire et du banc d’œuvre. Ce travail coûte à lui seul £ 5 000 et
ne sera entièrement payé qu’en 1840. C’était une église qui n’avait pas encore
été affectée par la grandeur monumentale des édifices néo-gothiques (Notre-Dame
de Montréal, Varennes, etc.) qui seront la marque de la mégalomanie de Mgr
Bourget lorsqu’il sera évêque du diocèse de Montréal. En 1923, la restauration
intérieure et la transformation de la façade extérieure de l'église seront
entreprises culminant, le jour de l'inauguration des travaux le 23 novembre
1924, par la bénédiction de cinq nouvelles cloches. À la fondation du diocèse,
l'église prendra le titre de cathédrale par le sacre de Mgr Anastase Forget, le
29 juin 1934, premier évêque du nouveau diocèse de Saint-Jean.
L’organisation de la paroisse progresse donc lentement. La vente des
bancs en 1833 rapporte £ 47 avec £ 11 d’arrérages; en 1834, £ 38. et £ 18
d’arrérages. Ces déficits obligent les marguillers à ordonner des poursuites et
pendant 40 ans et plus, les résolutions de Fabrique devront recourir à ces
procédés de temps de crise. En 1834, deux nouvelles tentatives sont faites pour
améliorer la situation : la menace de recourir à des poursuites judiciaires,
après un délais de 3 mois, tous ceux qui n’auront pas payé leurs bancs;
l’annexion du Petit Bernier (composé d’une trentaine d’âmes et jusque-là
rattaché à la paroisse de L’Acadie) afin de disposer des bancs mis en réserve.
Gabriel Marchand tient les cordons de la bourse le plus serré possible. Non
seulement il s’occupe de la tenue des livres, mais il perçoit les bancs, sur le
perron de l’église, après la messe. C’est lui qui négocie avec le nouvel évêché
de Montréal l’annexion du Petit Bernier. Au-delà de la dimension purement
spirituelle de la paroisse, c’est avant tout une affaire d’organisation
financière dans un monde souvent peu éduqué (2 des premiers marguilliers ne
savent pas signer leur nom) où il faut constituer une communauté autonome. Un
Memorandum permet de suivre les débuts financiers de la paroisse :
«Avant l’année 1834, la vente des bancs aurait
rapporté la somme de £ 29. En
1834, £ 23.; en 1835, £ 49.; en 1836, £ 162.
En cette dernière année, une quête en effets, vendus ensuite à l’encan,
a rapporté £ 19. et les quêtes du Dimanche £ 18.
Les arrérages dus à la Fabrique se montent à £
270. La Fabrique doit à divers créanciers £ 550.
Dans cet État de Comptes, il n’est pas fait
mention de la construction de l’église. Malgré la pauvreté de la naissante
paroisse, formée de défricheurs et de journaliers, la modeste construction
était à peu près payée, moins une somme de 323 livres due à la famille dévouée
des Marchands, les seuls relativement à l’aise…»
Si Dorchester s’enrichit,
les paroissiens de Saint-Jean sont plutôt pauvres. Une lettre d’Ignace Bourget,
toujours secrétaire de Mgr Lartigue, du 17 septembre 1836 à Gabriel Marchand souligne
qu’il serait dans l’obligation de retirer le curé Morissette vu la modicité
des revenus. Ce qui en dit long sur les difficultés de la paroisse. Le
dernier geste relaté de sa cure fut la décision tenue lors d’une assemblée de
la Fabrique, le 29 mars 1839, de faire mesurer et arpenter le terrain de la
Paroisse et de faire enregistrer, par le protonotaire de la Cour du Banc du Roi
à Montréal, le procès de l’arpenteur juré. La Fabrique veut ainsi s’assurer la
propriété du terrain en sa possession.
Le personnel administratif
de la paroisse est constitué alors des marguilliers Gabriel Marchand et
Pierre-Paul Demaray, le notaire patriote, John Rossiter, longtemps first
warden, Ambroise Bourgeois, François Marchand, Louis Marchand, Ambroise
Hébert, Édouard Bourgeois et F.-J. Davignon qui appartiennent à l’édile locale,
par contre Isidore Charland et Hilaire Lafaille semblent être des cultivateurs
peu instruits puisqu’ils signent d’un marque (X) les décrets officiels.
Les deux premiers curés de Saint-Jean n’étaient pas des ignares. Gaulin avait fait ses études classiques
et théologiques au Séminaire de Québec moins deux années de théologie au
Séminaire de Nicolet (1807-1809). Morissette fit également ses études aux
Séminaires de Québec et de Nicolet. À sa mort, il sera remplacé par un autre
curé des plus instruits, Claude Larocque (1844 à 1866). C’est lui qui donna l’impulsion à la
construction de l'église actuelle - la façade donnant sur la rue
Jacques-Cartier - en 1861. Il sera consacré évêque, pour le diocèse de
Saint-Hyacinthe, à la fin des travaux. Il sera alors remplacé par M. Aubry, 4e
curé, de 1866 à 1893. Ce dernier achèvera la décoration et l'aménagement
intérieur de l'église.
Premiers instituteurs. Le 1er mars 1830, l'institutrice Marie Derome ouvre une
école pour fillettes. 45 petites filles venues apprendre l'alphabet, la
grammaire et les éléments de la religion. Le 8 octobre suivant, c'était au tour
des garçons d'avoir un instituteur, Pierre Caisse. Il y enseigne à 34 élèves.
Ces écoles étaient le résultat des initiatives, encore, des frères François et
Louis Marchand, de Louis Rémillard et Pierre Gaboriault, ces deux derniers
étant les premiers syndics de la fabrique de paroisse en charge des écoles.
Gustave Lanctot rapporte : «Détail curieux, les écolières, seulement huit
sur quarante-cinq, versent une cotisation de quarante sous par mois, pendant
que les écoliers, seulement neuf sur trente-quatre doivent payer le double,
soit quatre-vingts sous par mois. Les autres élèves reçoivent leur instruction
gratuitement, grâce à une subvention du gouvernement».
Vingt ans plus tard, Saint-Jean comptera 8 écoles dont une dissidente, pour une
population de 1 493 (dont 1 443 d'origine française) pour la paroisse et 3 215
(dont 2 235 d'origine française) pour la ville.
«L’arrivée de protestants méthodistes et
baptistes qui entraîna en 1841 la fondation de l’église de rite méthodiste
s’établissent à Saint-Armand et fondent la Mission de la Grande-Ligne, à 6
milles de Dorchester. Cet établissement, nous le devons à Henrietta Feller et
au pasteur Louis Roussy en 1835-1836. La caractéristique de cette mission, est
qu’elle s’adresse aux protestants francophones. D’origine suisse, Henrietta
Feller enseigna aux enfants le jour et aux adultes le soir, et ce n’est qu’en 1840
qu’on y éleva la maison d’enseignement. Les fonds provenaient de différents
milieux et surtout des États-Unis. Destiné au début aux francophones
protestants, l’Institut Feller devint peu à peu bilingue. Henrietta Feller
décéda en 1868 et le pasteur Roussy en 1880. L’édifice, rasé par un incendie le
dimanche 22 décembre 1968, comprenait 2 ailes, une pour les garçons et l’autre
pour les filles. En 1925, on y éleva le Massé Hall, qui existe toujours, et en
1942 l’Institut délaissa sa vocation pour devenir un camp de détention de
prisonniers de guerre allemands. Une fois le conflit terminé, l’Institut Feller
ouvra à nouveau ses portes pour ne les refermer qu’en 1967, par manque
d’élèves».
Croissance de la première économie locale. En 1817, le troisième fort
Saint-Jean est la proie des flammes. C’est le premier incendie majeur qui
menace de s’étendre à la petite ville. Il n’y a alors que le 19e Light
Dragoons. La petite ville est épargnée, mais la plupart des bâtiments du fort
sont sérieusement endommagés. La garnison déménage à Montréal. Un plan tracé en
1823 par le lieutenant-colonel E. W. Dunfort nous présente le triste état des
lieux :
«
Sur un terrain de quatorze arpents par huit,
des fortifications délabrées entouraient un ensemble de constructions à l’apparence
plutôt paisible; on pouvait voir, le long de la rivière, la résidence du
commandant, quelques casernes et un entrepôt d’armes et de munitions; il y
avait aussi, tout près de l'eau, un petit bâtiment réservé au corps-de-garde; à
l’ouest, où est située l’actuelle entrée du Collège militaire, se trouvaient
une cour à bois et un hangar destiné au ravitaillement; enfin, au centre de la
place, s’élevait une petite cuisine. En 1825, une commission chargée d’évaluer
le système de défense du Canada recommanda de jeter à terre l’ensemble de ces
bâtiments de bois et de les remplacer par des solides casernes munies
d’instruments de défense, mais rien ne fut fait».
Peu importe, la vie urbaine, qui s'est maintenant détachée des
activités militaires, continue de croître au nord des anciennes casernes. C'est
le port de Saint-Jean désormais qui est le centre des activités locales. En
1822, Saint-Jean est le quatrième port du Canada. Cette année-là, il reçoit £
233.209 de marchandises ($ 932.836) et £ 91.925 en exportation ($ 367.700).
Tout au long de cette période, le grand moteur du développement économique et
social de la région reste le transport. Par sa position de centre de transit
non seulement des marchandises mais aussi des commerçants, Dorchester devient le
poste de relais incontournable pour les voyageurs qui vont et viennent de
Montréal et de Québec à New York. On a déjà vu que dès les lendemains de la
Conquête anglaise, Saint-Jean se caractérisait par ses hôtels. En 1809, des 40
immeubles de la rue Richelieu, 4 servent d'hôtels ou d'auberges et en 1851, on
dénombre 3 hôtels, 10 auberges et de nombreuses buvettes ou tavernes.
D'ailleurs, une fabrique de bière locale emploie 5 ouvriers. Une autre
brasserie s'installera quelques années plus tard au 299 rue Richelieu.
Désormais, «les militaires en congé, les vieillards et les badauds avaient
de quoi se distraire»! Ephraim Mott, qui participe à l'entreprise du
traversier, ouvre un vaste hôtel de 2 étages afin d'accueillir cette nouvelle
clientèle : «Cet hôtel composé de 2 maisons, l'une de briques et l'autre de
bois, était appelé "Hôtel Mott" et était situé à l'angle des rues
Front (aujourd'hui la rue Richelieu) et Partition (aujourd'hui la rue
Saint-Georges), à l'endroit où s'élève actuellement l'édifice des Douanes».
Le pont Jones. Le traversier mis en service par Ephraim Mott et les frères Louis et
François Marchand entre Dorchester et Christieville servit d’abord de liaison
entre les deux rives de la rivière Richelieu :
«
Celui-ci fut grandement utile non seulement
pour les piétons, les charretiers, etc. de ces deux localités, mais aussi pour
les cultivateurs des régions situées au sud et à l’est d’Iberville,
particulièrement des Cantons de l’Est qui se rendaient à Saint-Jean ou à
Montréal avec leurs grains, volailles, etc. Autrefois, l’on voyait souvent des
gens, un fouet à la main, conduisant vers "la ville" un troupeau
d’animaux, même des oies et des dindons, non dans des voitures, mais à pied et
à "pattes"».
Faut-il penser que le trafic entre les deux rives s’intensifia à un tel
point pour que, le 26 mars 1826, Robert Jones obtienne le privilège de bâtir un
pont de bois? Quoi qu'il en soit, le privilège stipulait bien que :
« …le gouvernement autorisait les
paroisses avoisinantes à construire eux-mêmes le pont à 2 conditions : qu’une
demande soit faite au "Grand Voyer" dans les 3 mois suivant la date
de la proclamation et que la construction se fasse en-dedans d’un an suivant la
même date.
Si aucune demande n’était faite, M. Robert
Jones s’assurait l’exclusivité. Nulle autre construction de pont ne serait
autorisée "à une demi-lieu au-dessous, et une lieu au-dessus du dit
pont". La période de construction exigée s’étendait alors sur 4 ans».
C’était un appel d’offres auquel aucune paroisse ne pouvait répondre,
Jones se voyait donc octroyer un monopole pour la région du Haut-Richelieu. De
plus, on exigea un pont-levis pour laisser passer les bateaux : «…une
ouverture d’au moins 90 pieds de largeur entre les piliers situés à l’endroit
le plus profond de la rivière afin que les "cages" (sorte de radeaux)
puissent y passer. On spécifie une élévation de 6 pieds sous "l’arche du
pont Levis"». De plus, le gouvernement se réservait le droit de
reprendre possession du pont après 50 ans, ce qui obligeait le colonel à faire
une requête pour le renouvellement de sa charge.
Le premier pont entre Saint-Jean et Iberville était en bois. Le «pont
blanc» mesurait 1 754 pieds de longueur. Pont de bois blanchi à la chaux, il
avait été autorisé par un statut du Bas-Canada, le 29 mars 1826 : «Le
pont-levis sur la rivière Richelieu à la ville de Dorchester, Saint-Jean, près
du haut des rapides de la dite rivière, dans le comté de Huntingdon,
c'est-à-dire entre les propriétés appartenant à Ephraim Mott sur le terrain
maintenant appartenant à Robert Hall et occupé par lui dans la sus dite Ville
de Dorchester, maintenant appelée Saint-Jean, augmenterait de beaucoup
l'aisance et la facilité de la communication de beaucoup de paroisses et
concessions voisines et du public en général…». Jones fit ériger un pont
suspendu et construit par les frères Howe d'Angleterre. C'était un pont à deux
voies. Ses gardiens furent Ryder, Joseph Bonin, François Chaput et M.
Choinière. Jones avait toute liberté de percevoir des frais de traversée. Le
même document spécifiait qu'il était «loisible au dit Robert Jones, ses
héritiers exécuteurs, curateurs et ayants cause, de temps à autre, et en tous
les temps de demander et exiger, recevoir et prendre à leur propre usage et
profit, pour le pontonage, sous le nom de péage ou droit, avant de permettre le
passage sur le dit pont, les différentes sommes suivantes, c'est-à-dire. Pour
chaque voiture à quatre roues, tirée par deux chevaux, un chelin et trois
deniers courant; Pour chaque cheval additionnel, quatre deniers courant; Pour
chaque cabriolet, calèche ou wagon, propre et tiré par un cheval, huit deniers
courants; Pour chaque cheval additionnel quatre deniers courants; Pour chaque
charette ou wagon, tiré par une paire de bœufs ou chevaux additionnels, huit
deniers courant; Pour chaque voiture à quatre roues propre et tirée par deux
chevaux douze deniers courant; Pour chaque cheval additionnel, quatre deniers
courant; Pour chaque carriole ou sleigh tirée par un cheval, six deniers
courant; Pour chaque cheval additionnel quatre deniers courant; Pour
chaque sleigh tirée par une paire de bœufs, dix deniers courant; Pour chaque
paire de bœufs additionnels six deniers courant; Pour chaque cheval de selle et
son cavalier, six deniers courant; Pour chaque cheval, mule ou autre bête de
somme, chargée ou non chargée trois deniers courant; Pour toute autre
description de bêtes à cornes, deux deniers courant chaque; Pour chaque
personne à pied, trois deniers courant; Pour chaque mouton, veau, cochon, un
denier courant». Il en coutait 1 cent par enfant et 17 cents par voiture à
4 roues tirées par 2 chevaux pour l'emprunter au début du XXe siècle. Ce pont
situé à 200 verges (184 mètres) du pont actuel fut abandonné en 1917. La limite
de vitesse imposée sur le pont de bois était de un pas (mesure d'époque).

Jones fit évidemment fortune avec son pont payant. Les utilisateurs,
surtout commerciaux, en vinrent à trouver le prix exorbitant. Très tôt, les
habitants de la région se rebellèrent contre l’avidité de Jones. «Avant la
rébellion de 1837, le Dr Davignon et le notaire Démaray maître de postes de
Saint-Jean, demandèrent l'abolition du péage sur le pont qui reliait Saint-Jean
et Iberville. Le colonel R. Jones propriétaire du pont, résidait dans son
château, construit de pierres des champs sur les hauteurs d’Iberville. Il
n’aimait pas les patriotes».
Les registres de délibérations du conseil de ville de Saint-Jean en date du 11
novembre 1876 nous informent de la proposition d’une délégation formée du
maire, du secrétaire-trésorier et d’une tierce personne auprès du gouvernement
provincial afin de demander  une réduction de 50% du taux de péage. Quelle que
soit l’issue de cette demande, durant ses 90 années d’existence, les usagers
durent payer le passage. Jones n’entendait donc pas à rire avec les taux ni
avec les contraventions. Si les postillons et les militaires en service sont
exempt du taux de péage, il faut payer l’amende si on franchit le pont sans
payer ou si on commande à sa monture d’aller plus vite que le pas. De plus,
Jones détient un monopole qui met fin au service de traversier Mott &
Marchand. En revanche, le pont doit être inspecté et entretenu régulièrement
afin qu’«à la crue des eaux du Richelieu, il devait y avoir un espace d’au
moins six pieds entre les eaux et l’arche du pont-levis».
une réduction de 50% du taux de péage. Quelle que
soit l’issue de cette demande, durant ses 90 années d’existence, les usagers
durent payer le passage. Jones n’entendait donc pas à rire avec les taux ni
avec les contraventions. Si les postillons et les militaires en service sont
exempt du taux de péage, il faut payer l’amende si on franchit le pont sans
payer ou si on commande à sa monture d’aller plus vite que le pas. De plus,
Jones détient un monopole qui met fin au service de traversier Mott &
Marchand. En revanche, le pont doit être inspecté et entretenu régulièrement
afin qu’«à la crue des eaux du Richelieu, il devait y avoir un espace d’au
moins six pieds entre les eaux et l’arche du pont-levis».
Pour ceux qui, l'hiver, ne voulaient pas payer les frais imposés par
Jones, ils empruntaient, à l'endroit où se situe aujourd'hui le pont Gouin, un
pont de glace gratuit. Au débouché de la rue Saint-Jacques, c'était le sentier
favori des piétons : «Plusieurs autres sentiers servaient aussi; par
exemple, de la rue Saint-Georges au quai du gouvernement à Iberville. Quelques
fois même, par les plus grands froids, on piquait en biais, des hangars à grain
Cousins (magasin Langlois) vers l’église d’Iberville. Le Richelieu était tout
zébré de chemins où l’on enjambait les crevasses et les craquelures».
On balisait les sentiers de jeunes sapins. Mais lorsque la rivière était bien
gelée, il y avait des pistes qui allaient dans toutes les directions. Ceux qui
ne traversaient pas à pieds, traversaient en traîneaux ou en voitures légères.
Celles-ci descendaient juste en amont du pont du Grand Tronc, au coin du parc
Laurier. Une pente douce sur les deux rives. Lorsqu'il y avait des hivers
vraiment très froids, des voitures plus lourdes pouvaient s'avancer sur la
glace épaisse. Ces petits accommodements locaux ne doivent pas faire oublier
les autres aménagements de transports. La bourgeoisie commerciale de Montréal
voulait que les produits puisés de l’arrière-pays canadien soient transportés à
New York par train. La petite bourgeoisie québécoise lui préférait le
développement d’un canal, amorcé sous le Régime français, afin que les bois
d’œuvre et de pulpe puisés des Laurentides et de la Mauricie passent en trains
flottants d’une rivière à l’autre. Cette question fut l’enjeu de débats
houleux au Parlement du Bas-Canada, surtout dans le contexte où les disputes
entre le gouverneur colonial et l’Assemblée législative démocratiquement élue,
les opposaient dans leur vision du développement de la colonie.
Le pont Jones allait de la rue Saint-Charles, à Dorchester, à la 9e
avenue à Christieville. Comme tous ces bâtiments qui ont constitué la poétique
de l'espace du Vieux Saint-Jean, le pont eut une fin bien triste. Un article,
paru dans Le Canada Français en date du 3 juillet 1902, nous informe que
le pont s’est acquis une mauvaise réputation lorsque une voiture chargée de
grains de la maison Cousins s’est aventurée sur le pont qui défonça et
précipita voiture, chevaux et conducteur dans la rivière. Bien qu’il n’y eut
aucun dommage important et que tous furent tirés vifs de ce bain forcé, les
gens s’inquiétaient désormais de le traverser. On le démolit en 1916 lorsque le
pont Gouin prit la relève.
Première poussée démographique. La croissance de la population indique assez
bien la rapidité avec laquelle s’opéra le développement de Saint-Jean à partir
de la troisième décennie du XIXe siècle. En 1831, la population tournait autour
de 800 habitants répartis en 150 maisons. Dix ans plus tard, elle atteindra 1
315 habitants!

Amélioration du transport routier. Le Chemin de Saint-Jean
semble impossible à aménager. En tous cas, les ingénieurs de la chaussée
anglais ne réussissent pas mieux que leurs prédécesseurs français. En 1830, au
lieu des 16 jours que ça prenait pour se rendre de Montréal à New York, le
trajet a été réduit à 3 jours : «C’était beaucoup mieux, mais il restait
toujours le trajet de 30 milles entre les 2 fleuves, à travers les terres
glaiseuses, détrempées pendant des mois par le dégel du printemps ou les pluies
prolongées de l’automne. Sans parler des tempêtes de neige et des froids
extrêmes; c’était bien la pire étape d’un interminable voyage». C’est
l’année pourtant où l’ingénieur Benjamin Holmes - celui-là même appelé pour
ériger l'église catholique en 1826 -, effectue d’importants travaux de la
chaussée afin de rendre ce chemin plus praticable. Revêtue de macadam, c’est
la seule amélioration obtenue, malgré les démarches infructueuses du douanier
William Macrae, pour reconstruire la route et d’en assurer l’entretien par un
système à péage.
Première révolution dans les transports : le
chemin de fer. En 1831, deux Écossais dynamiques de  Montréal, George Moffat et surtout
Peter McGill (1789-1860), alors président de la Banque de Montréal, décide de
financer la construction d’une première voie ferrée entre Laprairie et
Saint-Jean. En 1832, une compagnie de 74 actionnaires - dont
Montréal, George Moffat et surtout
Peter McGill (1789-1860), alors président de la Banque de Montréal, décide de
financer la construction d’une première voie ferrée entre Laprairie et
Saint-Jean. En 1832, une compagnie de 74 actionnaires - dont  un seul est de
Dorchester, Jason C. Pierce, officier américain capturé lors de la guerre de
1812 et qui a décidé de demeurer dans la région -, est formée avec un capital
de £ 50,000, la Champlain and St Lawrence Railroad, dont le président
est Peter McGill. Elle s’engage à transporter les voyageurs à une vitesse inouïe
de 10 à 15 milles à l’heure sur des rails - encore en bois recouverts de
feuillards d’acier, avec un écartement de six pieds et six pouces, dit chemin
de fer à la lisse -, entre Laprairie et Saint-Jean. On fit alors venir
d’Angleterre une petite machine Stephenson :
un seul est de
Dorchester, Jason C. Pierce, officier américain capturé lors de la guerre de
1812 et qui a décidé de demeurer dans la région -, est formée avec un capital
de £ 50,000, la Champlain and St Lawrence Railroad, dont le président
est Peter McGill. Elle s’engage à transporter les voyageurs à une vitesse inouïe
de 10 à 15 milles à l’heure sur des rails - encore en bois recouverts de
feuillards d’acier, avec un écartement de six pieds et six pouces, dit chemin
de fer à la lisse -, entre Laprairie et Saint-Jean. On fit alors venir
d’Angleterre une petite machine Stephenson :
«
La locomotive reposait sur 2
paires de roues accouplées de 48 pouces de diamètre - les pistons mesuraient 14
pouces dans un cylindre de 9 pouces de diamètre - la chaudière était de 27
pouces de largeur sur 78 pouces de longueur et contenait 64 tubes de 1 et 5/8e
de diamètre. À l’état opérationnel, la locomotive pesait 12,544 livres et
mesurait 5 pieds 8 pouces de hauteur (sans la cheminée) par 15 pieds de
longueur en incluant le wagon de service».
 Arrivée par New York, elle parvint sur une barge à
Saint-Jean. Elle fut baptisée la Dorchester, mais surnommée
affectueusement «kitten» (chaton) à cause de ses bonds et sursauts
intempestifs. Les wagons - de première classe avec 2 compartiments de 8
voyageurs et de deuxième avec 3 compartiments de 8 voyageurs - provenaient des
ateliers de mécanique appartenant à John Molson, ami de McGill. La première
voie ferrée du Canada, longue de 25,6 kilomètres, est complétée grâce à
l’habile ingénieur en chef William Casey et coûte en tout et pour tout £ 40 000
($ 160 000). Ce jeudi, 21 juillet 1836, tous les députés
Arrivée par New York, elle parvint sur une barge à
Saint-Jean. Elle fut baptisée la Dorchester, mais surnommée
affectueusement «kitten» (chaton) à cause de ses bonds et sursauts
intempestifs. Les wagons - de première classe avec 2 compartiments de 8
voyageurs et de deuxième avec 3 compartiments de 8 voyageurs - provenaient des
ateliers de mécanique appartenant à John Molson, ami de McGill. La première
voie ferrée du Canada, longue de 25,6 kilomètres, est complétée grâce à
l’habile ingénieur en chef William Casey et coûte en tout et pour tout £ 40 000
($ 160 000). Ce jeudi, 21 juillet 1836, tous les députés  résidant à Montréal, à
l’exception de deux, ont été invités à l’inauguration. D’après The Gazette, une
invitation a été envoyée à De Witt, de sorte qu’O’Callaghan restait le seul
député ostracisé pour ses tendances annexionnistes aux États-Unis. L’atmosphère
politique est lourde à la veille du déclenchement de la rébellion, aussi,
tient-on à oublier les querelles entre l’Assemblée et le Gouverneur pour
célébrer ce moment unique du premier voyage en train au Canada.
résidant à Montréal, à
l’exception de deux, ont été invités à l’inauguration. D’après The Gazette, une
invitation a été envoyée à De Witt, de sorte qu’O’Callaghan restait le seul
député ostracisé pour ses tendances annexionnistes aux États-Unis. L’atmosphère
politique est lourde à la veille du déclenchement de la rébellion, aussi,
tient-on à oublier les querelles entre l’Assemblée et le Gouverneur pour
célébrer ce moment unique du premier voyage en train au Canada.
Les voyageurs s’embarquent sur un traversier à
vapeur, le Princess Victoria, afin de se rendre de Montréal à Laprairie.
La Champlain & St. Lawrence
Railroad Company organise une véritable fête. John Molson, qui partage avec
McGill le mérite de cette journée, sera seul à ne pas y assister puisqu’il est
mort en janvier. C’est donc son fils qui le remplacera. Les invités d’honneur à
l’inauguration sont là, en grandes pompes, en présence du gouverneur Gosford,
d’officiers militaires et de l’administration publique et des députés de Québec
dont l’Orateur et député du comté, Louis-Joseph Papineau. On y retrouve,
également, le Supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice, M. Quiblier. La
traversée  du fleuve dure 50 minutes et vogue au son de la fanfare du 15e
Régiment. Arrivé à Laprairie, tout le monde se masse autour de La Dorchester.
La locomotive est si frêle qu’on ne parvient qu’à lui attacher deux wagons
de première classe. Le directeur général Lindsay ferme la porte sur les 32
premiers passagers tandis que les autres sont invités à s’entasser dans dix
autres wagons tirés par des attelages de chevaux pendant les deux heures du
trajet. La moindre montée exige le renfort des chevaux. «On rapporte à ce
sujet un trait humoristique qui est peut-être une légende, mais assez
vraisemblable, rapporte le père Brosseau. L’ingénieur écossais de la minuscule
machine ne connaissait que la houille anglaise comme
du fleuve dure 50 minutes et vogue au son de la fanfare du 15e
Régiment. Arrivé à Laprairie, tout le monde se masse autour de La Dorchester.
La locomotive est si frêle qu’on ne parvient qu’à lui attacher deux wagons
de première classe. Le directeur général Lindsay ferme la porte sur les 32
premiers passagers tandis que les autres sont invités à s’entasser dans dix
autres wagons tirés par des attelages de chevaux pendant les deux heures du
trajet. La moindre montée exige le renfort des chevaux. «On rapporte à ce
sujet un trait humoristique qui est peut-être une légende, mais assez
vraisemblable, rapporte le père Brosseau. L’ingénieur écossais de la minuscule
machine ne connaissait que la houille anglaise comme 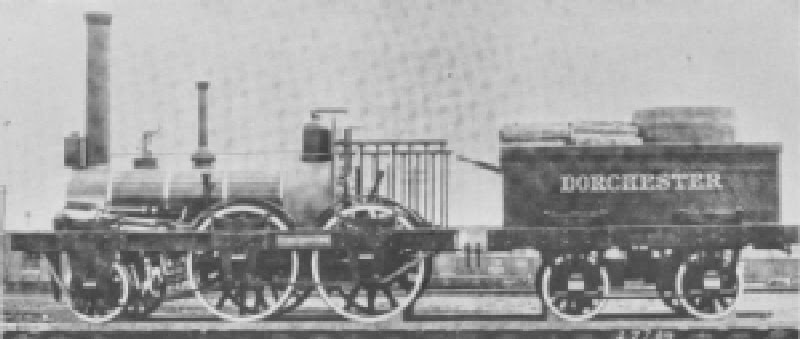 combustible. Or c’était un
aliment trop riche et trop lent à digérer pour le foyer de sa machine. Elle
s’était arrêtée, à bout de souffle, en montant une rampe, lorsqu’un habitant
vint à la rescousse chargé d’une brassée d’éclats de cèdre. “Tu ne sais pas
soigner ton cheval, l’ami; tu lui donnes trop d’avoine et pas assez de foin”.
La flamme avivée par ce nouvel aliment rendit des forces à l’essoufflée et
désormais l’Écossais chauffa son engin au bois».
Cette légende est probablement issue des premiers essais peu concluants de la Dorchester.
combustible. Or c’était un
aliment trop riche et trop lent à digérer pour le foyer de sa machine. Elle
s’était arrêtée, à bout de souffle, en montant une rampe, lorsqu’un habitant
vint à la rescousse chargé d’une brassée d’éclats de cèdre. “Tu ne sais pas
soigner ton cheval, l’ami; tu lui donnes trop d’avoine et pas assez de foin”.
La flamme avivée par ce nouvel aliment rendit des forces à l’essoufflée et
désormais l’Écossais chauffa son engin au bois».
Cette légende est probablement issue des premiers essais peu concluants de la Dorchester.
Lorsque le cortège, parti de Laprairie à 12 heures
30 circulant à la vitesse moyenne de 30 km/h. arrive à  Saint-Jean à 1 h. 29,
les invités ne trouvent qu’un hangar vitement transformé en salle de banquet
pour les 500 convives qui font partie du voyage. Située au sud des rues Lemoine
et Busby (Frontenac et Mercier), ce bâtiment ne mesure que 40 pieds sur 100
pieds et sa construction avait débuté en 1835 pour ne se terminer qu’à la toute
veille de l’inauguration. La gare, bâti en bois lambrissé, est
élégamment décorée avec des branches de sapin et des drapeaux. On sert un
buffet froid mais le champagne coule à flots, ce qui a pour effet de rendre le
retour beaucoup plus animé. Peter McGill Jr, dirigeant les festivités, propose
2 toasts, l’un au roi d’Angleterre et l’autre au Président des États-Unis, tant
l’aide apportée par Jason C. Pierce fut précieuse. Discours auquel répond le
Gouverneur Gosford. William Lindsay présenta une médaille en or à l’ingénieur
en chef Casey de la part des chefs d’équipe pour son attitude loyale
envers eux et le cortège pris le chemin du retour vers 16 heures. «Le
Saint-Jean à 1 h. 29,
les invités ne trouvent qu’un hangar vitement transformé en salle de banquet
pour les 500 convives qui font partie du voyage. Située au sud des rues Lemoine
et Busby (Frontenac et Mercier), ce bâtiment ne mesure que 40 pieds sur 100
pieds et sa construction avait débuté en 1835 pour ne se terminer qu’à la toute
veille de l’inauguration. La gare, bâti en bois lambrissé, est
élégamment décorée avec des branches de sapin et des drapeaux. On sert un
buffet froid mais le champagne coule à flots, ce qui a pour effet de rendre le
retour beaucoup plus animé. Peter McGill Jr, dirigeant les festivités, propose
2 toasts, l’un au roi d’Angleterre et l’autre au Président des États-Unis, tant
l’aide apportée par Jason C. Pierce fut précieuse. Discours auquel répond le
Gouverneur Gosford. William Lindsay présenta une médaille en or à l’ingénieur
en chef Casey de la part des chefs d’équipe pour son attitude loyale
envers eux et le cortège pris le chemin du retour vers 16 heures. «Le  voyage
fut plus bruyant qu’à l’aller : on but et on chanta des chansons canadiennes.
La locomotive tirait cette fois-ci les quatre wagons à passagers et ne prit que
cinquante-neuf minutes
à faire le trajet. Les autres voitures furent remorquées comme à l’aller par
des chevaux. Cependant, les invités durent coucher à Laprairie suite à un
fâcheux incident survenu sur le traverser».
En fait, le traversier s’échoua et les voyageurs durent passer la nuit à
Laprairie, pestant contre la Compagnie accusée d’être la cause de ce fâcheux
contretemps. Pendant ce temps, on s’affairait à réparer les dommages au steamboat.
voyage
fut plus bruyant qu’à l’aller : on but et on chanta des chansons canadiennes.
La locomotive tirait cette fois-ci les quatre wagons à passagers et ne prit que
cinquante-neuf minutes
à faire le trajet. Les autres voitures furent remorquées comme à l’aller par
des chevaux. Cependant, les invités durent coucher à Laprairie suite à un
fâcheux incident survenu sur le traverser».
En fait, le traversier s’échoua et les voyageurs durent passer la nuit à
Laprairie, pestant contre la Compagnie accusée d’être la cause de ce fâcheux
contretemps. Pendant ce temps, on s’affairait à réparer les dommages au steamboat.
Cet événement, qui est resté symbolique dans
l’histoire du Canada, inaugurait en fait un service plutôt cahoteux. La
Champlain & St. Lawrence Railroad n’avait fait que prendre de vitesse
la Montreal & New York Railroad, ligne adverse qui passerait par
Mooers, Caughnawaga et Lachine, dont les activités faillirent venir à bout de
la Champlain & St. Lawrence. Il en sera ainsi jusqu’en 1851, tant la
concurrence des  voies ferrées américaines exerçait une forte pression. Mais la Champlain
& St. Lawrence Railroad n’avait pas le choix d’améliorer ses engins
pour accroître son transit. A l'origine, le convoi comportait quatre voitures
de huit passagers chacune, suivies d'une vingtaine de wagons de fret d'une
capacité d'une dizaine de tonnes chacun. Saisonnier comme le trafic maritime,
le train ne circulait que l'été permettant aux excursionnistes montréalais de
s’éloigner de la métropole. Avec l'extension de la ligne à Rouses Point, à la
frontière de l'Etat de New York, le rôle de Saint-Jean comme lieu de
transbordement va s'atténuer. En 1853, la ligne de Portland (Maine), reliant
directement Montréal à un port de mer est parachevée. Les retombées suite au
développement des transports accrurent les activités commerciales de
Saint-Jean, ville constituée de 3 000 habitants, comptant 17 magasins, 12
auberges, 11 boucheries, 8 cordonneries et 5 épiceries. Le coup fatal fut donné
en 1870, lorsqu'une autre ligne liant Montréal à New York fit encore perdre de
son importance au vieux chemin de fer de 1836.
voies ferrées américaines exerçait une forte pression. Mais la Champlain
& St. Lawrence Railroad n’avait pas le choix d’améliorer ses engins
pour accroître son transit. A l'origine, le convoi comportait quatre voitures
de huit passagers chacune, suivies d'une vingtaine de wagons de fret d'une
capacité d'une dizaine de tonnes chacun. Saisonnier comme le trafic maritime,
le train ne circulait que l'été permettant aux excursionnistes montréalais de
s’éloigner de la métropole. Avec l'extension de la ligne à Rouses Point, à la
frontière de l'Etat de New York, le rôle de Saint-Jean comme lieu de
transbordement va s'atténuer. En 1853, la ligne de Portland (Maine), reliant
directement Montréal à un port de mer est parachevée. Les retombées suite au
développement des transports accrurent les activités commerciales de
Saint-Jean, ville constituée de 3 000 habitants, comptant 17 magasins, 12
auberges, 11 boucheries, 8 cordonneries et 5 épiceries. Le coup fatal fut donné
en 1870, lorsqu'une autre ligne liant Montréal à New York fit encore perdre de
son importance au vieux chemin de fer de 1836.
La Champlain & St. Lawrence Railroad passa,
en 1863, aux mains du Grand Trunk qui imprima au service un rapide
essor. Le destin de la Dorchester fut plus triste. À partir du 21
juillet 1836, elle fut mise en service sur la ligne Laprairie-Dorchester
jusqu’en 1849, date où elle fut vendue à la Compagnie de Chemin de fer du
Saint-Laurent afin de relier Lanoraie à Joliette. Une quinzaine d’années
plus tard, une explosion la rendit inutilisable. Les rails de bois sur lesquels
on avait appliqué de minces tiges de fer résistèrent au temps et aux saisons.
C’était une voie bien construite qui dura plus de cent ans après ce voyage
inaugural et une partie servit encore à relier les villages entre L’Acadie et
Saint-Jean. L’un des effets qu’on ne pouvait prévoir à l’époque fut que la
position de tête de Dorchester, avec son service de chemin de fer, dut jouer
dans la balance lorsque les potiers du village de Saint-Denis commencèrent à
abandonner leurs petites entreprises pour venir s’établir à Saint-Jean afin de
passer au service d’Américains venus installer une industrie concurrente à
Dorchester.

Seconde révolution dans les transports : le
canal de Chambly. On a répété maintes fois que le commerce maritime était la clef du
développement économique de Dorchester. C’est un achalandage constant qui se
fait surtout au niveau des importations : £ 233.202 en 1822 pour £ 91.925
seulement en exportation. William Dobie Lindsay, qui a succédé à son père comme
contrôleur des douanes et son beau-frère William Macrae, collecteur des
douanes, en butte aux tracasseries de l’Assemblée législative qui retarde le
paiement de leurs honoraires (c’est l’époque de la querelle des subsides),
décident de se servir à même les sommes perçues dans leurs fonctions. Des
plaintes sont couramment déposées auprès du juge de paix de Saint-Athanase, les
deux beau-frères s’enrichissant en propriétés et voyageant couramment aux
États-Unis et en Europe aux frais de la Reine. C’est dire combien le trafic est
rentable dans la région. Mais, la modernité bouscule. Le commerce s’active
grâce à l’arrivée des premiers bateaux à vapeur qui ont leur quai au pied de la
rue Lemoine, aujourd’hui Frontenac, et grâce surtout aux droits minimes que
paient les importations, ce qui permet de les exporter en Angleterre avec de
forts bénéfices. Une sorte de commerce triangulaire s’érige ainsi entre les
États-Unis via le Bas-Canada, à l’Angleterre!
Le projet de canalisation vise à contourner les
rapides les plus imortants du Richelieu. Après la Conquête, en 1775 puis encore
en 1787, un certain Silas Deane a suggéré de construire un canal entre Chambly
et Saint-Jean. Adam Lymberner est revenu à la charge en 1791. Un bill est même
passé à l’Assemblée du Bas-Canada, en 1818, autorisant la formation d’une
Compagnie chargée de canaliser le Richelieu. L’année suivante, cette Compagnie
soumet un projet auquel il n’est pas donné suite. Délaissé jusqu’en 1823, date
où le gouvernement vote l’appropriation des fonds nécessaires pour la
construction du canal, c’est-à-dire £ 60.000 (environ $ 240 000), on reprend le
travail interrompu à la hauteur de Saint-Ours.
«
En 1829, on assiste à la
création d’une commission chargée d’examiner les possibilités d’aménager un
canal sur la rivière Richelieu. Parmi les commissaires nommés, on retrouvait
des membres de l’élite canadienne-française comme Timothée, Franchère, René
Boileau et Gabriel Marchand. On sait que ce dernier exploitait un commerce de
bois à Saint-Jean. Il démissionne de son poste en 1831 et sera remplacé l’année
suivante par Eustache Soupras. Le président Samual Hatt, était un anglophone,
de même que l’autre membre : William Macrae. On sait que ce dernier était
également collecteur de douanes à Saint-Jean».
En 1830, le creusage du canal Chambly progresse
lentement : «un projet succédait à un autre sans nulle entente, avec grandes
pertes de temps et d’argent». Un certain John Black, immigrant
irlandais venu à Saint-Jean en 1830, fournit l’équipement nécessaire aux
travaux d’enverures du canal. Black assure lui-même le transport de matériel du
quai de Laprairie à Saint-Jean. John Black devait devenir le patriarche d'une
dynastie appelée à un grand avenir dans la région. Des ingénieurs américains
furent engagés ainsi que des travailleurs irlandais, main-d’œuvre à bon marché.
Les travaux reprennent efficacement le 1er octobre 1831. Les épidémies de
choléra de 1832 et de 1834 ralentissent à leur tour la progression des travaux.
Puis ce furent des conflits entre les entrepreneurs et les Américains qui
retournent chez eux. Seuls les entrepreneurs de la région, les Andrès,
poursuivent, pour un temps, les travaux qui sont interrompus à nouveau par
manque de capitaux. En 1835, toutefois, presque toutes les écluses sont
terminées, sauf les trois combinées du bassin de Chambly, et des moulins
peuvent s’établir le long du canal qui sera enfin complété le 17 novembre 1843,
où il est ouvert à la circulation sur l’initiative du Bureau des Travaux
Publics issu de l’Union des deux Canadas.
Il faudra encore des travaux pour obtenir la
profondeur exigée pour le trafic sans cesse croissant. En 1864,  le Canal aura
couté la somme de $ 643.711. Doté de 9 neuf écluses (la neuvième étant celle de Saint-Jean) sur une distance de 13
milles et montant les barges à une hauteur de 74 pieds : «Chacune des
écluses a 36,60 m de long sur 7.30 m de large. Autrefois mues à la force des
bras, les portes des écluses sont maintenant actionnées par un système
électrique. Le canal lui-même avait, jusqu’aux transformations entreprises en
1917, environ 16 m de large». Le
canal a rendu d’immenses services au commerce du bois de pulpe ou de
construction, de foin et de charbon entre le Canada et les États-Unis. Jumelé
au transport ferroviaire des marchandises, c'est une véritable révolution des
transports qui se réalise à Saint-Jean. Long de 18,5 km, le canal de Chambly va
de Saint-Jean à Chambly, contournant les trois infranchissables rapides entre
les deux villes. Ses 9 écluses, autrefois mues à bras d'hommes, permettent la
navigation sur une dénivellation de 23,5 mètres. Des travaux de réfection et de
consolidation auront lieu de 1850 à 1858. Dès son ouverture, on y voit
descendre des radeaux de bois provenant de la rivière des Outaouais. Les
billots sont assemblés en barques, surmontées d'une cabane servant aux «cageux»
qui accompagnent les chargements. Puis, viennent les voiliers au gabarit
variant de 50 à 150 tonneaux. Ces goélettes descendent la rivière jusqu’au
fleuve pour y commercer les produits maraîchers de la région. Vers 1860, on
évalue à 200 le nombre de ces voiliers qui
le Canal aura
couté la somme de $ 643.711. Doté de 9 neuf écluses (la neuvième étant celle de Saint-Jean) sur une distance de 13
milles et montant les barges à une hauteur de 74 pieds : «Chacune des
écluses a 36,60 m de long sur 7.30 m de large. Autrefois mues à la force des
bras, les portes des écluses sont maintenant actionnées par un système
électrique. Le canal lui-même avait, jusqu’aux transformations entreprises en
1917, environ 16 m de large». Le
canal a rendu d’immenses services au commerce du bois de pulpe ou de
construction, de foin et de charbon entre le Canada et les États-Unis. Jumelé
au transport ferroviaire des marchandises, c'est une véritable révolution des
transports qui se réalise à Saint-Jean. Long de 18,5 km, le canal de Chambly va
de Saint-Jean à Chambly, contournant les trois infranchissables rapides entre
les deux villes. Ses 9 écluses, autrefois mues à bras d'hommes, permettent la
navigation sur une dénivellation de 23,5 mètres. Des travaux de réfection et de
consolidation auront lieu de 1850 à 1858. Dès son ouverture, on y voit
descendre des radeaux de bois provenant de la rivière des Outaouais. Les
billots sont assemblés en barques, surmontées d'une cabane servant aux «cageux»
qui accompagnent les chargements. Puis, viennent les voiliers au gabarit
variant de 50 à 150 tonneaux. Ces goélettes descendent la rivière jusqu’au
fleuve pour y commercer les produits maraîchers de la région. Vers 1860, on
évalue à 200 le nombre de ces voiliers qui  sillonnent la rivière Richelieu et
le canal de Chambly. Enfin apparaissent les barges qui, mieux adaptées à la
navigation sur les canaux, persisteront jusqu'en 1930 environ. Pour circuler,
la barge doit pourtant compter sur le halage des chevaux qui, péniblement,
mettent une douzaine d'heures à franchir la distance de Chambly à Saint-Jean.
Élargi en 1970 devant le centre-ville, le canal a vu passer sa dernière barge,
dit-on, en 1973. Du coup, l'activité commerciale et économique a cédé le pas
aux loisirs et aujourd'hui le canal sert l'été aux embarcations de plaisance et
l'hiver, aux patineurs. Le long de la bande du canal on érigea des hangars et
des remises à bateaux qui demeureront sur place jusqu’à la fin des années 1960,
site obscur, propice aux activités illégales tout en permettant le jour des
sorties en embarcations pour la pêche à l’anguille sur le Richelieu.
sillonnent la rivière Richelieu et
le canal de Chambly. Enfin apparaissent les barges qui, mieux adaptées à la
navigation sur les canaux, persisteront jusqu'en 1930 environ. Pour circuler,
la barge doit pourtant compter sur le halage des chevaux qui, péniblement,
mettent une douzaine d'heures à franchir la distance de Chambly à Saint-Jean.
Élargi en 1970 devant le centre-ville, le canal a vu passer sa dernière barge,
dit-on, en 1973. Du coup, l'activité commerciale et économique a cédé le pas
aux loisirs et aujourd'hui le canal sert l'été aux embarcations de plaisance et
l'hiver, aux patineurs. Le long de la bande du canal on érigea des hangars et
des remises à bateaux qui demeureront sur place jusqu’à la fin des années 1960,
site obscur, propice aux activités illégales tout en permettant le jour des
sorties en embarcations pour la pêche à l’anguille sur le Richelieu.
Les Troubles de 1837-1838 et le coup de force
de Denis-Benjamin Viger. Les historiens se sont partagés sur le rôle joué par
la ville de Saint-Jean lors des Troubles de 1837-1838. Pour l’historien Gérard
Filteau il considère, dans sa somme, Histoire des Patriotes, que
Saint-Jean était un chateau-fort Bureaucrate, c’est-à-dire un centre loyal au
gouvernement; par contre, l'historienne Marcelle Reeves-Morache considère
Saint-Jean comme un bastion patriote : qui a raison? Tout s'éclaire lorsque
nous considérons l'importance du Parti Patriote parmi les cultivateurs de
Napierville et du plat-pays derrière Dorchester. Par contre, la ville elle-même
demeure pour l'essentiel entre les mains des partisans du gouverneur et de la
loyauté au roi.
C’est avec la réforme de la carte électorale de 1830 que la campagne
environnant Dorchester est témoin de charivaris et de cabales pour le Parti
Patriote ou pour le Parti Bureaucrate. Des professionnels (médecins, notaires)
font campagnes pour le Parti Patriote et soutiennent Louis-Joseph Papineau qui
tient tête au 
 pouvoir exécutif du Gouverneur. Lors de l’Assemblée patriote
tenue à Saint-Charles le 23 octobre 1837, ce sont des non-élus, le notaire
Pierre-Paul Démaray et le docteur Joseph-François Davignon, qui représentent la
voix de Saint-Jean, moins violente toutefois que celle du docteur Côté, du
compté voisin de L’Acadie, qui appelle ouvertement à la violence. Le notaire
Démaray (1798-1854) est originaire des Trois-Rivières et exerce le notariat à
Dorchester depuis 1824. Il a été l’un des premiers marguilliers et
secrétaire-trésorier de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste en 1829. Juge de
paix, il occupe aussi les fonctions de maître de postes. Plus tard, revenu
d’exil en 1841, il deviendra maire de Saint-Jean en août 1851 et créera le
premier corps de police de la Ville. Le docteur Davignon (1807-1867), lui, est
de Saint-Mathias et pratique la médecine à Dorchester depuis qu’il a été reçu
médecin, le 10 juillet 1833. À Saint-Charles, ni l’un ni l’autre ne prirent
publiquement la parole.
pouvoir exécutif du Gouverneur. Lors de l’Assemblée patriote
tenue à Saint-Charles le 23 octobre 1837, ce sont des non-élus, le notaire
Pierre-Paul Démaray et le docteur Joseph-François Davignon, qui représentent la
voix de Saint-Jean, moins violente toutefois que celle du docteur Côté, du
compté voisin de L’Acadie, qui appelle ouvertement à la violence. Le notaire
Démaray (1798-1854) est originaire des Trois-Rivières et exerce le notariat à
Dorchester depuis 1824. Il a été l’un des premiers marguilliers et
secrétaire-trésorier de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste en 1829. Juge de
paix, il occupe aussi les fonctions de maître de postes. Plus tard, revenu
d’exil en 1841, il deviendra maire de Saint-Jean en août 1851 et créera le
premier corps de police de la Ville. Le docteur Davignon (1807-1867), lui, est
de Saint-Mathias et pratique la médecine à Dorchester depuis qu’il a été reçu
médecin, le 10 juillet 1833. À Saint-Charles, ni l’un ni l’autre ne prirent
publiquement la parole.
À Montréal, les affrontements entre Patriotes et
Bureaucrates commencent à soulever les passions populaires. L’un de ces
affrontements a pour effet le sac des bureaux du Vindicator, journal
patriote, par des membres du Doric Club, mais voilà que les autorités
émettent des mandats d’arrêt contre les partisans patriotes! L’un d’eux
concerne un jeune homme, Joseph Duquette, âgé de 22 ans. Le jeune Duquette
s’enfuit à Dorchester, chez son oncle le notaire et maître de poste Pierre-Paul
Démaray. À Dorchester, déjà, le notaire Démaray et le docteur Davignon sont
reconnus comme des sympathisants rebelles notoires.
Pendant ce temps, suite à une campagne active dans
toutes les paroisses du sud du Québec, les Patriotes forcent les Bureaucrates à
démissionner de leurs fonctions administratives et publiques. Ils recourent aux
charivaris, à la terreur, aux menaces pour forcer les Loyaux à remettre leurs
fonctions. Souvent, il arrive que la résistance de l’un d’entre eux se termine
par une démonstration de force. Dans l’après-midi du 5 novembre se tient à
Iberville une grande assemblée publique. Le même soir, vers 8 heures, un groupe
d’environ 70 Patriotes, dont plusieurs résident à L’Acadie, entrent dans
Saint-Jean. Démaray et Davignon se portent aussitôt à leur tête et se rendent
chez les juges de paix afin de les contraindre à démissionner. Deux d’entre
eux, Macrae et Lindsay, également douaniers, sont absent, mais Jason Pierce
(l’actionnaire du chemin de fer) et François Marchand, ainsi que Virgil Titus,
un parent de la famille Mott, sont rejoints et obligés de se démettre de leurs
fonctions dans la milice. Parmi ces officiers, il y a Nelson Mott, futur maire
de Saint-Jean, alors capitaine de milice. Accosté par un parti de Patriotes
mené par un cultivateur de L’Acadie, Olivier Hébert, alors qu’il déambulait sur
la rue Front, Hébert lui demande, en français, de remettre sa commission. Mott,
ignorant la langue française, ne comprend pas. Il est alors conduit à l’hôtel
de son père où François-Xavier Ranger, marchand et Louis-Mars Decoigne,
notaire, tous les deux de L’Acadie, lui servent d’interprètes. Afin de donner
du poids à la désistance de son poste de commissionnaire, Decoigne force Mott à
signer une lettre de démission. Mott s’exécute. Il prétextera plus tard d’avoir
craint de voir ses propriétés détruites s’il refusait. Aussitôt la démission
obtenue, Démaray et Davignon mettent leur plan à exécution en ordonnant
l’abolition du péage sur le pont Jones.
Au moment de la Rébellion, le fort Saint-Jean n’est
plus en activité. Son commandant, résidant à Montréal se met à craindre le pire
et, à cette menace, réplique en dépéchant un détachement de Royaux, des
officiers de la Royal’s de Montréal pour venir occuper le vieux fort :
«Dès son arrivée, le
commandant des Royal’s veut sans tarder procéder à une reconnaissance des
lieux, surtout à Saint-Athanase. Il s’exécute donc. Sa sortie soulève
l’indignation de la population. Les Royal’s se font invectiver d’injures au
moment de leur retour à Saint-Jean, par la voie du pont qui était alors situé à
la hauteur de la rue Saint-Charles et de l’église Saint-Athanase.
Un attroupement dirigé par Démaray et Davignon, scande le slogan de l’époque : "Hourra pour les Patriotes; hourra pour Papineau. À bas les Anglais; à bas les Bureaucrates!"
Les Patriotes, au moment où les Royal's s'engagent sur le pont, chargent de pics la gueule d'un canon et tirent en direction des Anglais. Furieux, le commandant anglais fait amener un canon du fort Saint-Jean et répond par la bouche de "son" canon aux Patriotes. Puis il s'élance avec son peloton dans la direction de Saint-Athanase…»
«
Profitant de l’ahurissement
général, il passa au trot avec ses hommes. Il était donc maître du champ de
bataille et en guise de représailles il fit camper sa troupe, hommes et
chevaux, dans l’église d’Iberville, ayant réquisitionné les habitants de lui
fournir la paille nécessaire».
Le Gouverneur émet un mandat d’arrestation pour les
deux meneurs. Au cours de l’après-midi du 16 décembre 1837, le constable Malo,
un ancien huissier, est chargé d’arrêter les deux militants patriotes de
Saint-Jean. Le colonel Jones, qui n’accepte pas qu’on abolisse le péage sur son
pont, organise un bataillon de milice de Missisquoi dont il prend la tête afin
de se protéger lui et ses amis. Aidé d'espions et de  délateurs, s'appuyant sur
une troupe de 250 loyalistes, il parviendra à contrôler la paroisse de
Saint-Athanase et la région de Saint-Jean durant les troubles. Lors de la
marche du constable Malo, il lui fut adjoint un détachement de 18 cavaliers de
la Montreal Volunteer Cavalry, commandé par le lieutenant Ermatinger. «C’était
une maladresse ou plutôt une provocation directe».
La troupe arriva à Saint-Jean vers 3 heures du matin, au moment où la ville est
endormie. Tour à tour, les deux prévenus sont arrêtés, menottés et placés dans
un fourgon conduit par le constable. Au lieu de regagner Montréal par Laprairie
d’où ils étaient venus, Malo et ses hommes s’engagèrent vers Chambly où ils
arrivèrent à 6 heures du matin, le 17 décembre. Pendant ce temps, les Patriotes
se sont rassemblés à Laprairie afin de venir au secours des prisonniers. Dès
l’arrestation, le capitaine Vincent monta à cheval et chevaucha toute la nuit
sous une pluie battante pour prévenir les Patriotes que le convoi ne suivrait
pas le même parcours qu’à l’arrivée. Toute la nuit, les Patriotes se mirent à
faire fondre des balles. Ce travail fait, ils vinrent s’installer à la ferme à
Trudeau, entre Chambly et Saint-Jean. Ils sont 40 sous les ordres du jeune
Bonaventure Viger. Ce dernier fait disperser le petit nombre d’hommes afin de
donner à Malo l’impression qu’ils sont une troupe nombreuse. Lorsque le convoi
vient à passer, Viger saisit la bride de l’un des chevaux du constable Malo :
délateurs, s'appuyant sur
une troupe de 250 loyalistes, il parviendra à contrôler la paroisse de
Saint-Athanase et la région de Saint-Jean durant les troubles. Lors de la
marche du constable Malo, il lui fut adjoint un détachement de 18 cavaliers de
la Montreal Volunteer Cavalry, commandé par le lieutenant Ermatinger. «C’était
une maladresse ou plutôt une provocation directe».
La troupe arriva à Saint-Jean vers 3 heures du matin, au moment où la ville est
endormie. Tour à tour, les deux prévenus sont arrêtés, menottés et placés dans
un fourgon conduit par le constable. Au lieu de regagner Montréal par Laprairie
d’où ils étaient venus, Malo et ses hommes s’engagèrent vers Chambly où ils
arrivèrent à 6 heures du matin, le 17 décembre. Pendant ce temps, les Patriotes
se sont rassemblés à Laprairie afin de venir au secours des prisonniers. Dès
l’arrestation, le capitaine Vincent monta à cheval et chevaucha toute la nuit
sous une pluie battante pour prévenir les Patriotes que le convoi ne suivrait
pas le même parcours qu’à l’arrivée. Toute la nuit, les Patriotes se mirent à
faire fondre des balles. Ce travail fait, ils vinrent s’installer à la ferme à
Trudeau, entre Chambly et Saint-Jean. Ils sont 40 sous les ordres du jeune
Bonaventure Viger. Ce dernier fait disperser le petit nombre d’hommes afin de
donner à Malo l’impression qu’ils sont une troupe nombreuse. Lorsque le convoi
vient à passer, Viger saisit la bride de l’un des chevaux du constable Malo :
«…Bientôt le bruit de la
cavalcade comence à se faire entendre et des formes apparaissent dans la brume
du matin. Une décharge, tirée par les Patriotes embusqués, informe le convoi
qu’il ne passera pas; "Halte! crie Viger; Livrez-nous les Patriotes que
vous détenez injustement". Pour toute réponse, la troupe fait feu : Viger
est atteint de 2 balles; l’une lui effleure la jambe, l’autre lui coupe
l’extrémité du petit doigt.
Mais les Patriotes répondent.
Viger lui-même, avisant le dragon de tête, lui fracasse le genou. Les chevaux
s’emballent et leurs cavaliers ne demandent probablement pas mieux que de se
laisser emporter… Bientôt, il ne reste plus sur place que l’huissier, blessé et
tout frissonnant de peur. Tandis que les Patriotes se ruent sur les prisonniers
pour les délivrer, il réussit à se glisser à terre et court se cacher dans un
four.
Un forgeron brise les fers des
2 héros et l’on se rend à Longueuil fêter la victoire sur les Bureaucrates…»
N’empêche, les «héros» ont eu la frousse de leur vie
quand, «avant de fuir, les cavaliers avaient déchargé deux ou trois
pistolets sur les prisonniers. Démaray est quitte pour une joue égratignée et
une perforation de son manteau tandis que le
chapeau de Davignon est transpercé d’une balle».
Le coup de force avait trop bien réussi. Le 12 décembre, Lord Gosford émet une
proclamation mettant à prix les têtes de Démaray, Davignon, de Gagnon et autres
chefs patriotes au montant de $ 400 :
«
Mais lorsque les fumées de
l’enthousiasme se furent dissipées, on se demanda ce qu’il fallait maintenant
faire. Duquette lui-même venait d’apprendre qu’il était porté sur la liste
d’écrou et que seule son absence de Saint-Jean, au cours de la nuit, l’avait
sauvé de l’arrestation. Un unique moyen s’offrait d’échapper aux poursuites
judiciaires : passer la frontière. C’est à quoi se résignèrent les trois
Patriotes. Le lendemain, ils étaient en sûreté à High Gate Spring».
C’était là la mèche qui devait mettre le feu aux
poudres. Les hostilités se généralisèrent. Puis ce fut la victoire imprévue de
Saint-Denis, la défaite de Saint-Charles, puis celle de Saint-Eustache. Pendant
ce temps, le colonel Jones organisait son bataillon composé essentiellement
d’officiers venus de Saint-Armand. Il réussit  ainsi, en quelques jours, à enrôler
et à équiper 250 hommes et mettre ainsi les Patriotes dans l’impossibilité de
bouger. De plus, il avait son propre réseau d’espionnage dont faisait partie un
certain Joseph Armand dit Chartrand qui s’infiltra parmi les Patriotes du
Haut-Richelieu. Comprenant que la trahison de Chartrand avait permis
l’arrestation de quelques Patriotes, plusieurs d’entre eux lui tendirent une
embuscade dirigée par un instituteur de L’Acadie, François Nicolas. Une dizaine
de jeunes Patriotes s’emparèrent de Chartrand, lui menèrent un procès au bout
duquel il fut reconnu coupable. On le traîna aussitôt dans un bois voisin,
entre Saint-Jean et L’Acadie, on l’attacha à un arbre et on le fusilla. Pendant
ce temps, un cultivateur Patriote de la Grande-Ligne, Julien Gagnon, essayait
d’entraîner un groupe de Patriotes réfugié à La-Pointe-à-la-Meule pour
s’emparer du fort Saint-Jean. Apprenant qu’une batterie d’artillerie et un
détachement d’infanterie régulière se dirigeaient vers Dorchester, les
Patriotes, trop peu et trop mal armés - seulement une trentaine avaient de
mauvais fusils tandis que les autres brandissaient fourches et faux emmanchées
sur des bâtons - décidèrent d’abandonner le projet et de retourner dans leurs
foyers.
Saint-Jean, renforcée de troupes véhiculées par le train et sous la poigne de
Nelson Mott, lieutenant de la 2e Compagnie des volontaires loyaux de
Dorchester, resta passive.
ainsi, en quelques jours, à enrôler
et à équiper 250 hommes et mettre ainsi les Patriotes dans l’impossibilité de
bouger. De plus, il avait son propre réseau d’espionnage dont faisait partie un
certain Joseph Armand dit Chartrand qui s’infiltra parmi les Patriotes du
Haut-Richelieu. Comprenant que la trahison de Chartrand avait permis
l’arrestation de quelques Patriotes, plusieurs d’entre eux lui tendirent une
embuscade dirigée par un instituteur de L’Acadie, François Nicolas. Une dizaine
de jeunes Patriotes s’emparèrent de Chartrand, lui menèrent un procès au bout
duquel il fut reconnu coupable. On le traîna aussitôt dans un bois voisin,
entre Saint-Jean et L’Acadie, on l’attacha à un arbre et on le fusilla. Pendant
ce temps, un cultivateur Patriote de la Grande-Ligne, Julien Gagnon, essayait
d’entraîner un groupe de Patriotes réfugié à La-Pointe-à-la-Meule pour
s’emparer du fort Saint-Jean. Apprenant qu’une batterie d’artillerie et un
détachement d’infanterie régulière se dirigeaient vers Dorchester, les
Patriotes, trop peu et trop mal armés - seulement une trentaine avaient de
mauvais fusils tandis que les autres brandissaient fourches et faux emmanchées
sur des bâtons - décidèrent d’abandonner le projet et de retourner dans leurs
foyers.
Saint-Jean, renforcée de troupes véhiculées par le train et sous la poigne de
Nelson Mott, lieutenant de la 2e Compagnie des volontaires loyaux de
Dorchester, resta passive.
Ainsi, lorsque le 28 février 1838, Robert Nelson mit
à profit le démembrement de l’armée anglaise dont une partie allait combattre
les rebelles du Haut-Canada, il put franchir la frontière à la tête de 300
hommes qu’il avait rassemblé à Alburg et s’établir à un demi-mille de la
frontière, à Caldwell’s Manor d’où il
lut sa fameuse Déclaration d’Indépendance du Bas-Canada. La milice de
Missisquoi, appelée en renfort, se prépara à rejoindre les Réguliers du colonel
Booth, stationnés à Henryville. Le général américain Wool, qui avait quand même
tenu à prévenir le général Colborne tant le Président Van Buren ne voulait pas
que son pays s’implique dans les troubles du Canada, avertit, par sympathie,
les hommes de Nelson qu'ils allaient se faire tailler en pièces. Robert Nelson
repassa la frontière le matin du 1er mars. Au printemps 1838, des étudiants en
médecine repêchaient encore des cadavres de soldats anglais qu’on avait jetés
dans le Richelieu au début de l’hiver.
Alors que tout paraissait calme durant la belle saison, une société secrète,
les Frères Chasseurs, s’organisait dans l’arrière-pays du Haut-Richelieu en vue
de reprendre le combat. Les Frères Chasseurs «partent la nuit, par bandes de
dix, vingt ou trente, portant la plupart, au bout d’un bâton, un petit paquet
contenant une chemise, un morceau de pain ou de lard, racolant des compagnons
d’armes pour leur passage et forçant les gens de se lever, de décrocher le
vieux fusil de chasse suspendu au soliveau et de les suivre».
Au début de novembre, Robert Nelson revient, sa Déclaration sous le bras. Il
repasse la frontière avec ses hommes, descend le Richelieu dans une goélette avec
4 de ses lieutenants, dont 2 Français, Hindelang et Trouvay. Arrivé au quai
Vitman, il laisse là quelques Patriotes et se rend à Napierville où le comté de
L’Acadie l’attend. Tout se passera désormais à Napierville.
Après les Troubles, en 1839, on allait construire
les bâtiments actuels des casernes de Saint-Jean. Démaray revint exercer sa
profession de notaire après la grâce concédée aux Patriotes le 9 mai 1841.
Jamais se considérant comme vaincu, il va entreprendre de poursuivre la lutte
sur le plan local en jouant le jeu des institutions issues de l’Acte d’Union de
1840. En 1854, lorsqu’il mourra, il demandera à être inhumé avec les chaînes
qu’il avait portées en 1837. Le docteur Davignon, en novembre 1838, dispensa
les soins aux blessés d’Odelltown réfugiés à Rouse’s Point aux États-Unis. Au
début de 1839, il s’établit à Sable Forks dans l’état de New York et lors de la
Guerre de Sécession, devint chirurgien d’un régiment du New York. Fait
prisonnier par les Sudistes, il resta 4 mois en prison en Virginie. Durant
cette campagne, son épouse mourut et lui-même s’éteignit en avril 1867. Julien
Gagnon, le Frère Chasseur, s’était réfugié à Champlain aux États-Unis en
1838 où il devait mourir de la tuberculose et des misères endurées durant les
Troubles, le 7 janvier 1842 en disant : «Je meurs pour la patrie, qu’elle
soit heureuse». Le sort le plus triste, toutefois, fut réservé au jeune
Duquette qui fut pendu dans des conditions atroces en 1839.
Un Patriote d’opérette. Félix Poutré. On ne peut passer sous silence
le rôle rocambolesque de notre Patriote local, Félix Poutré (1814-1885). Natif
de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, Poutré aurait fait partie  des Frères
Chasseurs dont il aurait recruté, dit-on, 3 000 rebelles avec la ferme
intention de s’emparer des casernes de Saint-Jean, mais faute d’armes, de
munitions et de secours extérieurs, son plan aurait échoué avant même d’être
entrepris. En fait, et c’est ce que nous apprendrons plus tard, Félix Poutré,
le fin-renard, était un agent double travaillant pour la police et
l’armée britannique. Il faudra attendre l’année 1898 afin d’établir le fait que
le Patriote adulé par la population, «vendant ses frères pour une poignée
d’argent, après avoir acheté son pardon par la délation»
n'était pas ce qu'il prétendait être. Poutré avait, en effet, obtenu un grand
succès avec son récit d’aventure présenté comme autobiographique. Il se disait
avoir été arrêté, le 7 novembre 1838, entre L’Acadie et Saint-Jean et
emprisonné le 13. Libéré le 26, les gens crurent l’anecdote selon laquelle il
aurait réussi à échapper à la potence (c'est le titre de son livre) en
simulant la folie. La vérité était tout autre. Employé par P.-D. Leclère,
surintendant de police, il surveillait les agissements des Patriotes de
Saint-Jean et des paroisses environnantes. Leclère écrivait ainsi au
secrétaire-adjoint de Colborne, C. H. Montizambert, «une lettre contenant le
rapport de
des Frères
Chasseurs dont il aurait recruté, dit-on, 3 000 rebelles avec la ferme
intention de s’emparer des casernes de Saint-Jean, mais faute d’armes, de
munitions et de secours extérieurs, son plan aurait échoué avant même d’être
entrepris. En fait, et c’est ce que nous apprendrons plus tard, Félix Poutré,
le fin-renard, était un agent double travaillant pour la police et
l’armée britannique. Il faudra attendre l’année 1898 afin d’établir le fait que
le Patriote adulé par la population, «vendant ses frères pour une poignée
d’argent, après avoir acheté son pardon par la délation»
n'était pas ce qu'il prétendait être. Poutré avait, en effet, obtenu un grand
succès avec son récit d’aventure présenté comme autobiographique. Il se disait
avoir été arrêté, le 7 novembre 1838, entre L’Acadie et Saint-Jean et
emprisonné le 13. Libéré le 26, les gens crurent l’anecdote selon laquelle il
aurait réussi à échapper à la potence (c'est le titre de son livre) en
simulant la folie. La vérité était tout autre. Employé par P.-D. Leclère,
surintendant de police, il surveillait les agissements des Patriotes de
Saint-Jean et des paroisses environnantes. Leclère écrivait ainsi au
secrétaire-adjoint de Colborne, C. H. Montizambert, «une lettre contenant le
rapport de  Félix Poutré, "cultivateur respectable de la paroisse de
Saint-Jean, qui, depuis quelque temps, est attaché au personnel de la police
pour fins secrètes." Ce qui veut dire en toutes lettres, que Poutré est un
espion au service du gouvernement. La première preuve s’en trouve dans
l’explication de ses fonctions que donne, ensuite, Leclère. "Son devoir
spécial, écrit-il, est de surveiller sa paroisse et les paroisses environnantes
et quelquefois de visiter le côté américain de la frontière et entrer en
communication avec les réfugiés établis là depuis les deux révolutions».
Son récit avait été publié en 1862 et le poète et dramaturge Louis Fréchette en
avait tiré une pièce à succès, Félix Poutré. Aussitôt la vérité
découverte, livre et pièce de théâtre sont retirés du commerce.
Félix Poutré, "cultivateur respectable de la paroisse de
Saint-Jean, qui, depuis quelque temps, est attaché au personnel de la police
pour fins secrètes." Ce qui veut dire en toutes lettres, que Poutré est un
espion au service du gouvernement. La première preuve s’en trouve dans
l’explication de ses fonctions que donne, ensuite, Leclère. "Son devoir
spécial, écrit-il, est de surveiller sa paroisse et les paroisses environnantes
et quelquefois de visiter le côté américain de la frontière et entrer en
communication avec les réfugiés établis là depuis les deux révolutions».
Son récit avait été publié en 1862 et le poète et dramaturge Louis Fréchette en
avait tiré une pièce à succès, Félix Poutré. Aussitôt la vérité
découverte, livre et pièce de théâtre sont retirés du commerce.
Actes législatifs concernant Dorchester. Les actes législatifs
concernant la ville de Dorchester sont nombreux et fort confus. Dès le 1er
avril 1818 avait été créés des syndics de village, mais ce n'est qu'en 1825 que
les Sieurs Étienne Patenaude, Louis Marchand, John Gray, William Watson et
François Marchand, propriétaires au dit village, sont élus syndics du village.
Les Rébellions n’ont pas suscité l’engagement des affairistes de Dorchester.
Même Gabriel Marchand s'est fait discret. Il sait qu’il appartient à une
bourgeoisie ascendante, celle des hommes d’affaires et non des petits-bourgeois
de professions libérales. Il sait que les Francophones du Canada peuvent se
montrer aussi entreprenants que les Anglophones. Il y a donc possibilité de
conciliation des deux races au Canada, contrairement à ce que soutiendra
lord Durham dans son célèbre Rapport. Marchand joua prudemment sa carte. Il
refusa d’être nommé au poste de Conseiller léislatif le 22 août 1837; en 1838
il refusa de même le poste au Conseil Spécial pour ses convictions
patriotiques. Ses frères et lui jouèrent passivement leurs cartes en attendant
que les choses se tassent. Le 15 avril 1841 est créé la Municipalité régionale
(district de Saint-Jean) dont le préfet est William McGinnis père, de
Saint-Athanase de Bleury, nommé le 12 juin 1841; le greffier est Pierre
Gamelin, notaire de Saint-Jean et Gabriel Marchand, cultivateur (sic!)
représentent les résidents. Le 1er juillet 1845, la Municipalité de la paroisse
forme son premier conseil sous la direction de Pierre-Paul Démaray nommé maire.
Deux ans plus tard, elle est intégrée à la Municipalité du comté de Chambly.
Après la formation de la Municipalité du Village, sur laquelle nous
reviendrons, le 1er juillet 1855 sont créées les comtés municipaux de
Saint-Jean et Iberville. Cette municipalité de comté comprend six municipalités
locales : les paroisses Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Jean-l'Évangéliste,
Village de Saint-Jean, Saint-Luc, Sainte-Marguerite-de-Blairfindie et
Saint-Valentin. La Municipalité de Paroisse est reformée avec le maire Samuel
Vaughan. Il est difficile d'imaginer que ces juridictions confuses ne seront
pas les lieux de conflits.
La municipalité de Paroisse Saint-Jean-L’Évangéliste et le duel entre
les Trente propriétaire-fondateurs et le notaire Démaray. L’Acte d’Union, appliqué en
1840, crée les nouvelles lois sur les municipalités. Le premier gouverneur à régner
sur le Canada-Uni, lord Sydenham, pensait instaurer des municipalités de
district dans l’ensemble du Canada. Chaque district se trouvant sous la
juridiction d’un préfet nommé par le gouverneur. Ainsi, la municipalité de
district de Saint-Jean comprend-t-elle 22 localités dont le préfet est William
McGinnis de Saint-Athanase d’Iberville, et s’étend des rives du fleuve
(Laprairie) jusqu’à englober toute la vallée du Haut-Richelieu jusqu’à la
frontière américaine. Les localités peuvent se faire représenter par 2
conseillers, mais Saint-Jean-l’Évangéliste n’en a qu’un : l’incontournable
Gabriel Marchand.
«
C’est au village de Saint-Jean que se tenait
les assemblées du Conseil de district. La première assemblée dura cinq jours,
soit du 7 au 11 septembre 1841. Par la suite, le Conseil se réunit à treize
reprises pour une période de quatre ou cinq jours à chaque fois. La dernière
assemblée eut lieu du 3 au 7 décembre 1844».
C’était un système lourd, centralisé et lié au gouverneur. Aussi,
resta-t-il impopulaire, coûteux pour les contribuables et ne servant finalement
qu’à des menées électorales. Les Municipalités de district seront  abolies pour
faire place, le 1er juillet 1845, aux Municipalités de paroisse ayant des
pouvoirs bien définis de taxation foncière et de responsabilités locales. À la
tête de chaque municipalité siège un Conseil composé d’un maire et de 6
conseillers élus par les contribuables.
Or, à l’érection de la municipalité de paroisse, c’est nul autre que l’ancien
chef Patriote, le notaire Pierre-Paul Démaray qui est élu maire (jusqu’à la
première abrogation de la municipalité de paroisse, le 1er septembre 1847). La
loi qui entre en vigueur ce 1er juillet 1845 et instituant les 325 premières
municipalités de la Province de Québec, confie à chaque commission scolaire,
indépendant du Conseil municipal, la gestion des écoles établies sur son
territoire. La commission scolaire est érigée la même année et le notaire
Démaray va y siéger face à son ennemi idéologique, le curé LaRocque. Une
opposion acharnée entre le Vieux Patriote et le curé ultramontain va troubler
la petite société pour plusieurs années.
abolies pour
faire place, le 1er juillet 1845, aux Municipalités de paroisse ayant des
pouvoirs bien définis de taxation foncière et de responsabilités locales. À la
tête de chaque municipalité siège un Conseil composé d’un maire et de 6
conseillers élus par les contribuables.
Or, à l’érection de la municipalité de paroisse, c’est nul autre que l’ancien
chef Patriote, le notaire Pierre-Paul Démaray qui est élu maire (jusqu’à la
première abrogation de la municipalité de paroisse, le 1er septembre 1847). La
loi qui entre en vigueur ce 1er juillet 1845 et instituant les 325 premières
municipalités de la Province de Québec, confie à chaque commission scolaire,
indépendant du Conseil municipal, la gestion des écoles établies sur son
territoire. La commission scolaire est érigée la même année et le notaire
Démaray va y siéger face à son ennemi idéologique, le curé LaRocque. Une
opposion acharnée entre le Vieux Patriote et le curé ultramontain va troubler
la petite société pour plusieurs années.
Les Municipalités de paroisse s’avèrent insuffisantes au bon
fonctionnement municipal. Elles se présentent comme un organisme transitoire
entre l’ancienne structure politique ecclésiastique et une nouvelle structure
politique civile. Les autorités devront bien se rendre à l’évidence que la
répartition politique et le groupement social ne s’effectuent plus autour du
curé, mais des propriétaires et des hommes d’affaires, également fonctionnaires
importants de la région. De plus, la Municipalité de paroisse semble porter un
intérêt tout particulier aux problèmes ruraux, ce qui ne plaît pas aux citoyens
de la localité qui veulent une administration bien à eux.
Les articles 47, 48 et 49 de la loi de 1845 prévoient l’érection de
municipalités de vilages et de villes. Il faut pour cela 3 choses bien simples
: avoir une requête signée par 30 propriétaires; que la communauté ait 60 maisons
ou plus réparties sur un territoire de 30 arpents et que ses habitants aient
droit à l’élection aux conseillers de Paroisse ou de Township. Dorchester
répond sans difficultés aux critères émis par le gouvernement du Canada-Uni. Le
17 juillet 1846, les Trente propriétaires envoient une requête à William
Macrae, juge de paix, afin de convoquer l’assemblée prescrite par l’acte 47.
L’assemblée se tient au palais de justice l’après-midi du 27 juillet suivant,
sous la présidence du juge Macrae assisté de Thomas-Robert Jobson au poste de
secrétaire. Tout un homme, ce notaire Jobson :
«
Premier secrétaire-trésorier de la Commission
scolaire de Saint-Jean (1845-1875), secrétaire-trésorier de la Fabrique de
Saint-Jean l’Évangéliste (1847-1875), premier secrétaire-trésorier de la
Municipalité du village de Saint-Jean (1848-1875), secrétaire de la Société
d’agriculture du comté de Chambly, section Saint-Jean-L’Acadie-Saint-Luc
(1848-1854), le notaire Jobson (1818-1875) monopolise littéralement les
secrétariats de toutes sortes pendant plus d’un quart de siècle».
On décide alors, au cours de l’assemblée, de présenter une pétition au
Conseil municipal de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste afin de fixer les
limites et les bornes du village en vue de l’incorporation tel qu’exigé par
l’article 49 de la Loi. Le Conseil municipal de la Paroisse prend note de la
demande et lui donne une réponse favorable. Le notaire Démaray et ses
conseillers : Louis Fréchette père, Pierre Roi, John Rossiter et Hilaire
Lafaille, plus le secrétaire-trésorier Pierre Gamelin, établissent les
premières limites du village de Saint-Jean :
«
Il est unanimement agréé et Résolu par ce
Conseil que d’après la demande et réquisition des dits habitants, les limites
et bornes de cette dite Ville de Dorchester communément nommée Saint-Jean
soient comme suit, savoir; borné à l’Est par devant au miieu de la rivière
Richelieu, par derrière à l’ouest aux Terres de la deuxième Concession
communément nommé grand Bernier, au nord par la ligne sud de la terre d’Herman
Vaughan, au sud par la ligne nord de la terre d’Ephraïm Mott, ce qui fait y
compris «le Terrain du Gouvernement Trente quatre Arpents de front le long de
la rivière Richelieu ou environ sur Trente Arpents de profondeur à compter de
la Rivière Rcihelieu ou environ sur Trente Arpents de profondeur à compter de
la Rivière Richelieu jusqu’aux Terres de la dite seconde concesstion du Grand
Bernier et que cette Ville soit dorénavant connue et désignée sous le nom de
Saint-Jean Dorchester».
La Résolution parvient aussitôt au Secrétaire Provincial qui demande,
dans son accusé de réception, qu’on lui fasse parvenir un plan figuratif du
village fait par un arpenteur assermenté. Demande anodine en soi, elle va
soulever le conflit entre les habitants et le Conseil municipal de la paroisse.
En effet, il semblerait que le plan dressé par Hiram Corey ne correspond pas
aux limites établies en Conseil. En conséquence, le maire Démaray insiste pour
que le plan soit soumis au Conseil avant d’être expédié au Secrétaire Provincial.
À l’issue de cette séance, Corey est tenu de refaire son plan en y indiquant en
plus le tracé des rues et des différents lots de terrain compris dans le
territoire du village. Hiram Corey refait son plan et l’expédie au Conseil pour
qu’il soit étudié à la séance trimestrielle du 1er mars 1847 - les Conseils
Municipaux devant se tenir à sessions trimestrielles régulières, soit le
premier lundi des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année -,
mais voila que la réunion n’aura pas lieu.
Le 12 mars 1847, les tenants du projet d’incorporation reviennent à la
charge en déposant une petition sur le bureau du maire Démaray afin de
convoquer au plus tôt une assemblée spéciale du Conseil «afin de sanctionner
le plan soumis en févirer». Le maire hausse les épaules et la pétition
reste lettre morte. À la session du 1er juin, la question ne peut être amenée
sur la table du Conseil puisque, à nouveau, le Conseil ne siège pas! Les
propriétaires atteignent le comble de l’exaspération. Pourquoi Démaray tient-il
tant à repousser le projet d’incorporation en municipalité de village? La
question dépasse le simple fait qu’il a peur de perdre son poste de maire de
paroisse! La véritable raison du dédain pour le projet réside en son amertume
envers les signataires de la pétition. On y retrouve Nelson Mott et tous les
commerçants de la rue Front, pour la plupart anglophones et Bureaucrates durant
les Troubles. La vieille rancœur contre les alliés bureaucrates et cléricaux
semble animer la vie du notaire depuis son retour d’exil. Ses affrontements
avec le curé LaRocque sont vitrioliques. Les commerçants anglophones également
sont loin de priser le notaire et une pétition à lord Elgin, gouverneur du
Canada, le montre assez bien. Le caractère économique de la friction l’emporte
sur le caractère politique de l’affrontement entre propriétaires et Conseillers
municipaux :
1° Que la Municipalité contrairement à la 21e
section de la 28e clause de la loi de 1845, avait imposé une taxe annuelle de 4
livres aux marchands et aux commerçants en gros ou en détail tenant magasins ou
boutiques à l’intérieur des limites du village de Saint-Jean.
2° Que la Municipalité pour des raisons
inconnues des requérants n’avait imposé aucune taxe d’aucune sorte pour les
autres habitants de Saint-Jean, et que conséquemment le Conseil Municipal avait
créé une injustice envers les marchands et commerçants qui devaient supporter
seuls toutes les dépenses encourues et à encourir par la dite municipalité.
Non seulement le notaire Démaray évite à ses compatriotes le soin de
payer les taxes, mais il augmente en plus les taxes de riches propriétaires de
commerces et d’entreprises. Le Vieux Patriote surtaxe ses ennemis de la veille
et ménage les siens. Pour toute réponse, les Trente propriétaires-fondateurs
sont tenus en haleine, puisque le gouverneur Elgin ne peut «en venir à une
détermination sur le sujet avant d’avoir la réponse du Conseil municipal de
Saint-Jean». Et lorsque cette réponse vient, elle est franche. Dans un
premier temps, le Conseil identifie les Trente propriétaires-fondateurs comme
des chefs et meneurs s’opposant injustement au fonctionnement des
lois et du Conseil. En deuxième temps, un paragraphe superbe dénonce la
contradiction et la ségrégation qui se dissimulent derrière la requête des
Trente : «Vu que ses opposants ou contrevenants sont des personnes qui, pour
obtenir le but de se soustraire au devoir qui leur est imposé par la
Municipalité, demandent à grand cri la division de la Ville d’avec la Campagne
afin de mieux défier les pouvoirs de la Municipalité et mettre le comble au
mépris qu’ils y portent…»
Le décret se termine par la résolution adoptée en Conseil qu’il n’y aura pas de
séparation géographique, du moins pas avant que «les fauteurs de cette
opposition se soumettent et se conforment aux devoirs qui leur sont imposés et
au payement des licences que la loi leur impose et auxquels ils se sosnt
continuellement refusés et se refusent encore de payer».
Au moment où les pétitions et les contre-pétitions se défient, la situation
tombe dans une impasse jusqu’au jour où, le 1er septembre 1847, entre en
vigueur la nouvelle loi qui abroge celle de 1845 et du même coup, les 325
Municipalités de paroisse qui sont remplacées par les Municipalités de comté.
Chaque Municipalité de comté est dirigée par un Conseil composé de 2
conseillers nommés dans chaque paroisse incorporée au territoire du comté. La
paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste est donc incorporée à la municipalité de
comté de Chambly.
La paroisse doit donc se choisir 2 nouveaux délégués pour siéger au
Conseil de la Municipalité de comté de Chambly. Il semblerait qu’alors, les forces
occultes se soient liguées en vue de déloger le notraire Démaray. Les
élections sont prévues le 14 septembre 1847 : «Quatre candidats étaient en
lice; le notaire Pierre-Paul Démaray, le docteur Pierre-Moïse Moreau, James
Bissett
et Henry LaRocque. Or il arriva que Démaray et Moreau perdirent leurs
élections. Les candidats défaits protestèrent alors de certaines irrégularités
durant le scrutin. Ce sont 2 protêts notariés qui viennent faire la lumière sur
cette affaire, qui fut sans doute la première élection municipale contestée
dans l’histoire de Saint-Jean».
Les protêts notariés se prononcent sur l’irrégularité des conditions dans
lesquelles les élections se sont tenues. D’abord, les électeurs de Bissett et
LaRocque - dont nos Trente propriétaires-fondateurs - n’ont pas payé encore les
taxes et licences prescrites, ni versés pour le soutien des Écoles. (Or, ils ne
sont donc pas des «contribuables».) Par ailleurs, la liste du Poll a été
irrégulièrement tenue puisqu’elle ne distingue les locataires des
propriétaires, de manière que les propriétaires qui n’ont pas payé leurs taxes
à la Municipalité de la paroisse de Saint-Jean-l’Évangéliste ne sont pas soulignés.
En dernier lieu, le président d’élection - qui par hasard (?) était François
Marchand - devait tenir personnellement la liste du Poll durant la tenue du
scrutin, or, non seulement il ne l’avait pas, mais en plus il ne fit pas
lecture de l’acte ou la loi réglant les élections comme il était prescrit :
Marchand aurait procédé immédiatement à l’élection à l’ouverture du Poll. Les
protêts notariés déclarent l’élection de Bissett et LaRocque nulle de faits
et de droits. Le livre des minutes du Conseil du Comté de Chambly n’ayant
pas été retrouvé, on ignore ce qui advint de l’élection. Quoi qu’il en soit, il
semble bien que Bissett et LaRocque se soient rendus siéger quand même au
Conseil de Municipalité puisqu’ils ne tardèrent pas à y faire parvenir la
demande d’incorporation du village.
Cependant, le sort devait réserver un bien vilain tour aux espoirs des
Trente propriétaires-fondateurs. «À cause de certaines irrégularités ou
omissions dans les documents expédiés», le procureur général du Canada,
Louis-Hippolyte Lafontaine, transmet, le 11 avril 1848, une lettre à Charles G.
Scheffer, secrétaire-trésorier du Conseil municipal de Chambly, l’informant
qu’il regardait comme nuls tous les documents que le Conseil municipal du comté
lui avait fait parvenir concernant l’incorporation du village de Saint-Jean.
Toutes les procédures se trouvent donc à refaire!
Pour une troisième fois, les Trente propriétaires-fondateurs reviennent
à la charge. Cette fois-ci, c’est Nelson Mott qui, avec l’aide du notaire
Thomas-Robert Jobson et Joseph-E. Bourke, adressent une lettre le 1er mai 1848
au juge de paix William Macrae, afin de convoquer une assemblée des résidents
du village pour le 29 du même mois. On renouvelle une fois de plus la requête
adressée au Conseil municipal du comté de fixer les limites du village en vue
de son incorporation. Le Conseil municipal en discutte le 12 juin 1848, et
soumet la motion aux voix. Elle est emportée par une majorité de dix contre un
: «M. Paré seul ayant voté contre en disant qu’il est toujours d’opinion que
les notices doivent être données aux portes des Églises de la municipalité et
non seulement aux portes des Églises où est situé le village qui demande à être
incorporé». Il est triste que le nombre des habitants présents à
l’assemblée tenue le 29 mai 1848 ne soit pas rapporté. Considérant que
l’article 47 stipule la présence des habitants pouvant résider dans 60 maisons
ou plus et 30 propriétaires ayant habileté pour requérir des autorités la
demande d’incorporation, nous pouvons présumer que l’incorporation en
Municipalité de village de Saint-Jean s’est opérée un peu comme une
mini-Confédération. Seuls les gens du village, les riches propriétaires de la
rue Richelieu - qui par ailleurs ne payaient pas leurs taxes -, ont décidé du découpage
géo-politique de la Municipalité. Au minimum, 60 habitants bien choisis, économiquement
aisés, stratégiquement disposés dans les appareils publiques, dressèrent une
barrière entre la ville et la campagne. Du jour au lendemain, des
habitants de la municipalité de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste se sont
réveillés en dehors des limites de la ville de Dorchester! Peut-être faut-il
voir là la nécessité de réhabilliter la Municipalité de la paroisse en 1855?
Une chose est sûre, les Trente propriétaires-fondateurs, flanqués d’hommes de
pailles et de fonctionnaires dévoués, ont suffi à rassembler les 60 habitants
pouvant se partager dans 60 maisons réparties dans le village, et au mépris des
et plus qui n’étaient pas propriétaires ou dont la chose municipale
laissait froid, sont parvenus à fonder un nouveau village. Les autres habitants
de la région ont vu un jour afficher sur la porte de l’église
Saint-Jean-l’Évangéliste le décret qui les érigeait citoyens du Village de
Saint-Jean. Le tout fut proclamé officiellement par lord Elgin le 28 juillet
1848.
La Municipalité de paroisse est remise sur pied le 1er juillet 1855.
Son premier maire, Samuel Vaughan, restera en poste jusqu’en 1859. Ce
cultivateur était l’un des conseillers en 1845-1847 et il était directeur de la
Société d’agriculture du comté de Chambly, section
Saint-Jean-Saint-Luc-L’Acadie. John Crosby Towner, néophyte catholique, succède
à Vaughan de 1859 à 1864. Jean-Baptiste Moreau, de 1864 à 1866. Plus tard, il
sera président à son tour de la Société d’agriculture du comté de Saint-Jean
(1867-1869) ainsi que président-fondateur de la Compagnie d’assurance mutuelle
de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste en 1879. Le commerçant Samuel Langlois
succède à Moreau de 1866 à 1868. Julien Poissant de 1868 à 1869; il est l’un
des directeurs de la Mutuelle d’assurance de la paroisse en 1879. Narcisse
Brosseau, cultivateur, est maire en 1869-1870, puis il s’établit comme
commerçant à Saint-Jean. Charles Hébert est maire de paroisse de 1870 à 1872,
il est surtout actif dans les organismes administratifs de l’époque
(marguillier, commissaire d’école, etc.), puis Julien Richard de 1872 à 1875 et
Gilbert Lanoue en 1875-1876…
Cette même loi du 1er juillet 1855 qui restaurait la Municipalité de
paroisse était accompagnée de l’instauration de la Municipalité du comté de
Saint-Jean ayant pour but de s’occuper des ouvrages tels que chemins, ponts et
cours d’eau sur tout le comté et quelques-unes des municipalités locales de son
territoire. Dirigée par un Conseil de comité composé des maires de paroisses -
les maires de cités et de villes étant exclus -, la Municipalité du comté de
Saint-Jean est présidée par un Préfet nommé parmi les membres du
Conseil. Malheureusement, les archives de la période de 1855 à 1937 semblent
avoir disparu, aussi ne peut-on reconstituer que par bribes l’histoire de la
Municipalité de comté de Saint-Jean. Nous savons que la première séance du
Conseil se tint en août 1855 et que le préfet en était Joseph Delagrave, maire
du village de Saint-Jean :
«Par la suite, lors d’une deuxième séance
tenue le 12 septembre 1855, le conseil désignait le village de Saint-Jean comme
chef-lieu du comté et comme site du futur bureau d’enregistrement. Deux mois
plus tard, à l’occasion d’une séance spéciale tenue le 12 novembre 1855, le
conseil décidait l’achat d’une maison pour servir à la fois de bureau
d’enregistrement (au rez-de-chaussé) et de salle de réunion pour le conseil du
comté (au 2e étage).
Cette maison sise sur la rue Jacques-Cartier,
au nord de l’actuel hôtel National, servit jusqu’en 1970 alors qu’elle fut
vendue à la Compagnie Bell Canada. Elle a été démolie il y a quelques années et
un petit parc a été récemment aménagé sur son emplacement. Depuis 1970, le
Conseil de comté siège dans un édifice situé au 262 rue Foch, à
Saint-Jean-sur-Richelieu».
De 1864 à 1866, Jean-Baptiste Moreau, maire de la paroisse, est
également préfet du comté de Saint-Jean.
Le maire Nelson Mott et la fondation du village de Saint-Jean. Du 1er juillet 1848 date
l'incorporation de la Municipalité du village de Saint-Jean. Le premier maire,
Nelson Mott, préside d'août 1848 à juillet 1850, le conseil constitué de
Benjamin Burland, Robert H. Wight, Louis Fréchette (non le poète),
François-Xavier Langelier, Charles S. Peirce et Édouard Bourgeois.
L’indispensable notaire Jobson devient le secrétaire-trésorier de la
Municipalité de village. La première séance du Conseil municipal a lieu le 26
août 1848 dans l’édifice situé à l’angle nord-est des rues Champlain et
Saint-Jacques, lieu où le notaire Jobson tient son bureau. Les conseillers
Wight, Langelier, Bourgeois et Burland forment un comité afin d’élaborer les
règles et règlements pour la conduite et le bon ordre des procédés du Conseil
en conformité avec la 24e clause du Statut Provincial». Dès la deuxième
séance du Conseil, on procède à la nomination d’un premier inspecteur municipal
en la personne d’Henri-Joseph LaRocque. Trois jours plus tard, le Conseil
adopte un règlement concernant la bonne tenue du marché public et 4 jours plus
tard, à la 4e séance du Conseil, entre en vigueur un règlement régissant les
débats et le bon ordre des assemblées  municipales. On forme 5 comités afin de
faciliter le bon fonctionnement des affaires : le Comité des finances et des
comptes généraux, le Comité du marché, le Comité des chemins et des rues -
c’est alors que l'arpenteur Hiram Corey fait la verbalisation des rues et la
description de leur tracé -, le Comité des incendies et le Comité de police et
de santé. Nelson Mott se réserve la charge de superviser tous ces comités et on
se met à l’œuvre. Le 8 janvier 1849, le Conseil organise la première unité de
pompiers et nomme Louis Marchand surintendant de la Richelieu Fire Engine
Company. Il semblerait que la circulation ferroviaire ait été à l’origine
de cette mesure. Selon François Cinq-Mars, «la crainte d’un incendie
provoqué par le chemin de fer, qui laissait d’immense quantité de bois dans la
ville près de ses entrepôts, afin d’alimenter ses locomotives, ait également
influencé la mise sur pied de ce service. En effet, le conseil municipal de
Saint-Jean avisait en janvier 1849, le président de Champlain et
Saint-Laurent du danger d’incendie que représentait ce bois aux abords du
village». Le triste
événement de 1876 devait montrer que cette crainte était justifiée, mais que ce
ne serait pas des bois déposés par la compagnie que le feu se répandrait sur la
ville. Le 22 janvier suivant, le Conseil procède à l’adoption d’un règlement de
police pour le maintien de l’ordre, l’entretien des rues et des trottoirs, la
conservation des bonnes mœurs, etc. On interdit ainsi à quiconque d’aller se
baigner dans le canal de Chambly, de se battre, crier ou blasphémer dans la rue
et, en hiver, tous les résidants du village sont tenus d’enlever la neige et la
glace sur les trottoirs bordant leurs maisons. Pendant l’été, ils doivent
maintenir la propreté de ces mêmes trottoirs en les lavant ou en les balayant.
Le 16 avril, un règlement concernant les nuisances est adopté par la
municipalité. Désormais, il est interdit de laisser errer librement les animaux
dans les rues du village sous peine d’amende. Tout cela restera fort théorique,
bien entendu.
municipales. On forme 5 comités afin de
faciliter le bon fonctionnement des affaires : le Comité des finances et des
comptes généraux, le Comité du marché, le Comité des chemins et des rues -
c’est alors que l'arpenteur Hiram Corey fait la verbalisation des rues et la
description de leur tracé -, le Comité des incendies et le Comité de police et
de santé. Nelson Mott se réserve la charge de superviser tous ces comités et on
se met à l’œuvre. Le 8 janvier 1849, le Conseil organise la première unité de
pompiers et nomme Louis Marchand surintendant de la Richelieu Fire Engine
Company. Il semblerait que la circulation ferroviaire ait été à l’origine
de cette mesure. Selon François Cinq-Mars, «la crainte d’un incendie
provoqué par le chemin de fer, qui laissait d’immense quantité de bois dans la
ville près de ses entrepôts, afin d’alimenter ses locomotives, ait également
influencé la mise sur pied de ce service. En effet, le conseil municipal de
Saint-Jean avisait en janvier 1849, le président de Champlain et
Saint-Laurent du danger d’incendie que représentait ce bois aux abords du
village». Le triste
événement de 1876 devait montrer que cette crainte était justifiée, mais que ce
ne serait pas des bois déposés par la compagnie que le feu se répandrait sur la
ville. Le 22 janvier suivant, le Conseil procède à l’adoption d’un règlement de
police pour le maintien de l’ordre, l’entretien des rues et des trottoirs, la
conservation des bonnes mœurs, etc. On interdit ainsi à quiconque d’aller se
baigner dans le canal de Chambly, de se battre, crier ou blasphémer dans la rue
et, en hiver, tous les résidants du village sont tenus d’enlever la neige et la
glace sur les trottoirs bordant leurs maisons. Pendant l’été, ils doivent
maintenir la propreté de ces mêmes trottoirs en les lavant ou en les balayant.
Le 16 avril, un règlement concernant les nuisances est adopté par la
municipalité. Désormais, il est interdit de laisser errer librement les animaux
dans les rues du village sous peine d’amende. Tout cela restera fort théorique,
bien entendu.
Tous les lundis soir, vers 7 heures, le Conseil municipal se rassemble.
Il vote des mesures afin d’organiser le village de manière à encourager la
prospérité économique. Le 23 avril, après avoir pris connaissance d’un rapport
du Comité des chemins et des rues, il décide de refaire les trottoirs à la
grandeur du village tant les trottoirs, faits de pièces de bois et en très mauvaise
condition, sont remplacés par des trottoirs faits en madriers. Une loi du 14
mai stipule que désormais, tout commerçant en gros ou en détail, ou toute
personne tenant un magasin ou une boutique pour la vente de marchandise, se
devra d’obtenir une licence pour opérer dans les limites du village. C’est là
un moyen d’apporter des revenus supplémentaires aux caisses de la municipalité.
Les hôteliers et les aubergistes sont tenus de se soumettre aux mêmes
exigences. Le coût annuel d’une licence est de £ 7 et 10 shillings (environ $
30.00). Le 22 mai, le Conseil du village reçoit une requête de la part de
Richard Wilson et de William Miller, qui veulent établir une maison ou une
auberge pour l’accommodement de nombreux émigrants qui passent continuellement à
Saint-Jean pour se rendre aux États-Unis. Afin de diminuer le vagabondage, le
Conseil appuie le projet et le recommande au Gouverneur afin d’obtenir une aide
financière. Enfin :
«
les
règles et les normes régissant l'organisation de la municipalité sont adoptées
le 28 mai 1849. La gestion est régie par l'Acte des municipalités et des
chemins du Bas-Canada à partir de 1855. […]
Le suivi des dossiers est
assumé par le secrétaire-trésorier Thomas-Robert Jobson, notaire qui reçoit en
1848-1849 un salaire annuel de 30 livres. De 1848 à 1859, l'administration
ainsi que la tenue des assemblées se déroulent en son étude notariale, située
au coin des rues Saint-Jacques et Champlain, côté nord-est. Cette pratique sera
en vigueur jusqu'à l'ouverture de l'édifice du marché. C'est l'inspecteur du
village qui est responsable des travaux et de l'observance des règlements
municipaux. Au cours des premières années s'ajoutent le surveillant des
chemins, des rues, des ponts, le sous-voyer et les inspecteurs de clôtures. En février
1852, le poste de sous-voyer sera aboli. Durant l'année 1853, le conseil
municipal prend position en faveur de l'abolition de la tenue seigneuriale. En
1856, Saint-Jean obtient une charte de ville grâce au travail acharné du maire
de l'époque, l'avocat Joseph Delagrave. Toutes ces municipalités, dont les
territoires se recoupaient, devaient perdurer plus de cent ans. Il est vrai que
les besoins des milieux agricoles se distinguaient nettement de ceux des zones
urbaines».
Le 2 juillet 1849, faisant suite à la loi, le Conseil forme le premier
bureau de santé dont les membres sont le maire en personne, Nelson Mott, Thomas
Maguire père, et le docteur Pierre-Moïse Moreau. Ces officiers de santé doivent
veiller à déceler les maladies épidémiques, endémiques ou contagieuses et
mettre en quarantaine les maisons et les familles dont un ou plusieurs
individus présenteraient des indices de maladie sérieuse. La population reste
encore sous le choc de l’épidémie de typhus qui frappa la ville en 1847. Dans
la nuit du 23 décembre 1849, pour fêter Noël (?), un acte de sabotage
détruit une partie de la voie ferrée construite à la limite sud du village de
la Champlain & St Lawrence Railroad Cie. Le 26 décembre, aux
lendemains des réjouissances, le Conseil tient une réunion spéciale et adopte
une motion qui consacre le système d’ordre juridico-économique du village :
«…
premièrement, le Conseil blâmait sans
réserve tous dommages causés à la propriété privée et, deuxièmement, il
reprochait à la compagnie son attitude arbitraire lors de l’achat ou de
l’expropriation des bandes de terrain où passait le chemin de fer. Il semble en
effet que la Champlain and St. Lawrence Railroad Company
ne s’était pas
souciée de dédommager raisonnablement les propriétaires dont les terres avaient
été coupées en deux par le tracé de la voie ferrée. On s’imagine sans peine que
cela avait dû occasionner pour eux beaucoup d’inconvénients et de dépenses.
Quoi qu’il en soit, cette affaire n’eut pas de suite, du moins dans les minutes
du Conseil».
Le 11 février 1850, afin de prévenir les incendies, le Conseil exige de
tous les propriétaires de maison un ramonage de leurs cheminées trois fois par
an, soit en mars, en juillet et en novembre. Une pénalité de 5 shillings
(environ $ 1.00) est prévue pour chaque omission :
«
En vertu de l’article 59 de l’Acte municipal
de 1847, on devait procéder à un tirage au sort pour désigner qui des 7
conseillers devait céder son siège. À l’assemblée du Conseil tenue le 13 juin
1850, le sort tomba sur les conseillers François-Xavier Langelier, Robert H.
Wight et Louis Fréchette, qui furent remplacés, à l’élection du 9 juillet
suivant, par Pierre-Paul Démaray, notaire et Alexandre Nadeau; quant au
conseiller Fréchette, il fut réélu».
L’entrée de Pierre-Paul Démaray au Conseil municipal est la cause
indirecte de la défaite de Nelson Mott à l’élection du 22 juillet 1850. Démaray
peut se venger de l’affront subit en 1847 en soutenant la candidature de
Benjamin Burland à la succession de Mott. Au vote, Pierce et Bourgeois appuient
Mott, mais Fréchette, Nadeau et Démaray appuient Burland. Burland et Mott étant
dispensés de voter. Benjamin Burland est donc élu second maire de Saint-Jean.
Nelson Mott continuera toutefois à siéger comme conseiller jusqu’en août 1851,
puis délaissera la politique municipale durant 7 ans, jusqu’à sa réélection
comme conseiller, le 22 janvier 1858. Il n’y restera d’ailleurs qu’un an avant
de se retirer de la scène politique pour se consacrer à son poste de
marguillier de l’église Saint-James. C'est dans le petit cimetière adjacent à
l'église qu'il repose. On doit à Mott la construction d'une école paroissiale
qui sert aussi de Sunday School.
Aspect de Dorchester au milieu du XIXe siècle. En 1842, la population de
Dorchester est de 1 315 habitants, dont 280 chefs de famille et 177
propriétaires. «La ville renferme environ 250 maisons, un bureau de douanes,
trois églises : une catholique, une anglicane et une méthodiste; dix hôtels et
tavernes, neuf magasins, deux maisons de transport, deux tanneries et plusieurs
boutiques d’artisans. Les seules rues sont les rues Lemoine ou Frontenac, Front
ou Richelieu, McCumming ou Champlain, Busby ou Jacques-Cartier, Longueuil et
Grant ou Laurier».
Pour avoir une idée de l'aspect des rues de Saint-Jean à l'époque, il faut se
rappeler qu'elles ont une largeur d'environ 36 pieds français et sont en terre
battue recouverte de pierre. Elles sont éclairées à l'huile grâce à des
réverbères. Les trottoirs sont faits de bois que le conseil municipal achète
sous forme de madriers. En avril 1850, un règlement est adopté pour prolonger
la rue Saint-Georges vers l'ouest. Le 23 mai 1854, un autre règlement voté
ouvre une nouvelle rue située entre Longueuil et Champlain : la petite rue
Victoria. Le 1er décembre 1856, les élus décident de contribuer pour 50% avec
le conseil du comté au projet de construction du Half Way House Bridge
du pont Jones. En décembre 1857, William Ryder et Félix Côté sont engagés
respectivement à titre d'architecte et d'entrepreneur pour ériger l'édifice de
la Place du Marché qui ouvrira au printemps 1859 et qui servira également
d'Hôtel de ville durant plusieurs années. La rue Montcalm naît au cours des
années 1860. Le prolongement de la rue Mercier est possible jusqu'aux limites
sud de la ville grâce à la cession d'une lisière de terrain par le gouvernement
fédéral en juin 1871. En vingt-cinq ans environ, la ville de Saint-Jean est
devenue une vraie municipalité, avec un conseil de ville responsable et de plus
en plus français.
François Bourassa, député au Parlement du Canada-Uni. Avec la réforme de la carte
électorale de 1840, Dorchester continue de faire partie du comté de Chambly.
John Yale Jr en est député de 1841 à 1843, Louis Lacoste de 1843 à 1847, Pierre
Beaubien de 1848 à 1849 et Louis Lacoste, à nouveau, de 1849 à 1854. En 1845,
on procède à l’application de la troisième proposition du Rapport Durham visant
à l’institution des municipalités. Ceci comprend l’élection d’un Conseil
municipal composé de 7 membres qui choisissent un maire dans leur sein.
Dorchester aura définitivement été emportée par les Troubles de 1837-1838 et
l’histoire de la ville de Saint-Jean pourra alors commencer.
 En 1854, l’élection entraîne un nouveau comté, la circonscription de
Saint-Jean. François Bourassa (1813-1898), ancien Patriote, arrêté et détenu un
certain temps, qui servit ensuite de capitaine de milice locale, en est élu le
premier député. Établi à Saint-Jean, il représentait déjà la ville au conseil
du comté de Chambly. Bourassa est nettement un «Rouge» et ne parlait pas
anglais, seulement il avait appris le système de maraudage en vogue aux
États-Unis de donner des bonbons aux enfants et de serrer des poignées de mains
aux citoyens les plus ordinaires. L’instabilité des gouvernements de l’Union
entraîne pourtant déjà l’idée d’un nouveau régime constitutionnel. En tant que
libéral, Bourassa s’opposera à la Confédération, mais une fois le projet passé,
il se portera candidat et sera élu premier député de la circonscription
fédérale de Saint-Jean.
En 1854, l’élection entraîne un nouveau comté, la circonscription de
Saint-Jean. François Bourassa (1813-1898), ancien Patriote, arrêté et détenu un
certain temps, qui servit ensuite de capitaine de milice locale, en est élu le
premier député. Établi à Saint-Jean, il représentait déjà la ville au conseil
du comté de Chambly. Bourassa est nettement un «Rouge» et ne parlait pas
anglais, seulement il avait appris le système de maraudage en vogue aux
États-Unis de donner des bonbons aux enfants et de serrer des poignées de mains
aux citoyens les plus ordinaires. L’instabilité des gouvernements de l’Union
entraîne pourtant déjà l’idée d’un nouveau régime constitutionnel. En tant que
libéral, Bourassa s’opposera à la Confédération, mais une fois le projet passé,
il se portera candidat et sera élu premier député de la circonscription
fédérale de Saint-Jean.
L’auto-détermination comme facteur du dynamisme de Dorchester. Les années qui suivirent la
Rébellion se sont donc avérées plutôt calmes. Tout de même. Le gouvernement
décide de redresser le vieux fort. Les forces pro-gouvernementales ont eu très
chaud au cours de ces deux hivers de 37-38:
«
Au printemps de 1839, tout le monde parlait à
Saint-Jean du grand projet qui devait faire du fort un important établissement
militaire capable de contrer les activités révolutionnaires dans la vallée du
Richelieu et le Bas-Canada. Les travaux commencèrent au début de juin et se
poursuivirent sans relâche jusqu’au 1er décembre. Au coût de £ 17.231 livres
sterling, sous la direction du colonel K. H. Oldfield et du major R.-E. Roster,
on construisit alors un hôpital de 90 lits et des casernes pouvant abriter
jusqu’à 30 officiers, 12 sergents et 800 hommes. Les principaux bâtiments
construits à cette époque entourent aujourd’hui l’ancienne place d’armes du
Collège militaire. À cet endroit, seul l’édifice réservé à l’administration est
de construction récente (1937). Comme ces constructions ne comportaient aucun
ouvrage de défense, un autre projet fut présenté dès 1840 par le
lieutenant-énéral R.-D. Jackson. Des changements de gouvernement améliorèrent
toutefois les relations entre l’Angleterre et les États-Unis et on renonça à
aller plus loin. De 1839 à 1867, ces casernes furent occupées par des troupes
de l’armée impériale et, de 1867 à 1870, par le Royal Canadian Rifle Regiment».
En 1845, le canal de Chambly est complété. Le chemin de fer supplé
efficacement au trafic du Chemin Saint-Jean. Business
as usual. Deux aspects importants marquent l’âge de croissance. Le premier est d’ordre économique : le
déplacement du pôle d’attraction des activités militaires à l’activité
commerciale. Ce ne sont pas les éternels hauts et bas du fort Saint-Jean qui
ont permis le développement de notre ville, mais les trains de bois sur le
Richelieu, l’industrie navale en temps de guerre, les transits de grains sur le
pont Jones, le travail des premiers artisans pour ériger les maisons, les
commerces, les entrepôts, les hôtels, les églises… Les soldats barricadés dans
leurs forts ne pouvaient s’établir comme colons permanents. Les hommes
d’affaires peuvent attirer les colons en leur promettant des retombées de leurs
activités. Entre Montréal et New York, il y avait sûrement beaucoup à tirer du
site de Saint-Jean. Les habitants le réalisèrent assez vite. D’où cette
démarche qui visait à puiser des ressources locales les moyens de
développement. De toutes les ressources et par tous les moyens. Tant que les
résidents de Saint-Jean investiront dans la croissance de leur milieu, toutes
les activités sociales en bénéficieront. Mais pour parvenir à la réalisation de cet élan de croissance, un deuxième aspect doit être pris en compte : la solution du problème ethnique. La symbiose rapide entre anglophones et francophones. Dorchester : ville anglaise prématurée; Saint-Jean-l’Évangéliste : paroisse française attardée. Comme une frontière artificiellement comblée entre l’arrière-pays des cultivateurs et la cité des commerçants. Entre l’avance trop rapide de l’une et le retard appuyé de l’autre, une incongruité qui se manifeste à travers les Troubles de 1837-1838 et ne sera résolue que dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque ville et paroisse finiront par se superposer aux bénéfices des uns et des autres, mais surtout des autres… les francophones. Cette dynamique est là au moins pour
un siècle, et c’est grâce à elle que Saint-Jean va pouvoir enfin entrer en son
Siècle d’Or, l’Âge de Prestige.

 «Des chantiers de Saint-Jean, dirigés par les
capitaines Douglas et Pringle de la Royal Navy, sortirent entre autres, le Maria,
de 328 tonneaux, armé de 12 pièces de 6, l'Inflexible, de 189 tonneaux,
armé pour sa part de 18 pièces de 12 et le Thunderer, un ketch muni de
16 pièces. Un peu plus tard viendra aussi s'ajouter le Royal George, un
vaisseau qu'on arma de pas moins de 20 canons. À la fin de septembre, en plus
de ces vaisseaux, Carleton pouvait compter sur une soixantaine de bateaux à
fond plat, 34 canonnières, 6 gondoles armées (prises aux rebelles) et 25 autres
embarcations destinées au transport des troupes».[1]
À l'exception du Royal George (terminé au début de 1777 seulement),
cette flotte commandée par le capitaine Pringle quitta Saint-Jean au début
d'octobre et alla vaincre la flotte américaine constituée pourtant d'une
quinzaine de vaisseaux armés de 94 pièces dont le Royal Savage, capturé
l'automne précédent devant le fort Saint-Jean. C'était une défaite définitive,
car plus jamais les rebelles américains ne menaceront la vallée du Richelieu.
Malgré tout, il n'y eut pas un moment où la garnison du fort Saint-Jean ne
relâcha le guêt. Le chantier naval poursuivait régulièrement sa production de vaisseaux
pour alimenter la flotte britannique du lac Champlain. Les charpentiers
travaillaient également aux ouvrages de défense du fort Saint-Jean. En 1778, le
gouverneur Haldimand assigna £ 24 000 aux constructions du fort qui se
poursuivirent jusqu'en 1783, c'est-à-dire à la signature de la paix entre
l'Angleterre et les nouveaux États-Unis d'Amérique.
«Des chantiers de Saint-Jean, dirigés par les
capitaines Douglas et Pringle de la Royal Navy, sortirent entre autres, le Maria,
de 328 tonneaux, armé de 12 pièces de 6, l'Inflexible, de 189 tonneaux,
armé pour sa part de 18 pièces de 12 et le Thunderer, un ketch muni de
16 pièces. Un peu plus tard viendra aussi s'ajouter le Royal George, un
vaisseau qu'on arma de pas moins de 20 canons. À la fin de septembre, en plus
de ces vaisseaux, Carleton pouvait compter sur une soixantaine de bateaux à
fond plat, 34 canonnières, 6 gondoles armées (prises aux rebelles) et 25 autres
embarcations destinées au transport des troupes».[1]
À l'exception du Royal George (terminé au début de 1777 seulement),
cette flotte commandée par le capitaine Pringle quitta Saint-Jean au début
d'octobre et alla vaincre la flotte américaine constituée pourtant d'une
quinzaine de vaisseaux armés de 94 pièces dont le Royal Savage, capturé
l'automne précédent devant le fort Saint-Jean. C'était une défaite définitive,
car plus jamais les rebelles américains ne menaceront la vallée du Richelieu.
Malgré tout, il n'y eut pas un moment où la garnison du fort Saint-Jean ne
relâcha le guêt. Le chantier naval poursuivait régulièrement sa production de vaisseaux
pour alimenter la flotte britannique du lac Champlain. Les charpentiers
travaillaient également aux ouvrages de défense du fort Saint-Jean. En 1778, le
gouverneur Haldimand assigna £ 24 000 aux constructions du fort qui se
poursuivirent jusqu'en 1783, c'est-à-dire à la signature de la paix entre
l'Angleterre et les nouveaux États-Unis d'Amérique. population originale, ils
apportaient 213 habitants formés d'un contingent de 40 célibataires, jeunes
gens pour la plupart, et un autre de 37 familles : «L’état civil des
nouveaux immigrés pouvait se répartir à peu près comme suit : 38 journaliers, 6
marchands; et des gens de métiers au nombre de 26 dont un orfèvre et 2
bateliers. Au service public on trouve 2 maîtres d’école, 2 employés aux
Casernes et un aux Douanes».[3]
Deux familles d’origine américaine - Charles Greshon (au lieu de Grageon) et
les deux Robinson, appelés dans l’expertise de 1770, Robertson - résidaient
déjà dans la région de Saint-Jean quand le cortège des Loyalistes vint s’y
établir. Tous étaient de bien pauvres gens, dépourvus de leur fortune par les
rebelles et figurant longtemps à la charge de l’assistance publique. Une
agglomération naissait, davantage marquée par sa physionomie anglaise bien que
le plat-pays était développé par des cultivateurs francophones : «D’ailleurs
les loyalistes disparaissent rapidement». Mais certains d’entre eux
s’établirent à demeure auprès du fort. John Richardson établit le premier
magasin général et Ephraïm Mott, le premier service de traversiers entre les
deux rives jusqu’alors non reliées.
population originale, ils
apportaient 213 habitants formés d'un contingent de 40 célibataires, jeunes
gens pour la plupart, et un autre de 37 familles : «L’état civil des
nouveaux immigrés pouvait se répartir à peu près comme suit : 38 journaliers, 6
marchands; et des gens de métiers au nombre de 26 dont un orfèvre et 2
bateliers. Au service public on trouve 2 maîtres d’école, 2 employés aux
Casernes et un aux Douanes».[3]
Deux familles d’origine américaine - Charles Greshon (au lieu de Grageon) et
les deux Robinson, appelés dans l’expertise de 1770, Robertson - résidaient
déjà dans la région de Saint-Jean quand le cortège des Loyalistes vint s’y
établir. Tous étaient de bien pauvres gens, dépourvus de leur fortune par les
rebelles et figurant longtemps à la charge de l’assistance publique. Une
agglomération naissait, davantage marquée par sa physionomie anglaise bien que
le plat-pays était développé par des cultivateurs francophones : «D’ailleurs
les loyalistes disparaissent rapidement». Mais certains d’entre eux
s’établirent à demeure auprès du fort. John Richardson établit le premier
magasin général et Ephraïm Mott, le premier service de traversiers entre les
deux rives jusqu’alors non reliées. décembre 1796, Ira Allen, du Vermont, se rendit en France sous
prétexte d’acheter une grande quantité d’armes ostensiblement destinées aux
milices volontaires. Le produit de la transaction comprenait 20 000 fusils,
plusieurs pièces d’artillerie, munitions et autres provisions de guerre, le
tout chargé à bord d’un navire appelé La branche d’Olivier (Oliver
Branch). Le navire fut capturé et la cour d’amirauté déclara la saisie
valable. Au même moment, un certain David McLane, d’origine irlandaise, aurait
servi d’agent de liaison pour Adet en vue de sonder la population francophone
du Canada. L’arrestation, puis le procès de McLane montra qu’il avait bénéficié
de la complicité de certains habitants de Saint-Jean, dont le plus important,
du nom de Charles Frichet (ou plutôt Fréchette), lui aurait servi de guide dans
ses déplacements. Ce menuisier qu’on disait illettré avait un frère curé à Belœil.
En fait, il aurait également servi d’intermédiaire afin de soudoyer un député
de Québec à l’Assemblée législative du nom de Black. Contrairement à McLane qui
fut exécuté, Fréchette échappa à la mort mais vit ses biens confisqués. Afin
d’éviter que le commerce d’armes transite par Saint-Jean ou d’autres points de
la frontière, le président américain, John Adams, qui venait de signer un
accord commercial avec l’Angleterre, cella la frontière et mit fin aux
intrigues frontalières en forçant Adet à cesser ses intrigues. Plus tard,
Jérôme Bonaparte, le frère du Premier Consul, Napoléon, arriva à New York en
1803 et se dirigea vers Albany, puis vers le lac Champlain. Aussitôt, la
paranoïa s’empara des Anglais de Montréal : «Ne vient-il pas sonder le
terrain en vue d’une tentative d’invasion?». Jérôme Bonaparte était venu se
marier, et plus tard on le retrouvera roi de Westphalie.
décembre 1796, Ira Allen, du Vermont, se rendit en France sous
prétexte d’acheter une grande quantité d’armes ostensiblement destinées aux
milices volontaires. Le produit de la transaction comprenait 20 000 fusils,
plusieurs pièces d’artillerie, munitions et autres provisions de guerre, le
tout chargé à bord d’un navire appelé La branche d’Olivier (Oliver
Branch). Le navire fut capturé et la cour d’amirauté déclara la saisie
valable. Au même moment, un certain David McLane, d’origine irlandaise, aurait
servi d’agent de liaison pour Adet en vue de sonder la population francophone
du Canada. L’arrestation, puis le procès de McLane montra qu’il avait bénéficié
de la complicité de certains habitants de Saint-Jean, dont le plus important,
du nom de Charles Frichet (ou plutôt Fréchette), lui aurait servi de guide dans
ses déplacements. Ce menuisier qu’on disait illettré avait un frère curé à Belœil.
En fait, il aurait également servi d’intermédiaire afin de soudoyer un député
de Québec à l’Assemblée législative du nom de Black. Contrairement à McLane qui
fut exécuté, Fréchette échappa à la mort mais vit ses biens confisqués. Afin
d’éviter que le commerce d’armes transite par Saint-Jean ou d’autres points de
la frontière, le président américain, John Adams, qui venait de signer un
accord commercial avec l’Angleterre, cella la frontière et mit fin aux
intrigues frontalières en forçant Adet à cesser ses intrigues. Plus tard,
Jérôme Bonaparte, le frère du Premier Consul, Napoléon, arriva à New York en
1803 et se dirigea vers Albany, puis vers le lac Champlain. Aussitôt, la
paranoïa s’empara des Anglais de Montréal : «Ne vient-il pas sonder le
terrain en vue d’une tentative d’invasion?». Jérôme Bonaparte était venu se
marier, et plus tard on le retrouvera roi de Westphalie.  Les terres loties par l'arpenteur Simon Z. Watson déterminaient le site
originel de la Ville de Saint-Jean. La première rue ouverte se nomme Front
(Richelieu). Vient ensuite le nom de la rue Mc Cumming (Champlain), qui porte
le nom d'un ancien soldat et marchand établi sur la rue Richelieu avant 1791;
la rue James (devenue Saint-Jacques, évidemment); la rue Charles
(Saint-Charles); la rue Water (la Place du Quai) et la rue Partition
(Saint-Georges). En 1804, le seigneur Grant impose à la localité le nom de
Dorchester en l’honneur du titre accordé à l’ex-gouverneur Carleton. Les
citoyens francophones continueront d'utiliser l'ancien nom de Saint-Jean.
Les terres loties par l'arpenteur Simon Z. Watson déterminaient le site
originel de la Ville de Saint-Jean. La première rue ouverte se nomme Front
(Richelieu). Vient ensuite le nom de la rue Mc Cumming (Champlain), qui porte
le nom d'un ancien soldat et marchand établi sur la rue Richelieu avant 1791;
la rue James (devenue Saint-Jacques, évidemment); la rue Charles
(Saint-Charles); la rue Water (la Place du Quai) et la rue Partition
(Saint-Georges). En 1804, le seigneur Grant impose à la localité le nom de
Dorchester en l’honneur du titre accordé à l’ex-gouverneur Carleton. Les
citoyens francophones continueront d'utiliser l'ancien nom de Saint-Jean. travers de la route». Les deux meilleures auberges étant
pleines, il obtient un lit dans une troisième, «encore n’y trouvâmes-nous,
écrit-il, que deux lits vaquants dans une chambre où un étranger en occupait
déjà un». Le lendemain, 11 octobre, arrive au fort le premier visiteur
royal de Saint-Jean, le prince Edward, duc de Kent, fils de George III et
futur père de la reine Victoria, qui commande alors les troupes anglaises au
Canada. Reçu par les officiers de la garnison, il invite M. de Saint-Mesmin à
dîner à son côté et fait avec lui la conversation en un français absolument
parfait.[7]
En 1795, c’est au tour d’un voyageur anglais, Isaac Weld, de passer par chez
nous : «Le visiteur de 1795, Isaac Weld, parle de Saint-Jean en termes peu
flatteurs : un amas sans ordre d’une centaine de misérables maisons. Les
censitaires français de la Baronie de Longueuil établis le long de l’eau avaient
dû vendre leurs terres à Hazen ou Christie, pour aller s’établir vers l’ouest
ou dans les seigneuries voisines».[8]
Ces maisons devaient être celles des Loyalistes.
travers de la route». Les deux meilleures auberges étant
pleines, il obtient un lit dans une troisième, «encore n’y trouvâmes-nous,
écrit-il, que deux lits vaquants dans une chambre où un étranger en occupait
déjà un». Le lendemain, 11 octobre, arrive au fort le premier visiteur
royal de Saint-Jean, le prince Edward, duc de Kent, fils de George III et
futur père de la reine Victoria, qui commande alors les troupes anglaises au
Canada. Reçu par les officiers de la garnison, il invite M. de Saint-Mesmin à
dîner à son côté et fait avec lui la conversation en un français absolument
parfait.[7]
En 1795, c’est au tour d’un voyageur anglais, Isaac Weld, de passer par chez
nous : «Le visiteur de 1795, Isaac Weld, parle de Saint-Jean en termes peu
flatteurs : un amas sans ordre d’une centaine de misérables maisons. Les
censitaires français de la Baronie de Longueuil établis le long de l’eau avaient
dû vendre leurs terres à Hazen ou Christie, pour aller s’établir vers l’ouest
ou dans les seigneuries voisines».[8]
Ces maisons devaient être celles des Loyalistes. «Saint-Jean
contient environ cent misérables maisons de bois, et des casernes dans
lesquelles est logée toute la garnison. Les fortifications sont en si mauvais
état qu’il en coûterait moins pour élever de nouveaux ouvrages que pour réparer
les anciens. Il y a dans ce lieu un chantier royal, rempli de bois de
construction, ou qui du moins l’était quand nous passâmes; mais dans le cours
de l’été suivant, quand le brick dont j’ai fait mention, fut désarmé, tout ce
bois fut vendu. Les vieilles carcasses de plusieurs bâtiments considérables se
trouvaient à l’opposite du chantier. La ville de Saint-Jean étant le port des Anglais
sur le lac Champlain doit s’augmenter en raison de l’accroissement du commerce
entre New York et le Canada. Le pays des environs est plat et très dégarni
d’arbres, un incendie affreux ayant en 1788 détruit les forêts, à la distance
de plusieurs milles. Le manque de bois de chauffage fait extrêmement souffrir
les habitants de quelques cantons voisins…»[10]
En 1787, on l’a vu, un poste de douanes est établi au sein même du fort. Ville
parcourue par des voyageurs de passage, constituée de militaires et de débardeurs
du port, Dorchester devint un lieu propice aux vices et aux rixes entre mauvais
garçons.
«Saint-Jean
contient environ cent misérables maisons de bois, et des casernes dans
lesquelles est logée toute la garnison. Les fortifications sont en si mauvais
état qu’il en coûterait moins pour élever de nouveaux ouvrages que pour réparer
les anciens. Il y a dans ce lieu un chantier royal, rempli de bois de
construction, ou qui du moins l’était quand nous passâmes; mais dans le cours
de l’été suivant, quand le brick dont j’ai fait mention, fut désarmé, tout ce
bois fut vendu. Les vieilles carcasses de plusieurs bâtiments considérables se
trouvaient à l’opposite du chantier. La ville de Saint-Jean étant le port des Anglais
sur le lac Champlain doit s’augmenter en raison de l’accroissement du commerce
entre New York et le Canada. Le pays des environs est plat et très dégarni
d’arbres, un incendie affreux ayant en 1788 détruit les forêts, à la distance
de plusieurs milles. Le manque de bois de chauffage fait extrêmement souffrir
les habitants de quelques cantons voisins…»[10]
En 1787, on l’a vu, un poste de douanes est établi au sein même du fort. Ville
parcourue par des voyageurs de passage, constituée de militaires et de débardeurs
du port, Dorchester devint un lieu propice aux vices et aux rixes entre mauvais
garçons. la ville de Dorchester et le Fort de Saint-Jean. Dorchester mérite à peine le nom de ville, contenant tout au plus 80 maisons, dont plusieurs servent de magasins. Mais probablement, sous peu d’années, il deviendra plus important: étant situé assez favorablement pour devenir entre les deux pays, tant en été qu’en hiver, l’entrepôt des marchandises qui y passent par terre ou par eau. Pendant l’hiver, il y a une communication très active, par le moyen des traîneaux qui voyagent sur la surface gelée des lacs et des rivières.
 comté de Kent et ce jusqu'en 1830, puis au comté de Huntingdon.
De 1830 à 1854, la municipalité est rattachée au comté de Chambly et, de 1854 à
1867, au nouveau comté de Saint-Jean. Au plan judiciaire, la ville fait partie
du district de Montréal entre 1760 et 1857. À l’époque, ce sont des juridictions
administratives et politiques à la fois vastes et vagues. Deux députés
représentent le comté à l’Assemblée législative du Bas-Canada : René Boileau et
Pierre Legras-Pierreville, premiers députés du comté de Kent de 1792 à 1796,
puis Antoine Mesnard Lafontaine (de 1796 à 1804), Jacques Viger (de 1796 à sa
mort en 1798), Michel Amable Berthelot d’Artigny (de 1798 à 1800), François
Viger (de 1800 à 1808), Pierre Weilbrenner (de 1804 à 1808), Joseph Planté (de
1808 à 1809), le jeune tribun Louis-Joseph Papineau (de 1814 à 1816), Noël Breux
(de 1814 à 1816), Denis-Benjamin Viger (de 1816 à 1830), Pierre Bruneau (de
comté de Kent et ce jusqu'en 1830, puis au comté de Huntingdon.
De 1830 à 1854, la municipalité est rattachée au comté de Chambly et, de 1854 à
1867, au nouveau comté de Saint-Jean. Au plan judiciaire, la ville fait partie
du district de Montréal entre 1760 et 1857. À l’époque, ce sont des juridictions
administratives et politiques à la fois vastes et vagues. Deux députés
représentent le comté à l’Assemblée législative du Bas-Canada : René Boileau et
Pierre Legras-Pierreville, premiers députés du comté de Kent de 1792 à 1796,
puis Antoine Mesnard Lafontaine (de 1796 à 1804), Jacques Viger (de 1796 à sa
mort en 1798), Michel Amable Berthelot d’Artigny (de 1798 à 1800), François
Viger (de 1800 à 1808), Pierre Weilbrenner (de 1804 à 1808), Joseph Planté (de
1808 à 1809), le jeune tribun Louis-Joseph Papineau (de 1814 à 1816), Noël Breux
(de 1814 à 1816), Denis-Benjamin Viger (de 1816 à 1830), Pierre Bruneau (de
 1816 à sa mort, 1820) et Frédéric Auguste Quesnel (de 1820 à 1830). Les petits
villages se fondent et se développent dans les environs, mais le peuplement des
régions rurales francophones, par le taux de natalité, entraîne une loi de
refonte de la carte électorale en 1829 qui crée 3 nouveaux comtés portant les
noms de L’Acadie, Chambly et Rouville. Avec la réforme de la carte électorale,
les villes de Saint-Jean, Saint-Luc et L’Acadie se trouvent désormais comprises
dans le comté de Chambly, tandis que les villages situés plus au sud-ouest se
retrouvent dans le comté de l’Acadie. Dorchester est donc située à la frontière
des deux comtés. Frédéric Auguste Quesnel est député du comté de Chambly de
1830 à 1834, Louis-Michel Viger, de 1830 à 1838 et Louis Lacoste de 1834 à
1838. Robert Hoyle et François Languedoc sont les premiers députés du comté de
L’Acadie de 1830 à 1834, suivis de Cyrille-Hector-Octave Côté et Merritt
Hotchkiss de 1834 à 1838.
1816 à sa mort, 1820) et Frédéric Auguste Quesnel (de 1820 à 1830). Les petits
villages se fondent et se développent dans les environs, mais le peuplement des
régions rurales francophones, par le taux de natalité, entraîne une loi de
refonte de la carte électorale en 1829 qui crée 3 nouveaux comtés portant les
noms de L’Acadie, Chambly et Rouville. Avec la réforme de la carte électorale,
les villes de Saint-Jean, Saint-Luc et L’Acadie se trouvent désormais comprises
dans le comté de Chambly, tandis que les villages situés plus au sud-ouest se
retrouvent dans le comté de l’Acadie. Dorchester est donc située à la frontière
des deux comtés. Frédéric Auguste Quesnel est député du comté de Chambly de
1830 à 1834, Louis-Michel Viger, de 1830 à 1838 et Louis Lacoste de 1834 à
1838. Robert Hoyle et François Languedoc sont les premiers députés du comté de
L’Acadie de 1830 à 1834, suivis de Cyrille-Hector-Octave Côté et Merritt
Hotchkiss de 1834 à 1838. nuit du 19 au 20 novembre lorsque, installés à Lacolle avec une troupe de 300
autochtones, ils sont attaqués par surprise par une troupe de réguliers
américains, avant-garde de l'armée de Dearborn. À la faveur de la nuit, les
Américains se méprennent et tardent à s’apercevoir qu’ils s’entre-tuent. Ils
battent finalement en retraite. À son retour, de Salaberry fait embarrasser la
route de troncs d’arbres.[17]
Les batailles navales se déroulent essentiellement au lac Champlain et ne
remontent jamais aussi bas dans le Richelieu. Au printemps de 1814, alors que
la division américaine du général Wilkinson menace d’envahir à nouveau le
Canada, 750 hommes logent aux casernes. Ils font partis du 19e Light Dragoons,
du 13 et 49e Régiments et des Voltigeurs. Ce sont ces troupes qui, le 30 mars,
se portent à Lacolle pour arrêter la marche de l’ennemi en centrant la
résistance autour du moulin de l’endroit. La dernière tentative d’envahir le
Canada par la vallée du Richelieu se solde par un échec. Le gouverneur Prevost
tentera bien d’organiser des forces réunies à Saint-Jean en vue de marcher sur
Plattsburg, mais - comme Burgoyne en 1776, «pauvre homme de guerre» -, il
échouera complètement dans son entreprise.
nuit du 19 au 20 novembre lorsque, installés à Lacolle avec une troupe de 300
autochtones, ils sont attaqués par surprise par une troupe de réguliers
américains, avant-garde de l'armée de Dearborn. À la faveur de la nuit, les
Américains se méprennent et tardent à s’apercevoir qu’ils s’entre-tuent. Ils
battent finalement en retraite. À son retour, de Salaberry fait embarrasser la
route de troncs d’arbres.[17]
Les batailles navales se déroulent essentiellement au lac Champlain et ne
remontent jamais aussi bas dans le Richelieu. Au printemps de 1814, alors que
la division américaine du général Wilkinson menace d’envahir à nouveau le
Canada, 750 hommes logent aux casernes. Ils font partis du 19e Light Dragoons,
du 13 et 49e Régiments et des Voltigeurs. Ce sont ces troupes qui, le 30 mars,
se portent à Lacolle pour arrêter la marche de l’ennemi en centrant la
résistance autour du moulin de l’endroit. La dernière tentative d’envahir le
Canada par la vallée du Richelieu se solde par un échec. Le gouverneur Prevost
tentera bien d’organiser des forces réunies à Saint-Jean en vue de marcher sur
Plattsburg, mais - comme Burgoyne en 1776, «pauvre homme de guerre» -, il
échouera complètement dans son entreprise. recueillir des fonds pour la
construction d’un temple. Le 22 juillet, après une bonne collecte, on put poser
la pierre angulaire, et le 19 janvier 1817, le révérend Townsend de
Clarenceville y célébra le premier service divin suivant le rite de l’Église
d’Angleterre. Peu après, le révérend W.-D. Baldwyn accepta le poste de
clergyman et une requête fut adressée au gouverneur afin d’obtenir un bâtiment
hors d’usage qui appartenait aux Casernes. «On ne sait si la requête fut
acceptée ou si le Rectory actuel fut alors construit et habité». Quoi qu’il
en soit, le 10 mai 1822, des lettres patentes de Sa Majesté George IV donnent
comme territoire toute l’étendue seigneuriale de Longueuil sous le vocable de «Parsonage
and Rectory of the Parish Church of St John», et le Révérend William
Devereux Baldwyn est confirmé dans son titre.
recueillir des fonds pour la
construction d’un temple. Le 22 juillet, après une bonne collecte, on put poser
la pierre angulaire, et le 19 janvier 1817, le révérend Townsend de
Clarenceville y célébra le premier service divin suivant le rite de l’Église
d’Angleterre. Peu après, le révérend W.-D. Baldwyn accepta le poste de
clergyman et une requête fut adressée au gouverneur afin d’obtenir un bâtiment
hors d’usage qui appartenait aux Casernes. «On ne sait si la requête fut
acceptée ou si le Rectory actuel fut alors construit et habité». Quoi qu’il
en soit, le 10 mai 1822, des lettres patentes de Sa Majesté George IV donnent
comme territoire toute l’étendue seigneuriale de Longueuil sous le vocable de «Parsonage
and Rectory of the Parish Church of St John», et le Révérend William
Devereux Baldwyn est confirmé dans son titre. s’engagent à bâtir une
église avec sacristie et un presbytère avec une salle d’école. Mgr Bernard-Claude Panet, évêque de Québec, sous ces conditions, accepte d'ériger la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste. Commence alors
une longue correspondance entre Gabriel Marchand et les autorités civiles et
religieuses dans le but d’ériger la paroisse. Elle ne se terminera que le 21
décembre 1827, date de l’élection des syndics. Marchand
entreprend donc la démarche auprès de Thomas Busby, agent de la baronne,
afin d’acheter le terrain pour y ériger les bâtiments religieux. C’est par sa
fortune amassée dans le commerce du bois plutôt que par les collectes d’argent
péniblement amassées que va s’édifier la paroisse Saint-Jean l’Évangéliste.
Cette première paroisse Saint-Jean «commencera chez Louis Fréchette, où le
chemin de la Prairie laisse la Rivière Richelieu, et s’étendra jusqu’à la
Pointe-à-la-Mule, et que l’on comprendra dans la Paroisse le Rang-de-Bernier ou
Petite Acadie, ensemble formant un nombre de deux cents habitants au moins».[22]
Gabriel Marchand obtient ainsi les lots 99, 100, 106 et 107 mesurant 144 pieds
de longueur par 288 de largeur, bornés de face par Busby Street (aujourd’hui
Jacques-Cartier), à l’arrière par une autre rue (Longueuil), au sud par James
Street (Saint-Jacques) et au nord par les lots 101 et 107, avec paiement d’un
cens de rente annuel de 3" (le signe sur le document est douteux).
s’engagent à bâtir une
église avec sacristie et un presbytère avec une salle d’école. Mgr Bernard-Claude Panet, évêque de Québec, sous ces conditions, accepte d'ériger la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste. Commence alors
une longue correspondance entre Gabriel Marchand et les autorités civiles et
religieuses dans le but d’ériger la paroisse. Elle ne se terminera que le 21
décembre 1827, date de l’élection des syndics. Marchand
entreprend donc la démarche auprès de Thomas Busby, agent de la baronne,
afin d’acheter le terrain pour y ériger les bâtiments religieux. C’est par sa
fortune amassée dans le commerce du bois plutôt que par les collectes d’argent
péniblement amassées que va s’édifier la paroisse Saint-Jean l’Évangéliste.
Cette première paroisse Saint-Jean «commencera chez Louis Fréchette, où le
chemin de la Prairie laisse la Rivière Richelieu, et s’étendra jusqu’à la
Pointe-à-la-Mule, et que l’on comprendra dans la Paroisse le Rang-de-Bernier ou
Petite Acadie, ensemble formant un nombre de deux cents habitants au moins».[22]
Gabriel Marchand obtient ainsi les lots 99, 100, 106 et 107 mesurant 144 pieds
de longueur par 288 de largeur, bornés de face par Busby Street (aujourd’hui
Jacques-Cartier), à l’arrière par une autre rue (Longueuil), au sud par James
Street (Saint-Jacques) et au nord par les lots 101 et 107, avec paiement d’un
cens de rente annuel de 3" (le signe sur le document est douteux). la bougeotte, M. Rémi Gaulin est reconnu pour ne pas tenir à la même place plus
que 2 ou 3 années. Il prendra donc sa cure le 21 octobre 1828 et se présentera
à ses fidèles comme sachant parfaitement l’anglais et prêchant avec
grâce et dignité. Gaulin, en effet, avait été curé un peu partout, aussi
bien en Ontario qu’au Québec et dans les provinces maritimes auprès des
Acadiens. En 1822, il était curé de Saint-Luc et connaissait donc bien les
paroissiens de Saint-Jean qu’il dessert, couvrant également les deux rives du
Richelieu (à l’est jusqu’à la savane de Farnham) et au sud jusqu’à la
frontière américaine. Il restera 3 ans à la cure de la nouvelle paroisse de
Saint-Jean avant d’aller s’installer à Sainte-Scholastique, puis au
Sault-au-Récollet. Il sera nommé par après évêque-auxiliaire de Kingston en
1833 avant de redevenir simple curé à L’Assomption jusqu’à sa mort, le 8 mai
1857. À son arrivée à Saint-Jean, aucun faste ne semble l’avoir accueilli. Son
premier acte d’administration est la bénédiction de l’église, le 6 novembre
1828, sous le vocable de Saint-Jean-l’Évangéliste, ce qui donne occasion à de
vives réjouissances. Le 4 juin 1829, Mgr Lartigue vient faire sa première
visite pastorale. Il y décrète l’élection annuelle des marguilliers. Le curé Gaulin s’affaire, lui, à baptiser, à marier, à recevoir des abjurations de
protestants anglophones qui deviennent des néophytes appréciables. Puis, le
temps vient où il faut penser à construire le presbytère et ériger un cimetière
catholique
la bougeotte, M. Rémi Gaulin est reconnu pour ne pas tenir à la même place plus
que 2 ou 3 années. Il prendra donc sa cure le 21 octobre 1828 et se présentera
à ses fidèles comme sachant parfaitement l’anglais et prêchant avec
grâce et dignité. Gaulin, en effet, avait été curé un peu partout, aussi
bien en Ontario qu’au Québec et dans les provinces maritimes auprès des
Acadiens. En 1822, il était curé de Saint-Luc et connaissait donc bien les
paroissiens de Saint-Jean qu’il dessert, couvrant également les deux rives du
Richelieu (à l’est jusqu’à la savane de Farnham) et au sud jusqu’à la
frontière américaine. Il restera 3 ans à la cure de la nouvelle paroisse de
Saint-Jean avant d’aller s’installer à Sainte-Scholastique, puis au
Sault-au-Récollet. Il sera nommé par après évêque-auxiliaire de Kingston en
1833 avant de redevenir simple curé à L’Assomption jusqu’à sa mort, le 8 mai
1857. À son arrivée à Saint-Jean, aucun faste ne semble l’avoir accueilli. Son
premier acte d’administration est la bénédiction de l’église, le 6 novembre
1828, sous le vocable de Saint-Jean-l’Évangéliste, ce qui donne occasion à de
vives réjouissances. Le 4 juin 1829, Mgr Lartigue vient faire sa première
visite pastorale. Il y décrète l’élection annuelle des marguilliers. Le curé Gaulin s’affaire, lui, à baptiser, à marier, à recevoir des abjurations de
protestants anglophones qui deviennent des néophytes appréciables. Puis, le
temps vient où il faut penser à construire le presbytère et ériger un cimetière
catholique  Joseph-Édouard Morissette qui, lui, restera jusqu’à sa mort en 1844. M.
Morrissette s’occupe des âmes tandis que M. Marchand s’occupe des finances de
la Fabrique. Les recettes de 1832 se chiffrent à £ 1 047.104½, les dépenses
sont de £ 1 371. La balance de la paroisse est donc déficitaire de £ 323. Cela
n’empêche pas de poursuivre les travaux sur le bâtiment. En 1832, on termine la
voûte passée au blanc de céruse, en décembre 1833 on construit des autels
latéraux ainsi que des armoires pour les enfants de chœur et, à la fin du mois,
on achète un poèle que l’on installe pour chauffer l’église. Un menuisier et
sculpteur du Sault-au-Récollet, Pierre Salomon Marquette, entreprend en 1834 la
construction du jubé avec retrait en gradins pour l’orgue et les chantres,
ainsi que de la chaire et du banc d’œuvre. Ce travail coûte à lui seul £ 5 000 et
ne sera entièrement payé qu’en 1840. C’était une église qui n’avait pas encore
été affectée par la grandeur monumentale des édifices néo-gothiques (Notre-Dame
de Montréal, Varennes, etc.) qui seront la marque de la mégalomanie de Mgr
Bourget lorsqu’il sera évêque du diocèse de Montréal. En 1923, la restauration
intérieure et la transformation de la façade extérieure de l'église seront
entreprises culminant, le jour de l'inauguration des travaux le 23 novembre
1924, par la bénédiction de cinq nouvelles cloches. À la fondation du diocèse,
l'église prendra le titre de cathédrale par le sacre de Mgr Anastase Forget, le
29 juin 1934, premier évêque du nouveau diocèse de Saint-Jean.
Joseph-Édouard Morissette qui, lui, restera jusqu’à sa mort en 1844. M.
Morrissette s’occupe des âmes tandis que M. Marchand s’occupe des finances de
la Fabrique. Les recettes de 1832 se chiffrent à £ 1 047.104½, les dépenses
sont de £ 1 371. La balance de la paroisse est donc déficitaire de £ 323. Cela
n’empêche pas de poursuivre les travaux sur le bâtiment. En 1832, on termine la
voûte passée au blanc de céruse, en décembre 1833 on construit des autels
latéraux ainsi que des armoires pour les enfants de chœur et, à la fin du mois,
on achète un poèle que l’on installe pour chauffer l’église. Un menuisier et
sculpteur du Sault-au-Récollet, Pierre Salomon Marquette, entreprend en 1834 la
construction du jubé avec retrait en gradins pour l’orgue et les chantres,
ainsi que de la chaire et du banc d’œuvre. Ce travail coûte à lui seul £ 5 000 et
ne sera entièrement payé qu’en 1840. C’était une église qui n’avait pas encore
été affectée par la grandeur monumentale des édifices néo-gothiques (Notre-Dame
de Montréal, Varennes, etc.) qui seront la marque de la mégalomanie de Mgr
Bourget lorsqu’il sera évêque du diocèse de Montréal. En 1923, la restauration
intérieure et la transformation de la façade extérieure de l'église seront
entreprises culminant, le jour de l'inauguration des travaux le 23 novembre
1924, par la bénédiction de cinq nouvelles cloches. À la fondation du diocèse,
l'église prendra le titre de cathédrale par le sacre de Mgr Anastase Forget, le
29 juin 1934, premier évêque du nouveau diocèse de Saint-Jean. une réduction de 50% du taux de péage. Quelle que
soit l’issue de cette demande, durant ses 90 années d’existence, les usagers
durent payer le passage. Jones n’entendait donc pas à rire avec les taux ni
avec les contraventions. Si les postillons et les militaires en service sont
exempt du taux de péage, il faut payer l’amende si on franchit le pont sans
payer ou si on commande à sa monture d’aller plus vite que le pas. De plus,
Jones détient un monopole qui met fin au service de traversier Mott &
Marchand. En revanche, le pont doit être inspecté et entretenu régulièrement
afin qu’«à la crue des eaux du Richelieu, il devait y avoir un espace d’au
moins six pieds entre les eaux et l’arche du pont-levis».[32]
une réduction de 50% du taux de péage. Quelle que
soit l’issue de cette demande, durant ses 90 années d’existence, les usagers
durent payer le passage. Jones n’entendait donc pas à rire avec les taux ni
avec les contraventions. Si les postillons et les militaires en service sont
exempt du taux de péage, il faut payer l’amende si on franchit le pont sans
payer ou si on commande à sa monture d’aller plus vite que le pas. De plus,
Jones détient un monopole qui met fin au service de traversier Mott &
Marchand. En revanche, le pont doit être inspecté et entretenu régulièrement
afin qu’«à la crue des eaux du Richelieu, il devait y avoir un espace d’au
moins six pieds entre les eaux et l’arche du pont-levis».[32] Montréal, George Moffat et surtout
Peter McGill (1789-1860), alors président de la Banque de Montréal, décide de
financer la construction d’une première voie ferrée entre Laprairie et
Saint-Jean. En 1832, une compagnie de 74 actionnaires - dont
Montréal, George Moffat et surtout
Peter McGill (1789-1860), alors président de la Banque de Montréal, décide de
financer la construction d’une première voie ferrée entre Laprairie et
Saint-Jean. En 1832, une compagnie de 74 actionnaires - dont  un seul est de
Dorchester, Jason C. Pierce, officier américain capturé lors de la guerre de
1812 et qui a décidé de demeurer dans la région -, est formée avec un capital
de £ 50,000, la Champlain and St Lawrence Railroad, dont le président
est Peter McGill. Elle s’engage à transporter les voyageurs à une vitesse inouïe
de 10 à 15 milles à l’heure sur des rails - encore en bois recouverts de
feuillards d’acier, avec un écartement de six pieds et six pouces, dit chemin
de fer à la lisse -, entre Laprairie et Saint-Jean. On fit alors venir
d’Angleterre une petite machine Stephenson :
un seul est de
Dorchester, Jason C. Pierce, officier américain capturé lors de la guerre de
1812 et qui a décidé de demeurer dans la région -, est formée avec un capital
de £ 50,000, la Champlain and St Lawrence Railroad, dont le président
est Peter McGill. Elle s’engage à transporter les voyageurs à une vitesse inouïe
de 10 à 15 milles à l’heure sur des rails - encore en bois recouverts de
feuillards d’acier, avec un écartement de six pieds et six pouces, dit chemin
de fer à la lisse -, entre Laprairie et Saint-Jean. On fit alors venir
d’Angleterre une petite machine Stephenson : Arrivée par New York, elle parvint sur une barge à
Saint-Jean. Elle fut baptisée la Dorchester, mais surnommée
affectueusement «kitten» (chaton) à cause de ses bonds et sursauts
intempestifs. Les wagons - de première classe avec 2 compartiments de 8
voyageurs et de deuxième avec 3 compartiments de 8 voyageurs - provenaient des
ateliers de mécanique appartenant à John Molson, ami de McGill. La première
voie ferrée du Canada, longue de 25,6 kilomètres, est complétée grâce à
l’habile ingénieur en chef William Casey et coûte en tout et pour tout £ 40 000
($ 160 000). Ce jeudi, 21 juillet 1836, tous les députés
Arrivée par New York, elle parvint sur une barge à
Saint-Jean. Elle fut baptisée la Dorchester, mais surnommée
affectueusement «kitten» (chaton) à cause de ses bonds et sursauts
intempestifs. Les wagons - de première classe avec 2 compartiments de 8
voyageurs et de deuxième avec 3 compartiments de 8 voyageurs - provenaient des
ateliers de mécanique appartenant à John Molson, ami de McGill. La première
voie ferrée du Canada, longue de 25,6 kilomètres, est complétée grâce à
l’habile ingénieur en chef William Casey et coûte en tout et pour tout £ 40 000
($ 160 000). Ce jeudi, 21 juillet 1836, tous les députés  résidant à Montréal, à
l’exception de deux, ont été invités à l’inauguration. D’après The Gazette, une
invitation a été envoyée à De Witt, de sorte qu’O’Callaghan restait le seul
député ostracisé pour ses tendances annexionnistes aux États-Unis. L’atmosphère
politique est lourde à la veille du déclenchement de la rébellion, aussi,
tient-on à oublier les querelles entre l’Assemblée et le Gouverneur pour
célébrer ce moment unique du premier voyage en train au Canada.
résidant à Montréal, à
l’exception de deux, ont été invités à l’inauguration. D’après The Gazette, une
invitation a été envoyée à De Witt, de sorte qu’O’Callaghan restait le seul
député ostracisé pour ses tendances annexionnistes aux États-Unis. L’atmosphère
politique est lourde à la veille du déclenchement de la rébellion, aussi,
tient-on à oublier les querelles entre l’Assemblée et le Gouverneur pour
célébrer ce moment unique du premier voyage en train au Canada. du fleuve dure 50 minutes et vogue au son de la fanfare du 15e
Régiment. Arrivé à Laprairie, tout le monde se masse autour de La Dorchester.
La locomotive est si frêle qu’on ne parvient qu’à lui attacher deux wagons
de première classe. Le directeur général Lindsay ferme la porte sur les 32
premiers passagers tandis que les autres sont invités à s’entasser dans dix
autres wagons tirés par des attelages de chevaux pendant les deux heures du
trajet. La moindre montée exige le renfort des chevaux. «On rapporte à ce
sujet un trait humoristique qui est peut-être une légende, mais assez
vraisemblable, rapporte le père Brosseau. L’ingénieur écossais de la minuscule
machine ne connaissait que la houille anglaise comme
du fleuve dure 50 minutes et vogue au son de la fanfare du 15e
Régiment. Arrivé à Laprairie, tout le monde se masse autour de La Dorchester.
La locomotive est si frêle qu’on ne parvient qu’à lui attacher deux wagons
de première classe. Le directeur général Lindsay ferme la porte sur les 32
premiers passagers tandis que les autres sont invités à s’entasser dans dix
autres wagons tirés par des attelages de chevaux pendant les deux heures du
trajet. La moindre montée exige le renfort des chevaux. «On rapporte à ce
sujet un trait humoristique qui est peut-être une légende, mais assez
vraisemblable, rapporte le père Brosseau. L’ingénieur écossais de la minuscule
machine ne connaissait que la houille anglaise comme 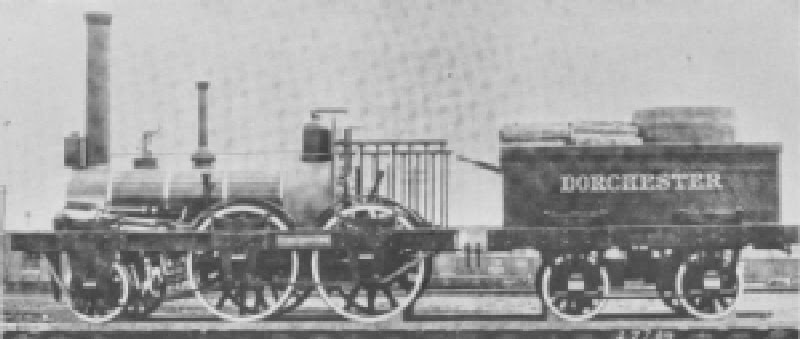 combustible. Or c’était un
aliment trop riche et trop lent à digérer pour le foyer de sa machine. Elle
s’était arrêtée, à bout de souffle, en montant une rampe, lorsqu’un habitant
vint à la rescousse chargé d’une brassée d’éclats de cèdre. “Tu ne sais pas
soigner ton cheval, l’ami; tu lui donnes trop d’avoine et pas assez de foin”.
La flamme avivée par ce nouvel aliment rendit des forces à l’essoufflée et
désormais l’Écossais chauffa son engin au bois».[35]
Cette légende est probablement issue des premiers essais peu concluants de la Dorchester.
combustible. Or c’était un
aliment trop riche et trop lent à digérer pour le foyer de sa machine. Elle
s’était arrêtée, à bout de souffle, en montant une rampe, lorsqu’un habitant
vint à la rescousse chargé d’une brassée d’éclats de cèdre. “Tu ne sais pas
soigner ton cheval, l’ami; tu lui donnes trop d’avoine et pas assez de foin”.
La flamme avivée par ce nouvel aliment rendit des forces à l’essoufflée et
désormais l’Écossais chauffa son engin au bois».[35]
Cette légende est probablement issue des premiers essais peu concluants de la Dorchester.  Saint-Jean à 1 h. 29,
les invités ne trouvent qu’un hangar vitement transformé en salle de banquet
pour les 500 convives qui font partie du voyage. Située au sud des rues Lemoine
et Busby (Frontenac et Mercier), ce bâtiment ne mesure que 40 pieds sur 100
pieds et sa construction avait débuté en 1835 pour ne se terminer qu’à la toute
veille de l’inauguration. La gare, bâti en bois lambrissé, est
élégamment décorée avec des branches de sapin et des drapeaux. On sert un
buffet froid mais le champagne coule à flots, ce qui a pour effet de rendre le
retour beaucoup plus animé. Peter McGill Jr, dirigeant les festivités, propose
2 toasts, l’un au roi d’Angleterre et l’autre au Président des États-Unis, tant
l’aide apportée par Jason C. Pierce fut précieuse. Discours auquel répond le
Gouverneur Gosford. William Lindsay présenta une médaille en or à l’ingénieur
en chef Casey de la part des chefs d’équipe pour son attitude loyale
envers eux et le cortège pris le chemin du retour vers 16 heures. «Le
Saint-Jean à 1 h. 29,
les invités ne trouvent qu’un hangar vitement transformé en salle de banquet
pour les 500 convives qui font partie du voyage. Située au sud des rues Lemoine
et Busby (Frontenac et Mercier), ce bâtiment ne mesure que 40 pieds sur 100
pieds et sa construction avait débuté en 1835 pour ne se terminer qu’à la toute
veille de l’inauguration. La gare, bâti en bois lambrissé, est
élégamment décorée avec des branches de sapin et des drapeaux. On sert un
buffet froid mais le champagne coule à flots, ce qui a pour effet de rendre le
retour beaucoup plus animé. Peter McGill Jr, dirigeant les festivités, propose
2 toasts, l’un au roi d’Angleterre et l’autre au Président des États-Unis, tant
l’aide apportée par Jason C. Pierce fut précieuse. Discours auquel répond le
Gouverneur Gosford. William Lindsay présenta une médaille en or à l’ingénieur
en chef Casey de la part des chefs d’équipe pour son attitude loyale
envers eux et le cortège pris le chemin du retour vers 16 heures. «Le  voyage
fut plus bruyant qu’à l’aller : on but et on chanta des chansons canadiennes.
La locomotive tirait cette fois-ci les quatre wagons à passagers et ne prit que
cinquante-neuf minutes[36]
à faire le trajet. Les autres voitures furent remorquées comme à l’aller par
des chevaux. Cependant, les invités durent coucher à Laprairie suite à un
fâcheux incident survenu sur le traverser».[37]
En fait, le traversier s’échoua et les voyageurs durent passer la nuit à
Laprairie, pestant contre la Compagnie accusée d’être la cause de ce fâcheux
contretemps. Pendant ce temps, on s’affairait à réparer les dommages au steamboat.
voyage
fut plus bruyant qu’à l’aller : on but et on chanta des chansons canadiennes.
La locomotive tirait cette fois-ci les quatre wagons à passagers et ne prit que
cinquante-neuf minutes[36]
à faire le trajet. Les autres voitures furent remorquées comme à l’aller par
des chevaux. Cependant, les invités durent coucher à Laprairie suite à un
fâcheux incident survenu sur le traverser».[37]
En fait, le traversier s’échoua et les voyageurs durent passer la nuit à
Laprairie, pestant contre la Compagnie accusée d’être la cause de ce fâcheux
contretemps. Pendant ce temps, on s’affairait à réparer les dommages au steamboat.  voies ferrées américaines exerçait une forte pression. Mais la Champlain
& St. Lawrence Railroad n’avait pas le choix d’améliorer ses engins
pour accroître son transit. A l'origine, le convoi comportait quatre voitures
de huit passagers chacune, suivies d'une vingtaine de wagons de fret d'une
capacité d'une dizaine de tonnes chacun. Saisonnier comme le trafic maritime,
le train ne circulait que l'été permettant aux excursionnistes montréalais de
s’éloigner de la métropole. Avec l'extension de la ligne à Rouses Point, à la
frontière de l'Etat de New York, le rôle de Saint-Jean comme lieu de
transbordement va s'atténuer. En 1853, la ligne de Portland (Maine), reliant
directement Montréal à un port de mer est parachevée. Les retombées suite au
développement des transports accrurent les activités commerciales de
Saint-Jean, ville constituée de 3 000 habitants, comptant 17 magasins, 12
auberges, 11 boucheries, 8 cordonneries et 5 épiceries. Le coup fatal fut donné
en 1870, lorsqu'une autre ligne liant Montréal à New York fit encore perdre de
son importance au vieux chemin de fer de 1836.
voies ferrées américaines exerçait une forte pression. Mais la Champlain
& St. Lawrence Railroad n’avait pas le choix d’améliorer ses engins
pour accroître son transit. A l'origine, le convoi comportait quatre voitures
de huit passagers chacune, suivies d'une vingtaine de wagons de fret d'une
capacité d'une dizaine de tonnes chacun. Saisonnier comme le trafic maritime,
le train ne circulait que l'été permettant aux excursionnistes montréalais de
s’éloigner de la métropole. Avec l'extension de la ligne à Rouses Point, à la
frontière de l'Etat de New York, le rôle de Saint-Jean comme lieu de
transbordement va s'atténuer. En 1853, la ligne de Portland (Maine), reliant
directement Montréal à un port de mer est parachevée. Les retombées suite au
développement des transports accrurent les activités commerciales de
Saint-Jean, ville constituée de 3 000 habitants, comptant 17 magasins, 12
auberges, 11 boucheries, 8 cordonneries et 5 épiceries. Le coup fatal fut donné
en 1870, lorsqu'une autre ligne liant Montréal à New York fit encore perdre de
son importance au vieux chemin de fer de 1836. le Canal aura
couté la somme de $ 643.711. Doté de 9 neuf écluses (la neuvième étant celle de Saint-Jean) sur une distance de 13
milles et montant les barges à une hauteur de 74 pieds : «Chacune des
écluses a 36,60 m de long sur 7.30 m de large. Autrefois mues à la force des
bras, les portes des écluses sont maintenant actionnées par un système
électrique. Le canal lui-même avait, jusqu’aux transformations entreprises en
1917, environ 16 m de large». Le
canal a rendu d’immenses services au commerce du bois de pulpe ou de
construction, de foin et de charbon entre le Canada et les États-Unis. Jumelé
au transport ferroviaire des marchandises, c'est une véritable révolution des
transports qui se réalise à Saint-Jean. Long de 18,5 km, le canal de Chambly va
de Saint-Jean à Chambly, contournant les trois infranchissables rapides entre
les deux villes. Ses 9 écluses, autrefois mues à bras d'hommes, permettent la
navigation sur une dénivellation de 23,5 mètres. Des travaux de réfection et de
consolidation auront lieu de 1850 à 1858. Dès son ouverture, on y voit
descendre des radeaux de bois provenant de la rivière des Outaouais. Les
billots sont assemblés en barques, surmontées d'une cabane servant aux «cageux»
qui accompagnent les chargements. Puis, viennent les voiliers au gabarit
variant de 50 à 150 tonneaux. Ces goélettes descendent la rivière jusqu’au
fleuve pour y commercer les produits maraîchers de la région. Vers 1860, on
évalue à 200 le nombre de ces voiliers qui
le Canal aura
couté la somme de $ 643.711. Doté de 9 neuf écluses (la neuvième étant celle de Saint-Jean) sur une distance de 13
milles et montant les barges à une hauteur de 74 pieds : «Chacune des
écluses a 36,60 m de long sur 7.30 m de large. Autrefois mues à la force des
bras, les portes des écluses sont maintenant actionnées par un système
électrique. Le canal lui-même avait, jusqu’aux transformations entreprises en
1917, environ 16 m de large». Le
canal a rendu d’immenses services au commerce du bois de pulpe ou de
construction, de foin et de charbon entre le Canada et les États-Unis. Jumelé
au transport ferroviaire des marchandises, c'est une véritable révolution des
transports qui se réalise à Saint-Jean. Long de 18,5 km, le canal de Chambly va
de Saint-Jean à Chambly, contournant les trois infranchissables rapides entre
les deux villes. Ses 9 écluses, autrefois mues à bras d'hommes, permettent la
navigation sur une dénivellation de 23,5 mètres. Des travaux de réfection et de
consolidation auront lieu de 1850 à 1858. Dès son ouverture, on y voit
descendre des radeaux de bois provenant de la rivière des Outaouais. Les
billots sont assemblés en barques, surmontées d'une cabane servant aux «cageux»
qui accompagnent les chargements. Puis, viennent les voiliers au gabarit
variant de 50 à 150 tonneaux. Ces goélettes descendent la rivière jusqu’au
fleuve pour y commercer les produits maraîchers de la région. Vers 1860, on
évalue à 200 le nombre de ces voiliers qui  sillonnent la rivière Richelieu et
le canal de Chambly. Enfin apparaissent les barges qui, mieux adaptées à la
navigation sur les canaux, persisteront jusqu'en 1930 environ. Pour circuler,
la barge doit pourtant compter sur le halage des chevaux qui, péniblement,
mettent une douzaine d'heures à franchir la distance de Chambly à Saint-Jean.
Élargi en 1970 devant le centre-ville, le canal a vu passer sa dernière barge,
dit-on, en 1973. Du coup, l'activité commerciale et économique a cédé le pas
aux loisirs et aujourd'hui le canal sert l'été aux embarcations de plaisance et
l'hiver, aux patineurs. Le long de la bande du canal on érigea des hangars et
des remises à bateaux qui demeureront sur place jusqu’à la fin des années 1960,
site obscur, propice aux activités illégales tout en permettant le jour des
sorties en embarcations pour la pêche à l’anguille sur le Richelieu.
sillonnent la rivière Richelieu et
le canal de Chambly. Enfin apparaissent les barges qui, mieux adaptées à la
navigation sur les canaux, persisteront jusqu'en 1930 environ. Pour circuler,
la barge doit pourtant compter sur le halage des chevaux qui, péniblement,
mettent une douzaine d'heures à franchir la distance de Chambly à Saint-Jean.
Élargi en 1970 devant le centre-ville, le canal a vu passer sa dernière barge,
dit-on, en 1973. Du coup, l'activité commerciale et économique a cédé le pas
aux loisirs et aujourd'hui le canal sert l'été aux embarcations de plaisance et
l'hiver, aux patineurs. Le long de la bande du canal on érigea des hangars et
des remises à bateaux qui demeureront sur place jusqu’à la fin des années 1960,
site obscur, propice aux activités illégales tout en permettant le jour des
sorties en embarcations pour la pêche à l’anguille sur le Richelieu.

 délateurs, s'appuyant sur
une troupe de 250 loyalistes, il parviendra à contrôler la paroisse de
Saint-Athanase et la région de Saint-Jean durant les troubles. Lors de la
marche du constable Malo, il lui fut adjoint un détachement de 18 cavaliers de
la Montreal Volunteer Cavalry, commandé par le lieutenant Ermatinger. «C’était
une maladresse ou plutôt une provocation directe».[41]
La troupe arriva à Saint-Jean vers 3 heures du matin, au moment où la ville est
endormie. Tour à tour, les deux prévenus sont arrêtés, menottés et placés dans
un fourgon conduit par le constable. Au lieu de regagner Montréal par Laprairie
d’où ils étaient venus, Malo et ses hommes s’engagèrent vers Chambly où ils
arrivèrent à 6 heures du matin, le 17 décembre. Pendant ce temps, les Patriotes
se sont rassemblés à Laprairie afin de venir au secours des prisonniers. Dès
l’arrestation, le capitaine Vincent monta à cheval et chevaucha toute la nuit
sous une pluie battante pour prévenir les Patriotes que le convoi ne suivrait
pas le même parcours qu’à l’arrivée. Toute la nuit, les Patriotes se mirent à
faire fondre des balles. Ce travail fait, ils vinrent s’installer à la ferme à
Trudeau, entre Chambly et Saint-Jean. Ils sont 40 sous les ordres du jeune
Bonaventure Viger. Ce dernier fait disperser le petit nombre d’hommes afin de
donner à Malo l’impression qu’ils sont une troupe nombreuse. Lorsque le convoi
vient à passer, Viger saisit la bride de l’un des chevaux du constable Malo :
délateurs, s'appuyant sur
une troupe de 250 loyalistes, il parviendra à contrôler la paroisse de
Saint-Athanase et la région de Saint-Jean durant les troubles. Lors de la
marche du constable Malo, il lui fut adjoint un détachement de 18 cavaliers de
la Montreal Volunteer Cavalry, commandé par le lieutenant Ermatinger. «C’était
une maladresse ou plutôt une provocation directe».[41]
La troupe arriva à Saint-Jean vers 3 heures du matin, au moment où la ville est
endormie. Tour à tour, les deux prévenus sont arrêtés, menottés et placés dans
un fourgon conduit par le constable. Au lieu de regagner Montréal par Laprairie
d’où ils étaient venus, Malo et ses hommes s’engagèrent vers Chambly où ils
arrivèrent à 6 heures du matin, le 17 décembre. Pendant ce temps, les Patriotes
se sont rassemblés à Laprairie afin de venir au secours des prisonniers. Dès
l’arrestation, le capitaine Vincent monta à cheval et chevaucha toute la nuit
sous une pluie battante pour prévenir les Patriotes que le convoi ne suivrait
pas le même parcours qu’à l’arrivée. Toute la nuit, les Patriotes se mirent à
faire fondre des balles. Ce travail fait, ils vinrent s’installer à la ferme à
Trudeau, entre Chambly et Saint-Jean. Ils sont 40 sous les ordres du jeune
Bonaventure Viger. Ce dernier fait disperser le petit nombre d’hommes afin de
donner à Malo l’impression qu’ils sont une troupe nombreuse. Lorsque le convoi
vient à passer, Viger saisit la bride de l’un des chevaux du constable Malo : ainsi, en quelques jours, à enrôler
et à équiper 250 hommes et mettre ainsi les Patriotes dans l’impossibilité de
bouger. De plus, il avait son propre réseau d’espionnage dont faisait partie un
certain Joseph Armand dit Chartrand qui s’infiltra parmi les Patriotes du
Haut-Richelieu. Comprenant que la trahison de Chartrand avait permis
l’arrestation de quelques Patriotes, plusieurs d’entre eux lui tendirent une
embuscade dirigée par un instituteur de L’Acadie, François Nicolas. Une dizaine
de jeunes Patriotes s’emparèrent de Chartrand, lui menèrent un procès au bout
duquel il fut reconnu coupable. On le traîna aussitôt dans un bois voisin,
entre Saint-Jean et L’Acadie, on l’attacha à un arbre et on le fusilla. Pendant
ce temps, un cultivateur Patriote de la Grande-Ligne, Julien Gagnon, essayait
d’entraîner un groupe de Patriotes réfugié à La-Pointe-à-la-Meule pour
s’emparer du fort Saint-Jean. Apprenant qu’une batterie d’artillerie et un
détachement d’infanterie régulière se dirigeaient vers Dorchester, les
Patriotes, trop peu et trop mal armés - seulement une trentaine avaient de
mauvais fusils tandis que les autres brandissaient fourches et faux emmanchées
sur des bâtons - décidèrent d’abandonner le projet et de retourner dans leurs
foyers.[45]
Saint-Jean, renforcée de troupes véhiculées par le train et sous la poigne de
Nelson Mott, lieutenant de la 2e Compagnie des volontaires loyaux de
Dorchester, resta passive.
ainsi, en quelques jours, à enrôler
et à équiper 250 hommes et mettre ainsi les Patriotes dans l’impossibilité de
bouger. De plus, il avait son propre réseau d’espionnage dont faisait partie un
certain Joseph Armand dit Chartrand qui s’infiltra parmi les Patriotes du
Haut-Richelieu. Comprenant que la trahison de Chartrand avait permis
l’arrestation de quelques Patriotes, plusieurs d’entre eux lui tendirent une
embuscade dirigée par un instituteur de L’Acadie, François Nicolas. Une dizaine
de jeunes Patriotes s’emparèrent de Chartrand, lui menèrent un procès au bout
duquel il fut reconnu coupable. On le traîna aussitôt dans un bois voisin,
entre Saint-Jean et L’Acadie, on l’attacha à un arbre et on le fusilla. Pendant
ce temps, un cultivateur Patriote de la Grande-Ligne, Julien Gagnon, essayait
d’entraîner un groupe de Patriotes réfugié à La-Pointe-à-la-Meule pour
s’emparer du fort Saint-Jean. Apprenant qu’une batterie d’artillerie et un
détachement d’infanterie régulière se dirigeaient vers Dorchester, les
Patriotes, trop peu et trop mal armés - seulement une trentaine avaient de
mauvais fusils tandis que les autres brandissaient fourches et faux emmanchées
sur des bâtons - décidèrent d’abandonner le projet et de retourner dans leurs
foyers.[45]
Saint-Jean, renforcée de troupes véhiculées par le train et sous la poigne de
Nelson Mott, lieutenant de la 2e Compagnie des volontaires loyaux de
Dorchester, resta passive.  des Frères
Chasseurs dont il aurait recruté, dit-on, 3 000 rebelles avec la ferme
intention de s’emparer des casernes de Saint-Jean, mais faute d’armes, de
munitions et de secours extérieurs, son plan aurait échoué avant même d’être
entrepris. En fait, et c’est ce que nous apprendrons plus tard, Félix Poutré,
le fin-renard, était un agent double travaillant pour la police et
l’armée britannique. Il faudra attendre l’année 1898 afin d’établir le fait que
le Patriote adulé par la population, «vendant ses frères pour une poignée
d’argent, après avoir acheté son pardon par la délation»[48]
n'était pas ce qu'il prétendait être. Poutré avait, en effet, obtenu un grand
succès avec son récit d’aventure présenté comme autobiographique. Il se disait
avoir été arrêté, le 7 novembre 1838, entre L’Acadie et Saint-Jean et
emprisonné le 13. Libéré le 26, les gens crurent l’anecdote selon laquelle il
aurait réussi à échapper à la potence (c'est le titre de son livre) en
simulant la folie. La vérité était tout autre. Employé par P.-D. Leclère,
surintendant de police, il surveillait les agissements des Patriotes de
Saint-Jean et des paroisses environnantes. Leclère écrivait ainsi au
secrétaire-adjoint de Colborne, C. H. Montizambert, «une lettre contenant le
rapport de
des Frères
Chasseurs dont il aurait recruté, dit-on, 3 000 rebelles avec la ferme
intention de s’emparer des casernes de Saint-Jean, mais faute d’armes, de
munitions et de secours extérieurs, son plan aurait échoué avant même d’être
entrepris. En fait, et c’est ce que nous apprendrons plus tard, Félix Poutré,
le fin-renard, était un agent double travaillant pour la police et
l’armée britannique. Il faudra attendre l’année 1898 afin d’établir le fait que
le Patriote adulé par la population, «vendant ses frères pour une poignée
d’argent, après avoir acheté son pardon par la délation»[48]
n'était pas ce qu'il prétendait être. Poutré avait, en effet, obtenu un grand
succès avec son récit d’aventure présenté comme autobiographique. Il se disait
avoir été arrêté, le 7 novembre 1838, entre L’Acadie et Saint-Jean et
emprisonné le 13. Libéré le 26, les gens crurent l’anecdote selon laquelle il
aurait réussi à échapper à la potence (c'est le titre de son livre) en
simulant la folie. La vérité était tout autre. Employé par P.-D. Leclère,
surintendant de police, il surveillait les agissements des Patriotes de
Saint-Jean et des paroisses environnantes. Leclère écrivait ainsi au
secrétaire-adjoint de Colborne, C. H. Montizambert, «une lettre contenant le
rapport de  Félix Poutré, "cultivateur respectable de la paroisse de
Saint-Jean, qui, depuis quelque temps, est attaché au personnel de la police
pour fins secrètes." Ce qui veut dire en toutes lettres, que Poutré est un
espion au service du gouvernement. La première preuve s’en trouve dans
l’explication de ses fonctions que donne, ensuite, Leclère. "Son devoir
spécial, écrit-il, est de surveiller sa paroisse et les paroisses environnantes
et quelquefois de visiter le côté américain de la frontière et entrer en
communication avec les réfugiés établis là depuis les deux révolutions».[49]
Son récit avait été publié en 1862 et le poète et dramaturge Louis Fréchette en
avait tiré une pièce à succès, Félix Poutré. Aussitôt la vérité
découverte, livre et pièce de théâtre sont retirés du commerce.[50]
Félix Poutré, "cultivateur respectable de la paroisse de
Saint-Jean, qui, depuis quelque temps, est attaché au personnel de la police
pour fins secrètes." Ce qui veut dire en toutes lettres, que Poutré est un
espion au service du gouvernement. La première preuve s’en trouve dans
l’explication de ses fonctions que donne, ensuite, Leclère. "Son devoir
spécial, écrit-il, est de surveiller sa paroisse et les paroisses environnantes
et quelquefois de visiter le côté américain de la frontière et entrer en
communication avec les réfugiés établis là depuis les deux révolutions».[49]
Son récit avait été publié en 1862 et le poète et dramaturge Louis Fréchette en
avait tiré une pièce à succès, Félix Poutré. Aussitôt la vérité
découverte, livre et pièce de théâtre sont retirés du commerce.[50] abolies pour
faire place, le 1er juillet 1845, aux Municipalités de paroisse ayant des
pouvoirs bien définis de taxation foncière et de responsabilités locales. À la
tête de chaque municipalité siège un Conseil composé d’un maire et de 6
conseillers élus par les contribuables.[52]
Or, à l’érection de la municipalité de paroisse, c’est nul autre que l’ancien
chef Patriote, le notaire Pierre-Paul Démaray qui est élu maire (jusqu’à la
première abrogation de la municipalité de paroisse, le 1er septembre 1847). La
loi qui entre en vigueur ce 1er juillet 1845 et instituant les 325 premières
municipalités de la Province de Québec, confie à chaque commission scolaire,
indépendant du Conseil municipal, la gestion des écoles établies sur son
territoire. La commission scolaire est érigée la même année et le notaire
Démaray va y siéger face à son ennemi idéologique, le curé LaRocque. Une
opposion acharnée entre le Vieux Patriote et le curé ultramontain va troubler
la petite société pour plusieurs années.
abolies pour
faire place, le 1er juillet 1845, aux Municipalités de paroisse ayant des
pouvoirs bien définis de taxation foncière et de responsabilités locales. À la
tête de chaque municipalité siège un Conseil composé d’un maire et de 6
conseillers élus par les contribuables.[52]
Or, à l’érection de la municipalité de paroisse, c’est nul autre que l’ancien
chef Patriote, le notaire Pierre-Paul Démaray qui est élu maire (jusqu’à la
première abrogation de la municipalité de paroisse, le 1er septembre 1847). La
loi qui entre en vigueur ce 1er juillet 1845 et instituant les 325 premières
municipalités de la Province de Québec, confie à chaque commission scolaire,
indépendant du Conseil municipal, la gestion des écoles établies sur son
territoire. La commission scolaire est érigée la même année et le notaire
Démaray va y siéger face à son ennemi idéologique, le curé LaRocque. Une
opposion acharnée entre le Vieux Patriote et le curé ultramontain va troubler
la petite société pour plusieurs années. municipales. On forme 5 comités afin de
faciliter le bon fonctionnement des affaires : le Comité des finances et des
comptes généraux, le Comité du marché, le Comité des chemins et des rues -
c’est alors que l'arpenteur Hiram Corey fait la verbalisation des rues et la
description de leur tracé -, le Comité des incendies et le Comité de police et
de santé. Nelson Mott se réserve la charge de superviser tous ces comités et on
se met à l’œuvre. Le 8 janvier 1849, le Conseil organise la première unité de
pompiers et nomme Louis Marchand surintendant de la Richelieu Fire Engine
Company. Il semblerait que la circulation ferroviaire ait été à l’origine
de cette mesure. Selon François Cinq-Mars, «la crainte d’un incendie
provoqué par le chemin de fer, qui laissait d’immense quantité de bois dans la
ville près de ses entrepôts, afin d’alimenter ses locomotives, ait également
influencé la mise sur pied de ce service. En effet, le conseil municipal de
Saint-Jean avisait en janvier 1849, le président de Champlain et
Saint-Laurent du danger d’incendie que représentait ce bois aux abords du
village».[60] Le triste
événement de 1876 devait montrer que cette crainte était justifiée, mais que ce
ne serait pas des bois déposés par la compagnie que le feu se répandrait sur la
ville. Le 22 janvier suivant, le Conseil procède à l’adoption d’un règlement de
police pour le maintien de l’ordre, l’entretien des rues et des trottoirs, la
conservation des bonnes mœurs, etc. On interdit ainsi à quiconque d’aller se
baigner dans le canal de Chambly, de se battre, crier ou blasphémer dans la rue
et, en hiver, tous les résidants du village sont tenus d’enlever la neige et la
glace sur les trottoirs bordant leurs maisons. Pendant l’été, ils doivent
maintenir la propreté de ces mêmes trottoirs en les lavant ou en les balayant.
Le 16 avril, un règlement concernant les nuisances est adopté par la
municipalité. Désormais, il est interdit de laisser errer librement les animaux
dans les rues du village sous peine d’amende. Tout cela restera fort théorique,
bien entendu.
municipales. On forme 5 comités afin de
faciliter le bon fonctionnement des affaires : le Comité des finances et des
comptes généraux, le Comité du marché, le Comité des chemins et des rues -
c’est alors que l'arpenteur Hiram Corey fait la verbalisation des rues et la
description de leur tracé -, le Comité des incendies et le Comité de police et
de santé. Nelson Mott se réserve la charge de superviser tous ces comités et on
se met à l’œuvre. Le 8 janvier 1849, le Conseil organise la première unité de
pompiers et nomme Louis Marchand surintendant de la Richelieu Fire Engine
Company. Il semblerait que la circulation ferroviaire ait été à l’origine
de cette mesure. Selon François Cinq-Mars, «la crainte d’un incendie
provoqué par le chemin de fer, qui laissait d’immense quantité de bois dans la
ville près de ses entrepôts, afin d’alimenter ses locomotives, ait également
influencé la mise sur pied de ce service. En effet, le conseil municipal de
Saint-Jean avisait en janvier 1849, le président de Champlain et
Saint-Laurent du danger d’incendie que représentait ce bois aux abords du
village».[60] Le triste
événement de 1876 devait montrer que cette crainte était justifiée, mais que ce
ne serait pas des bois déposés par la compagnie que le feu se répandrait sur la
ville. Le 22 janvier suivant, le Conseil procède à l’adoption d’un règlement de
police pour le maintien de l’ordre, l’entretien des rues et des trottoirs, la
conservation des bonnes mœurs, etc. On interdit ainsi à quiconque d’aller se
baigner dans le canal de Chambly, de se battre, crier ou blasphémer dans la rue
et, en hiver, tous les résidants du village sont tenus d’enlever la neige et la
glace sur les trottoirs bordant leurs maisons. Pendant l’été, ils doivent
maintenir la propreté de ces mêmes trottoirs en les lavant ou en les balayant.
Le 16 avril, un règlement concernant les nuisances est adopté par la
municipalité. Désormais, il est interdit de laisser errer librement les animaux
dans les rues du village sous peine d’amende. Tout cela restera fort théorique,
bien entendu. En 1854, l’élection entraîne un nouveau comté, la circonscription de
Saint-Jean. François Bourassa (1813-1898), ancien Patriote, arrêté et détenu un
certain temps, qui servit ensuite de capitaine de milice locale, en est élu le
premier député. Établi à Saint-Jean, il représentait déjà la ville au conseil
du comté de Chambly. Bourassa est nettement un «Rouge» et ne parlait pas
anglais, seulement il avait appris le système de maraudage en vogue aux
États-Unis de donner des bonbons aux enfants et de serrer des poignées de mains
aux citoyens les plus ordinaires. L’instabilité des gouvernements de l’Union
entraîne pourtant déjà l’idée d’un nouveau régime constitutionnel. En tant que
libéral, Bourassa s’opposera à la Confédération, mais une fois le projet passé,
il se portera candidat et sera élu premier député de la circonscription
fédérale de Saint-Jean.
En 1854, l’élection entraîne un nouveau comté, la circonscription de
Saint-Jean. François Bourassa (1813-1898), ancien Patriote, arrêté et détenu un
certain temps, qui servit ensuite de capitaine de milice locale, en est élu le
premier député. Établi à Saint-Jean, il représentait déjà la ville au conseil
du comté de Chambly. Bourassa est nettement un «Rouge» et ne parlait pas
anglais, seulement il avait appris le système de maraudage en vogue aux
États-Unis de donner des bonbons aux enfants et de serrer des poignées de mains
aux citoyens les plus ordinaires. L’instabilité des gouvernements de l’Union
entraîne pourtant déjà l’idée d’un nouveau régime constitutionnel. En tant que
libéral, Bourassa s’opposera à la Confédération, mais une fois le projet passé,
il se portera candidat et sera élu premier député de la circonscription
fédérale de Saint-Jean.
































































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire