1812, OU COMMENT CÉLÉBRER A NEEDLESS WAR
CÉRÉMONIES CONTESTÉES ET CONTESTABLES
 monstruosité qu'est la loi omnibus, dite loi-mammouth,
pour célébrer le bicentenaire de la guerre de 1812 qui opposa le
Canada, en tant qu’Amérique du Nord britannique, aux États-Unis
d'Amérique. Bien sûr, les historiens se sont sentis insultés dans la
mesure où les budgets à la conservation des archives, à la recherche et à
l’enseignement de l’histoire sont toujours victimes des couperets des
ministères, alors que pour cultiver l’histoire-spectacle, l’exotisme
temporel, le tourisme blasé, les Parcs du Canada - en fait ceux de
l’Ontario - vont présenter des re-anactments
des différents épisodes de cette guerre qui fut, en fait, moins un
affrontement qu’une série de coups d’échecs entre troupes britanniques
et troupes américaines.
monstruosité qu'est la loi omnibus, dite loi-mammouth,
pour célébrer le bicentenaire de la guerre de 1812 qui opposa le
Canada, en tant qu’Amérique du Nord britannique, aux États-Unis
d'Amérique. Bien sûr, les historiens se sont sentis insultés dans la
mesure où les budgets à la conservation des archives, à la recherche et à
l’enseignement de l’histoire sont toujours victimes des couperets des
ministères, alors que pour cultiver l’histoire-spectacle, l’exotisme
temporel, le tourisme blasé, les Parcs du Canada - en fait ceux de
l’Ontario - vont présenter des re-anactments
des différents épisodes de cette guerre qui fut, en fait, moins un
affrontement qu’une série de coups d’échecs entre troupes britanniques
et troupes américaines. officielle
du supra-historien Stephen Harper, la guerre de 1812 fut un «moment
décisif de notre pays». Le ministre tient particulièrement à rappeler
que ce sont «les États-Unis [qui] ont déclaré la guerre au Canada», ce
qui est historiquement impossible puisque le Canada n’existait, sur le
plan international, qu’en tant que colonie britannique. C’est donc à
l’Angleterre que le gouvernement de Washington déclara la guerre de 1812
et non au Canada! «Il aura fallu les efforts conjoints des soldats
britanniques, des milices canadiennes francophones et anglophones, et
des Canadiens autochtones pour contrer l’invasion des Américains et
défendre le Canada». Évidemment, dans ce jeu d’échecs, les coups
procédaient par rivalités vengeresses. La marine britannique, dotée par
son gouvernement d'un droit de visite abusif des navires américains,
enrôlait de
officielle
du supra-historien Stephen Harper, la guerre de 1812 fut un «moment
décisif de notre pays». Le ministre tient particulièrement à rappeler
que ce sont «les États-Unis [qui] ont déclaré la guerre au Canada», ce
qui est historiquement impossible puisque le Canada n’existait, sur le
plan international, qu’en tant que colonie britannique. C’est donc à
l’Angleterre que le gouvernement de Washington déclara la guerre de 1812
et non au Canada! «Il aura fallu les efforts conjoints des soldats
britanniques, des milices canadiennes francophones et anglophones, et
des Canadiens autochtones pour contrer l’invasion des Américains et
défendre le Canada». Évidemment, dans ce jeu d’échecs, les coups
procédaient par rivalités vengeresses. La marine britannique, dotée par
son gouvernement d'un droit de visite abusif des navires américains,
enrôlait de  force
ses marins, pratiquant ainsi de véritables enlèvements dans le contexte
où l’effort ultime devait être porté contre le Blocus continental de
Napoléon dont l'armée, en cette année 1812, allait revenir complètement
désarticulée de la désastreuse campagne de Russie. En réplique, les
Américains, s'inspirant de la première invasion du Canada, celle de
1775, se portèrent sur les frontières britanniques qui leur étaient
accessibles, nourrie de l'idée de s'approprier la colonie afin de faire
«un continent, un pays», America. Aussi, les War Hawks de la politique américaine poussèrent-ils le président Madison,
qui venait de succéder à Jefferson, de s’engager dans cette guerre de
conquête, la première véritable guerre faite en vue de s’approprier un
territoire étranger et qui devait mieux réussir plus de trente ans plus
tard, lorsqu’à l’issue de la guerre avec le Mexique, les
Américains raflèrent 40% du territoire mexicain comprenant outre
l’Arizona et le Nouveau-Mexique, la Californie où, quelques années plus
tard, les mines d’or devaient faire la richesse!
force
ses marins, pratiquant ainsi de véritables enlèvements dans le contexte
où l’effort ultime devait être porté contre le Blocus continental de
Napoléon dont l'armée, en cette année 1812, allait revenir complètement
désarticulée de la désastreuse campagne de Russie. En réplique, les
Américains, s'inspirant de la première invasion du Canada, celle de
1775, se portèrent sur les frontières britanniques qui leur étaient
accessibles, nourrie de l'idée de s'approprier la colonie afin de faire
«un continent, un pays», America. Aussi, les War Hawks de la politique américaine poussèrent-ils le président Madison,
qui venait de succéder à Jefferson, de s’engager dans cette guerre de
conquête, la première véritable guerre faite en vue de s’approprier un
territoire étranger et qui devait mieux réussir plus de trente ans plus
tard, lorsqu’à l’issue de la guerre avec le Mexique, les
Américains raflèrent 40% du territoire mexicain comprenant outre
l’Arizona et le Nouveau-Mexique, la Californie où, quelques années plus
tard, les mines d’or devaient faire la richesse! Dans
le conflit, les Américains prirent d’abord York, alors capitale du
Haut-Canada (et non du Canada) et l’incendièrent. Pour se venger, les
Britanniques, un an plus tard, prirent Washington et mirent le feu aux
nouveaux édifices du gouvernement, y compris la Maison-Blanche d’où les
Madison s’enfuirent, Dolly,
la charmante épouse du Président (on en fait depuis des poupées),
apportant sous le bras le célèbre tableau de George Washington peint par
Gilbert Stuart et que l’on peut voir reproduit sur les billets de
$1.00. C’est dans ce contexte de guerre que le jeune Francis Scott Key,
prisonnier sur un navire britannique, composa The Star-Spangled Banner,
poème racontant le bombardement du fort McHenry dans le port de
Baltimore. En 1931, on adopta ce chant comme hymne national américain et
le premier vers du poème de Key, "Oh, say can you see through the
dawn's early light" est devenu le célèbre «Oh, say can you see by the
dawn's early light» que les Canadiens peuvent entendent au début de
chaque partie de hockey, de baseball ou de football américaine et qu’ils
connaissent sans doute mieux que leur Ô Canada!
Dans
le conflit, les Américains prirent d’abord York, alors capitale du
Haut-Canada (et non du Canada) et l’incendièrent. Pour se venger, les
Britanniques, un an plus tard, prirent Washington et mirent le feu aux
nouveaux édifices du gouvernement, y compris la Maison-Blanche d’où les
Madison s’enfuirent, Dolly,
la charmante épouse du Président (on en fait depuis des poupées),
apportant sous le bras le célèbre tableau de George Washington peint par
Gilbert Stuart et que l’on peut voir reproduit sur les billets de
$1.00. C’est dans ce contexte de guerre que le jeune Francis Scott Key,
prisonnier sur un navire britannique, composa The Star-Spangled Banner,
poème racontant le bombardement du fort McHenry dans le port de
Baltimore. En 1931, on adopta ce chant comme hymne national américain et
le premier vers du poème de Key, "Oh, say can you see through the
dawn's early light" est devenu le célèbre «Oh, say can you see by the
dawn's early light» que les Canadiens peuvent entendent au début de
chaque partie de hockey, de baseball ou de football américaine et qu’ils
connaissent sans doute mieux que leur Ô Canada! Si
les États-Unis sont véritablement les agresseurs dans cette histoire,
on devrait s’attendre à un enthousiasme semblable de l’autre côté de la
frontière. Or, tel n’est pas le cas. Même les petits Américains qui, la
main sur le cœur, chaque matin en classe entonnent le Oh, say can you see by the dawn's early light, ignorent que ce chant fut composé dans le contexte d’une guerre que leurs manuels désignent comme une nedless war, une guerre inutile. Inutile pour les Américains, inutile en fait aussi pour les Canadiens, même si, a posteriori,
on peut lui attribuer le salut du Canada et le projet confédératif! En
fait, à sonder les cœurs et les reins de beaucoup de conservateurs, un
grand nombre souhaiterait sans doute que cette guerre fut perdue, ce qui
ferait d’eux d’authentiques électeurs républicains.
Si
les États-Unis sont véritablement les agresseurs dans cette histoire,
on devrait s’attendre à un enthousiasme semblable de l’autre côté de la
frontière. Or, tel n’est pas le cas. Même les petits Américains qui, la
main sur le cœur, chaque matin en classe entonnent le Oh, say can you see by the dawn's early light, ignorent que ce chant fut composé dans le contexte d’une guerre que leurs manuels désignent comme une nedless war, une guerre inutile. Inutile pour les Américains, inutile en fait aussi pour les Canadiens, même si, a posteriori,
on peut lui attribuer le salut du Canada et le projet confédératif! En
fait, à sonder les cœurs et les reins de beaucoup de conservateurs, un
grand nombre souhaiterait sans doute que cette guerre fut perdue, ce qui
ferait d’eux d’authentiques électeurs républicains. sous
la présidence du successeur de Madison et qui signifiait, pour les
ambitions européennes, que les affaires d’Amérique concernaient
strictement les intérêts américains. C'est l'esprit de 1812 encore, et
leurs animateurs toujours vivants, qui s'engagèrent dans la politique
impérialiste du Manifest Destiny et alimenta les raisons de faire
la guerre au Mexique. Lors de l'autre Guerre du Mexique, celle menée
par la France au moment où les États-Unis étaient encore occupés par
leur Guerre civile entre 1861 et 1865, les Français furent sommés de
quitter le territoire mexicain et d’y laisser leur empereur fantoche, Maximilien de Habsbourg,
se faire fusiller par les troupes de Juarez. Évidemment, personne ne
songea à considérer que tous ces événements tragiques découlaient
directement de l’affrontement et de la semi-victoire américaine au
traité de Gand de 1814.
sous
la présidence du successeur de Madison et qui signifiait, pour les
ambitions européennes, que les affaires d’Amérique concernaient
strictement les intérêts américains. C'est l'esprit de 1812 encore, et
leurs animateurs toujours vivants, qui s'engagèrent dans la politique
impérialiste du Manifest Destiny et alimenta les raisons de faire
la guerre au Mexique. Lors de l'autre Guerre du Mexique, celle menée
par la France au moment où les États-Unis étaient encore occupés par
leur Guerre civile entre 1861 et 1865, les Français furent sommés de
quitter le territoire mexicain et d’y laisser leur empereur fantoche, Maximilien de Habsbourg,
se faire fusiller par les troupes de Juarez. Évidemment, personne ne
songea à considérer que tous ces événements tragiques découlaient
directement de l’affrontement et de la semi-victoire américaine au
traité de Gand de 1814. d’USA Today.
«Americans, on the other hand, are familiar with the 1959 hit song The
Battle of New Orleans and have a vague image of Dolley Madison fleeing
the White House ahead of torch-brandishing Royal Marines with a portrait
of George Washington under her arm». L’équivalent, pour le Canada,
c’est la poignée de main entre le général britannique Brock et le chef des Shawnees, Tecumseh,
alliés contre un ennemi commun des mains desquels ils devaient périr
tous deux. À Dolly Madison fuyant avec le tableau, les Canadiens
opposent Laura Second,
traversant les lignes ennemies déguisée en fermière allant traire ses
vaches pour informer le général Fitzgibbon que les Américains
attaqueraient à Beaver Dams. Depuis, les chocolats Laura Secord, si
délicieux, si onctueux, si… enfin, ont effacé de la mémoire de la plupart
des Canadiens l’acte guerrier de cette Madeleine de Verchères anglophone. Jordan Chittley, du Daily Buzz,
rapporte les résultats d’un sondage qui montre que 17% des Canadiens
sentent que la Guerre de 1812 fut la guerre la plus importante dans la
formation de l’identité nationale canadienne, alors que seulement 3% des
Américains considèrent la Guerre de
d’USA Today.
«Americans, on the other hand, are familiar with the 1959 hit song The
Battle of New Orleans and have a vague image of Dolley Madison fleeing
the White House ahead of torch-brandishing Royal Marines with a portrait
of George Washington under her arm». L’équivalent, pour le Canada,
c’est la poignée de main entre le général britannique Brock et le chef des Shawnees, Tecumseh,
alliés contre un ennemi commun des mains desquels ils devaient périr
tous deux. À Dolly Madison fuyant avec le tableau, les Canadiens
opposent Laura Second,
traversant les lignes ennemies déguisée en fermière allant traire ses
vaches pour informer le général Fitzgibbon que les Américains
attaqueraient à Beaver Dams. Depuis, les chocolats Laura Secord, si
délicieux, si onctueux, si… enfin, ont effacé de la mémoire de la plupart
des Canadiens l’acte guerrier de cette Madeleine de Verchères anglophone. Jordan Chittley, du Daily Buzz,
rapporte les résultats d’un sondage qui montre que 17% des Canadiens
sentent que la Guerre de 1812 fut la guerre la plus importante dans la
formation de l’identité nationale canadienne, alors que seulement 3% des
Américains considèrent la Guerre de  1812 ayant eu des effets identiques
sur leur nation. Les historiens partagent une indifférence semblable,
sinon un mépris certain pour la Guerre de 1812. Chittley cite encore
Jerald Podair, professeur à la Lawrence University au Wisconsin, qui
affirme au Los Angeles Time «It's just a hodgepodge of buildings
burning, bombs bursting in air and paintings being saved from the
invaders, all for a vaguely defined purpose». Autant dire, une querelle
de mouches. L’explication nous ramène toujours au sobriquet de la needless war,
parce qu’aucun des deux partis ne gagna véritablement quoi que ce soit
de tangible sur le champ de bataille. Ni territoires, ni frontières, ni
ransons, rien. À la gloire posthume de Brock et Tecumseh, les Américains
eurent le général William-Henry Harrison qui gagna l’escarmouche de
Tippecanoe, ce qui forma son jingle lors de l’élection présidentielle de 1840: Tippecanoe and Tyler too. Un mois après son installation à la Maison-Blanche, il décédait.
1812 ayant eu des effets identiques
sur leur nation. Les historiens partagent une indifférence semblable,
sinon un mépris certain pour la Guerre de 1812. Chittley cite encore
Jerald Podair, professeur à la Lawrence University au Wisconsin, qui
affirme au Los Angeles Time «It's just a hodgepodge of buildings
burning, bombs bursting in air and paintings being saved from the
invaders, all for a vaguely defined purpose». Autant dire, une querelle
de mouches. L’explication nous ramène toujours au sobriquet de la needless war,
parce qu’aucun des deux partis ne gagna véritablement quoi que ce soit
de tangible sur le champ de bataille. Ni territoires, ni frontières, ni
ransons, rien. À la gloire posthume de Brock et Tecumseh, les Américains
eurent le général William-Henry Harrison qui gagna l’escarmouche de
Tippecanoe, ce qui forma son jingle lors de l’élection présidentielle de 1840: Tippecanoe and Tyler too. Un mois après son installation à la Maison-Blanche, il décédait. de
1812 avec Harper. Tout ça, pour les Britanniques, est sans la moindre
signification, et encore moins non traductible en termes de moralisation
historique. Il est vrai que les raisons du déclenchement de cette
guerre sont difficiles à cerner : la protestation des Américains contre
l’enrôlement forcé des marins par les capitaines
britanniques, ou l'entrave du libre commerce entre les deux pays? Les querelles entre pionniers et autochtones dans l'Ouest? Bref, les re-enactments
de la Guerre de 1812 joués au Canada mettront des citoyens canadiens dans les uniformes de l’armée américaine, tant les
Américains ne semblent pas intéressés à se joindre aux «armées de
théâtre» de leur voisin du nord!
de
1812 avec Harper. Tout ça, pour les Britanniques, est sans la moindre
signification, et encore moins non traductible en termes de moralisation
historique. Il est vrai que les raisons du déclenchement de cette
guerre sont difficiles à cerner : la protestation des Américains contre
l’enrôlement forcé des marins par les capitaines
britanniques, ou l'entrave du libre commerce entre les deux pays? Les querelles entre pionniers et autochtones dans l'Ouest? Bref, les re-enactments
de la Guerre de 1812 joués au Canada mettront des citoyens canadiens dans les uniformes de l’armée américaine, tant les
Américains ne semblent pas intéressés à se joindre aux «armées de
théâtre» de leur voisin du nord! où
le général Pakenham, beau-frère de Wellington, fut tué avec une bonne partie de son armée de débarquement par les troupes américaines du jeune
Andrew Jackson, appuyé sur la guérilla navale du pirate français Jean
Lafitte, habitué à écumer les eaux du Golfe du Mexique. À la fin de la
journée, les Britanniques dénombraient 2 042 victimes : 291 tués (y
compris les généraux Pakenham et Gibbs), 1 267 blessés (dont le général
Keane) et 484 capturés ou portés disparus, alors que les Américains
avaient eu 71 victimes : 13 morts, 39 blessés et 19 disparus. Ainsi, aux
yeux des Américains, la victoire retentissante de la Nouvelle-Orléans
effaça le reste de la guerre livrée à la frontière Canado-américaine.
Jackson eut une carrière fulgurante qui, après la conquête de la Floride
arrachée aux Espagnols, la déportation des Séminoles et la conquête de
la Maison-Blanche en 1828, installa un système de corruption politique
qui porte pudiquement le nom de démocratie jacksonienne.
où
le général Pakenham, beau-frère de Wellington, fut tué avec une bonne partie de son armée de débarquement par les troupes américaines du jeune
Andrew Jackson, appuyé sur la guérilla navale du pirate français Jean
Lafitte, habitué à écumer les eaux du Golfe du Mexique. À la fin de la
journée, les Britanniques dénombraient 2 042 victimes : 291 tués (y
compris les généraux Pakenham et Gibbs), 1 267 blessés (dont le général
Keane) et 484 capturés ou portés disparus, alors que les Américains
avaient eu 71 victimes : 13 morts, 39 blessés et 19 disparus. Ainsi, aux
yeux des Américains, la victoire retentissante de la Nouvelle-Orléans
effaça le reste de la guerre livrée à la frontière Canado-américaine.
Jackson eut une carrière fulgurante qui, après la conquête de la Floride
arrachée aux Espagnols, la déportation des Séminoles et la conquête de
la Maison-Blanche en 1828, installa un système de corruption politique
qui porte pudiquement le nom de démocratie jacksonienne. d’histoire qui font un travail plus sérieux que se déguiser sous un habit rouge en faisant rebondir sa bédaine
de bière sur la selle d’un cheval ou en portant un képi carré qui va
rouler par terre lorsque le figurant s’enfargera dans son pantalon à
sous-pieds comme en portaient les officiers britanniques de l’époque.
Sans oublier ceux qui se piqueront avec une baïonnette ou essaieront de cruiser l’interprète de la Laura Secord du jour. Outre la propagande politique pro-belliqueuse
du gouvernement Harper, la Guerre de 1812 reste un épisode de
l’histoire ontarienne beaucoup plus que de l’ensemble du Canada. Aucun
combat livré durant cette guerre n’a une portée significative aussi
importante que
d’histoire qui font un travail plus sérieux que se déguiser sous un habit rouge en faisant rebondir sa bédaine
de bière sur la selle d’un cheval ou en portant un képi carré qui va
rouler par terre lorsque le figurant s’enfargera dans son pantalon à
sous-pieds comme en portaient les officiers britanniques de l’époque.
Sans oublier ceux qui se piqueront avec une baïonnette ou essaieront de cruiser l’interprète de la Laura Secord du jour. Outre la propagande politique pro-belliqueuse
du gouvernement Harper, la Guerre de 1812 reste un épisode de
l’histoire ontarienne beaucoup plus que de l’ensemble du Canada. Aucun
combat livré durant cette guerre n’a une portée significative aussi
importante que  la
bataille des Plaines d’Abraham, de Ypres durant la Première Guerre
mondiale, ou du Monte Cassino en 1943 pour les combattants canadiens.
Seuls les historiens militaires se sont intéressés à cette guerre.
L’œuvre de référence reste le gros bouquin de George F. G. Stanley, qui
ne concerne que les opérations terrestres, alors que les opérations
maritimes furent souvent plus importantes (sur les lacs Ontario et Érié,
le lac Champlain, sur la côte Atlantique). L’ouvrage du Stanley analyse
le Guerre de 1812 du point de vue canadien, mentionnant au passage la
désastreuse bataille de la Nouvelle-Orléans qui n’entre pas dans la
marge de ses travaux, indiquant ainsi à quel point la Guerre de 1812
célébrée par les Canadiens n’est pas la guerre anglo-américaine négligée
respectivement par les Britanniques et les Américains.
la
bataille des Plaines d’Abraham, de Ypres durant la Première Guerre
mondiale, ou du Monte Cassino en 1943 pour les combattants canadiens.
Seuls les historiens militaires se sont intéressés à cette guerre.
L’œuvre de référence reste le gros bouquin de George F. G. Stanley, qui
ne concerne que les opérations terrestres, alors que les opérations
maritimes furent souvent plus importantes (sur les lacs Ontario et Érié,
le lac Champlain, sur la côte Atlantique). L’ouvrage du Stanley analyse
le Guerre de 1812 du point de vue canadien, mentionnant au passage la
désastreuse bataille de la Nouvelle-Orléans qui n’entre pas dans la
marge de ses travaux, indiquant ainsi à quel point la Guerre de 1812
célébrée par les Canadiens n’est pas la guerre anglo-américaine négligée
respectivement par les Britanniques et les Américains. de
1775 occupe une place plus importante dans l’histoire du Québec car,
après l’occupation de Montréal et de Trois-Rivières, les deux troupes
américaines firent leur jonction devant Québec et furent repoussés
par les défenseurs canadiens de la capitale menés par le gouverneur
Carleton. Mais l’importance de l’événement tient moins à sa valeur
militaire qu’au fait que les Canadiens se laissèrent peu séduire par le
lyrisme d’un Benjamin Franklin appelé à convaincre les Canadiens de
s’unir à la cause de l’indépendance américaine. Tout ce beau monde
repartit au printemps 1776, avec armes et bagages, n’entraînant avec eux
que quelques collaborateurs douteux qui les avaient un peu trop
chaudement accueillis lors de leur passage l’année précédente. Le fait
que Fleury Mesplet, un Français protestant amené avec les Américains,
resta au Québec et développa la presse à journaux demeure sans doute
l’apport le plus important de cet événement. À côté de cela, 1812 n’a
pas apporté grand chose de plus
de
1775 occupe une place plus importante dans l’histoire du Québec car,
après l’occupation de Montréal et de Trois-Rivières, les deux troupes
américaines firent leur jonction devant Québec et furent repoussés
par les défenseurs canadiens de la capitale menés par le gouverneur
Carleton. Mais l’importance de l’événement tient moins à sa valeur
militaire qu’au fait que les Canadiens se laissèrent peu séduire par le
lyrisme d’un Benjamin Franklin appelé à convaincre les Canadiens de
s’unir à la cause de l’indépendance américaine. Tout ce beau monde
repartit au printemps 1776, avec armes et bagages, n’entraînant avec eux
que quelques collaborateurs douteux qui les avaient un peu trop
chaudement accueillis lors de leur passage l’année précédente. Le fait
que Fleury Mesplet, un Français protestant amené avec les Américains,
resta au Québec et développa la presse à journaux demeure sans doute
l’apport le plus important de cet événement. À côté de cela, 1812 n’a
pas apporté grand chose de plus  sinon que les Canadiens, avec le corps des Voltigeurs dirigé par Salaberry, stoppa l’avance de l’armée américaine de Hampton à Châteauguay. L’image d’Épinal a conservé le souvenir de ce Léonidas québécois,
sabre levé, juché sur un tronc d’arbre. Il est douteux que les jeunes
Québécois sortis des écoles depuis 20 ans, aient conservé ce souvenir
intact qui ne fait qu’affleurer à la surface de la conscience historique
une fois l’année scolaire terminée. Et même dans les cours
universitaires, ce fait n’existe virtuellement pas. Après tout,
Salaberry appartenait davantage à l’armée britannique avec laquelle il
servit partout, aux Antilles, aux Pays-Bas, en Sicile, en Irlande, enfin
seulement au Canada. Lié à la seigneurie de Rouxville, après
Châteauguay, il alla s’installer à Chambly où il mourut. Héros,
peut-être, mais il est douteux qu’il ait entretenu avec la population
québécoise des relations aussi intimistes que certains lui attribuent.
Par sa vie, Salaberry était plus un Anglais, comme les seigneurs du
nouveau régime qui avaient épousé des filles de seigneurs de la
Nouvelle-France, qu’un Canadien, et encore moins un Québécois!
sinon que les Canadiens, avec le corps des Voltigeurs dirigé par Salaberry, stoppa l’avance de l’armée américaine de Hampton à Châteauguay. L’image d’Épinal a conservé le souvenir de ce Léonidas québécois,
sabre levé, juché sur un tronc d’arbre. Il est douteux que les jeunes
Québécois sortis des écoles depuis 20 ans, aient conservé ce souvenir
intact qui ne fait qu’affleurer à la surface de la conscience historique
une fois l’année scolaire terminée. Et même dans les cours
universitaires, ce fait n’existe virtuellement pas. Après tout,
Salaberry appartenait davantage à l’armée britannique avec laquelle il
servit partout, aux Antilles, aux Pays-Bas, en Sicile, en Irlande, enfin
seulement au Canada. Lié à la seigneurie de Rouxville, après
Châteauguay, il alla s’installer à Chambly où il mourut. Héros,
peut-être, mais il est douteux qu’il ait entretenu avec la population
québécoise des relations aussi intimistes que certains lui attribuent.
Par sa vie, Salaberry était plus un Anglais, comme les seigneurs du
nouveau régime qui avaient épousé des filles de seigneurs de la
Nouvelle-France, qu’un Canadien, et encore moins un Québécois! avaient
provoqué un grand mécontentement en Amérique, et celle-ci avait répondu
en cessant tout commerce avec l’Angleterre. En 1812 elle lui déclara la
guerre, tenta vainement d’envahir le Canada, mais remporte un grand
nombre de petites victoires sur mer, particulièrement au moyen de ses
vastes et lourdes frégates armées, qui s’emparaient facilement des
nôtres et faisaient de terribles ravages dans notre marine marchande.
Mais elles ne pouvaient, comme en témoigne la lutte célèbre du Chesapeake et du Shanon,
soutenir le choc de navires anglais de force égale. Après la fin de la
guerre d’Espagne, les vétérans de Wellington furent embarqués pour
l’Amérique, où ils prirent et détruisirent Washington, mais échouèrent
au Lac Champlain, à Baltimore et à New Orleans. Finalement, le 24
décembre 1814, la médiation du Czar aboutit au Traité de Gand, qui régla
la querelle par un compromis et remit à d’autres temps la solution du
problème, si délicat, des frontières. Ce fut là une guerre aussi
ruineuse qu’inutile, qui, avec un peu de tact et de bons sens des deux
côtés, aurait pu être évitée» (F. York Powell et T. F. Tout. Histoire d'Angleterre, Paris,
Payot, Col. Bibliothèque historique, 1932, pp. 1021-1022). Cette vision
du tournant du XXe siècle montre l’importance des affrontements
anglo-américains sur mer par rapport aux petites victoires remportées
sur le sol canado-américain. La bataille du 8 janvier 1815 est même
rétroportée avant la signature du traité de Gand! Les causes sont
d’ordre commercial (la rupture commerciale suite aux «Ordres en
Conseil». Conclusion tirée : a needless war.
avaient
provoqué un grand mécontentement en Amérique, et celle-ci avait répondu
en cessant tout commerce avec l’Angleterre. En 1812 elle lui déclara la
guerre, tenta vainement d’envahir le Canada, mais remporte un grand
nombre de petites victoires sur mer, particulièrement au moyen de ses
vastes et lourdes frégates armées, qui s’emparaient facilement des
nôtres et faisaient de terribles ravages dans notre marine marchande.
Mais elles ne pouvaient, comme en témoigne la lutte célèbre du Chesapeake et du Shanon,
soutenir le choc de navires anglais de force égale. Après la fin de la
guerre d’Espagne, les vétérans de Wellington furent embarqués pour
l’Amérique, où ils prirent et détruisirent Washington, mais échouèrent
au Lac Champlain, à Baltimore et à New Orleans. Finalement, le 24
décembre 1814, la médiation du Czar aboutit au Traité de Gand, qui régla
la querelle par un compromis et remit à d’autres temps la solution du
problème, si délicat, des frontières. Ce fut là une guerre aussi
ruineuse qu’inutile, qui, avec un peu de tact et de bons sens des deux
côtés, aurait pu être évitée» (F. York Powell et T. F. Tout. Histoire d'Angleterre, Paris,
Payot, Col. Bibliothèque historique, 1932, pp. 1021-1022). Cette vision
du tournant du XXe siècle montre l’importance des affrontements
anglo-américains sur mer par rapport aux petites victoires remportées
sur le sol canado-américain. La bataille du 8 janvier 1815 est même
rétroportée avant la signature du traité de Gand! Les causes sont
d’ordre commercial (la rupture commerciale suite aux «Ordres en
Conseil». Conclusion tirée : a needless war. |
| Bataille de Queenston Heights et mort du général Brock |
 |
| Mort du général Robert Ross à la bataille de Baltimore |
Plus loin nous remontons dans l’historiographie américaine, plus la guerre de 1812 occupe un chapitre complet. Ici, on commence d’abord par parler des troubles indiens, les Shawnees de Tecumseh et de son demi-frère, le Prophète, sèment l’émoi parmi les pionniers américains à la frontière canadienne. Pendant ce temps, les causes de conflits avec l’Angleterre se multiplient. Dès 1811, l’ambassadeur Pinkney est rappelé à Washington et un combat maritime oppose les vaisseaux President et Little Belt. Comme le souligne l’historien Henry William Elson, «Le douzième Congrès se réunit en décembre 1811. Il différait grandement de ses prédécesseurs. On n’y retrouve plus l’esprit de temporisation; le Congrès n’est plus dominé par les Pères de la Révolution. Une nouvelle génération est en possession des affaires publiques. C’est surtout dans la Chambre que se manifeste le nouvel état d’esprit. Nous y trouvons une demi-douzaine de jeunes leaders, qui prirent la direction de la politique. C’étaient Henry Clay, du Kentucky, et John C. Calhoun, de la Caroline du Sud, qui allaient rester près d’un demi-siècle au premier rang de la vie nationale» (H. W. Elson. Histoire des États-Unis, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1930, p. 427). C'est la propagande
 et les manœuvres électorales des War Hawks qui devaient conduire aux hostilités. Le 18 juin 1812, «Madison hésitait. Il était presque aussi attaché à la paix que le grand Démorate qui l’avait précédé [Jefferson]. Mais une nouvelle élection approchait et les jeunes leaders du Congrès donnèrent à entendre au président qu’il ne devait pas compter sur leur appui, s’il ne consentait à déclarer la guerre. Madison céda. Pendant l’hiver, le Congrès vota l’augmentation de l’armée régulière et autorisa un emprunt de onze millions de dollars. Au début d’avril, un embargo de quatre-vingt dix jours fut lancé sur les navires, comme préliminaire à la déclaration de guerre. Un peu plus tard, le Congrès autorisa le Président à appeler sous les drapeaux cinquante mille miliciens. Le 1er juin, le président envoya au Congrès son discours sur la guerre, réclamant une déclaration de guerre immédiate. Il énumérait quatre causes principales : l’enrôlement forcé de nos marins, le harcèlement de nos navires marchands le long du littoral américain par les croiseurs britanniques, le blocus des côtes européennes en vertu duquel les vaisseaux américains avaient été capturés dans toutes les mers, et enfin les ordres en Conseil» (p. 428). Elson ajoute que la France avait vexé en bien des occasions la marine marchande américaine et la guerre aurait très bien pu se déclarer contre elle, mais comme «l’Angleterre était la mère-patrie; il était plus irritant de recevoir de sa part un traitement aussi rude et aussi impitoyable, que de la part de Napoléon» (p. 428). Encore, l’opinion américaine ne faisait-elle pas l’unanimité. La Nouvelle-Angleterre se positionna contre tandis que le Sud et l’Ouest, plus éloigné des champs de bataille, se positionnèrent pour. Le Centre vacilla et ce fut finalement la Pennsylvanie qui, en réélisant Madison, entraîna la guerre de 1812.
et les manœuvres électorales des War Hawks qui devaient conduire aux hostilités. Le 18 juin 1812, «Madison hésitait. Il était presque aussi attaché à la paix que le grand Démorate qui l’avait précédé [Jefferson]. Mais une nouvelle élection approchait et les jeunes leaders du Congrès donnèrent à entendre au président qu’il ne devait pas compter sur leur appui, s’il ne consentait à déclarer la guerre. Madison céda. Pendant l’hiver, le Congrès vota l’augmentation de l’armée régulière et autorisa un emprunt de onze millions de dollars. Au début d’avril, un embargo de quatre-vingt dix jours fut lancé sur les navires, comme préliminaire à la déclaration de guerre. Un peu plus tard, le Congrès autorisa le Président à appeler sous les drapeaux cinquante mille miliciens. Le 1er juin, le président envoya au Congrès son discours sur la guerre, réclamant une déclaration de guerre immédiate. Il énumérait quatre causes principales : l’enrôlement forcé de nos marins, le harcèlement de nos navires marchands le long du littoral américain par les croiseurs britanniques, le blocus des côtes européennes en vertu duquel les vaisseaux américains avaient été capturés dans toutes les mers, et enfin les ordres en Conseil» (p. 428). Elson ajoute que la France avait vexé en bien des occasions la marine marchande américaine et la guerre aurait très bien pu se déclarer contre elle, mais comme «l’Angleterre était la mère-patrie; il était plus irritant de recevoir de sa part un traitement aussi rude et aussi impitoyable, que de la part de Napoléon» (p. 428). Encore, l’opinion américaine ne faisait-elle pas l’unanimité. La Nouvelle-Angleterre se positionna contre tandis que le Sud et l’Ouest, plus éloigné des champs de bataille, se positionnèrent pour. Le Centre vacilla et ce fut finalement la Pennsylvanie qui, en réélisant Madison, entraîna la guerre de 1812.Manquant de combattants, s’engageant avec une opinion publique plutôt divisée sur la question, les Américains n'y allèrent pas avec cœur dans ce combat voulu par une minorité de War Hawks qui voulaient s’affirmer sur la scène politique nationale. Les combats sur mer, avons-nous dit, furent plus nombreux et plus décisifs que les combats terrestres. Washington fut prise et incendiée pour venger le pillage de York un an plus tôt et le gouvernement dut emprunter pour soutenir l’effort de guerre. «Les représentants des deux nations belligérantes s’étaient rencontrés à Gand, en Belgique, dans l’été de 1814. Les instructions que leur
 avaient données leurs gouvernements respectifs étaient telles que d’abord il parut impossible d’arriver à un arrangement. Les Anglais, entre autres choses, demandaient que l’Amérique cédât de vastes portions du New-York et du Maine septentrionnal, et réservât au Nord-Ouest un vaste territoire pour les Indiens. Mais sur la nouvelle de la défaite de Prevost dans le New-York, et de Ross à Baltimore, ils abandonnèrent leurs demandes extravagantes. Les Américains d’autre part cédèrent sur la question de l’enrôlement forcé. Le traité, dans sa forme définitive, est plus remarquable par ce qu’il omet que par ce qu’il contient. Ce n’était guère plus qu’une Convention réciproque de finir la guerre, dont les deux pays étaient las. La question de l’enrôlement forcé en était omise dans l’idée que, puisque les guerres européennes semblaient être finies, l’Angleterre n’aurait plus de raison de se livrer à cette pratique. Aucune des deux nations ne fit de cession de territoire. Le traité stipulait la restauration des frontières telles qu’elles existaient en 1783, ainsi que la paix avec les Indiens. Il réservait pour des arrangements futurs, les vieilles querelles de frontières et les questions de pêcheries, de même que le droit des Anglais de naviguer sur le Mississipi. Les deux Nations convinrent de faire tout leur possible pour introduire l’abolition totale du trafic des esclaves. La nouvelle de la paix et de la victoire de la Nouvelle-Orléans parvint dans les États du Nord a peu près en même temps, et grandes furent les réjouissances» (H. W. Elson. ibid. pp. 452-453).
avaient données leurs gouvernements respectifs étaient telles que d’abord il parut impossible d’arriver à un arrangement. Les Anglais, entre autres choses, demandaient que l’Amérique cédât de vastes portions du New-York et du Maine septentrionnal, et réservât au Nord-Ouest un vaste territoire pour les Indiens. Mais sur la nouvelle de la défaite de Prevost dans le New-York, et de Ross à Baltimore, ils abandonnèrent leurs demandes extravagantes. Les Américains d’autre part cédèrent sur la question de l’enrôlement forcé. Le traité, dans sa forme définitive, est plus remarquable par ce qu’il omet que par ce qu’il contient. Ce n’était guère plus qu’une Convention réciproque de finir la guerre, dont les deux pays étaient las. La question de l’enrôlement forcé en était omise dans l’idée que, puisque les guerres européennes semblaient être finies, l’Angleterre n’aurait plus de raison de se livrer à cette pratique. Aucune des deux nations ne fit de cession de territoire. Le traité stipulait la restauration des frontières telles qu’elles existaient en 1783, ainsi que la paix avec les Indiens. Il réservait pour des arrangements futurs, les vieilles querelles de frontières et les questions de pêcheries, de même que le droit des Anglais de naviguer sur le Mississipi. Les deux Nations convinrent de faire tout leur possible pour introduire l’abolition totale du trafic des esclaves. La nouvelle de la paix et de la victoire de la Nouvelle-Orléans parvint dans les États du Nord a peu près en même temps, et grandes furent les réjouissances» (H. W. Elson. ibid. pp. 452-453).Quel bilan notre historien trace-t-il de la Guerre de 1812? «La guerre, du côté anglais, fut une erreur
 lourde et coûteuse. La Grande-Bretagne n’acquit pas un pouce de terrain, n’établit pas un principe, et ne gagna pas un seul ami. Elle aurait pu, par quelques concessions légères, se concilier l’Amérique et s’en faire une alliée contre Napoléon. Elle aurait pu porter un rude coup à l’Empereur, en ouvrant ses ports à notre commerce, et en rendant ainsi inutiles toutes les prétentions de ce dernier à bloquer le littoral anglais. Mais elle laissa la querelle qu’elle avait contre nous dégénérer en guerre ouverte. Par là elle perdit son monopole des mers, sacrifia des milliers de vies et dépensa plus d’argent qu’il n’en eût fallu pour élever la paie de ses marins à un tel prix, qu’ils n’eussent plus eu envie de déserter; ainsi l’enrôlement forcé fût devenu inutile. Une des caractéristiques de cette guerre fut le haut pourcentage de morts parmi les chefs britanniques. Sept capitaines de vaisseaux furent tués dans l’action, outre les généraux Brock, Ross, Pakenham, Gibbs, Tecumseh, et sir Peter Parker et les autres chefs» (H. W. Elson. ibid. pp. 454-455). Elson établit ici un bilan lourd, complétant ce que l’historiographie anglaise tait pudiquement. D’accord avec les York Powell, Tout et Trevelyan, Elson souligne l’entêtement du gouvernement britannique dans les affaires commerciales qui l’opposaient aux États-Unis entraînant ainsi une surenchère des positions qui ne purent que débloquer sur la guerre ouverte.
lourde et coûteuse. La Grande-Bretagne n’acquit pas un pouce de terrain, n’établit pas un principe, et ne gagna pas un seul ami. Elle aurait pu, par quelques concessions légères, se concilier l’Amérique et s’en faire une alliée contre Napoléon. Elle aurait pu porter un rude coup à l’Empereur, en ouvrant ses ports à notre commerce, et en rendant ainsi inutiles toutes les prétentions de ce dernier à bloquer le littoral anglais. Mais elle laissa la querelle qu’elle avait contre nous dégénérer en guerre ouverte. Par là elle perdit son monopole des mers, sacrifia des milliers de vies et dépensa plus d’argent qu’il n’en eût fallu pour élever la paie de ses marins à un tel prix, qu’ils n’eussent plus eu envie de déserter; ainsi l’enrôlement forcé fût devenu inutile. Une des caractéristiques de cette guerre fut le haut pourcentage de morts parmi les chefs britanniques. Sept capitaines de vaisseaux furent tués dans l’action, outre les généraux Brock, Ross, Pakenham, Gibbs, Tecumseh, et sir Peter Parker et les autres chefs» (H. W. Elson. ibid. pp. 454-455). Elson établit ici un bilan lourd, complétant ce que l’historiographie anglaise tait pudiquement. D’accord avec les York Powell, Tout et Trevelyan, Elson souligne l’entêtement du gouvernement britannique dans les affaires commerciales qui l’opposaient aux États-Unis entraînant ainsi une surenchère des positions qui ne purent que débloquer sur la guerre ouverte.Mais que dit Elson à propos du bilan américain, car après tout, il ne faut pas oublier que ce sont eux qui déclarèrent la guerre: «Les Américains, au contraire, gagnèrent beaucoup à la guerre bien que cela n’apparut pas dans le traité, ni même au début à l’observateur superficiel. La guerre avait été coûteuse aussi pour eux, ils avaient perdu trente mille hommes et cent millions de dollars. L’argent s’était déprécié au point de menacer tous les intérêts industriels et commerciaux du pays. La capitale avait été prise et incendiée. Une partie
 des citoyens s’étaient rangés parmi les mécontents et avaient aidé et soutenu l’ennemi. Mais malgré tout, la guerre fut heureuse pour les États-Unis. Elle amena l’indépendance commerciale et la séparation définitive d’avec les affaires européennes, absolument nécessaire à un gouvernement national. […] sans monarque, nous avions résisté honorablement sur terre pendant près de trois ans, et mieux que résisté, sur mer, à la plus grande puissance navale du globe; le monde entier restait frappé de surprise. Avant cette guerre, personne n’avait considéré les États-Unis comme une puissance de premier ordre. Depuis lors, on n’a jamais cessé de la considérer comme telle. À ce moment, les Nations commencèrent à comprendre que l’Amérique était une géante adolescente, qui exigeait leur respect et, depuis, elles ne lui ont jamais refusé» (H. W. Elson. ibid. p. 455). Elson amplifie sans doute la reconnaissance européenne. Certes, le fait d’avoir affronté la flotte britannique était remarquable, mais elle ne gagna réellement que parce que cette flotte était davantage occupée à forcer le blocus continental de Napoléon. Toutes les forces britanniques n’étaient pas dans le plateau de la balance de la guerre américaine.
des citoyens s’étaient rangés parmi les mécontents et avaient aidé et soutenu l’ennemi. Mais malgré tout, la guerre fut heureuse pour les États-Unis. Elle amena l’indépendance commerciale et la séparation définitive d’avec les affaires européennes, absolument nécessaire à un gouvernement national. […] sans monarque, nous avions résisté honorablement sur terre pendant près de trois ans, et mieux que résisté, sur mer, à la plus grande puissance navale du globe; le monde entier restait frappé de surprise. Avant cette guerre, personne n’avait considéré les États-Unis comme une puissance de premier ordre. Depuis lors, on n’a jamais cessé de la considérer comme telle. À ce moment, les Nations commencèrent à comprendre que l’Amérique était une géante adolescente, qui exigeait leur respect et, depuis, elles ne lui ont jamais refusé» (H. W. Elson. ibid. p. 455). Elson amplifie sans doute la reconnaissance européenne. Certes, le fait d’avoir affronté la flotte britannique était remarquable, mais elle ne gagna réellement que parce que cette flotte était davantage occupée à forcer le blocus continental de Napoléon. Toutes les forces britanniques n’étaient pas dans le plateau de la balance de la guerre américaine.«Notre succès, poursuit Elson, fut également remarquable au point de vue des affaires intérieures. Pour la première fois le peuple commença à éprouver un sentiment national. Il comprit mieux qu’auparavant que le pays avait un avenir, une destinée, qu’aucune intrusion européenne ne pouvait troubler. Les partis français et anglais disparurent de notre politique. Peu après la fin de la guerre,
 |
| Uncle Sam, d'après le fournisseur Samuel Wilson |
D’autres historiens américains, Nye et Morpurgo, s’étendent sur l’animosité virulente que véhicula la presse américaine fournie par les discours des War Hawks, Calhoun et Clay. Également sur les négociations ouvertes par Madison avec Napoléon qui se retournèrent finalement contre lui. Dès les débuts, les officiels américains ignoraient où le déclenchement de cette guerre les entraînerait :«Ainsi qu’elle avait commencé, la guerre de 1812 se poursuivit sans nécessité ni profit. L’un de ses principaux motifs se trouvait éteint dès avant que le premier coup de feu ne fût tiré. Les États dont l’économie vitale dépendait du commerce se déclaraient violemment hostiles au conflit. Pour empêcher qu’il ne se poursuivît ils iraient, s’il le fallait, jusqu’à la trahison et la sécession. L’ennemi, le Britannique, témoignait généralement d’une désaffection parfaite pour ces campagnes lointaines, ces doléances inaccessibles. Ou bien il les regardait comme une diversion vaine et impertinente au conflit essentiel, la guerre avec Napoléon. Aucun des deux belligérants ne gagna, en l’affaire, rien qui fût de valeur. Et la plus notable bataille, ô ironie, fut livrée après la conclusion du traité de paix» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. Histoire des États-Unis, Paris, Gallimard, Col. La suite des temps, 1961, pp. 240-241). Causes et bilans ramenés à la même inutilité, plus l’ironie du massacre de la Nouvelle-Orléans. Pourtant, ils reconnaissent que
 les War Hawks s’étaient lourdement trompés en croyant que le Canada «se laisserait cueillir comme un fruit mûr» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 242). Mais là où Nye et Morpurgo exposent le gain américain, c’est lorsque nous comparons ce paragraphe au bilan dressé par Elson, des officiers supérieurs britanniques morts aux combats : «Et cependant, pour l’avenir du nationalisme américain, la guerre de 1812 revêtait une signification immense. Si divisé fût-il touchant l’idée qu’il se faisait de la justice de sa cause, le peuple américain surmontait, à l’unisson, des difficultés énormes pour contenir, une fois de plus, l’une des plus grandes puissances. Sa modeste marine y trouva une organisation cohérente et les prémices d’une splendide tradition. Les Stephen Decatur, les Oliver Hazard Perry devinrent, dans les années futures, des stimulants de la fierté américaine au même titre que les Drake et les Nelson pour les Anglais. Et, au cours de la dernière bataille avortée, la bataille de la Nouvelle-Orléans, l’Ouest suscita un héros, Andrew Jackson, l’un des épigones des leaders agrariens» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 241). C’est dire que si la Guerre de 1812 n’apporta rien à la fierté nationale britannique, elle fournit beaucoup de héros à celle des Américains.
les War Hawks s’étaient lourdement trompés en croyant que le Canada «se laisserait cueillir comme un fruit mûr» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 242). Mais là où Nye et Morpurgo exposent le gain américain, c’est lorsque nous comparons ce paragraphe au bilan dressé par Elson, des officiers supérieurs britanniques morts aux combats : «Et cependant, pour l’avenir du nationalisme américain, la guerre de 1812 revêtait une signification immense. Si divisé fût-il touchant l’idée qu’il se faisait de la justice de sa cause, le peuple américain surmontait, à l’unisson, des difficultés énormes pour contenir, une fois de plus, l’une des plus grandes puissances. Sa modeste marine y trouva une organisation cohérente et les prémices d’une splendide tradition. Les Stephen Decatur, les Oliver Hazard Perry devinrent, dans les années futures, des stimulants de la fierté américaine au même titre que les Drake et les Nelson pour les Anglais. Et, au cours de la dernière bataille avortée, la bataille de la Nouvelle-Orléans, l’Ouest suscita un héros, Andrew Jackson, l’un des épigones des leaders agrariens» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 241). C’est dire que si la Guerre de 1812 n’apporta rien à la fierté nationale britannique, elle fournit beaucoup de héros à celle des Américains. un détachement anglais commandé par le général Ross et venant directement de France se mit à harceler des points d’élection sur le littoral des États-Unis. Débarquées à Maryland, les troupes avancèrent ne rencontrant qu’une opposition sporadique. Leur objectif était la capitale. Elles établirent leur camp en face de la cité. Dans un accès de vindicte les hommes pénétrèrent à Washington, se livrant à des pillages évalués à un million et demi de dollars. À la Chambre des représentants, l’amiral Cockburn monta à la tribune présidentielle: “Faut-il brûler ce havre de la démocratie yankee? Tout le monde répondra : Oui!” Et tout le monde répondit : Oui. Il mit le feu, de gaîté de cœur, à des édifices publics, voire à des quartiers résidentiels, regagna calmement la flotte britannique et prit le large. “Cette organisation bancale”, fulminait le Times, “se trouve à la veille de son déclin. Il faut promptement délivrer le monde de l’exemple pernicieux d’un gouvernement fondé sur la rébellion démocratique”. Et l’on avait bien, en effet, le sentiment de cette délivrance lorsque Madison et son
un détachement anglais commandé par le général Ross et venant directement de France se mit à harceler des points d’élection sur le littoral des États-Unis. Débarquées à Maryland, les troupes avancèrent ne rencontrant qu’une opposition sporadique. Leur objectif était la capitale. Elles établirent leur camp en face de la cité. Dans un accès de vindicte les hommes pénétrèrent à Washington, se livrant à des pillages évalués à un million et demi de dollars. À la Chambre des représentants, l’amiral Cockburn monta à la tribune présidentielle: “Faut-il brûler ce havre de la démocratie yankee? Tout le monde répondra : Oui!” Et tout le monde répondit : Oui. Il mit le feu, de gaîté de cœur, à des édifices publics, voire à des quartiers résidentiels, regagna calmement la flotte britannique et prit le large. “Cette organisation bancale”, fulminait le Times, “se trouve à la veille de son déclin. Il faut promptement délivrer le monde de l’exemple pernicieux d’un gouvernement fondé sur la rébellion démocratique”. Et l’on avait bien, en effet, le sentiment de cette délivrance lorsque Madison et son  gouvernement réintégrèrent à tâtons leur capitale carbonisée» (p. 246). C’était à ce moment précis que les plénipotentiaires britanniques à Gand exigèrent les mesures jugées déraisonnables par Elson. L’humeur américaine était au plus bas, mais c’est aussi à ce moment que Francis Scott Key composa son refrain, ce qui signifiait qu’au creux de l’abîme, la guerre prenait un sens qu’elle n’avait pas eu jusque-là. Après la mort de Ross et la défaite britannique au Lac Champlain, ne restait plus qu’à signer le traité de paix. «Traité étrange, épilogue d’une guerre étrange. Et pas plus que la guerre il n’était concluant. Gand marqua néanmoins une étape dans les relations entre les deux signataires. Il reconnaissait, en effet, l’importance des conversations basées sur la bienveillance mutuelle. Chacun des chefs de litige fut reporté à une date ultérieure aux fins de discussion et quatre commissions furent créées pour fixer la frontière entre les États-Unis et le Canada. “Il régnera une paix inébranlable et universelle entre Sa Majesté britannique et les États-Unis”; tel était le préambule du premier article. À l’encontre de la plupart des contrats internationaux les clauses du traité de Gand se révélèrent d’un bon usage» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 247), bien qu’ils furent légèrement ébranlés lorsque l’Angleterre prit fait et cause pour le Sud lors de la Guerre de Sécession.
gouvernement réintégrèrent à tâtons leur capitale carbonisée» (p. 246). C’était à ce moment précis que les plénipotentiaires britanniques à Gand exigèrent les mesures jugées déraisonnables par Elson. L’humeur américaine était au plus bas, mais c’est aussi à ce moment que Francis Scott Key composa son refrain, ce qui signifiait qu’au creux de l’abîme, la guerre prenait un sens qu’elle n’avait pas eu jusque-là. Après la mort de Ross et la défaite britannique au Lac Champlain, ne restait plus qu’à signer le traité de paix. «Traité étrange, épilogue d’une guerre étrange. Et pas plus que la guerre il n’était concluant. Gand marqua néanmoins une étape dans les relations entre les deux signataires. Il reconnaissait, en effet, l’importance des conversations basées sur la bienveillance mutuelle. Chacun des chefs de litige fut reporté à une date ultérieure aux fins de discussion et quatre commissions furent créées pour fixer la frontière entre les États-Unis et le Canada. “Il régnera une paix inébranlable et universelle entre Sa Majesté britannique et les États-Unis”; tel était le préambule du premier article. À l’encontre de la plupart des contrats internationaux les clauses du traité de Gand se révélèrent d’un bon usage» (R. B. Nye et J. E. Morpurgo. ibid. p. 247), bien qu’ils furent légèrement ébranlés lorsque l’Angleterre prit fait et cause pour le Sud lors de la Guerre de Sécession.La consolidation nationale attribuée à la Guerre de 1812 suppose que tout n’allait pas si bien dans les États-Unis du début du XIXe siècle. En fait, les menaces de Sécession pleuvaient de part et d’autres, et il fallait la souplesse d’esprit d’un Thomas Jefferson
 pour tenir le tout lier. Les enrôlements forcés de marins avaient commencé sous sa présidence et Jefferson obligea «les États récalcitrants de la Nouvelle-Angleterre à accepter une rupture économique avec la Grande-Bretagne; plus désinvolte encore envers les intérêts économiques des États commerciaux, Madison entraîna le pays dans la guerre contre la Grande-Bretagne en 1812. En contraignant les États nordistes, le gouvernement s’assurait le soutien total des sudistes, qui précédemment s’étaient faits les champions des droits des États, de sorte que les gens de Nouvelle-Angleterre, anciens nationalistes ardents, parlèrent de sécession et employèrent le langage des résolutions de Virginie et du Kentucky. Sous l’égide du républicanisme de Jefferson, il apparut une deuxième vague de nationalisme… : une route nationale fut construite à travers les Alleghanys, une seconde Banque Nationale fut établie, un tarif fut voté pour protéger les industriels, et un nouveau programme d’aide nationale pour les communications intérieures fut mis à l’étude», rappelle W. R. Brock (Introduction à l'histoire américaine, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1962. pp. 81-82), soulignant à quel point les tensions entre les autonomies locales et l’autonomie nationale s’affrontaient en tous points. La Guerre de 1812 donna une impulsion décisive à l’autonomie nationale, impulsion qui s’achèvera dans la tragique guerre de 1861-1865.
pour tenir le tout lier. Les enrôlements forcés de marins avaient commencé sous sa présidence et Jefferson obligea «les États récalcitrants de la Nouvelle-Angleterre à accepter une rupture économique avec la Grande-Bretagne; plus désinvolte encore envers les intérêts économiques des États commerciaux, Madison entraîna le pays dans la guerre contre la Grande-Bretagne en 1812. En contraignant les États nordistes, le gouvernement s’assurait le soutien total des sudistes, qui précédemment s’étaient faits les champions des droits des États, de sorte que les gens de Nouvelle-Angleterre, anciens nationalistes ardents, parlèrent de sécession et employèrent le langage des résolutions de Virginie et du Kentucky. Sous l’égide du républicanisme de Jefferson, il apparut une deuxième vague de nationalisme… : une route nationale fut construite à travers les Alleghanys, une seconde Banque Nationale fut établie, un tarif fut voté pour protéger les industriels, et un nouveau programme d’aide nationale pour les communications intérieures fut mis à l’étude», rappelle W. R. Brock (Introduction à l'histoire américaine, Paris, Payot, Col. Bibliothèque historique, 1962. pp. 81-82), soulignant à quel point les tensions entre les autonomies locales et l’autonomie nationale s’affrontaient en tous points. La Guerre de 1812 donna une impulsion décisive à l’autonomie nationale, impulsion qui s’achèvera dans la tragique guerre de 1861-1865.Franck L. Schoell rappelle ce point sur lequel Elson commençait son chapitre sur la guerre de 1812 : les incursions indiennes en territoire américain. Comme le traité de paix passé en 1763 entre les tribus autochtones et le gouvernement vainqueur de la Guerre de Sept Ans donnait la responsabilité des affaires indiennes au gouvernement britannique, c’était là un grief d’autonomie locale qui s’érigeait contre les Britanniques du Canada : «Ils étaient particulièrement violents chez les colons du Nord-Ouest, dont la voix se faisait entendre de plus en plus haut au Congrès. Quotidiennement aux prises avec les Indiens, ceux-ci continuaient de les croire soutenus en sous-main par des agents britanniques venus du Canada. En fait, impitoyablement refoulés vers l’Ouest par les pionniers, dépossédés de leurs terrains de chasse, les Indiens avaient de périodiques sursauts de résistance et les dissensions entre tribus faisaient place à de véritables coalitions ourdies contre les Blancs. L’une des plus redoutables venait de l’être à l’instigation d’un chef shawnee très capable, Tecumseh. La confédération qu’il avait réussi à mettre sur pied comprenait non seulement les tribus du territoire du Nord-Ouest, mais aussi celles du bassin du bas Mississippi. La demi-victoire que le gouverneur de l’Indiana W. H. Harrison remporta à Tippecanoe, en novembre 1815, sur les guerriers Indiens ne mit nullement fin aux embûches meurtrières. À supposer que les Anglais n’eussent pas fourni des armes aux “sauvages” comme on le croyait, il paraissait évident que Tecumseh n’aurait pas attaqué s’il n’avait pas cru pouvoir compter sur une assistance britannique» (F. L. Schoell. Histoire des États-Unis, Paris, Payot, Col. P.B.P. #80, 1965, p. 146). Le problème des frontières,
 c’était donc avant tout celui de la migration des autochtones devant la conquête des pionniers. Ce sur quoi le traité de Gand passa silence. «Chacun des deux belligérants avait ainsi sauvé la face et ils allaient désormais pouvoir vivre côte à côte dans une amitié qui ne s’est pas démentie depuis lors», […] «du côté américain, cependant, la guerre avait eu des effets tangibles, tout au moins sur l’éternel, mais mouvant front indien. Dans le Nord-Ouest la confédération de tribus organisée par Tecumseh avait été défaite et dispersée, et son chef tué (5 octobre 1813). Dans le Sud, les Indiens Creek, qui avaient répondu à l’appel de Tecumseh, avaient été, après plusieurs mois d’une lutte féroce, anéantis à la bataille de Talapoosa (mars 1814) par les milices du Tennessee que Jackson avait commandées avant de devenir le chef de l’armée régulière. Les survivants furent contraints de signer le traité en quelque sorte rituel par lequel ils cédaient aux Blancs presque tout leur territoire» (F. L. Schoell. ibid. p. 148). En un sens, s’il ne fut ni vainqueur ni vaincu entre Britanniques et Américains, il y eut un groupe qui fut littéralement battu dans la Guerre de 1812 : les Amérindiens.
c’était donc avant tout celui de la migration des autochtones devant la conquête des pionniers. Ce sur quoi le traité de Gand passa silence. «Chacun des deux belligérants avait ainsi sauvé la face et ils allaient désormais pouvoir vivre côte à côte dans une amitié qui ne s’est pas démentie depuis lors», […] «du côté américain, cependant, la guerre avait eu des effets tangibles, tout au moins sur l’éternel, mais mouvant front indien. Dans le Nord-Ouest la confédération de tribus organisée par Tecumseh avait été défaite et dispersée, et son chef tué (5 octobre 1813). Dans le Sud, les Indiens Creek, qui avaient répondu à l’appel de Tecumseh, avaient été, après plusieurs mois d’une lutte féroce, anéantis à la bataille de Talapoosa (mars 1814) par les milices du Tennessee que Jackson avait commandées avant de devenir le chef de l’armée régulière. Les survivants furent contraints de signer le traité en quelque sorte rituel par lequel ils cédaient aux Blancs presque tout leur territoire» (F. L. Schoell. ibid. p. 148). En un sens, s’il ne fut ni vainqueur ni vaincu entre Britanniques et Américains, il y eut un groupe qui fut littéralement battu dans la Guerre de 1812 : les Amérindiens. |
| USS Constitution capturant la Guerriere |
 |
| Victoire anglaise de Queenston Heights |
Aujourd’hui, aux yeux des historiens, ce qui apparaît le plus paradoxale de la Guerre de 1812, c’est l’opposition entre la banalité des récriminations américaines et le grand bénéfice que les États-Unis tirèrent de cette needless war. L’historien français André Kaspi, auteur d’une synthèse sur l’histoire américaine, insiste à son tour sur les querelles économiques qui précédèrent la déclaration de guerre : «À partir de mai 1810 (Macon’s Bill No. 2), les États-Unis reprennent leur commerce avec la France et l’Angleterre, tout en déclarant que si la France abroge ses décrets qui instituent le blocus, les États-Unis boycotteront les importations britanniques. Napoléon fait un geste à l’endroit des Américains et en mars 1811 l’Angleterre ne peut plus exporter vers les États-Unis. L’année suivante, le président Madison entraîne son pays dans un conflit armé avec l’ancienne métropole. Sans doute est-ce pour en finir avec cette guéguerre économique, pour protester contre le recrutement forcé des Américains dans la marine britannique. Sans doute aussi parce qu’aux États-Unis ils sont nombreux ceux qui pensent que le Canada et la Floride devraient être annexés à l’Union et qu’il est temps de profiter des difficultés de l’Angleterre en Europe continentale. Sans doute enfin l’arrogance de la Grande-Bretagne est-elle devenue insupportable. Les Américains ont le sentiment que leur indépendance n’a toujours pas été acceptée par l’ancienne métropole. Il n’est pas étonnant que cette guerre anglo-américaine ait été baptisée la “deuxième guerre d’Indépendance”» (A. Kaspi. Les Américains, t. 1: Naissance et essor des États-Unis 1607-1945, p. 124). Voilà. Rien qu’une guégerre associée à un complexe d’Œdipe national où le fils libéré reviendrait hanté le Pater familias anglo-saxon. Et Kaspi de terminer : «À la réflexion, les
 États-Unis ont obtenu mieux. L’Angleterre a compris que ces “damnés Yankees” méritent le respect, qu’il faut compter avec eux sur le continent américain et qu’au fond en dépit d’un vieux fond de méfiance, voire d’hostilité, inaugurerait entre les deux nations un “grand rapprochement”. Quant aux Américains, ils ont appris, depuis une trentaine d’années, à ne plus se sentir anglais. Au sein de leur immense pays dont la superficie a doublé par l’acquisition de la Louisiane, ils prennent conscience maintenant de leur force, démographique, économique, commerciale. En ce sens, l’année 1815 est peut-être plus importante que l’année 1783. Elle symbolise la fin du commencement et inaugure une autre période de l’histoire des États-Unis» (A. Kaspi. ibid. p. 125). Voilà qui est manifeste. En plaçant 1815 au-devant de 1783 (date du traité de Versailles qui reconnaissait l’indépendance des États-Unis), c’est peut-être en 1815 que les Américains finiront par fêter la Guerre de 1812?
États-Unis ont obtenu mieux. L’Angleterre a compris que ces “damnés Yankees” méritent le respect, qu’il faut compter avec eux sur le continent américain et qu’au fond en dépit d’un vieux fond de méfiance, voire d’hostilité, inaugurerait entre les deux nations un “grand rapprochement”. Quant aux Américains, ils ont appris, depuis une trentaine d’années, à ne plus se sentir anglais. Au sein de leur immense pays dont la superficie a doublé par l’acquisition de la Louisiane, ils prennent conscience maintenant de leur force, démographique, économique, commerciale. En ce sens, l’année 1815 est peut-être plus importante que l’année 1783. Elle symbolise la fin du commencement et inaugure une autre période de l’histoire des États-Unis» (A. Kaspi. ibid. p. 125). Voilà qui est manifeste. En plaçant 1815 au-devant de 1783 (date du traité de Versailles qui reconnaissait l’indépendance des États-Unis), c’est peut-être en 1815 que les Américains finiront par fêter la Guerre de 1812?Pour Howard Zinn, auteur d’une très «populaire» Histoire populaire des États-Unis, la Guerre de 1812 est entièrement absorbée par les guerres indiennes, dans lesquelles Jackson fit non seulement son profit thymotique, mais également des profits de terres, d’argent et d’esclaves. L’auteur de gauche ramène la Guerre de 1812 en une seule phrase: «[Jackson] devint un véritable héros au cours de la guerre de 1812, qui ne fut pas - quoi qu’en disent les manuels d’histoire - un simple réflexe de survie de la part de la jeune nation face à l’agrssivité des Anglais, mais une véritable guerre d’expansion vers la Floride, le Canada et les territoires indiens» (H. Zinn. Une histoire populaire des États-Unis, Marseille/Montréal, Agone/Lux, 2002, p. 151). Bref, la Guerre de 1812 marquerait le départ de l’impérialisme formel des américains, ce que concrétisent l’idéologie de la Manifest Destiny et la Guerre du Mexique de 1848.
Que conclure de ce survol de l’historiographie américaine? Tandis que l'historiographie britannique passait assez vite sur les causes économiques du conflit et se bornait à tirer un bilan de l'inutilité de cette guerre; pour sa part, l'historiographie américaine a développé, au cours du dernier siècle, une vision positive de la Guerre de 1812. Certes, les États-Unis ont peu gagné au traité de Gand, sinon le statu quo ante bellum, alors qu'ils auraient pu perdre beaucoup si Prevost et Ross avaient réussi à mettre à genoux le gouvernement de Washington, dont la capitale avait déjà été incendiée. Or les défaites britanniques ont non seulement éteintes les demandes anglaises, mais ont stimulé un nouveau sentiment national, un sentiment appelé à se dresser de plus en plus devant les forces régionales. Dans l'issue de la Guerre de 1812, on sent déjà poindre l'inexorable aporie devant mener à la Guerre civile, un demi-siècle plus tard. Ceci pourrait expliquer le sentiment trouble des Américains devant une Guerre qu'ils cherchent maintenant à minimiser dans la mémoire nationale. La Guerre d'Indépendance est de moins en moins une révolution américaine; les champs de bataille de la Guerre de Sécession ont recouverts les accrochages de 1812 et la terrible guerre avec le Mexique de 1848. Enfin, les guerres du XXe siècle, en particulier la Seconde Guerre mondiale, la Guerre de Corée et la Guerre du Vietnam ont fourni une épopée militaire refoulant dans l'insignifiance les défaites terrestres et l'humiliation de l'incendie de la résidence présidentielle qui, depuis l'époque, porte le nom de Maison-Blanche. L'image de l'Oncle Sam, qui devait progressivement succéder à celle de Brother Jonathan comme idiosyncrasie nationale et l'hymne américain sont tous des produits de cette Guerre de 1812, qui, ainsi, complètent l'œuvre inachevée de la Révolution américaine.
c) chez les Canadiens:
Nous voici rendu de plein pied sur le champ de l’historiographie canadienne. Après la Britannique et l’Américaine, que nous dit-elle de la Guerre de 1812; qu’évoque-t-elle à notre conscience celle que les principaux intéressés reconnaissent comme une needless war et que le gouvernement conservateur Harper est prêt à célébrer à coups de gros millions de dollars?
Il faut bien commencer par le commencement, et dans l’historiographie canadienne aussi bien que québécoise, le commencement, c’est François-Xavier Garneau. Garneau, qui avait 3 ans lorsque débuta la guerre, s’est informé auprès des sources britanniques et américaines de son temps. Le chapitre premier de son livre quatorze, des pages 491 à 544 du volume 2 de son Histoire du Canada (édition française de 1920), accorde donc une place très importante à cette guerre, contrairement aux historiens nationalistes actuels qui, suivant Jacques Lacoursière, minimisent l’importance de cette guerre dans l’histoire du Québec. Car c’est avant tout du point de vue des Canadiens-Français que Garneau écrit son récit. Il est le premier, parmi nos historiens choisis, à remarquer très tôt l’apparition d’une perplexité dans le cours de l’engagement américain, surtout après la violente propagande que les War Hawks avaient exercée sur la population des États-Unis. Garneau écrit ainsi, aussi philosophe qu’historien: «Le mobile des hommes d’aujourd’hui est surtout un intérêt froid et calculateur. C’est le seul des citoyens de la République américaine. La guerre du Canada, après la première ardeur passée, parut une spéculation hasardeuse. Aussi, craignant de trop s’aventurer, ce peuple marcha-t-il avec précaution; par suite la guerre de 1812 fut un ensemble d’escarmouches, où il se cueillit peu de lauriers des deux côtés. Engagée comme elle l’était en Europe, l’Angleterre résolut de se tenir d’abord sur la défensive en Amérique. Ce plan était le seul du reste qu’elle pût suivre avec les forces dont elle disposait. L’immensité de la frontière
 coloniale rendait sa situation d’autant plus difficile que le Saint-Laurent est fermé l’hiver par les glaces, et que la partie de son territoire que baigne l’Océan était séparée du Canada par des forêts et de vastes territoires inhabités. Le courage des colons et le peu de secours qu’elle pourrait leur envoyer devaient former la principale barrière» (F.-X. Garneau. Histoire du Canada, t. 2, Paris, Librairie Félix Alcan, 1920, p. 495) Garneau situe ici le conflit dans son contexte géographique proprement nord-américain (l’hiver, le faible taux démographique, les communications difficiles) et diminue l’argument américain de «l’agressivité» britannique, qui se situait peut-être à Londres mais ni à Québec ni à York. C’est donc bien une guerre défensive dans laquelle vont s’engager les Canadiens en 1812. Avec résignation mais fermement, le gouverneur George Prevost et les députés de l’Assemblée législative recrutèrent les miliciens essentiels à la protection du territoire de la colonie britannique. Le clergé se mobilisa pour encourager les paroissiens à soutenir le gouvernement. Garneau insiste: «Les dispositions militaires prises en Canada furent entièrement des moyens de défensive. La tâche paraissait plus difficile qu’elle ne l’était en réalité, car le gouvernement de Washington allait conduire toute cette guerre avec l’inexpérience et la timidité d’un état-major bourgeois. Les efforts de la République, durant la guerre de 1812, se perdirent dans une multitude de petits chocs, sur une frontière de trois à quatre cents lieues, et il est difficile de dire ce qu’elle attendait de cette tactique» (F.-X. Garneau. ibid. p. 502). Nous retrouvons ici l’étrange stratégie soulignée par Maurois.
coloniale rendait sa situation d’autant plus difficile que le Saint-Laurent est fermé l’hiver par les glaces, et que la partie de son territoire que baigne l’Océan était séparée du Canada par des forêts et de vastes territoires inhabités. Le courage des colons et le peu de secours qu’elle pourrait leur envoyer devaient former la principale barrière» (F.-X. Garneau. Histoire du Canada, t. 2, Paris, Librairie Félix Alcan, 1920, p. 495) Garneau situe ici le conflit dans son contexte géographique proprement nord-américain (l’hiver, le faible taux démographique, les communications difficiles) et diminue l’argument américain de «l’agressivité» britannique, qui se situait peut-être à Londres mais ni à Québec ni à York. C’est donc bien une guerre défensive dans laquelle vont s’engager les Canadiens en 1812. Avec résignation mais fermement, le gouverneur George Prevost et les députés de l’Assemblée législative recrutèrent les miliciens essentiels à la protection du territoire de la colonie britannique. Le clergé se mobilisa pour encourager les paroissiens à soutenir le gouvernement. Garneau insiste: «Les dispositions militaires prises en Canada furent entièrement des moyens de défensive. La tâche paraissait plus difficile qu’elle ne l’était en réalité, car le gouvernement de Washington allait conduire toute cette guerre avec l’inexpérience et la timidité d’un état-major bourgeois. Les efforts de la République, durant la guerre de 1812, se perdirent dans une multitude de petits chocs, sur une frontière de trois à quatre cents lieues, et il est difficile de dire ce qu’elle attendait de cette tactique» (F.-X. Garneau. ibid. p. 502). Nous retrouvons ici l’étrange stratégie soulignée par Maurois.Comme l’expérience de 1775 l’avait enseignée, la rivière Richelieu avait de bonnes chances de servir à nouveau de voie de pénétration aux armées américaines. Aussi, les corps de milices s’organisèrent-ils à la frontière du lac Champlain. «Cependant les Américains montraient sur cette
 frontière, comme sur celle du Haut-Canada, beaucoup d’hésitations dans leurs mouvements. Il n’y avait encore eu que de petites escarmouches, lorsque le général Dearborn sembla enfin vouloir s’ébranler. Salaberry, qui commandait nos avant-postes, s’était fortifié à la rivière Lacolle. Le matin du 20 novembre (1812), avant le jour, une de ses gardes avancées fut assaillie par quatorze cents fantassins et quelques cavaliers, qui avaient traversé la rivière par deux gués à la fois; mais en voulant envelopper cette garde, les ennemis se fusillèrent entre eux dans l’obscurité, ce qui détermina aussitôt leur retraite. Dès que la nouvelle de cette attaque parvint à Montréal, le colonel Deschambault eut ordre de traverser le fleuve à Lachine et de marcher au village d’Acadie avec les milices de la Pointe-Claire, de la rivière du Chêne, de Vaudreuil et de la Longue-Pointe; une partie de celles de la ville de Montréal était passé à Longueuil et à Laprairie; toute la milice du district était déjà sur pied, prête à courir aux points menacés. Soit que Dearborn fût intimidé par ces mouvements, soit qu’il n’entrât point dans ses plans d’envahir alors le Canada, il se retira dans ses quartiers de Plattsburg et de Burlington, sur le lac Champlain, pour y passer l’hiver» (F.-X. Garneau. ibid. pp. 507-508). L’impréparation des troupes américaines et la position défensive prise par les forces canadiennes pose l’essentiel de la dynamique des combats qui s’étireront jusqu’en 1814.
frontière, comme sur celle du Haut-Canada, beaucoup d’hésitations dans leurs mouvements. Il n’y avait encore eu que de petites escarmouches, lorsque le général Dearborn sembla enfin vouloir s’ébranler. Salaberry, qui commandait nos avant-postes, s’était fortifié à la rivière Lacolle. Le matin du 20 novembre (1812), avant le jour, une de ses gardes avancées fut assaillie par quatorze cents fantassins et quelques cavaliers, qui avaient traversé la rivière par deux gués à la fois; mais en voulant envelopper cette garde, les ennemis se fusillèrent entre eux dans l’obscurité, ce qui détermina aussitôt leur retraite. Dès que la nouvelle de cette attaque parvint à Montréal, le colonel Deschambault eut ordre de traverser le fleuve à Lachine et de marcher au village d’Acadie avec les milices de la Pointe-Claire, de la rivière du Chêne, de Vaudreuil et de la Longue-Pointe; une partie de celles de la ville de Montréal était passé à Longueuil et à Laprairie; toute la milice du district était déjà sur pied, prête à courir aux points menacés. Soit que Dearborn fût intimidé par ces mouvements, soit qu’il n’entrât point dans ses plans d’envahir alors le Canada, il se retira dans ses quartiers de Plattsburg et de Burlington, sur le lac Champlain, pour y passer l’hiver» (F.-X. Garneau. ibid. pp. 507-508). L’impréparation des troupes américaines et la position défensive prise par les forces canadiennes pose l’essentiel de la dynamique des combats qui s’étireront jusqu’en 1814.C’est alors que l’essentiel de la force de pénétration américaine se déplaça vers les Grands Lacs et par le fait même, le Haut-Canada. Ce sont ces événements que le gouvernement conservateur a en tête lorsqu’il entend célébrer le bicentenaire. Le lac Érié, le lac Ontario devinrent des lacs de batailles, comme le général Harrison et ses officiers
 traversèrent la frontière afin de poursuivre les Amérindiens qui venaient faire des incursions sur le territoire américain. C’est dans ce contexte que le commandant Brock et le chef Tecumseh conclurent l’accord célèbre. À la fin de 1813, Garneau note: «On touchait à la fin de la deuxième année de la guerre. Où en étaient alors les parties belligérantes? Après de multiples petits combats, dont la diversité embarrasse, dont le but est difficile à démêler, le résultat de la campagne semblait favorable aux Américains; mais c’était tout. S’ils occupaient la frontière de Niagara, leurs généraux, trouvant bientôt leurs entreprises de conquête au-dessus de leurs forces, avaient résigné le commandement. Le secrétaire de la guerre aussi avait été changé. Sous son successeur, le général John Armstrong, leurs affaires n’allèrent pas mieux. Au contraire, le succès des armes anglaises dans le Bas-Canada va leur faire perdre les avantages qu’ils ont obtenus dans le Haut, et les rejeter partout sur leur territoire, à la fin de la campagne, avec d’assez grandes pertes» (F.-X. Garneau. ibid. p. 519). La Guerre de 1812, c'est en fin de compte que ça : une guerre de mouvements hésitants, improvisés, sans buts stratégiques fixes.
traversèrent la frontière afin de poursuivre les Amérindiens qui venaient faire des incursions sur le territoire américain. C’est dans ce contexte que le commandant Brock et le chef Tecumseh conclurent l’accord célèbre. À la fin de 1813, Garneau note: «On touchait à la fin de la deuxième année de la guerre. Où en étaient alors les parties belligérantes? Après de multiples petits combats, dont la diversité embarrasse, dont le but est difficile à démêler, le résultat de la campagne semblait favorable aux Américains; mais c’était tout. S’ils occupaient la frontière de Niagara, leurs généraux, trouvant bientôt leurs entreprises de conquête au-dessus de leurs forces, avaient résigné le commandement. Le secrétaire de la guerre aussi avait été changé. Sous son successeur, le général John Armstrong, leurs affaires n’allèrent pas mieux. Au contraire, le succès des armes anglaises dans le Bas-Canada va leur faire perdre les avantages qu’ils ont obtenus dans le Haut, et les rejeter partout sur leur territoire, à la fin de la campagne, avec d’assez grandes pertes» (F.-X. Garneau. ibid. p. 519). La Guerre de 1812, c'est en fin de compte que ça : une guerre de mouvements hésitants, improvisés, sans buts stratégiques fixes.C’est au cours de cette année 1813 que se produisit l’événement qui touche la mémoire québécoise: «L’armée du Nord, commandée par Hampton, était restée immobile durant presque tout l’été. En juillet, le colonel anglais John Murray avait fait irruption, à la tête de mille hommes, jusque dans son voisinage. Parti de l’Île-aux-Noix sur une petite flottille, il était entré dans le lac Champlain, avait brûlé les casernes, les arsenaux et les édifices publics de Plattsburg, de Burlington, de Champlain, de Swanton (31 juillet-3 août 1813), et était revenu sans accident. Le 20 septembre, Hampton voulut s’ébranler, mais il fut arrêté sur la route d’Acadie par le colonel Charles de Salaberry, chargé de l’y attendre avec six cents hommes. Après plusieurs escarmouches, n’osant risquer cette action générale dans les bois, les Américains se portèrent à Four Corners, vers la naissance de la rivière Châteauguay, où Salaberry surprit leur camp dans une reconnaissance qu’il fit avec deux cents voltigeurs et cent sauvages abénaquis, et les jeta un moment dans une confusion extrême (1er octobre)» (p. 520)
Tout se mettait en place pour la scène conservée par les manuels scolaires: «Hampton poussa en avant une colonne d’infanterie, forte de trois mille cinq cents hommes, à la tête de laquelle marchait un officier de haute stature, qui se détacha et cria en français aux voltigeurs : “Braves Canadiens, rendez-vous; nous ne voulons pas vous faire de mal!” Pour réponse il recut un coup de fusil qui le coucha par terre. Ce fut le signal du combat. Les trompettes sonnèrent, et la fusillade s’engagea sur toute la ligne. Comme elle se prolongeait sans aucun résultat, le général américain changea ses dispositions pour essayer de percer la ligne anglaise par des charges vigoureuses. Il concentra ses forces et se mit à attaquer tantôt le centre des Canadiens, tantôt une aile et tantôt l’autre. Partout repoussé, il quitta enfin le champ de bataille. Le bruit du combat avait attiré l’attention de la division du colonel Purdy,
 qui était entrée dans le bois, de l’autre côté de la rivière, et qui s’y était égarée. Aussitôt qu’elle se fut reconnue, elle marcha aux détachements postés en avant du gué, et les fit reculer d’abord devant la trop grande supériorité de son feu. C’était au moment où la fusillade sur la rive nord avait presque cessé par la retraite d’Hampton. Salaberry, voyant que l’action à sa gauche devenait sérieuse, alla se mettre à la tête des troupes placées en potence le long de la rivière, et dirigea de la voix les mouvements de celles qui étaient au delà. Il fit faire dans le moment sur le flanc de la colonne ennemie un feu si vif, qu’il la contraignit de retraiter avec précipitation. Telle était l’ardeur de ses gens, qu’on vit des voltigeurs traverser la rivière à la nage, sous les balles, pour aller forcer des Américains à se rendre. Hampton, dont toutes les mesures étaient dérangées et qui croyait les Canadiens beaucoup plus nombreux qu’ils ne l’étaient, prit alors la résolution d’abandonner la lutte. Ainsi trois à quatre cents hommes à peine en avaient vaincu sept mille après un combat opiniâtre de quatre heures. Le gouverneur Prevost, accompagné du colonel Watteville, arriva vers la fin de l’action; il complimenta les Canadiens sur leur courage et leur commandant sur ses dispositions judicieuses» (F.-X. Garneau. ibid. pp. 523-524). Poursuivi, Hampton ne put que retourner prendre son quartier d’hiver à Plattsburg. Son collègue, Wilkinson, qui dirigeait ses troupes vers Montréal décida à son tour de battre en retraite. La guerre était finie sur le territoire du Bas-Canada. Reportés à nouveau dans le Haut-Canada, les combats furent nettement plus sérieux. Les armées des deux camps eurent à souffrir des combats terribles, des échecs sanglants compensés seulement par des victoires incertaines, jamais définitives.
qui était entrée dans le bois, de l’autre côté de la rivière, et qui s’y était égarée. Aussitôt qu’elle se fut reconnue, elle marcha aux détachements postés en avant du gué, et les fit reculer d’abord devant la trop grande supériorité de son feu. C’était au moment où la fusillade sur la rive nord avait presque cessé par la retraite d’Hampton. Salaberry, voyant que l’action à sa gauche devenait sérieuse, alla se mettre à la tête des troupes placées en potence le long de la rivière, et dirigea de la voix les mouvements de celles qui étaient au delà. Il fit faire dans le moment sur le flanc de la colonne ennemie un feu si vif, qu’il la contraignit de retraiter avec précipitation. Telle était l’ardeur de ses gens, qu’on vit des voltigeurs traverser la rivière à la nage, sous les balles, pour aller forcer des Américains à se rendre. Hampton, dont toutes les mesures étaient dérangées et qui croyait les Canadiens beaucoup plus nombreux qu’ils ne l’étaient, prit alors la résolution d’abandonner la lutte. Ainsi trois à quatre cents hommes à peine en avaient vaincu sept mille après un combat opiniâtre de quatre heures. Le gouverneur Prevost, accompagné du colonel Watteville, arriva vers la fin de l’action; il complimenta les Canadiens sur leur courage et leur commandant sur ses dispositions judicieuses» (F.-X. Garneau. ibid. pp. 523-524). Poursuivi, Hampton ne put que retourner prendre son quartier d’hiver à Plattsburg. Son collègue, Wilkinson, qui dirigeait ses troupes vers Montréal décida à son tour de battre en retraite. La guerre était finie sur le territoire du Bas-Canada. Reportés à nouveau dans le Haut-Canada, les combats furent nettement plus sérieux. Les armées des deux camps eurent à souffrir des combats terribles, des échecs sanglants compensés seulement par des victoires incertaines, jamais définitives.Pour Garneau, «le traité de Gand ruina les espérances du parti qui avait poussé à la République à tenter la fortune des armes, car il n’avait rien obtenu de ce qu’il s’était proposé par la guerre. Une grande faute des Américains, c’était d’avoir attendu trop tard pour agir. Depuis longtemps Napoléon les pressait de prendre les armes. Il savait que, depuis la révolution, les Américains convoitaient les provinces anglaises, qui, adossées au Nord, semblent peser sur eux dans toute la largeur du continent. Mais ils mirent tant de lenteur à se décider, qu’ils ne s’ébranlèrent qu’au moment où leur puissant allié commençait à pencher vers sa ruine. Le vrai motif de la guerre était la conquête du Canada; les prétextes en étaient le droit de visite et le refus des Anglais d’admettre le principe que le pavillon couvre la marchandise» (F.-X. Garneau. ibid. pp. 538-539) Garneau est donc le premier historien canadien, à ma connaissance, à oser affirmer que l’objectif de la Guerre de 1812 était la conquête du Canada, mais il exagère l'importance du facteur américain dans la stratégie de Napoléon.
Mais Garneau ne se contente pas de constater, il analyse, il prophétise : «L’Angleterre fit une faute en laissant persister ces prétextes; car sa faiblesse en Amérique augmente en proportion de la marche
 |
| Le Leopard britannique prend d'assaut le Chesapeake américain, 1807 |
Garneau note ensuite: «Le traité de Gand fut accueilli avec joie par le Haut-Canada, où la guerre avait été une suite d’invasions cruelles et ruineuses. Il fut bien reçu aussi des États-Unis, surtout des pays qui bordent la mer [ceux qui avaient résisté à la propagande des War Hawks et menacés de Sécession]» (p. 539). Garneau confronte régulièrement la Guerre de 1812 aux Rébellions de 37-38. Sa philosophie de l’histoire du Canada s’inscrit dans la disparition éventuelle du lien colonial, ce qui, par le fait même, rend obsolète la volonté américaine de «libérer» le Canada : «…il est peu probable que les Américains cherchent jamais à acquérir le Canada malgré ses habitants. À leurs yeux, la dépendance coloniale n’est pas un état naturel et permanent, et les métropoles elles-mêmes ont ce sentiment sur l’avenir. Le sort des colonies préoccupe les politiques et les historiens de l’Angleterre; mais ni ses historiens, ni ses hommes d’État ne peuvent s’affranchir assez de leurs antiques préjugés pour porter un jugement impartial sur ce qu’il faudrait faire afin de conserver l’intégrité de l’Empire. De quelque manière qu’on envisage cette question, la solution paraît bien difficile. L’Angleterre ne peut permettre à ses colonies d’exercer la même influence sur son gouvernement que les provinces qui la constituent elle-même, ni donner à leurs députés le droit de siéger dans le Parlement impérial en nombre proportionné à la population, car il viendrait un temps où la représentation totale du Canada et de toutes les autres colonies excéderait celle de la métropole, qui serait ainsi réduite au rôle de dépendance et recevrait la loi comme telle. Cette conséquence nécessaire montre la force des obstacles que rencontre le régime colonial à mesure qu’il vieillit et que les populations s’accroissent. La séparation parait donc inévitable, malgré le désir que l’on peut encore avoir de part et d’autre de l’éviter. Il ne reste à la politique qu’à travailler à en reculer l’événement, et, quand elle arrivera, qu’à en diminuer autant que possible les effets les plus funestes. Mais cette prévoyance manque presque toujours aux métropoles, lorsque le temps est venu de donner la liberté à une colonie trop puissante. La crainte retient la main des gouvernants, et la contrainte irrite l’ardeur de la jeune nation, qui se révolte et brise ses liens. Les métropoles se trompent souvent sur la cause de ces révolutions. “Pour nous assurer la possession de nos colonies de l’Amérique du Nord, dit encore Alison en jugeant les événements de 1837, nous devons surtout nous en attacher les habitants. Quoique nous devions déplorer l’effet des actes coupables et de l’ambition criminelle des révolutionnaires du Bas-Canada, qui nous ont aliéné l’affection d’un peuple simple et industrieux, autrefois fidèle et dévoué, le mal n’est pas encore sans espoir : si l’on y remédie dans un bon esprit, il peut résulter de ces maux passagers un bien durable. Ces événements, en attirant l’attention, ont fait découvrir bien des abus qui, sans cela, seraient restés dans l’ombre, et ils nous ont montré la nécessité de les faire disparaître”. Mais les abus sont l’abîme des gouvernements coloniaux. Ceux qui, à Londres, paraissent désirer les réformes avec le plus d’ardeur, sont ceux-là mêmes qui s’attaquent avec le moins de réserve aux réformateurs coloniaux. Les insurrections qui ont eu lieu dans les deux Canadas en 1837, n’ont été que la conséquence de la mauvaise administration de ces deux provinces, et de l’obstination du pouvoir à ne pas prêter l’oreille aux représentations formelles de leurs députés en pleine législature, pendant une longue suite d’années. Les préjugés sont si difficiles à surmonter, qu’Alison justifie presque le révolté du Haut-Canada, sans doute parce que ce pays est peuplé d’hommes de sa race, et note le rebelle du Bas-Canada, parce qu’il est d’une autre origine; il attribue la conduite de l’un à la supériorité de ses lumières et de son énergie, et la conduite de l’autre à l’ignorance et à l’ambition; de la même chose, il fait un crime au Canadien-Français, et un mérite à l’Anglais» (F.-X. Garneau. ibid. pp. 541-542). Dans cet exposé, Garneau nous montre qu’il est bien de la trempe d'un Tocqueville, son contemporain. Il voit l’avenir du Canada dans la mesure où, reprenant à son compte le conservatisme européen des institutions impériales (et plus tard ultramontaines), les États-Unis n’auront plus de raisons pour envahir la colonie, car elle cessera d’être colonie pour être un voisin de statut égal à celui des anciennes treize colonies, avec une pensée et un système politique essentiellement conservateur et bourgeois.
Garneau rappelle, enfin, l’adresse de la Chambre d’Assemblée lue par l’Orateur, le jeune Louis-Joseph Papineau, au gouverneur Prevost: «Les événements de la dernière guerre ont resserré les liens qui unissent ensemble la Grande-Bretagne et les Canadas.
 Ces provinces lui ont été conservées dans des circonstances extrêmement difficiles. Lorsque la guerre a éclaté, le pays était sans troupes, sans argent, et Votre Excellence se voyait à la tête d’un peuple en qui, disait-on, plus d’un demi-siècle de repos avait détruit tout esprit militaire. Vous plaçant au-dessus des préjugés, vous avez su trouver dans le dévouement de ce peuple brave et fidèle, injustement calomnié, assez de ressources pour déjouer les projets de conquête d’un ennemi nombreux et plein de confiance en ses forces. Le sang des enfants du Canada a coulé, mêlé avec celui des braves soldats envoyés à leur secours. Après toutes les preuves que la métropole et la colonie ont données, l’une de l’efficacité de sa protection, et l’autre de sa fidélité inaltérable, les habitants de ce pays peuvent prétendre avec plus de raison que jamais à la conservation et au libre exercice des avantages que leur assurent leur constitution et leurs lois» (in F.-X. Garneau. ibid. p. 543). Prevost était rappelé peu après pour rendre compte de sa défaite à Plattsburg en 1814.
Ces provinces lui ont été conservées dans des circonstances extrêmement difficiles. Lorsque la guerre a éclaté, le pays était sans troupes, sans argent, et Votre Excellence se voyait à la tête d’un peuple en qui, disait-on, plus d’un demi-siècle de repos avait détruit tout esprit militaire. Vous plaçant au-dessus des préjugés, vous avez su trouver dans le dévouement de ce peuple brave et fidèle, injustement calomnié, assez de ressources pour déjouer les projets de conquête d’un ennemi nombreux et plein de confiance en ses forces. Le sang des enfants du Canada a coulé, mêlé avec celui des braves soldats envoyés à leur secours. Après toutes les preuves que la métropole et la colonie ont données, l’une de l’efficacité de sa protection, et l’autre de sa fidélité inaltérable, les habitants de ce pays peuvent prétendre avec plus de raison que jamais à la conservation et au libre exercice des avantages que leur assurent leur constitution et leurs lois» (in F.-X. Garneau. ibid. p. 543). Prevost était rappelé peu après pour rendre compte de sa défaite à Plattsburg en 1814.Il apparait important de tirer les lignes dominantes du texte de Garneau. D’un côté, la position militaire du Canada ne pouvait être qu’une position défensive et non agressive. D’autre part, les forces assaillantes en provenance des États-Unis n’étaient pas dirigées par un plan précis, malgré sa stratégie de déployer trois armées vers le Canada. Les officiers répondaient aux circonstances plus qu’aux nécessités d’objectifs précis et unanimes. La guerre se transforma en guerre d’escarmouches, en jeu d’échecs d’un fort à l’autre, d’un côté de la frontière à l’autre. Les victoires de 1812 et de 1813 dans le Bas-Canada montrèrent la participation active des Canadiens-Français dans la défense du territoire qui est le leur, avec la même énergie et le même courage qu’ils en mettront, vingt-cinq ans plus tard, pour s’opposer au même gouvernement colonial dont ils venaient de sauver la peau des fesses.
La position de Garneau fut reprise par les clercs ultramontains et nationalistes, insistant davantage sur l’aspect «messianique» du geste de Salaberry et des Voltigeurs. Pourtant, des événements
 secondaires se rajoutent au récit princeps. Une des causes d’origine canadienne de l’aigreur des Américains envers les Canadiens proviendrait de «la publication d’une correspondance de Craig avec son agent Henry. Mécontent de se voir refuser un emploi, Henry vendit, en 1812, au président Madison, les lettres du gouverneur pour une somme de $10,000» (P.-É. Farley et G. Lamarche. Histoire du Canada, Trois-Rivières, Librairie Saint-Viateur, 1935, p. 273). Ces lettres devaient être assez compromettantes pour que le Président paie une telle somme à un émissaire frustré. Le bilan que les auteurs Farley et Lamarche tirent de la Guerre de 1812, à la suite de Garneau, est l’intention américaine de conquérir purement et simplement le Canada dissimulé sous des prétextes oiseux: «Les Américains, maintenant convaincus qu’ils ne réussiraient pas à conquérir le Canada, ne tenaient pas à continuer la guerre. D’autre part, les Canadiens n’avaient combattu que pour se défendre. La paix s’imposait» (P.-É. Farley et G. Lamarche. ibid. p. 280). Cette vision est strictement canadocentriste et fait passer à l’arrière-plan les vrais dimensions de la guerre anglo-américaine de 1812. Le bilan reprend celui convenu : «Le traité qui mit fin aux hostilités fut signé à Gand le 24 décembre 1814. Les deux nations revenaient au statu quo. C’était vraiment beaucoup de sang répandu et d’immenses richesses gaspillées pour aboutir à une telle conclusion» (P.-É. Farley et G. Lamarche. ibid. p. 280).
secondaires se rajoutent au récit princeps. Une des causes d’origine canadienne de l’aigreur des Américains envers les Canadiens proviendrait de «la publication d’une correspondance de Craig avec son agent Henry. Mécontent de se voir refuser un emploi, Henry vendit, en 1812, au président Madison, les lettres du gouverneur pour une somme de $10,000» (P.-É. Farley et G. Lamarche. Histoire du Canada, Trois-Rivières, Librairie Saint-Viateur, 1935, p. 273). Ces lettres devaient être assez compromettantes pour que le Président paie une telle somme à un émissaire frustré. Le bilan que les auteurs Farley et Lamarche tirent de la Guerre de 1812, à la suite de Garneau, est l’intention américaine de conquérir purement et simplement le Canada dissimulé sous des prétextes oiseux: «Les Américains, maintenant convaincus qu’ils ne réussiraient pas à conquérir le Canada, ne tenaient pas à continuer la guerre. D’autre part, les Canadiens n’avaient combattu que pour se défendre. La paix s’imposait» (P.-É. Farley et G. Lamarche. ibid. p. 280). Cette vision est strictement canadocentriste et fait passer à l’arrière-plan les vrais dimensions de la guerre anglo-américaine de 1812. Le bilan reprend celui convenu : «Le traité qui mit fin aux hostilités fut signé à Gand le 24 décembre 1814. Les deux nations revenaient au statu quo. C’était vraiment beaucoup de sang répandu et d’immenses richesses gaspillées pour aboutir à une telle conclusion» (P.-É. Farley et G. Lamarche. ibid. p. 280).Regardant la Guerre de 1812 avec un siècle de distance, les conclusions de Farley-Lamarche élargissaient la vision de Garneau : «Si la guerre de 1812 n’eut pas de suites politiques, elle exerça au Canada une sérieuse influence sociale. Comme
 les hostilités s’étaient surtout déroulées dans le Haut-Canada, les Loyalistes eurent la conviction qu’ils avaient sauvé le pays et, pour ce motif, réclamèrent une plus grande part dans l’administration. De plus, la coopération des Canadiens-Français, des Anglais, des Écossais et des Irlandais durant la guerre allait se continuer, établir une plus étroite cohésion entre les groupes ethniques et contribuer à développer le sentiment national, malgré les conflits qui surgirent dans la suite à propos de la distribution des subsides. Personne désormais ne pourrait accuser les Canadiens-Français d’être “de mauvais sujets britanniques”. La victoire de Châteauguay constituait une preuve éclatante de leur loyalisme et de leur patriotisme» (P.-É. Farley et G. Lamarche. ibid. p. 281). Ce n’est là que l’expression d’un rêve, puisque moins de vingt ans après cette étroite cohésion, des journalistes de la trempe d’Adam Thom reprendront ouvertement, dans leurs journaux racistes, l’idée que les Canadiens-Français sont bien de mauvais sujets britanniques. L’idéal canadianiste sorti de la coopération dans les coups de feu de 1812-1814 et que reprend aujourd’hui le gouvernement conservateur appartient aux désirs frustrés et non au principe de réalité historique.
les hostilités s’étaient surtout déroulées dans le Haut-Canada, les Loyalistes eurent la conviction qu’ils avaient sauvé le pays et, pour ce motif, réclamèrent une plus grande part dans l’administration. De plus, la coopération des Canadiens-Français, des Anglais, des Écossais et des Irlandais durant la guerre allait se continuer, établir une plus étroite cohésion entre les groupes ethniques et contribuer à développer le sentiment national, malgré les conflits qui surgirent dans la suite à propos de la distribution des subsides. Personne désormais ne pourrait accuser les Canadiens-Français d’être “de mauvais sujets britanniques”. La victoire de Châteauguay constituait une preuve éclatante de leur loyalisme et de leur patriotisme» (P.-É. Farley et G. Lamarche. ibid. p. 281). Ce n’est là que l’expression d’un rêve, puisque moins de vingt ans après cette étroite cohésion, des journalistes de la trempe d’Adam Thom reprendront ouvertement, dans leurs journaux racistes, l’idée que les Canadiens-Français sont bien de mauvais sujets britanniques. L’idéal canadianiste sorti de la coopération dans les coups de feu de 1812-1814 et que reprend aujourd’hui le gouvernement conservateur appartient aux désirs frustrés et non au principe de réalité historique.Contemporain du manuel des deux Clercs de Saint-Viateur, l’Histoire du Canada de Bruchési nous informe que les documents vendus par Henry à Madison contenaient les échanges de Craig qui demandait à Henry «d’enquêter secrètement sur les tendances de l’opinon publique aux États-Unis» (J. Bruchési. Histoire du Canada, Montréal, Beauchemin, 1954, p. 402 ), ce qui suscita des accusations de trahison reprisent par les War Hawks. Bruchési insiste sur la légèreté d’esprit avec laquelle les Américains pensèrent prendre le Canada : «Les Américains, dont c’était le désir, se voyaient déjà maîtres du Canada. Rien, pensait-on, ne devait être plus facile que d’en faire la conquête. “Ce sera l’affaire d’une simple marche”, affirmait Jefferson. “Nous pouvons prendre le Canada sans soldats”. Et, de fait, comment un pays, dont la population disséminée atteignait 500.000 à peine, pourrait-il résister à l’attaque d’un État voisin qui comptait près de huit millions d’habitants» (P. Bruchési. ibid. p. 402). Bruchési soulève donc «l’intoxication de la victoire» qui animait, dès le départ, l’establishment américain aux risques de se méprendre sur les dispositions militaires, politiques et morales des Canadiens des deux «races».
Pour la suite, Bruchési reprend l’enseignement de Garneau : lenteur de l’organisation américaine, rapidité de la réaction du gouverneur Prevost, enrôlement de l’Église dans la consolidation de la résistance canadienne-française : «Battus sur terre, les Américains avaient, d’autre part, remporté
 plusieurs succès sur mer», etc. Et surtout, malgré le fait que c’est dans le Haut-Canada que furent livrés les combats les plus sanglants, notre nationaliste canadien-français n’hésite pas à écrire : «C’est dans le Bas-Canada que l’ennemi devait subir l’échec le plus cuisant de toute la campagne [de 1813]» (J. Bruchési. ibid. p. 405), et c’est le récit de la bataille de Châteauguay, inscrivant dans l’historiographie, ce que Garneau s’était bien gardé de faire à propos de Salaberry : «Celui que ses contemporains ont surnommé le “Léonidas canadien”, allant même jusqu’à comparer sa victoire au célèbre combat des Thermopyles, venait de sauver Montréal et de venger les défaites essuyées sur d’autres points par les troupes anglaises. Celles-ci, du reste, ne tardèrent pas à reprendre l’offensive dans le Haut-Canada, envahissant à leur tour le territoire ennemi, brûlant, sur leur passage, Lewiston, Manchester et Buffalo. Pendant ce temps, quelques victoires navales s’ajoutaient au crédit de la Grande-Bretagne» (J. Bruchési. ibid. p. 406). Bruchési rappelle toutefois que les Américains devaient, malgré les traités d’amitiés conclus avec Gand, ronger quelques terres canadiennes, en particulier à la frontière du Bas-Canada. Non sans tristesse, reconnaît-il, «les Américains invoquaient des prétentions qui allaient finir par être reconnues. Ils sortaient de la guerre avec un prestige accru et prenaient rang parmi les grandes nations» (J. Bruchési. ibid. p. 407). Nulle apologie du sentiment national canadien autant que l’amplification du succès prêté à la bataille de Châteauguay dans le cours de la campagne de 1813.
plusieurs succès sur mer», etc. Et surtout, malgré le fait que c’est dans le Haut-Canada que furent livrés les combats les plus sanglants, notre nationaliste canadien-français n’hésite pas à écrire : «C’est dans le Bas-Canada que l’ennemi devait subir l’échec le plus cuisant de toute la campagne [de 1813]» (J. Bruchési. ibid. p. 405), et c’est le récit de la bataille de Châteauguay, inscrivant dans l’historiographie, ce que Garneau s’était bien gardé de faire à propos de Salaberry : «Celui que ses contemporains ont surnommé le “Léonidas canadien”, allant même jusqu’à comparer sa victoire au célèbre combat des Thermopyles, venait de sauver Montréal et de venger les défaites essuyées sur d’autres points par les troupes anglaises. Celles-ci, du reste, ne tardèrent pas à reprendre l’offensive dans le Haut-Canada, envahissant à leur tour le territoire ennemi, brûlant, sur leur passage, Lewiston, Manchester et Buffalo. Pendant ce temps, quelques victoires navales s’ajoutaient au crédit de la Grande-Bretagne» (J. Bruchési. ibid. p. 406). Bruchési rappelle toutefois que les Américains devaient, malgré les traités d’amitiés conclus avec Gand, ronger quelques terres canadiennes, en particulier à la frontière du Bas-Canada. Non sans tristesse, reconnaît-il, «les Américains invoquaient des prétentions qui allaient finir par être reconnues. Ils sortaient de la guerre avec un prestige accru et prenaient rang parmi les grandes nations» (J. Bruchési. ibid. p. 407). Nulle apologie du sentiment national canadien autant que l’amplification du succès prêté à la bataille de Châteauguay dans le cours de la campagne de 1813.La guerre de 1812 est également traité en un chapitre dans l’Histoire du Canada de Robert Rumilly. Lui aussi accorde beaucoup d’importance aux lettres vendues par Henry à Madison. Ici encore, les populations britanniques des différentes colonies sont solidaires avec l’Empire contre les prétentions américaines. Sa présentation de la bataille de Châteauguay est moins dithyrambique que celle de Bruchési : «La bataille de Châteauguay, rencontre peu sanglante, où les armées ne se sont pas engagées à fond, entraîne des conséquences majeures. Elle compense les résultats de la campagne dans le Haut-Canada. Elle permet une contre-offensive, où des régiments anglais renforcés par des sauvages de l’Ouest, reprennent Newark dévasté par l’ennemi et dévastent de petites villes américaines en représailles. L’année 1813 se termine sur l’échec généralisé de la tentative d’invasion. Sur mer, les
 escadres anglaises ont remporté l’avantage, détruit des bâtiments américains dans la baie de Delaware et ravagé quelques établissements sur les côtes de la Virginie» (R. Rumilly. Histoire du Canada, Montréal, La Clé d'Or, 1951, p. 293). Bref, Châteauguay est un point tournant, un renversement dans le cours malheureux de la guerre. Les défaites de 1812-1813, en octobre 1813, se renversent à travers la victoire des Voltigeurs, et l’année 1814 conduira à la revanche des Britanniques qui envahiront et sèmeront la peur et la destruction sur le territoire américain même. Rumilly souligne «le succès décisif remporté par un chef canadien à la tête de troupes canadiennes fait sensation. Le Conseil législatif et l’Assemblée du Bas-Canada votent des félicitations à Salaberry, surnommé le Léonidas canadien, et à ses intrépides voltigeurs. Le duc de Kent fait frapper une médaille commémorative. Les Canadiens Français lèvent le front» (R. Rumilly. ibid. pp. 293-294). Rumilly achève en rappelant le match nul décrété par le traité de Gand.
escadres anglaises ont remporté l’avantage, détruit des bâtiments américains dans la baie de Delaware et ravagé quelques établissements sur les côtes de la Virginie» (R. Rumilly. Histoire du Canada, Montréal, La Clé d'Or, 1951, p. 293). Bref, Châteauguay est un point tournant, un renversement dans le cours malheureux de la guerre. Les défaites de 1812-1813, en octobre 1813, se renversent à travers la victoire des Voltigeurs, et l’année 1814 conduira à la revanche des Britanniques qui envahiront et sèmeront la peur et la destruction sur le territoire américain même. Rumilly souligne «le succès décisif remporté par un chef canadien à la tête de troupes canadiennes fait sensation. Le Conseil législatif et l’Assemblée du Bas-Canada votent des félicitations à Salaberry, surnommé le Léonidas canadien, et à ses intrépides voltigeurs. Le duc de Kent fait frapper une médaille commémorative. Les Canadiens Français lèvent le front» (R. Rumilly. ibid. pp. 293-294). Rumilly achève en rappelant le match nul décrété par le traité de Gand.Un autre français, Robert Lacour-Gayet, dans son Histoire du Canada, parvient à amalgamer les origines européennes et nord-américaines du conflit. «La situation était, d’ailleurs, absurde, et les historiens de langue anglaise, américains, britanniques, canadiens, l’ont jugée sévèrement. “Une guerre très étrange…” (Brebner); “futile et d’aucune utilité…” (Morison); “une succession de prudentes offensives et de retraites hâtives, de plans mal conçus, de stratégies incompétentes, le tout relevé par quelques brillantes actions et quelques manœuvres adroites, tout à la gloire de quelques-uns mais peu flatteuses pour les autres…” (Lower). Le plus dur est l’Anglais Carrington : “Dans l’histoire des deux pays il n’y a sûrement pas d’événement qui fasse à l’un et l’autre si peu d’honneur. En Amérique, on s’en souvient encore comme une sorte d’épilogue de la guerre d’Indépendance; en Angleterre, on l’a pratiquement oublié, et c’est pour le mieux. Issue de préjugés nationaux, conduite de chaque côté avec un manque total de magnanimité, cette guerre n’a abouti
 qu’à raviver de vieilles rancunes. Il est navrant que l’historien impartial soit obligé d’exhumer un si vilain épisode…» (R. Lacour-Gayet. Histoire du Canada, Paris, Fayard, 1979, p. 307) Bref, on a peine à croire que le Canada a vraiment été mêlé dans cette rencontre, même si c’est sur une grande partie de son territoire qu’elle s’est déroulée! L’historien français reprend ici les couleurs de ses confrères québécois à propos de la campagne de 1813 : «L’effort [que les Américains] accomplirent au début de 1813 déplaça l’équilibre naval à leur profit. Grâce à de meilleures lignes de communication, ils reprirent Detroit et avancèrent suffisamment en territoire ennemi pour s’emparer de York (le futur Toronto, alors encore un village [mais tout de même, capitale du Haut-Canada où siégeait son gouverneur]) qu’ils pillèrent et brûlèrent en partie. Ces succès dans une région excentrique ne réglaient rien, cependant. La prise de Montréal eût été d’une autre importance. Une attaque renouvelée de la stratégie du XVIIIe siècle fut mise sur pied. Un détachement descendant le Richelieu devait rejoindre dans la vallée du Saint-Laurent une colonne partie du lac Ontario. Ce fut l’occasion pour les Canadiens français de montrer, plus encore qu’en 1776, qu’à tout prendre ils préféraient les Anglais aux Américains. Deux mille miliciens avaient été tirés au sort parmi les célibataires de dix-huit à trente ans. À part une émeute de peu de conséquence à Lachine, cette conscription, bien modeste, s’effectua sans difficultés. À Châteauguay, non loin de Montréal, les jeunes recrues prouvèrent leur valeur. À un contre trois, sous la conduite du colonel de Salaberry, Canadien français, officier dans l’armée anglaise, ils arrêtèrent en octobre l’offensive américaine. “Châteauguay a servi de Thermopyles au Canada”, écrit avec quelque exagération un savant religieux. Ce fut la seule circonstance où des opérations militaires se déroulèrent sur le territoire du Bas-Canada» (R. Lacour-Gayet. ibid. p. 310). Lacour-Gayet mentionne, en passant, la mini-émeute de Lachine tout en attribuant à un clerc l’exagération, l’amplification des Bruchési et autres Rumilly, mais déjà Salaberry lui-même et ses savants contemporains se comparaient à l’épisode racontée par Hérodote.
qu’à raviver de vieilles rancunes. Il est navrant que l’historien impartial soit obligé d’exhumer un si vilain épisode…» (R. Lacour-Gayet. Histoire du Canada, Paris, Fayard, 1979, p. 307) Bref, on a peine à croire que le Canada a vraiment été mêlé dans cette rencontre, même si c’est sur une grande partie de son territoire qu’elle s’est déroulée! L’historien français reprend ici les couleurs de ses confrères québécois à propos de la campagne de 1813 : «L’effort [que les Américains] accomplirent au début de 1813 déplaça l’équilibre naval à leur profit. Grâce à de meilleures lignes de communication, ils reprirent Detroit et avancèrent suffisamment en territoire ennemi pour s’emparer de York (le futur Toronto, alors encore un village [mais tout de même, capitale du Haut-Canada où siégeait son gouverneur]) qu’ils pillèrent et brûlèrent en partie. Ces succès dans une région excentrique ne réglaient rien, cependant. La prise de Montréal eût été d’une autre importance. Une attaque renouvelée de la stratégie du XVIIIe siècle fut mise sur pied. Un détachement descendant le Richelieu devait rejoindre dans la vallée du Saint-Laurent une colonne partie du lac Ontario. Ce fut l’occasion pour les Canadiens français de montrer, plus encore qu’en 1776, qu’à tout prendre ils préféraient les Anglais aux Américains. Deux mille miliciens avaient été tirés au sort parmi les célibataires de dix-huit à trente ans. À part une émeute de peu de conséquence à Lachine, cette conscription, bien modeste, s’effectua sans difficultés. À Châteauguay, non loin de Montréal, les jeunes recrues prouvèrent leur valeur. À un contre trois, sous la conduite du colonel de Salaberry, Canadien français, officier dans l’armée anglaise, ils arrêtèrent en octobre l’offensive américaine. “Châteauguay a servi de Thermopyles au Canada”, écrit avec quelque exagération un savant religieux. Ce fut la seule circonstance où des opérations militaires se déroulèrent sur le territoire du Bas-Canada» (R. Lacour-Gayet. ibid. p. 310). Lacour-Gayet mentionne, en passant, la mini-émeute de Lachine tout en attribuant à un clerc l’exagération, l’amplification des Bruchési et autres Rumilly, mais déjà Salaberry lui-même et ses savants contemporains se comparaient à l’épisode racontée par Hérodote.L’historien français ne peut éviter de reprendre la vision britannique du traité de Gand : «La paix de Gand fut, de part et d’autre, une paix de lassitude. On adopta la solution de facilité, celle du retour au statu quo ante bellum. […] Qui était vainqueur? Ni la Grande-Bretagne ni les États-Unis. La première avait constaté que la maîtrise des mers ne leur suffisait pas pour triompher: mais où trouver sur le continent américain les légions qui étaient venues à bout de Napoléon? Les seconds, de leur côté, avaient dû reconnaître que sans le contrôle de l’océan une lutte contre l’Angleterre ne pourrait jamais être décisive. Cette impuissance réciproque aurait dû conduire les deux pays à rechercher une entente : elle suscita, au contraire, chez l’un comme chez l’autre une atmosphère de rancœur et d’amertume, génératrice de nouvelles controverses. Il faudra une cinquantaine d’années pour que le risque d’un autre conflit militaire soit définitivement écarté. S’il y eut un bénéficiaire de la guerre de 1812, ce fut assurément le Canada. Elle enrichit, on le sait, les Provinces maritimes, mais ce n’est là qu’une de ses conséquences mineures. Plus important, elle créa chez beaucoup de Canadiens une vague conscience de leur nationalité; elle les confirma presque tous dans leur volonté de ne pas devenir Américains» (R. Lacour-Gayet. ibid. pp. 312-313). Il faut bien entendre que Lacour-Gayet épouse les conclusions de l'historiographie britannique lorsqu'il écrit que la Grande-Bretagne ne gagna rien à cette guerre, alors que la position canadienne est tout autre, au moins depuis Garneau : la Grande-Bretagne gagna le cœur des Canadiens qui n'étaient jusque-là que des colons essaimés ça et là sur un immense territoire de colonisation. Sa présence s'en trouva donc renforcée. Par contre, ce qui est un étrange corollaire, aussi étrange que les causes mêmes de la guerre, au Canada, la vague conscience de la nationalité était une conscience négative; celle non pas d’être Canadien, mais de ne pas devenir Américains. Cette conscience négative prolongeait la position défensive qu'avait tenu la population des Canadas devant l'agression étrangère. Aux États-Unis, au contraire, le sentiment était positif et ne correspondait pas à ne pas devenir Canadiens, ou ne pas redevenir Britanniques. Dans tous les cas, une scission psychologique s'insinuait entre les origines européennes des habitants du Nouveau-Monde, et l'identité propre aux nouveaux pays en voie d'appropriation.
L’arrivée de la génération des historiens nationaux des années 60 du XXe siècle porta ombrage aux faits d’armes de la Guerre de 1812. Le célèbre manuel scolaire Lacoursière, Provencher, Vaugeois, en vigueur dans les écoles depuis près d’un demi-siècle, reprend les données connues de l’historiographie canadienne, mais le portrait est plutôt mat. Les campagnes sont ternes, y compris celles de 1813. Avec Châteauguay et Chrysler’s Farm, «les écoliers du Québec et de l’Ontario y trouveront leurs héros respectifs : Charles de Salaberry et J. W. Morrison». Le traité de Gand en ressort, une fois de plus, inepte. Les conséquences de la guerre? «Si les provinces maritimes ont été tout à fait épargnées, il n’en va pas de même
 pour les deux Canadas. Trois années de guerre, bien qu’aussi mal conduite d’un côté que de l’autre, avaient donné à réfléchir. Les Britanniques des deux Canadas se sentent plus près que jamais aupravant des Canadiens. Ils commencent à se considérer eux-mêmes Canadiens et souffriront de moins en moins de se faire traiter d’étrangers. Ils ont eu peur et ils en concluent à la nécessité de s’unir, de fédérer le “British North America”. Grouper les forces de l’Amérique du Nord britannique, c’est compter sur tous les éléments non républicains. Les Canadiens français en sont. On revient aux idées de Murray, Carleton et Haldimand : entretenir, préserver et utiliser le particularisme canadien-français. […] Les Canadiens français, pour leur part, comprennent mieux la différence entre une appartenance à l’empire britannique et l’annexion aux États-Unis. Les uns conscients de la protection que leur assure la Grande-Bretagne, jurent sur leur vie qu’ils sont les plus loyaux des plus loyaux sujets de Sa Majesté. Ils acceptent donc le drapeau britannique, mais demandent à jouir de leur majorité dans le Bas-Canada. D’autres, peu nombreux il est vrai, souhaitent un rapprochement avec les autres provinces pour mieux lutter contre les États-Unis. La guerre de 1812, aussi ridicule fut-elle, a donné une conscience nouvelle aux Canadiens anglais; on a même affirmé qu’elle leur avait donné une âme!» (J. Lacoursière, J. Provencher, D. Vaugeois. Canada-Québec, 1534-2000, Sillery, Septentrion, 2006, pp. 220-221). Cette vision n’est pas très loin de celle exprimée par Lacour-Gayet, la prise de conscience canadienne, tant anglophone que francophone, est une prise de conscience négative.
pour les deux Canadas. Trois années de guerre, bien qu’aussi mal conduite d’un côté que de l’autre, avaient donné à réfléchir. Les Britanniques des deux Canadas se sentent plus près que jamais aupravant des Canadiens. Ils commencent à se considérer eux-mêmes Canadiens et souffriront de moins en moins de se faire traiter d’étrangers. Ils ont eu peur et ils en concluent à la nécessité de s’unir, de fédérer le “British North America”. Grouper les forces de l’Amérique du Nord britannique, c’est compter sur tous les éléments non républicains. Les Canadiens français en sont. On revient aux idées de Murray, Carleton et Haldimand : entretenir, préserver et utiliser le particularisme canadien-français. […] Les Canadiens français, pour leur part, comprennent mieux la différence entre une appartenance à l’empire britannique et l’annexion aux États-Unis. Les uns conscients de la protection que leur assure la Grande-Bretagne, jurent sur leur vie qu’ils sont les plus loyaux des plus loyaux sujets de Sa Majesté. Ils acceptent donc le drapeau britannique, mais demandent à jouir de leur majorité dans le Bas-Canada. D’autres, peu nombreux il est vrai, souhaitent un rapprochement avec les autres provinces pour mieux lutter contre les États-Unis. La guerre de 1812, aussi ridicule fut-elle, a donné une conscience nouvelle aux Canadiens anglais; on a même affirmé qu’elle leur avait donné une âme!» (J. Lacoursière, J. Provencher, D. Vaugeois. Canada-Québec, 1534-2000, Sillery, Septentrion, 2006, pp. 220-221). Cette vision n’est pas très loin de celle exprimée par Lacour-Gayet, la prise de conscience canadienne, tant anglophone que francophone, est une prise de conscience négative.L’Histoire des Canadas d’un groupe d’historiens, dont certains d’orientation idéologique marxiste, noie la guerre de 1812 dans le conflit constitutionnel qui sévira de Craig à Dalhousie. En fait, la factualité de la guerre n’y existe tout simplement pas. Le tome 2 de l’Histoire du Canada de Lahaise-Vallerand, L’Amérique du Nord britannique 1760-1867, parle bien de la guerre canado-américaine de 1812-1814 (ce qui omet la bataille de la Nouvelle-Orléans, propre à l’affrontement strictement anglo-américain). Les auteurs ouvrent ainsi leur chapitre : «La guerre de 1812 fut, au sens propre du terme, un accident historique dont les causes, en raison de leur multiplicité et de leur complexité, sont difficiles à cerner. Elles découlent directement de la conjoncture internationale extrêmement mouvante des années 1793-1812 et convergent, au gré de rebondissements imprévisibles, vers cette audacieuse déclaration de guerre des États-Unis à l’Angleterre que les Américains croyaient pouvoir ainsi incommoder en frappant le Canada» (N. Vallerand et R. Lahaise. L'Amérique du Nord britannique 1760-1867, Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 1971, p. 105). Si le Canada est la cible de la guerre, il n’en est ni le causus belli, ni l’objet de convoitise. Les auteurs font toutefois précéder les questions des droits de navigation de «l’appétit territorial des “Frontiersmen” américains, leur nationalisme exacerbé et leur désir d’anéantir l’opposition des Indiens à la colonisation de l’hinterland» (N. Vallerand et R. Lahaise. ibid. p. 107) Pour eux, le bilan se résume à la paix blanche, c’est-à-dire au traité de Gand.
À la même époque parut un livre d’histoire du Canada, présenté comme le manuel national d’Histoire du Canada. Ce manuel, dirigé par une équipe d’historiens des «deux peuples fondateurs», Cornell, Hamelin, Ouellet et Trudel, décrit l’état du Haut et du Bas-Canada au moment du déclenchement du conflit, dont la responsabilité demeure la rivalité entre les pionniers américains et les Autochtones qui leur résistent, soutenus par les Anglais du Haut-Canada. Du côté sud de la frontière, «bien des gens
 |
| Les Britanniques tentent de reprendre le fort Érié, août 1814. |
Cornell, Hamelin, Ouellet et Trudel concluent : «Le peuple du Haut-Canada trouva… dans les expériences de la guerre de 1812 beaucoup d’idées et d’attitudes qui venaient entretenir le sentiment national. Les héros de guerre, qu’ils aient été Canadiens ou Britanniques, étaient devenus des patriotes locaux : Brock, le capitaine Barclay de la bataille de Put-in-Bay, Laura Secord et le colonel Fitzgibbon de Beaver Dams. Durant les générations suivantes, les représentants de la haute société tory, du monde des affaires et du gouvernement se réclamaient pour une part du rôle qu’avaient joué leurs pères dans la défense du pays pour revendiquer une place particulière dans cette société. Jusqu’à la guerre de 1812, les gens de la colonie ne faisaient pas de différence, chose étonnante, entre colons Loyalistes et Britanniques ni entre “Américains”. La guerre vint modifier cet état de choses. On commença dès lors à prendre conscience que les gens des États-Unis étaient “étrangers” et “différents”. […] Le service militaire, après 1812, devint un devoir normal et attendu des citoyens. Les événements des années 1812-1814 laissèrent une trace indélébile dans la mémoire du peuple du Haut-Canada et constituèrent le premier jalon de l’histoire de cette région» (Cornell, Hamelin, Ouellet, Trudel. ibid. pp. 215-216). Ce qui confirme notre assertion que les cérémonies du bicentenaire de la Guerre de 1812 sont une affaire essentiellement ontarienne. Enfin, l’Histoire générale du Canada, dirigée par Craig Brown,
 ramène la guerre de 1812 à deux pages et demie, dont une pleines de vignettes. Par quelques coups de crayons, les manœuvres sont esquissées, et la conclusion reprend celle de l’équipe de Cornell, Hamelin, Ouellet et Trudel : «Le Haut-Canada, ont noté plusieurs de ses habitants, a été “sauvegardé” pour la Grande-Bretagne. Au cours des 175 années qui se sont écoulées depuis, nombre de Canadiens se sont découvert parmi les participants à cette guerre, des héros et des héroïnes - Brock, Salaberry, Secord et Tecumseh ne sont pas les moindres - mais en défintive, il ne s’agit que d’un conflit local» (G. Wynn, in C. Brown (éd.) Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1988, p. 256). Il est à observer ici que la bataille du Léonidas canadien est intégré au mouvement militaire du Haut-Canada, ce qui exclu logiquement le Bas-Canada de son héritage d’une mémoire de la Guerre de 1812!
ramène la guerre de 1812 à deux pages et demie, dont une pleines de vignettes. Par quelques coups de crayons, les manœuvres sont esquissées, et la conclusion reprend celle de l’équipe de Cornell, Hamelin, Ouellet et Trudel : «Le Haut-Canada, ont noté plusieurs de ses habitants, a été “sauvegardé” pour la Grande-Bretagne. Au cours des 175 années qui se sont écoulées depuis, nombre de Canadiens se sont découvert parmi les participants à cette guerre, des héros et des héroïnes - Brock, Salaberry, Secord et Tecumseh ne sont pas les moindres - mais en défintive, il ne s’agit que d’un conflit local» (G. Wynn, in C. Brown (éd.) Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1988, p. 256). Il est à observer ici que la bataille du Léonidas canadien est intégré au mouvement militaire du Haut-Canada, ce qui exclu logiquement le Bas-Canada de son héritage d’une mémoire de la Guerre de 1812!Le premier tome du Canada Une histoire populaire, mentionne évidemment la Guerre de 1812. À l’origine d’une série télévisée retraçant l’histoire (dramatisée) du Canada, les deux tomes télescopent souvent des explications simplistes. Ainsi «une atmosphère d’hostilité et d’avidité règne au sein du Congrès des États-Unis. “Je ne mourrai en paix, déclare Richard Johnson, représentant du Kentucky, que lorsque je verrai les territoires de [la Grande-Bretagne] incorporés aux États-Unis…» (D. Gillmor et P. Turgeon. Le Canada Une histoire populaire, Montréal, Fides, 2000, pp. 164-165). Expliquer une
 |
| Bataille de Lundy's Lane, 1814 |
Victor Suthren, dans un article pour la série Horizon Canada, décrit d’emblée la Guerre de 1812 comme «une guerre d’embuscades et d’attaques sournoises. Une guerre de bons procédés chez les officiers anglais, mais de maraudage impitoyable chez les renégats. Une guerre où des armées étaient déployées en ordre rangé comme pour ces tueries bien ordonnées des champs de bataille européens, alors que retentissaient les cris de guerre stridents des Indiens dans les sombres profondeurs des forêts. Pour les Américains, la Guerre de 1812 fut une “deuxième guerre d’Indépendance” qui complétait l’œuvre inachevée de 1773-1783 et permettait d’ouvrir les mers à la marine marchande américaine. Au Canada, la légende aura fait naître le mythe de ces hardis miliciens qui, avec l’aide de quelques habits rouges anglais, auront refoulé les Yankees. Dans les deux pays, la vérité sera voilée, afin de stimuler les sentiments nationalistes» (V. Suthren. Horizon Canada, t. 3, # 25, 1985, p. 577). Malgré la paix blanche qui clôt le conflit, Suthren affirme, dès le départ : «S’il est vrai que les Américains ont souvent vu un seul de leurs navires remporter d’étonnantes victoires contre la Marine royale, il est également vrai que les États-Unis étaient soumis à un gigantesque blocus maritime qui rendait ces victoires dérisoires. Que les défenseurs américains aient repoussé les Anglais à la Nouvelle-Orléans n’empêchait pas les États-Unis d’avoir perdu, à quelques exceptions près, toutes les autres batailles de cette guerre livrées sur terre. Au Canada, c’est aux fantassins britanniques et à leurs alliés indiens, à la vérité, que revient presque tout le mérite de la victoire remportée sur les armées américaines» (V. Suthren. ibid. pp. 577-578). Rendu à ce point, nous pouvons conclure que le Canada s’est définitivement fait une idée sur la place de la Guerre de 1812 dans son Histoire.
Mais de toutes ces synthèses, il faut tenir à part la somme que représente l'œuvre de George F. G. Stanley. La Guerre de 1812, les opérations terrestres, (Montréal, Trécarré, 1984), qui n'a pas été suivi, malheureusement, du volume sur les opérations maritimes, toutes aussi importantes. Le livre de Stanley relève d'un exposé classique. Historien militaire avant tout, Stanley évoque le contexte dans lequel se sont ouvertes les hostilités. Une fois la préface parcourue, le premier chapitre s'ouvre avec un Harper, non le Canadien Stephen, mais l'Américain John, représentant du New Hampshire et qui
 écrivait, au sénateur Plumer du même État : «Cette fameuse question sera indubitablement abordée au début de juin. Le président fera sans doute parvenir au Congrès un message important, qui prêtera à une ardente controverse. Le Comité chargé des affaires étrangères soumettra un manifeste dans lequel on déclarera que les États-Unis et la couronne britannique, ainsi que ses dépendances coloniales, "sont en guerre"» (G. F. G. Stanley. ibid. p. 3). Stanley, même s'il raconte avec un style enlevé et captivant les différents épisodes de la guerre, s'intéresse aux questions des causes et aux bilans à tirer de la Guerre de 1812. «En juin 1812, les Haligoniens [les habitants d'Halifax] ou les Montréalais pouvaient bien croire que le début des hostilités entre les États-Unis et la Grande-Bretagne était attribuable à l'ambition politique d'un James Madison ou aux sinistres manigances d'un Napoléon Bonaparte. Mais aucune de ces hypothèses ne repose sur une connaissance approfondie de l'histoire ou sur une véritable compréhension de la nature des rapports qui existaient entre ces deux puissances au cours de la génération précédente. La principale cause de la guerre remontait à au moins trente ans auparavant, soit à cette lutte qui amena la Grande-Bretagne à s'humilier et à voir ses armées en déroute, et qui devait forcer les dirigeants britanniques à reconnaître que leurs colonies rebelles constitueraient dorénavant une nouvelle entité politique, séparée et indépendante de la mère patrie. Pour les Britanniques, la défaite avait été amère et ils avaient tardé à saisir toute la portée de la victoire américaine, ou le véritable sens de l'indépendance des États-Unis. Pour les Américains, par contre, une telle réussite militaire et politique avait certes été douce mais, s'ils avaient acquis de l'aplomb, ils n'étaient pas encore, en 1812, parvenus à cette assurance qui les caractérisera plus tard. Le temps devait suivre son cours. Aux yeux des Américains, qui se frayaient un chemin au sein des nations du monde, l'indépendance était cette faculté de choisir librement leur propre ligne de conduite politique ou économique sans avoir à céder aux pressions extérieures. Rien ne ronge davantage le sentiment d'appartenir à une nation distincte que de se voir constamment forcé de faire des concessions à de puissants voisins. Aussi, entre 1783 et 1812, la nationalité était-elle au centre des préoccupations des chefs de file de l'opinion américaine. Et, fort malheureusement, la Grande-Bretagne se trouvait alors engagée dans un combat déterminant en Europe, ce qui l'amenait, pour des raisons de légitime défense, ou peut-être même par instinct de conservation, à ne pas tenir compte de la susceptibilité de ses anciens colons d'Amérique du Nord. La dureté des Britanniques et l'hypersensibilité des Américains - toutes deux issues de la guerre de l'Indépendance - furent donc les principaux mobiles d'une reprise du conflit en 1812. Ce sont ainsi l'histoire et la géographie - et non pas tant le ressentiment ou le caprice - qui sont à la source des prises de positions et des disputes qui précédèrent le début des hostilités de 1812. Les Américains, bien entendu, combattaient pour une juste cause - du moins la tenaient-ils pour telle - et demeuraient persuadés qu'il faudrait la défendre, à défaut d'autres moyens, par les armes. Les Britanniques, pour leur part, qui envisageaient la guerre avec beaucoup plus de maturité d'esprit, se bornèrent à soutenir qu'ils se battaient pour défendre leur empire» (G. F. G. Stanley. ibid. pp. 11-12).
écrivait, au sénateur Plumer du même État : «Cette fameuse question sera indubitablement abordée au début de juin. Le président fera sans doute parvenir au Congrès un message important, qui prêtera à une ardente controverse. Le Comité chargé des affaires étrangères soumettra un manifeste dans lequel on déclarera que les États-Unis et la couronne britannique, ainsi que ses dépendances coloniales, "sont en guerre"» (G. F. G. Stanley. ibid. p. 3). Stanley, même s'il raconte avec un style enlevé et captivant les différents épisodes de la guerre, s'intéresse aux questions des causes et aux bilans à tirer de la Guerre de 1812. «En juin 1812, les Haligoniens [les habitants d'Halifax] ou les Montréalais pouvaient bien croire que le début des hostilités entre les États-Unis et la Grande-Bretagne était attribuable à l'ambition politique d'un James Madison ou aux sinistres manigances d'un Napoléon Bonaparte. Mais aucune de ces hypothèses ne repose sur une connaissance approfondie de l'histoire ou sur une véritable compréhension de la nature des rapports qui existaient entre ces deux puissances au cours de la génération précédente. La principale cause de la guerre remontait à au moins trente ans auparavant, soit à cette lutte qui amena la Grande-Bretagne à s'humilier et à voir ses armées en déroute, et qui devait forcer les dirigeants britanniques à reconnaître que leurs colonies rebelles constitueraient dorénavant une nouvelle entité politique, séparée et indépendante de la mère patrie. Pour les Britanniques, la défaite avait été amère et ils avaient tardé à saisir toute la portée de la victoire américaine, ou le véritable sens de l'indépendance des États-Unis. Pour les Américains, par contre, une telle réussite militaire et politique avait certes été douce mais, s'ils avaient acquis de l'aplomb, ils n'étaient pas encore, en 1812, parvenus à cette assurance qui les caractérisera plus tard. Le temps devait suivre son cours. Aux yeux des Américains, qui se frayaient un chemin au sein des nations du monde, l'indépendance était cette faculté de choisir librement leur propre ligne de conduite politique ou économique sans avoir à céder aux pressions extérieures. Rien ne ronge davantage le sentiment d'appartenir à une nation distincte que de se voir constamment forcé de faire des concessions à de puissants voisins. Aussi, entre 1783 et 1812, la nationalité était-elle au centre des préoccupations des chefs de file de l'opinion américaine. Et, fort malheureusement, la Grande-Bretagne se trouvait alors engagée dans un combat déterminant en Europe, ce qui l'amenait, pour des raisons de légitime défense, ou peut-être même par instinct de conservation, à ne pas tenir compte de la susceptibilité de ses anciens colons d'Amérique du Nord. La dureté des Britanniques et l'hypersensibilité des Américains - toutes deux issues de la guerre de l'Indépendance - furent donc les principaux mobiles d'une reprise du conflit en 1812. Ce sont ainsi l'histoire et la géographie - et non pas tant le ressentiment ou le caprice - qui sont à la source des prises de positions et des disputes qui précédèrent le début des hostilités de 1812. Les Américains, bien entendu, combattaient pour une juste cause - du moins la tenaient-ils pour telle - et demeuraient persuadés qu'il faudrait la défendre, à défaut d'autres moyens, par les armes. Les Britanniques, pour leur part, qui envisageaient la guerre avec beaucoup plus de maturité d'esprit, se bornèrent à soutenir qu'ils se battaient pour défendre leur empire» (G. F. G. Stanley. ibid. pp. 11-12).Ce long paragraphe préparatoire de Stanley nous dit d'abord que la lutte est une confrontation de deux thymos : celui, vexé et plein de ressentiment des Britanniques et celui, «hypersensible» et national des Américains. Une fois affirmées les causes de psychologie collective, l'historien renverse son explication : «non, ce sont la géographie et l'histoire» qui sont à l'origine du conflit. Bref, deux formes déterministes, deux nécessités historiques, qui auraient conduit les Américains et les Britanniques du Canada à s'affronter. La première série de causes est psychologique, la seconde métaphysique. Stanley doit donc pousser plus
 loin les causes «historiques», réelles, de l'agressivité qui amènera Madison à déclencher la guerre. Bien sûr, nous retrouvons les questions économiques, la limite des échanges commerciaux et l'arrogance des navires marchands britanniques contre les navires américains. Mais tout cela se révèle secondaire. Stanley rejoindra plutôt l'historiographie américaine lorsqu'il écrira : «Quelle qu'ait été l'incidence de ces questions de libre échange et de droits des marins dans les états du littoral de l'Atlantique, la psychose de guerre, dans les régions de l'Ouest, fut provoquée surtout par la conviction que les Britanniques des Canadas incitaient les peuples indiens à s'opposer constamment à la progression des établissements américains sur leurs territoires. Les Américains étaient toujours obsédés par les Indiens, depuis l'époque des raids guerriers abénaquis et micmacs sur les établissements frontaliers de la Nouvelle-Angleterre et de l'état de New York, sous le régime français. Mais les Français n'avaient pas été les seuls à se servir des Indiens pour combattre les Américains, puisque les successeurs de Frontenac au château Saint-Louis à Québec, Guy Carleton et Frederick Haldimand, avaient fait de même pendant la Révolution américaine. Quelques Indiens avaient suivi John Burgoyne; d'autres commandés par le colonel Barrimore St. Leger, avaient attiré le général américain Nicholas Herkimer dans une embuscade à Oriskany (état de New York). Puis d'autres encore s'étaient joints aux chasseurs de Butler pour faire des raids dans l'état de New York (Cherry Valley et German Flatts) et en Pennsylvanie (Wyoming Valley). D'ailleurs, les Britanniques n'avaient-ils pas donné au réputé Joseph Brant, un Indien de la nation iroquoise des Agniers, un brevet d'officier dans leur armée? Et que dire des raids sur la frontière occidentale qui furent
loin les causes «historiques», réelles, de l'agressivité qui amènera Madison à déclencher la guerre. Bien sûr, nous retrouvons les questions économiques, la limite des échanges commerciaux et l'arrogance des navires marchands britanniques contre les navires américains. Mais tout cela se révèle secondaire. Stanley rejoindra plutôt l'historiographie américaine lorsqu'il écrira : «Quelle qu'ait été l'incidence de ces questions de libre échange et de droits des marins dans les états du littoral de l'Atlantique, la psychose de guerre, dans les régions de l'Ouest, fut provoquée surtout par la conviction que les Britanniques des Canadas incitaient les peuples indiens à s'opposer constamment à la progression des établissements américains sur leurs territoires. Les Américains étaient toujours obsédés par les Indiens, depuis l'époque des raids guerriers abénaquis et micmacs sur les établissements frontaliers de la Nouvelle-Angleterre et de l'état de New York, sous le régime français. Mais les Français n'avaient pas été les seuls à se servir des Indiens pour combattre les Américains, puisque les successeurs de Frontenac au château Saint-Louis à Québec, Guy Carleton et Frederick Haldimand, avaient fait de même pendant la Révolution américaine. Quelques Indiens avaient suivi John Burgoyne; d'autres commandés par le colonel Barrimore St. Leger, avaient attiré le général américain Nicholas Herkimer dans une embuscade à Oriskany (état de New York). Puis d'autres encore s'étaient joints aux chasseurs de Butler pour faire des raids dans l'état de New York (Cherry Valley et German Flatts) et en Pennsylvanie (Wyoming Valley). D'ailleurs, les Britanniques n'avaient-ils pas donné au réputé Joseph Brant, un Indien de la nation iroquoise des Agniers, un brevet d'officier dans leur armée? Et que dire des raids sur la frontière occidentale qui furent  effectués, à l'instigation d'agents britanniques auprès des Indiens - Alexander McKee et Henry Hamilton, "l'acheteur de scalps" par exemple - à Détroit?…» (G. F. G. Stanley. ibid. pp. 21-22). Encore là, l'essentiel de l'explication de Stanley repose sur des traits psychologiques : «psychose de guerre», les Américains «obsédés» par les Indiens. «Bien sûr, ni les marchands ni les agents n'avaient poussé les Indiens à poursuivre la lutte. De l'aveu général, ils se battaient en vain, mais c'était leur bataille, qu'ils livraient afin de pouvoir vivre, à leur guise, sur leurs terres et selon leurs traditions; et seule la pression constante de la progression inexorable de la colonisation vers l'Ouest par les blancs les incitait à continuer leur résistance. Les Américains, pour leur part, ne voyaient dans ce geste des Indiens que la sinistre influence des agents britanniques : des vies américaines étaient sacrifiées, en territoire américain, par des "sauvages", armés de mousquets britanniques, chargés de balles britanniques. "L'amertume ainsi engendrée aux États-Unis empoisonnait l'attitude des Américains, et contribuait à rallumer la guerre contre la Grande-Bretagne", écrit un historien qui connait aussi bien l'histoire du Canada que celle des États-Unis [A. L. Burt]» (G. F. G. Stanley. ibid. pp. 27-28). Le jeu du ressentiment et de l'amertume entre Britanniques et Américains à l'Est; poussée autochtone et psychose de guerre à l'Ouest, il semblerait que si la Guerre de 1812 fut si erratique dans son commandement et si acharnée dans la résistance que lui opposèrent les Canadiens, le tout repose sur des attitudes psychologiques qui n'auraient aucune racines dans les faits réels, d'où le renversement fatal dans une métaphysique de l'Histoire. La Guerre de 1812 serait-elle née alors de purs fantasmes?
effectués, à l'instigation d'agents britanniques auprès des Indiens - Alexander McKee et Henry Hamilton, "l'acheteur de scalps" par exemple - à Détroit?…» (G. F. G. Stanley. ibid. pp. 21-22). Encore là, l'essentiel de l'explication de Stanley repose sur des traits psychologiques : «psychose de guerre», les Américains «obsédés» par les Indiens. «Bien sûr, ni les marchands ni les agents n'avaient poussé les Indiens à poursuivre la lutte. De l'aveu général, ils se battaient en vain, mais c'était leur bataille, qu'ils livraient afin de pouvoir vivre, à leur guise, sur leurs terres et selon leurs traditions; et seule la pression constante de la progression inexorable de la colonisation vers l'Ouest par les blancs les incitait à continuer leur résistance. Les Américains, pour leur part, ne voyaient dans ce geste des Indiens que la sinistre influence des agents britanniques : des vies américaines étaient sacrifiées, en territoire américain, par des "sauvages", armés de mousquets britanniques, chargés de balles britanniques. "L'amertume ainsi engendrée aux États-Unis empoisonnait l'attitude des Américains, et contribuait à rallumer la guerre contre la Grande-Bretagne", écrit un historien qui connait aussi bien l'histoire du Canada que celle des États-Unis [A. L. Burt]» (G. F. G. Stanley. ibid. pp. 27-28). Le jeu du ressentiment et de l'amertume entre Britanniques et Américains à l'Est; poussée autochtone et psychose de guerre à l'Ouest, il semblerait que si la Guerre de 1812 fut si erratique dans son commandement et si acharnée dans la résistance que lui opposèrent les Canadiens, le tout repose sur des attitudes psychologiques qui n'auraient aucune racines dans les faits réels, d'où le renversement fatal dans une métaphysique de l'Histoire. La Guerre de 1812 serait-elle née alors de purs fantasmes?La traduction concrète de ces fantasmes serait alors la conquête militaire du Canada afin de solutionner tous les problèmes, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest; solution radicale, solution miracle. «En général, rappelle Stanley, les Américains n'ont jamais aimé entendre dire que des motifs impérialistes, du moins en partie, avaient pu pousser les États-Unis à déclarer la guerre de 1812. Pourtant, de toute évidence, l'incorporation du Canada dans l'Union américaine était l'un des buts des hommes qui dominaient au Congrès en 1812. L'idée n'était pas nouvelle. Elle avait motivé l'action du Congrès et des hommes qui avaient suivi Richard Montgomery et Benedict Arnold à Québec en 1775» (G. F. G. Stanley. ibid. p. 29). Contre l'opinion exprimée à travers l'historiographie américaine, Stanley conclut que les buts de conquête impérialiste furent à l'origine de l'invasion du Canada, prenant prétexte de la guerre avec la Grande-Bretagne et des vexations qu'elle faisait subir à la marine marchande américaine. En ce sens, le fait que le traité de Gand n'ait pas évincé les Britanniques du Canada serait une défaite des intentions américaines. Pourtant, Stanley, lorsqu'il traite de la paix, n'insiste pas sur cette «défaite» : «Le traité de Gand - "le traité des Omissions", comme l'appelait Jean-Baptiste Petry, diplomate français, dans une lettre à Talleyrand - fut un triomphe pour la diplomatie américaine.

 Les cinq commissaires s'étaient révélés plus habiles et plus déterminés que leurs trois homologues britanniques, et ils avaient, tout compte fait, reçu plus qu'ils n'étaient prêts à donner. Ils avaient bien agi envers leur pays. Jusqu'à quel point? On ne le sut que le 11 février 1815, quand on apprit, à New York, ce qu'ils avaient réalisé; plusieurs jours après, le traité soumis au sénat des États-Unis, y fut ratifié» (G. F. G. Stanley. ibid. p. 394). C'est le traité Webster-Ashburton qui, trente ans plus tard (1842), allait, en rognant certains territoires jouxtant la frontière canadienne au Bas-Canada et au Nouveau-Brunswick, donner un «os» du côté canadien aux revendications américaines. En rognant la frontière canadienne, les Américains bloquaient toute possibilité d'expansion territoriale en deçà du 49º parallèle. «On salua joyeusement, tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, la fin des hostilités, sans se soucier des conditions de paix. Toutefois, en Amérique du Nord britannique, on fut bien moins enthousiaste. Les habitants des Maritimes, surtout les gens de Halifax, se demandaient si la prospérité inégalée apportée par la guerre n'allait pas maintenant disparaître; dans les Canadas, les marchands de fourrures trouvaient que le gouvernement de Londres, par indifférence, les avait non seulement abandonnés mais trahis, au même titre que les Indiens, dont la loyauté à la cause britannique en Amérique du Nord assurait la prospérité du commerce des fourrures. Comme d'habitude, on avait sacrifié les victoires obtenues par cette vieille alliance des soldats britanniques de l'armée régulière, des marchands de fourrures et des Indiens dans le but d'apaiser une jeune république ombrageuse à l'excès, et d'obtenir son amitié précaire» (G. F. G. Stanley. ibid. pp. 394-395)
Les cinq commissaires s'étaient révélés plus habiles et plus déterminés que leurs trois homologues britanniques, et ils avaient, tout compte fait, reçu plus qu'ils n'étaient prêts à donner. Ils avaient bien agi envers leur pays. Jusqu'à quel point? On ne le sut que le 11 février 1815, quand on apprit, à New York, ce qu'ils avaient réalisé; plusieurs jours après, le traité soumis au sénat des États-Unis, y fut ratifié» (G. F. G. Stanley. ibid. p. 394). C'est le traité Webster-Ashburton qui, trente ans plus tard (1842), allait, en rognant certains territoires jouxtant la frontière canadienne au Bas-Canada et au Nouveau-Brunswick, donner un «os» du côté canadien aux revendications américaines. En rognant la frontière canadienne, les Américains bloquaient toute possibilité d'expansion territoriale en deçà du 49º parallèle. «On salua joyeusement, tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, la fin des hostilités, sans se soucier des conditions de paix. Toutefois, en Amérique du Nord britannique, on fut bien moins enthousiaste. Les habitants des Maritimes, surtout les gens de Halifax, se demandaient si la prospérité inégalée apportée par la guerre n'allait pas maintenant disparaître; dans les Canadas, les marchands de fourrures trouvaient que le gouvernement de Londres, par indifférence, les avait non seulement abandonnés mais trahis, au même titre que les Indiens, dont la loyauté à la cause britannique en Amérique du Nord assurait la prospérité du commerce des fourrures. Comme d'habitude, on avait sacrifié les victoires obtenues par cette vieille alliance des soldats britanniques de l'armée régulière, des marchands de fourrures et des Indiens dans le but d'apaiser une jeune république ombrageuse à l'excès, et d'obtenir son amitié précaire» (G. F. G. Stanley. ibid. pp. 394-395)Cette conclusion de Stanley renverse tous les «succès» attribués par les autres interprétations historiographiques canadiennes. Si le sentiment de nationalité amorçait son commencement sur un flanc négatif, comme nous l'avons vu pour les Canadiens Français, les Canadiens Anglais sortaient, à leur tour, vexés, frustrés, abandonnés par la Mère-Patrie britannique comme les Canadiens Français s'étaient sentis, cinquante ans plus tôt, abandonnés par la Mère-Patrie française. Le sort commun les rassemblait tous deux, et c'est dans l'«omission» du traité de Gand de 1814 qu'il faut peut-être chercher les origines du ressentiment violent qui devait conduire, vingt ans plus tard, les citoyens du Haut-Canada à s'engager dans la voie de la rébellion armée contre le gouvernement colonial britannique.
d) chez les Québécois:
Les historiens canadiens-français, puis québécois, ont leur vision propre de la Guerre de 1812. Certes, cette vision s’est dégagée progressivement de l’historiographie canadienne dont nous venons de tracer l’essentiel. Cette spécification s’est accomplie au cours du dernier demi-siècle. Dans son
 Histoire du Canada français, l’abbé Lionel Groulx ne consacrait encore qu’une page aux événements de 1812-1814. Il l’inscrivait dans le prolongement de la crise constitutionnelle qui avait accompagné «le règne de la Terreur » du gouverneur Craig. Dans son esprit, une certaine continuité unissait la crise parlementaire et la participation à la guerre, à la fois comme trêve, mais aussi comme accélérateur des conflits à venir : «Pour le Canada, voici bien encore une guerre gratuite, provoquée par un conflit où il n’est rien. La défense du territoire n’en rallie pas moins tous les esprits. La Chambre du Bas-Canada vote les crédits extraordinaires qu’on lui demande. Trois ans la guerre sévit dans le Haut et le Bas-Canada avec des alternatives de revers et de succès. Des bataillons de miliciens canadiens-français se portent à la défense des frontières de leur province. En 1813 les Voltigeurs du major de Salaberry bloquent Châteauguay, l’invasion américaine qui déferle vers Montréal. Années d’alertes militaires, mais qui valent au Bas-Canada, disions-nous, une paix politique relative. Deux gouverneurs d’esprit conciliant procurent à la province cet apaisement» (L. Groulx. Histoire du Canada français, t. 2, Montréal, Fides, 1960, pp. 121-122). Le fait, qu’au sortir des guerres napoléoniennes le trésor britannique est à sec, obligera le gouverneur à puiser dans les revenus des lois fiscales du Bas-Canada. Aussi, la belle conciliation entretenue sous Prevost, puis sous son successeur Sherbrooke, précédait de terribles orages, dont la querelle des subsides allait être le puissant déclencheur des crises qui devaient suivre.
Histoire du Canada français, l’abbé Lionel Groulx ne consacrait encore qu’une page aux événements de 1812-1814. Il l’inscrivait dans le prolongement de la crise constitutionnelle qui avait accompagné «le règne de la Terreur » du gouverneur Craig. Dans son esprit, une certaine continuité unissait la crise parlementaire et la participation à la guerre, à la fois comme trêve, mais aussi comme accélérateur des conflits à venir : «Pour le Canada, voici bien encore une guerre gratuite, provoquée par un conflit où il n’est rien. La défense du territoire n’en rallie pas moins tous les esprits. La Chambre du Bas-Canada vote les crédits extraordinaires qu’on lui demande. Trois ans la guerre sévit dans le Haut et le Bas-Canada avec des alternatives de revers et de succès. Des bataillons de miliciens canadiens-français se portent à la défense des frontières de leur province. En 1813 les Voltigeurs du major de Salaberry bloquent Châteauguay, l’invasion américaine qui déferle vers Montréal. Années d’alertes militaires, mais qui valent au Bas-Canada, disions-nous, une paix politique relative. Deux gouverneurs d’esprit conciliant procurent à la province cet apaisement» (L. Groulx. Histoire du Canada français, t. 2, Montréal, Fides, 1960, pp. 121-122). Le fait, qu’au sortir des guerres napoléoniennes le trésor britannique est à sec, obligera le gouverneur à puiser dans les revenus des lois fiscales du Bas-Canada. Aussi, la belle conciliation entretenue sous Prevost, puis sous son successeur Sherbrooke, précédait de terribles orages, dont la querelle des subsides allait être le puissant déclencheur des crises qui devaient suivre.Groulx, on le voit, présente la guerre comme une autre
 tuile qui tombe sur la tête des malheureux canadiens-français, trimbalés par la politique internationale de l’Empire, aussi ne la voit-il que comme une interruption des vrais combats propres aux intérêts nationaux : ceux entre l’Assemblée législative et le gouvernement colonial. Un Français, Léon Lemonnier, auteur également d’une Histoire du Canada français (1942), s’intéresse certes davantage au Régime français, mais il accorde une place quand même au Canada britannique. Il décrit comment, au déclenchement de la guerre, «les Canadiens français s’en émurent aussitôt. Sous l’influence du clergé catholique, qui craignait de voir ses fidèles assimilés par les vastes États-Unis, les habitants du Bas-Canada se déclarèrent résolument pour l’Angleterre et les miliciens, répondant à l’appel du gouverneur, se préparèrent à défendre leur pays» (L. Lemonnier. Histoire du Canada français, Paris, Hachette, 1942, p. 372). Cette importance accordée au clergé n’est plus seulement celle d'un simple «accessoire» que nous retrouvions dans le récit de Garneau. Le clergé est doté d'une influence des plus déterminantes dans la décision des Canadiens français de soutenir le régime colonial. Lemonnier apparaît ici tributaire de l’historiographie cléricalo-nationaliste du tournant des XIXe-XXe siècles.
tuile qui tombe sur la tête des malheureux canadiens-français, trimbalés par la politique internationale de l’Empire, aussi ne la voit-il que comme une interruption des vrais combats propres aux intérêts nationaux : ceux entre l’Assemblée législative et le gouvernement colonial. Un Français, Léon Lemonnier, auteur également d’une Histoire du Canada français (1942), s’intéresse certes davantage au Régime français, mais il accorde une place quand même au Canada britannique. Il décrit comment, au déclenchement de la guerre, «les Canadiens français s’en émurent aussitôt. Sous l’influence du clergé catholique, qui craignait de voir ses fidèles assimilés par les vastes États-Unis, les habitants du Bas-Canada se déclarèrent résolument pour l’Angleterre et les miliciens, répondant à l’appel du gouverneur, se préparèrent à défendre leur pays» (L. Lemonnier. Histoire du Canada français, Paris, Hachette, 1942, p. 372). Cette importance accordée au clergé n’est plus seulement celle d'un simple «accessoire» que nous retrouvions dans le récit de Garneau. Le clergé est doté d'une influence des plus déterminantes dans la décision des Canadiens français de soutenir le régime colonial. Lemonnier apparaît ici tributaire de l’historiographie cléricalo-nationaliste du tournant des XIXe-XXe siècles.Un autre étranger, Mason Wade, un Américain, a traité, dans Les Canadiens français de 1760 à nos
 jours, de l’importance de la guerre pour la population francophone du Canada. Si Groulx n’insistait pas sur les faits d’armes canadiens-français, Wade rappelle pour sa part : «Bien que les historiens aient beaucoup glorifié la part prise par les Canadiens français à la guerre de 1812, ce fut surtout sur mer et dans l’Ouest que se déroula cette guerre et le Québec n’y joua qu’un rôle très modeste. Joseph Bouchette, fils du guide de Carleton en 1775, a beau mettre en relief “le désir insatiable du gain” des Américains - il est vrai que certains d’entre eux, tels que Philémon Wright du Massachusetts, fondateur de l’industrie du bois de construction à Ottawa, faisaient preuve d’une activité particulièrement anti-canadienne - si bien que les visées yankee sur le Québec soient mentionnées dans maintes histoire du conflit, c’est en fait le sud et l’ouest des États-Unis qui voulurent la guerre et leur but en attaquant le Canada était de nuire à l’Angleterre et non l’annexion. Le long retard apporté par l’Angleterre à la cession des postes de traite de l’Ouest, cause du conflit des trafiquants et de leurs Peaux-Rouges avec les Américains, et les difficultés maritimes anglo-américaines avaient irrité le grandissant orgueil national des États-Unis. Orgueil qui s’exprima quelques années plus tard par les cris stridents de l’Aigle
jours, de l’importance de la guerre pour la population francophone du Canada. Si Groulx n’insistait pas sur les faits d’armes canadiens-français, Wade rappelle pour sa part : «Bien que les historiens aient beaucoup glorifié la part prise par les Canadiens français à la guerre de 1812, ce fut surtout sur mer et dans l’Ouest que se déroula cette guerre et le Québec n’y joua qu’un rôle très modeste. Joseph Bouchette, fils du guide de Carleton en 1775, a beau mettre en relief “le désir insatiable du gain” des Américains - il est vrai que certains d’entre eux, tels que Philémon Wright du Massachusetts, fondateur de l’industrie du bois de construction à Ottawa, faisaient preuve d’une activité particulièrement anti-canadienne - si bien que les visées yankee sur le Québec soient mentionnées dans maintes histoire du conflit, c’est en fait le sud et l’ouest des États-Unis qui voulurent la guerre et leur but en attaquant le Canada était de nuire à l’Angleterre et non l’annexion. Le long retard apporté par l’Angleterre à la cession des postes de traite de l’Ouest, cause du conflit des trafiquants et de leurs Peaux-Rouges avec les Américains, et les difficultés maritimes anglo-américaines avaient irrité le grandissant orgueil national des États-Unis. Orgueil qui s’exprima quelques années plus tard par les cris stridents de l’Aigle  proclamant la doctrine de Manifest Destiny». (M. Wade. Les Canadiens français de 1760 à nos jours, Ottawa, Cercle du Livre du France, 1966, pp. 140-141). En tant qu’Américain, Wade greffe la doxa de l’historiographie américaine sur la question canadienne, écartant ainsi toute l’interprétation classique des historiens canadiens basée sur la convoitise du Canada. Plus loin, il ajoute : «L’annexion du Québec ne figurait plus dans le plan yankee : les relations économiques entre la Nouvelle-Angleterre et son voisin du nord étaient devenues si étroites et si profitables qu’un Américain pouvait écrire : “Nous regretterions beaucoup (entre nous) que Québec ne reste pas en possession des Anglais. Ils ne nous imposent aucun droit sur nos exportations vers l’embouchure du fleuve et nos produits étant expédiés du Canada comme produits d’une colonie anglaise, nous recevons les subsides ou bénéficions ainsi des droits protecteurs”. En 1808, le gouverneur du Vermont assurait encore à John Henry, le double renégat servant alors d’agent secret pour Craig, qu’en cas de guerre son État adopterait une attitude de neutralité envers le Canada. Henry révéla les projets anglais au président Madison après avoir été licencié par Craig, ce qui eut une certaine influence sur l’aggravation de la psychose de guerre en Nouvelle-Angleterre. Cependant, les états qui avaient une frontière commune avec le Québec restèrent neutre pendant la guerre» (M. Wade. ibid. p. 141). Qu’est-ce à dire? Que les War Hawks ne se souciaient nullement d’acquérir le Bas-Canada; ce qu’ils voulaient, c’était le Haut-Canada, les terres de l’Ouest jusqu’à l’océan Pacifique, alors que les commerçants de la Nouvelle-Angleterre trouvaient profitables les liens avec le Bas-Canada, voie d'accès sans tarifs vers les ports britanniques, d'où le mécontentement, à la limite du sécessionnisme, des États limitrophes de l'Est. Le métissage des interprétations opéré par Wade nous permet de mieux saisir les motivations et les tensions suscitées par la guerre au sein même des États-Unis, beaucoup mieux que la position bas-canadienne face au déclenchement du conflit.
proclamant la doctrine de Manifest Destiny». (M. Wade. Les Canadiens français de 1760 à nos jours, Ottawa, Cercle du Livre du France, 1966, pp. 140-141). En tant qu’Américain, Wade greffe la doxa de l’historiographie américaine sur la question canadienne, écartant ainsi toute l’interprétation classique des historiens canadiens basée sur la convoitise du Canada. Plus loin, il ajoute : «L’annexion du Québec ne figurait plus dans le plan yankee : les relations économiques entre la Nouvelle-Angleterre et son voisin du nord étaient devenues si étroites et si profitables qu’un Américain pouvait écrire : “Nous regretterions beaucoup (entre nous) que Québec ne reste pas en possession des Anglais. Ils ne nous imposent aucun droit sur nos exportations vers l’embouchure du fleuve et nos produits étant expédiés du Canada comme produits d’une colonie anglaise, nous recevons les subsides ou bénéficions ainsi des droits protecteurs”. En 1808, le gouverneur du Vermont assurait encore à John Henry, le double renégat servant alors d’agent secret pour Craig, qu’en cas de guerre son État adopterait une attitude de neutralité envers le Canada. Henry révéla les projets anglais au président Madison après avoir été licencié par Craig, ce qui eut une certaine influence sur l’aggravation de la psychose de guerre en Nouvelle-Angleterre. Cependant, les états qui avaient une frontière commune avec le Québec restèrent neutre pendant la guerre» (M. Wade. ibid. p. 141). Qu’est-ce à dire? Que les War Hawks ne se souciaient nullement d’acquérir le Bas-Canada; ce qu’ils voulaient, c’était le Haut-Canada, les terres de l’Ouest jusqu’à l’océan Pacifique, alors que les commerçants de la Nouvelle-Angleterre trouvaient profitables les liens avec le Bas-Canada, voie d'accès sans tarifs vers les ports britanniques, d'où le mécontentement, à la limite du sécessionnisme, des États limitrophes de l'Est. Le métissage des interprétations opéré par Wade nous permet de mieux saisir les motivations et les tensions suscitées par la guerre au sein même des États-Unis, beaucoup mieux que la position bas-canadienne face au déclenchement du conflit.Et le Québec? «La plus grande partie de la guerre de 1812 se déroula dans le Haut-Canada et, à l’exception de la part prise par les “voyageurs” et “engagés” canadiens-français du trafic des fourrures aux batailles autour des postes des Grands Lacs, Québec n’eut guère l’occasion de traduire
 par des actes sa loyauté et sa volonté de combattre» (M. Wade. ibid. p. 142), ce qui banalise ce que l’historiographie classique canadienne montait aux nues comme l’engagement «patriotique» des Voltigeurs à défendre coûte que coûte le régime colonial. Un point essentiel que soulève Wade est le suivant : «Les belliqueux marchands de Montréal, qui exhortaient constamment le gouvernement à un plus grand effort et dont les “engagés” et les Indiens influencés par eux furent d’utiles alliés pour les ‘tuniques rouges”, contribuèrent beaucoup aux succès britanniques dans l’Ouest. Une grande partie de l’ancien empire de la traite des fourrures fut récupérée au cours de la guerre mais, une fois de plus, la diplomatie anglaise, malgré l’insistance des marchands pour un nouveau tracé de la frontière de l’Ouest et la création d’un État-tampon indien, sacrifia les gains de la guerre au Traité de Gand (1815). La puissance grandissante d’Astor dans le commerce des fourrures en fut renforcée tandis que les traitants de Montréal voyaient leur dernière ressource dans le Nord-Ouest menacée, après 1812, par les établissements de Lord Selkirk dans le pays de la Rivière Rouge et par l’expansion de la Compagnie de la Baie d’Hudson
par des actes sa loyauté et sa volonté de combattre» (M. Wade. ibid. p. 142), ce qui banalise ce que l’historiographie classique canadienne montait aux nues comme l’engagement «patriotique» des Voltigeurs à défendre coûte que coûte le régime colonial. Un point essentiel que soulève Wade est le suivant : «Les belliqueux marchands de Montréal, qui exhortaient constamment le gouvernement à un plus grand effort et dont les “engagés” et les Indiens influencés par eux furent d’utiles alliés pour les ‘tuniques rouges”, contribuèrent beaucoup aux succès britanniques dans l’Ouest. Une grande partie de l’ancien empire de la traite des fourrures fut récupérée au cours de la guerre mais, une fois de plus, la diplomatie anglaise, malgré l’insistance des marchands pour un nouveau tracé de la frontière de l’Ouest et la création d’un État-tampon indien, sacrifia les gains de la guerre au Traité de Gand (1815). La puissance grandissante d’Astor dans le commerce des fourrures en fut renforcée tandis que les traitants de Montréal voyaient leur dernière ressource dans le Nord-Ouest menacée, après 1812, par les établissements de Lord Selkirk dans le pays de la Rivière Rouge et par l’expansion de la Compagnie de la Baie d’Hudson  qui absorba la Compagnie du Nord-Ouest en 1821» (M. Wade. ibid. p. 143). La dynamique de la participation canadienne-française prend une tournure qu’évitait l’historiographie canadienne. Les intérêts commerciaux étaient ceux que les engagés venaient défendre dans le Haut-Canada. C’étaient les intérêts des riches marchands de Londres et de Montréal contre ceux des premiers tycoons américains, dont John Jacob Astor était le prototype le plus agressif. Le bilan que tracera donc Wade sera beaucoup plus nuancé : «La guerre de 1812 affaiblit la loyauté britannique des Anglais dans le Québec, tandis que les Canadiens français firent preuve d’une loyauté beaucoup plus grande qu’en 1775. Une nouvelle loyauté canadienne commençait à naître dans les deux groupes qui avaient combattu ensemble pour repousser l’invasion et dont la méfiance réciproque avait été dissipée par l’effort commun. Ce nouveau canadianisme devait être mis en lumière dans les années qui suivirent par la collaboration des membres des deux groupes ethniques pour obtenir un gouvernement canadien autonome et combattre les erreurs de l’administration anglaise» (M. Wade. ibid. p. 143).
qui absorba la Compagnie du Nord-Ouest en 1821» (M. Wade. ibid. p. 143). La dynamique de la participation canadienne-française prend une tournure qu’évitait l’historiographie canadienne. Les intérêts commerciaux étaient ceux que les engagés venaient défendre dans le Haut-Canada. C’étaient les intérêts des riches marchands de Londres et de Montréal contre ceux des premiers tycoons américains, dont John Jacob Astor était le prototype le plus agressif. Le bilan que tracera donc Wade sera beaucoup plus nuancé : «La guerre de 1812 affaiblit la loyauté britannique des Anglais dans le Québec, tandis que les Canadiens français firent preuve d’une loyauté beaucoup plus grande qu’en 1775. Une nouvelle loyauté canadienne commençait à naître dans les deux groupes qui avaient combattu ensemble pour repousser l’invasion et dont la méfiance réciproque avait été dissipée par l’effort commun. Ce nouveau canadianisme devait être mis en lumière dans les années qui suivirent par la collaboration des membres des deux groupes ethniques pour obtenir un gouvernement canadien autonome et combattre les erreurs de l’administration anglaise» (M. Wade. ibid. p. 143).Le bilan de Wade nourrit la thèse de Stephen Harper dans la mesure où le coude à coude anglo-canadien (français) serait le semis de la future Confédération. En ce sens, après le détour des intérêts commerciaux, Wade revient aux conclusions mises de l’avant lorsque l’historiographie canadienne trace le bilan de la Guerre de 1812. C”est à ce point qu’arrive l’authentique historiographie nationaliste des années 1960-1980. André Garon, dans l’Histoire du Québec dirigée par Jean Hamelin (1976) parue l’année de l’élection du Parti Québécois au gouvernement, commence ainsi le paragraphe sur la Guerre de 1812 : «La guerre canado-américaine donna lieu à une trêve politico-
 |
| Drapeau de la première milice du Bas-Canada, 1812 |
Plutôt que par ses combats, la Guerre de 1812 s’inscrit dans les crises sociales et constitutionnelles du Bas-Canada, ajoutant une prépondérance du clergé catholique qui n’était pas aussi évidente qu’elle n’y paraît. Dans un ouvrage de propagande marxiste, Léandre Bergeron, avec son célèbre Petit manuel d’histoire du Québec paru en octobre 1974 poursuit pourtant dans la lignée de Groulx et des nationalistes dans la mesure où la Guerre de 1812 intervient seulement comme suspension dans l’action d’assimilation et de confrontations issue du gouvernement Craig et qui sera repris immédiatement après la fin des hostilités. Le soi-disant
 «enthousiasme» des Canadiens Français à participer à la guerre n’est rien de plus qu’un opportunisme béat : «Quel est cet événement extérieur en 1812? Le jeune peuple américain connaît une crise de croissance assez poussée. Il se sent fort et dynamique et veut étendre sa puissance le plus vite possible sur toute l’Amérique du Nord. Au sud, il veut s’assimiler la Floride qui est une possession espagnole; à l’ouest, il veut vaincre la résistance rouge et étendre ses frontières dans les plaines fertiles, au nord, il voudrait bien prendre le fleuve Saint-Laurent qui est une voie commerciale importante. L’ennemi, pour l’Américain, est l’Anglais qui est l’allié de l’Espagnol au sud, l’allié de l’homme rouge à l’ouest et le maître des Canadas au nord. Un incident naval amène les États-Unis à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne» (L. Bergeron, Petit manuel d'histoire du Québec, s.v., Éditions québécoises, 1974, p. 79). Le mauvais rôle est donc donné à l’Angleterre, même si l’«impérialisme», ce que décrit le marxiste Bergeron, et dont il ne dit pas le nom, dévore les Américains, s’associant à une atmosphère d’«esprit de garnison», i.e. une fièvre obsidionale chez nos voisins du Sud. L’explication privilégiée par Lacour-Gayet, Gilmor et Turgeon et surtout Stanley résonne donc dans le pamphlet de Bergeron! Passant vite sur les années de guerre - pour lui, «Salaberry devient un petit héros» suite à la bataille de la Châteauguay -, le bilan tiré par Bergeron est le suivant : «Quand la guerre éclate, les Canayens n’ont pas envie de se joindre aux Américains parce qu’ils craignent les visées expansionnistes, impérialistes de cette jeune nation et n’ont pas de sympathie pour les frères de tous ces Américains qui sont venus s’installer dans les Cantons de l’Est pour les noyer. Pour les Canayens l’Américain est aussi un “maudit anglais”. Le gouverneur va exploiter ce sentiment. Il demande au clergé de rallier le peuple canayen contre les Américains. L’Assemblée vote 928,000 dollars pour les dépenses militaires et une loi de milice qui permet d’enrôler 6,000 hommes. Salaberry recrute le premier régiment canayen, les Voltigeurs canadiens, en quelques jours» (L. Bergeron. ibid. p. 80). On comprend que les «Canayens» sont victimes de la manipulation politique du gouvernement colonial. Comme on peut le constater, Bergeron ne fait pas dans la dentelle, et pousse à l’extrême les interprétations canadiennes et québécoises (nationalistes), beaucoup plus que de fournir une interprétation originale à même la dialectique historique de Marx.
«enthousiasme» des Canadiens Français à participer à la guerre n’est rien de plus qu’un opportunisme béat : «Quel est cet événement extérieur en 1812? Le jeune peuple américain connaît une crise de croissance assez poussée. Il se sent fort et dynamique et veut étendre sa puissance le plus vite possible sur toute l’Amérique du Nord. Au sud, il veut s’assimiler la Floride qui est une possession espagnole; à l’ouest, il veut vaincre la résistance rouge et étendre ses frontières dans les plaines fertiles, au nord, il voudrait bien prendre le fleuve Saint-Laurent qui est une voie commerciale importante. L’ennemi, pour l’Américain, est l’Anglais qui est l’allié de l’Espagnol au sud, l’allié de l’homme rouge à l’ouest et le maître des Canadas au nord. Un incident naval amène les États-Unis à déclarer la guerre à la Grande-Bretagne» (L. Bergeron, Petit manuel d'histoire du Québec, s.v., Éditions québécoises, 1974, p. 79). Le mauvais rôle est donc donné à l’Angleterre, même si l’«impérialisme», ce que décrit le marxiste Bergeron, et dont il ne dit pas le nom, dévore les Américains, s’associant à une atmosphère d’«esprit de garnison», i.e. une fièvre obsidionale chez nos voisins du Sud. L’explication privilégiée par Lacour-Gayet, Gilmor et Turgeon et surtout Stanley résonne donc dans le pamphlet de Bergeron! Passant vite sur les années de guerre - pour lui, «Salaberry devient un petit héros» suite à la bataille de la Châteauguay -, le bilan tiré par Bergeron est le suivant : «Quand la guerre éclate, les Canayens n’ont pas envie de se joindre aux Américains parce qu’ils craignent les visées expansionnistes, impérialistes de cette jeune nation et n’ont pas de sympathie pour les frères de tous ces Américains qui sont venus s’installer dans les Cantons de l’Est pour les noyer. Pour les Canayens l’Américain est aussi un “maudit anglais”. Le gouverneur va exploiter ce sentiment. Il demande au clergé de rallier le peuple canayen contre les Américains. L’Assemblée vote 928,000 dollars pour les dépenses militaires et une loi de milice qui permet d’enrôler 6,000 hommes. Salaberry recrute le premier régiment canayen, les Voltigeurs canadiens, en quelques jours» (L. Bergeron. ibid. p. 80). On comprend que les «Canayens» sont victimes de la manipulation politique du gouvernement colonial. Comme on peut le constater, Bergeron ne fait pas dans la dentelle, et pousse à l’extrême les interprétations canadiennes et québécoises (nationalistes), beaucoup plus que de fournir une interprétation originale à même la dialectique historique de Marx.Une historienne canadienne-anglaise, Susan Mann Trofimenkoff, également centrée sur l’histoire sociale du Québec, présente avec plus de subtilité l’enjeu que représente la Guerre de 1812 pour les
 Canadiens Français : «En interrompant momentanément le jeu politique du Bas-Canada, la guerre de 1812 rappelle opportunément au Québec qu’il fait encore partie de l’empire britannique. Cette guerre ne fait que traverser le Québec, mais elle accorde un répit aux élites traditionnelles et révèle la nature véritable des élites nouvelles. L’affrontement américano-britannique, qui porte une fois de plus sur les territoires de l’Ouest, rencontre peu de sympathie chez les habitants des États américains du Nord ayant des frontières communes avec le Bas-Canada : ces deux régions sont liées par des échanges économiques le long du Richelieu qui font de Saint-Denis un port actif. Elles sont également liées par des mouvements de population, beaucoup de Canadiens français émigrant vers le Sud pour travailler dans l’industrie forestière du lac Champlain. Malgré ces liens, c’est une fois encore cette région qui sert de couloir d’invasion à la guerre, ce qui permet aux vieilles familles seigneuriales de vivre à nouveau quelques heures de gloire militaire : le lieutenant-colonel Charles-Michel de Salaberry repousse les troupes américaines à Lacolle en 1812, puis à nouveau à Châteauguay en 1813. De Salaberry et les siens souhaitent ardemment défendre les vieilles valeurs aristocratiques et celles-ci, pour eux, passent maintenant par la fidélité à la Grande-Bretagne. Ils redoutent plus les conséquences sociales que les conséquences militaires d’une victoire américaine. Le clergé se fait le porte-parole des mêmes sentiments et il y ajoute une note religieuse : on doit soutenir l’ordre établi. Il ne se trouve qu’un seul prêtre, le futur évêque de Montréal, monseigneur Lartigue, pour y ajouter la notion neuve de l’obligation nationale. Quant aux marchands anglais du Québec, les liens qui les unissent à l’Empire sont de nature économique et ils ne sont pas prêts à les voir rompre au moment où les victoires britanniques dans le Haut-Canada leur ouvrent à nouveau les territoires à fourrure situés au sud des Grands Lacs et à l’ouest, en direction du Mississippi. Le vieux rêve d’expansion continentale des marchands reprend vie au moment même où la guerre stimule le commerce local dans la vallée du Saint-Laurent. Mais ce rêve est voué à l’échec, une fois de plus, car à la fin de la guerre, la Grande-Bretagne va remettre purement et simplement aux États-Unis les régions de l’Ouest qui ont été conquises. Le seul résultat de la guerre, c’est qu’elle confirme l’existence de deux entités séparées en Amérique du Nord. Malgré la séduction que doivent exercer sur elle plus tard les idées démocratiques
Canadiens Français : «En interrompant momentanément le jeu politique du Bas-Canada, la guerre de 1812 rappelle opportunément au Québec qu’il fait encore partie de l’empire britannique. Cette guerre ne fait que traverser le Québec, mais elle accorde un répit aux élites traditionnelles et révèle la nature véritable des élites nouvelles. L’affrontement américano-britannique, qui porte une fois de plus sur les territoires de l’Ouest, rencontre peu de sympathie chez les habitants des États américains du Nord ayant des frontières communes avec le Bas-Canada : ces deux régions sont liées par des échanges économiques le long du Richelieu qui font de Saint-Denis un port actif. Elles sont également liées par des mouvements de population, beaucoup de Canadiens français émigrant vers le Sud pour travailler dans l’industrie forestière du lac Champlain. Malgré ces liens, c’est une fois encore cette région qui sert de couloir d’invasion à la guerre, ce qui permet aux vieilles familles seigneuriales de vivre à nouveau quelques heures de gloire militaire : le lieutenant-colonel Charles-Michel de Salaberry repousse les troupes américaines à Lacolle en 1812, puis à nouveau à Châteauguay en 1813. De Salaberry et les siens souhaitent ardemment défendre les vieilles valeurs aristocratiques et celles-ci, pour eux, passent maintenant par la fidélité à la Grande-Bretagne. Ils redoutent plus les conséquences sociales que les conséquences militaires d’une victoire américaine. Le clergé se fait le porte-parole des mêmes sentiments et il y ajoute une note religieuse : on doit soutenir l’ordre établi. Il ne se trouve qu’un seul prêtre, le futur évêque de Montréal, monseigneur Lartigue, pour y ajouter la notion neuve de l’obligation nationale. Quant aux marchands anglais du Québec, les liens qui les unissent à l’Empire sont de nature économique et ils ne sont pas prêts à les voir rompre au moment où les victoires britanniques dans le Haut-Canada leur ouvrent à nouveau les territoires à fourrure situés au sud des Grands Lacs et à l’ouest, en direction du Mississippi. Le vieux rêve d’expansion continentale des marchands reprend vie au moment même où la guerre stimule le commerce local dans la vallée du Saint-Laurent. Mais ce rêve est voué à l’échec, une fois de plus, car à la fin de la guerre, la Grande-Bretagne va remettre purement et simplement aux États-Unis les régions de l’Ouest qui ont été conquises. Le seul résultat de la guerre, c’est qu’elle confirme l’existence de deux entités séparées en Amérique du Nord. Malgré la séduction que doivent exercer sur elle plus tard les idées démocratiques  et républicaines des États-Unis, la nouvelle classe moyenne est alors attachée à un destin différent, qui, pour le moment, ne peut être que britannique. Face à la menace militaire venue des États-Unis, beaucoup de voix se font entendre dans la classe moyenne pour exprimer un sentiment nationaliste» (S. Mann Trofimenkoff. Visions nationales, Saint-Laurent, Trécarré, 1986, p. 94). Résultat de plus de vingt années de travaux sur l’histoire sociale du Bas-Canada, inaugurés par les ouvrages de Fernand Ouellet, Stanley Ryerson et Gilles Bourque, où les approches libérales aussi bien que marxistes coopèrent à faire connaître l’infrastructure socio-économique d’un Québec que les historiens, jusque-là, faisaient porter sur une dynamique conflictuelle constitutionnelle, il apparaît mieux que les raisons conservatrices (aristocratiques) vont désormais définir l’esprit canadien face à l’affirmation américaine. Pour certains, la Guerre de 1812 a même sauvé le régime seigneurial, lui donnant encore plus de quarante ans à vivre. Mann Trofimenkoff mentionne également que «la guerre a des conséquences financières sur la réalité politique du Bas-Canada. L’envoi de troupes britanniques supplémentaires a apporté à la colonie les subsides mis à la disposition du gouverneur en tant que chef militaire et politique; à la fin de la guerre, en 1814, le retrait de ces subsides accentue ses difficultés financières» (S. Mann Trofimenkoff. ibid. p. 94).
et républicaines des États-Unis, la nouvelle classe moyenne est alors attachée à un destin différent, qui, pour le moment, ne peut être que britannique. Face à la menace militaire venue des États-Unis, beaucoup de voix se font entendre dans la classe moyenne pour exprimer un sentiment nationaliste» (S. Mann Trofimenkoff. Visions nationales, Saint-Laurent, Trécarré, 1986, p. 94). Résultat de plus de vingt années de travaux sur l’histoire sociale du Bas-Canada, inaugurés par les ouvrages de Fernand Ouellet, Stanley Ryerson et Gilles Bourque, où les approches libérales aussi bien que marxistes coopèrent à faire connaître l’infrastructure socio-économique d’un Québec que les historiens, jusque-là, faisaient porter sur une dynamique conflictuelle constitutionnelle, il apparaît mieux que les raisons conservatrices (aristocratiques) vont désormais définir l’esprit canadien face à l’affirmation américaine. Pour certains, la Guerre de 1812 a même sauvé le régime seigneurial, lui donnant encore plus de quarante ans à vivre. Mann Trofimenkoff mentionne également que «la guerre a des conséquences financières sur la réalité politique du Bas-Canada. L’envoi de troupes britanniques supplémentaires a apporté à la colonie les subsides mis à la disposition du gouverneur en tant que chef militaire et politique; à la fin de la guerre, en 1814, le retrait de ces subsides accentue ses difficultés financières» (S. Mann Trofimenkoff. ibid. p. 94).Pendant que s’écrivait l’histoire sociale du Bas-Canada, la tendance nationaliste, animée par Jacques Lacoursière et Hélène-Andrée Bizier, produisait une collection, Nos Racines, où l’on y trouve l’interprétation définitive de la Guerre de 1812. Sur une série qui contient 144 fascicules, deux sont
 |
| Drapeau de la milice durant la guerre de 1812-1814 |
 aux lois et de réussir avec l’aide d’une armée anglaise à détruire l’union et à établir des liaisons politiques entre ce qui en fait la partie est et la Grande-Bretagne. Outre l’effet que la découverte de tels procédés doit avoir sur les conseils publics, elle ne manquera pas de rendre encore plus chère à tous les bons citoyens cette heureuse union des États qui, sous les ordres de la divine Providence, est le gage de leur liberté, de leur sûreté, de leur tranquillité et de leur prospérité”. C’était faire beaucoup d’honneur à John Henry, l’informateur de Craig et de Ryland, que de croire qu’à lui seul il pouvait ébranler les États-Unis. L’espion, déçu de voir que ses services à la Grande-Bretagne ne recevait pas une reconnaissance pécuniaire suffisante, était allé tout raconter au secrétaire d’État vers la fin de janvier. Son geste, selon les rumeurs qui courent au Bas-Canada, lui vaut la somme de 50 000 dollars» (J. Lacoursière et H.-A. Bizier (éd.) Nos racines, t. 5, vol. 52, s.v., T.L.M., 1979, pp. 1027-1028). Londres répliquera, par la voix de Lord Castlereagh «que les ministres n’avaient rien su de la mission Henry». Bref, cette pénible affaire résonnait comme le dernier coup, post-mortem, de la politique de l’ancien gouverneur Craig, si malfaisant envers les Canadiens Français durant son «règne de la Terreur».
aux lois et de réussir avec l’aide d’une armée anglaise à détruire l’union et à établir des liaisons politiques entre ce qui en fait la partie est et la Grande-Bretagne. Outre l’effet que la découverte de tels procédés doit avoir sur les conseils publics, elle ne manquera pas de rendre encore plus chère à tous les bons citoyens cette heureuse union des États qui, sous les ordres de la divine Providence, est le gage de leur liberté, de leur sûreté, de leur tranquillité et de leur prospérité”. C’était faire beaucoup d’honneur à John Henry, l’informateur de Craig et de Ryland, que de croire qu’à lui seul il pouvait ébranler les États-Unis. L’espion, déçu de voir que ses services à la Grande-Bretagne ne recevait pas une reconnaissance pécuniaire suffisante, était allé tout raconter au secrétaire d’État vers la fin de janvier. Son geste, selon les rumeurs qui courent au Bas-Canada, lui vaut la somme de 50 000 dollars» (J. Lacoursière et H.-A. Bizier (éd.) Nos racines, t. 5, vol. 52, s.v., T.L.M., 1979, pp. 1027-1028). Londres répliquera, par la voix de Lord Castlereagh «que les ministres n’avaient rien su de la mission Henry». Bref, cette pénible affaire résonnait comme le dernier coup, post-mortem, de la politique de l’ancien gouverneur Craig, si malfaisant envers les Canadiens Français durant son «règne de la Terreur».Par après, la Guerre de 1812 racontée par Lacoursière-Bizier ignore les faits d’armes du Haut-Canada pour s’en tenir à la levée des milices, la composition des bataillons, leurs commandements, la vie quotidienne des engagés. Nous retrouvons ici la résistance à la conscription déjà mentionnée par
 Wade. Des émeutiers, résistant à la conscription ouverte par le gouverneur Prevost, veulent se rendre jusqu’à Lachine pour délivrer les déserteurs déjà mis sous arrêts : «On se donne rendez-vous pour le lendemain et on passe une partie de la soirée et de la nuit à cabaler. Le 1er juillet [1812], une centaine de personnes, plusieurs armées de fusils, de pistolets ou de bâtons, prennent le chemin de Lachine, puis de Saint-Laurent. Le groupe décide enfin d’envoyer deux émissaires rencontrer les autorités à Montréal pour en connaître davantage sur la loi de la milice et sur ses implications. “Thibodeau et François Rapin, écrit Wallot, se rendirent à Montréal. Ils devaient revenir vers quatre heures de l’après-midi aux 4 fourches du Saint-Laurent”. Pendant ce temps, le Conseil exécutif envoie, à son tour, deux émissaires pour calmer la population et, en cas d’échec, lui lancer un ultimatum : l’intervention armée. L’affaire prend une autre tournure avec l’intervention du magistrat John McCord qui ordonne aux mécontents de se disperser, après avoir lu la loi sur les attroupements illégaux.
Wade. Des émeutiers, résistant à la conscription ouverte par le gouverneur Prevost, veulent se rendre jusqu’à Lachine pour délivrer les déserteurs déjà mis sous arrêts : «On se donne rendez-vous pour le lendemain et on passe une partie de la soirée et de la nuit à cabaler. Le 1er juillet [1812], une centaine de personnes, plusieurs armées de fusils, de pistolets ou de bâtons, prennent le chemin de Lachine, puis de Saint-Laurent. Le groupe décide enfin d’envoyer deux émissaires rencontrer les autorités à Montréal pour en connaître davantage sur la loi de la milice et sur ses implications. “Thibodeau et François Rapin, écrit Wallot, se rendirent à Montréal. Ils devaient revenir vers quatre heures de l’après-midi aux 4 fourches du Saint-Laurent”. Pendant ce temps, le Conseil exécutif envoie, à son tour, deux émissaires pour calmer la population et, en cas d’échec, lui lancer un ultimatum : l’intervention armée. L’affaire prend une autre tournure avec l’intervention du magistrat John McCord qui ordonne aux mécontents de se disperser, après avoir lu la loi sur les attroupements illégaux. Après deux avertissements officiels, les soldats qui étaient arrivés sur les lieux tirent un coup de canon au-dessus des têtes. Quelques manifestants ripostent. Des coups de feu sont échangés et l’engagement se termine par la mort d’un Canadien. Un autre manifestant est grièvement blessé. Le 2, l’armée arrête 24 personnes soupçonnées de pratiques séditieuses. Deux jours plus tard, le gouverneur Prevost reçoit la soumission et la demande de pardon de 300 habitants. La Gazette de Québec, dans son édition du 4 juillet, demande que l’on fasse exemple. “S’il y a un homme dans le pays assez malin pour empêcher l’opération des lois, très assurément il sera puni. S’il y en a d’assez ignorants pour ne pas savoir que le premier devoir de tout homme est d’obéir à ceux qui ont une autorité légale sur eux, il faut qu’ils soient instruits, et nous craignons bien qu’une ignorance aussi grossière ne puisse être guérie que par l’exemple”» (J. Lacoursière et H.-A. Bizier (éd.) ibid. p. 1033). C’est la que ces mêmes autorités font intervenir le clergé afin de prêcher la soumission aux lois et l’engagement de fidélité au gouverneur. Comme en 1917 et en 1942, la «crise anti-conscriptionniste» n’ira pas plus loin. Ainsi se borne l’originalité apportée par l’historiographie nationaliste dans son approche de la Guerre de 1812. Les récits de combats resteront centrés sur le Bas-Canada, malgré leurs relatives insignifiances dans le contexte général du conflit
Après deux avertissements officiels, les soldats qui étaient arrivés sur les lieux tirent un coup de canon au-dessus des têtes. Quelques manifestants ripostent. Des coups de feu sont échangés et l’engagement se termine par la mort d’un Canadien. Un autre manifestant est grièvement blessé. Le 2, l’armée arrête 24 personnes soupçonnées de pratiques séditieuses. Deux jours plus tard, le gouverneur Prevost reçoit la soumission et la demande de pardon de 300 habitants. La Gazette de Québec, dans son édition du 4 juillet, demande que l’on fasse exemple. “S’il y a un homme dans le pays assez malin pour empêcher l’opération des lois, très assurément il sera puni. S’il y en a d’assez ignorants pour ne pas savoir que le premier devoir de tout homme est d’obéir à ceux qui ont une autorité légale sur eux, il faut qu’ils soient instruits, et nous craignons bien qu’une ignorance aussi grossière ne puisse être guérie que par l’exemple”» (J. Lacoursière et H.-A. Bizier (éd.) ibid. p. 1033). C’est la que ces mêmes autorités font intervenir le clergé afin de prêcher la soumission aux lois et l’engagement de fidélité au gouverneur. Comme en 1917 et en 1942, la «crise anti-conscriptionniste» n’ira pas plus loin. Ainsi se borne l’originalité apportée par l’historiographie nationaliste dans son approche de la Guerre de 1812. Les récits de combats resteront centrés sur le Bas-Canada, malgré leurs relatives insignifiances dans le contexte général du conflitDans les études qui se portent essentiellement sur les relations entre le Québec et leurs voisins du Sud, la Guerre de 1812 est, ou bien abordée à l’occasion, comme dans la vieille étude éditée par Gustave Lanctot, Les Canadiens Français et leurs voisins du Sud, Montréal, Éditions Bernard Valiquette, 1941), ou totalement ignorée comme dans la publication de l’Institut québécois de la recherche culturelle, Les rapports culturels entre le Québec et les États-Unis, sous la direction de Claude Savary, (1984). On retrouve, par contre, dans l’ouvrage dirigé par Gérard Bouchard et
 Yvan Lamonde, Québécois et Américains, la culture québécoise aux XIXe et XXe siècles, des à-propos considérant le rapport de la culture québécoise à l’américanité : «L’américanité québécoise s’est… construite au cœur d’un discours bien adapté aux réalités sociales et politiques du Nouveau Monde. Pourtant, en 1806, rien ne présage le rejet des modèles européens qui marque la période ultérieure. À l’aube de la guerre de 1812, l’Américain incarne l’immoralité politique dans le discours du parti canadien. On lui reproche son matérialisme et on dénonce sa déchéance morale. Son gouvernement, teinté de corruption, fait preuve des plus flagrants abus de pouvoir. Selon les critiques canadiens, les Américains auraient perdu leurs mœurs politiques en abandonnant l’agriculture pour le commerce. Le caractère américain n’est donc pas propice à la préservation de la liberté et, en conséquence, la république bascule entre l’anarchie et la dictature. Cette caricature de l’Américain sert aussi à dépeindre les ennemis du parti canadien, l’oligarchie locale composée de bureaucrates et de marchands britanniques. Ces “gens à place” exercent leur influence par un patronage corrupteur et menacent ainsi l’indépendance de l’Assemblée et la liberté politique des Canadiens. Cette image de l’oligarchie a son fondement historique dans l’origine américaine de certains hauts fonctionnaires bas-canadiens et elle s’alimente à leurs projets visant l’établissement d’une population américaine dans les Townships. L’arrivée de quelques immigrants dans la province sert de prétexte à une nouvelle attaque sur le caractère des Américains dans les pages du Canadien où l’on prétend que l’oligarchie locale cherche à corrompre la population canadienne par l’introduction d’un peuple sans mœurs politiques. En contrepartie, les auteurs ne manquent pas l’occasion de souligner le caractère vertueux des Canadiens. La vertu politique de ce “nouveau peuple qui est nécessairement agricole” découle tout naturellement du fait qu’il est composé en majorité de petits propriétaires. “La propriété foncière, écrit ‘Canadensis’, est à la base de la civilisation” (Le Canadien, 5 décembre 1807). Selon ce raisonnement, le régime seigneurial se porte garant du caractère vertueux des Canadiens en préservant la nature égalitaire de la société canadienne. En effet, les tentatives de le réformer à l’image du système anglais transformeraient les petits propriétaires canadiens en “esclaves des grands capitalistes qui s’emparent déjà de toutes les terres dans les Townships” (Le Canadien, 12 décembre 1807)» (G. Bouchard et Y. Lamonde. Québécois et Américains, Montréal, Fides, 1995, pp. 92-93). Nous comprenons mieux les intérêts qui guidèrent un Salaberry, seigneur de Rouxville, à se porter à la tête des Voltigeurs pour enrayer l’avance des troupes américaines en sol bas-canadien. C’est la dimension «vieille France», avec ses petits propriétaires seigneuriaux, qui dresse une véritable frontière entre l’américanité nord-américaine et le désir de sauvegarder un héritage culturel européen (français et britannique, comme chez Louis-Joseph Papineau) contre le flot de cette américanité que représente l’armée des États-Unis.
Yvan Lamonde, Québécois et Américains, la culture québécoise aux XIXe et XXe siècles, des à-propos considérant le rapport de la culture québécoise à l’américanité : «L’américanité québécoise s’est… construite au cœur d’un discours bien adapté aux réalités sociales et politiques du Nouveau Monde. Pourtant, en 1806, rien ne présage le rejet des modèles européens qui marque la période ultérieure. À l’aube de la guerre de 1812, l’Américain incarne l’immoralité politique dans le discours du parti canadien. On lui reproche son matérialisme et on dénonce sa déchéance morale. Son gouvernement, teinté de corruption, fait preuve des plus flagrants abus de pouvoir. Selon les critiques canadiens, les Américains auraient perdu leurs mœurs politiques en abandonnant l’agriculture pour le commerce. Le caractère américain n’est donc pas propice à la préservation de la liberté et, en conséquence, la république bascule entre l’anarchie et la dictature. Cette caricature de l’Américain sert aussi à dépeindre les ennemis du parti canadien, l’oligarchie locale composée de bureaucrates et de marchands britanniques. Ces “gens à place” exercent leur influence par un patronage corrupteur et menacent ainsi l’indépendance de l’Assemblée et la liberté politique des Canadiens. Cette image de l’oligarchie a son fondement historique dans l’origine américaine de certains hauts fonctionnaires bas-canadiens et elle s’alimente à leurs projets visant l’établissement d’une population américaine dans les Townships. L’arrivée de quelques immigrants dans la province sert de prétexte à une nouvelle attaque sur le caractère des Américains dans les pages du Canadien où l’on prétend que l’oligarchie locale cherche à corrompre la population canadienne par l’introduction d’un peuple sans mœurs politiques. En contrepartie, les auteurs ne manquent pas l’occasion de souligner le caractère vertueux des Canadiens. La vertu politique de ce “nouveau peuple qui est nécessairement agricole” découle tout naturellement du fait qu’il est composé en majorité de petits propriétaires. “La propriété foncière, écrit ‘Canadensis’, est à la base de la civilisation” (Le Canadien, 5 décembre 1807). Selon ce raisonnement, le régime seigneurial se porte garant du caractère vertueux des Canadiens en préservant la nature égalitaire de la société canadienne. En effet, les tentatives de le réformer à l’image du système anglais transformeraient les petits propriétaires canadiens en “esclaves des grands capitalistes qui s’emparent déjà de toutes les terres dans les Townships” (Le Canadien, 12 décembre 1807)» (G. Bouchard et Y. Lamonde. Québécois et Américains, Montréal, Fides, 1995, pp. 92-93). Nous comprenons mieux les intérêts qui guidèrent un Salaberry, seigneur de Rouxville, à se porter à la tête des Voltigeurs pour enrayer l’avance des troupes américaines en sol bas-canadien. C’est la dimension «vieille France», avec ses petits propriétaires seigneuriaux, qui dresse une véritable frontière entre l’américanité nord-américaine et le désir de sauvegarder un héritage culturel européen (français et britannique, comme chez Louis-Joseph Papineau) contre le flot de cette américanité que représente l’armée des États-Unis.Tel était donc le contexte psychologique et moral lorsqu’arriva la Guerre de 1812 : «L’image globalement négative des États-Unis et l’absence d’une définition explicite de l’américanité bas-canadienne dans le discours politique d’avant 1815 reflètent la situation précaire des chefs politiques canadiens. D’une part, la situation
 géopolitique ne favorise pas l’américanisme. Les tensions entre la Grande-Bretagne et les États-Unis mettent la colonie sur un pied de guerre dès 1807. La confirmation des rumeurs de guerre en 1812 provoque même un rare moment de consensus entre les diverses factions coloniales. L’élite canadienne semble répondre avec enthousiasme à l’appel impérial et elle se porte à la défense de la colonie. S’il y a lieu de s’interroger sur ses motivations, son comportement démontre que sa marge de manœuvre avant 1815 est très étroite. Sous la menace d’une invasion américaine, les leaders canadiens cherchent d’abord à faire preuve de leur loyalisme et ensuite à remettre en cause celui de leurs ennemis (J.-P. Wallot, 1973)» (G. Bouchard et Y. Lamonde. ibid. p. 93). Ce repos sur le quant-à-soi canadien dit bien ce que sera l’appartenance à un sentiment national québécois négatif. Il annonce déjà ce que sera la grande réaction conservatrice et ultramontaine qui suivra les défaites des rébellions de 1837-1838, la collaboration à l’Union puis à la Confédération. À chaque étape, la marge de manœuvre ne cessera de se réduire : de la répression militaire et politique par l’Acte d’Union (1840), au rep by pop lorsque la population anglophone surpassera dans le Canada-Uni la population francophone, l’abolition du régime seigneurial en 1854, enfin la Confédération de 1867, avec son partage des pouvoirs qui, pour l’époque, se présentait comme une ligne tranchée entre les pouvoirs partagés du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. C'est en vue de stopper cette «réduction» de la marge de manœuvre québécoise dans le Canada que la Confédération créa le gouvernement provincial de la Province de Québec. Mais, ce faisant, l’Histoire du Québec s’isolait de l’Histoire du Canada, et l’américanité se mit à opérer en sous-main, par l’attraction du matérialisme des grandes villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre, l’appel baroque à parcourir l’Ouest américain en quête d’or ou d’aventures hors normes, enfin l’abandon quasi-total et sans critique à la société de consommation aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale.
géopolitique ne favorise pas l’américanisme. Les tensions entre la Grande-Bretagne et les États-Unis mettent la colonie sur un pied de guerre dès 1807. La confirmation des rumeurs de guerre en 1812 provoque même un rare moment de consensus entre les diverses factions coloniales. L’élite canadienne semble répondre avec enthousiasme à l’appel impérial et elle se porte à la défense de la colonie. S’il y a lieu de s’interroger sur ses motivations, son comportement démontre que sa marge de manœuvre avant 1815 est très étroite. Sous la menace d’une invasion américaine, les leaders canadiens cherchent d’abord à faire preuve de leur loyalisme et ensuite à remettre en cause celui de leurs ennemis (J.-P. Wallot, 1973)» (G. Bouchard et Y. Lamonde. ibid. p. 93). Ce repos sur le quant-à-soi canadien dit bien ce que sera l’appartenance à un sentiment national québécois négatif. Il annonce déjà ce que sera la grande réaction conservatrice et ultramontaine qui suivra les défaites des rébellions de 1837-1838, la collaboration à l’Union puis à la Confédération. À chaque étape, la marge de manœuvre ne cessera de se réduire : de la répression militaire et politique par l’Acte d’Union (1840), au rep by pop lorsque la population anglophone surpassera dans le Canada-Uni la population francophone, l’abolition du régime seigneurial en 1854, enfin la Confédération de 1867, avec son partage des pouvoirs qui, pour l’époque, se présentait comme une ligne tranchée entre les pouvoirs partagés du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. C'est en vue de stopper cette «réduction» de la marge de manœuvre québécoise dans le Canada que la Confédération créa le gouvernement provincial de la Province de Québec. Mais, ce faisant, l’Histoire du Québec s’isolait de l’Histoire du Canada, et l’américanité se mit à opérer en sous-main, par l’attraction du matérialisme des grandes villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre, l’appel baroque à parcourir l’Ouest américain en quête d’or ou d’aventures hors normes, enfin l’abandon quasi-total et sans critique à la société de consommation aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale.L’historiographie québécoise a donc pris de la Guerre de 1812 le strict minimum, c’est-à-dire l’impact de la menace, puis des invasions américaines, la résistance limitée, puis le «nationalisme canadien» négatif des lendemains de guerre. Après 1815, les vieilles querelles, suspendues le temps de la menace américaine, reprendront de plus belles autour de la fameuse querelle des subsides qui devaient conduire directement aux 92 Résolutions, puis aux rébellions de 1837-1838. La place prise par la participation à la Guerre de 1812 dans la conscience historique québécoise a donc diminué au fur et à mesure que celle-ci était prise par les affrontements sanglants des hivers de 1837 et de 1838. De la figure du Léonidas canadien, de Salaberry devenait un «petit héros», pour reprendre la formule insolente de Bergeron. Aujourd’hui, alors que le gouvernement Harper veut mousser sa propagande autour des célébrations du bicentenaire de la guerre inutile, les Québécois se demandent sincèrement ce qu’ils ont eu avoir à faire avec cette guerre dont ils paient, par leurs impôts, une partie des frais en festivités.
CONCLUSION
Après avoir interrogé quatre historiographies nationales au sujet de la Guerre de 1812, pouvons-nous justifier les dépenses de 28 millions de dollars affectées aux commémorations du bicentenaire de cette needless war? Les re-anactments, qui sont devenus la passion des travestis de
 l'Histoire, ne sont que des exotismes qui apportent un divertissement en pique-niques, mais qui suscitent davantage de fausses consciences historiques que d'authentiques. Les fantômes de l'Histoire n'ont pas besoin de figurants en costumes pour revenir hanter les époques ultérieures. L'ombre du XIXe, sinon du XVIIIe siècles pèse sur le début du XXIe comme il n'était pas possible d'imaginer voilà à peine vingt ou dix ans. Du néo-libéralisme sorti tout droit de l'École des économistes de Chicago au néo-conservatisme patriarcal, fondamentaliste et impitoyablement intolérant, nous retrouvons aussi bien la pensée magique de Adam Smith dans nos Think Tanks que le procès du singe, qui mobilisât en juillet 1925 les Américains autour du professeur Scopes, qui avait osé enseigner la théorie de Darwin en classe, est réactualisé maintenant par les partisans du dessein intelligent. Le Canada, dans son penchant pathologique vers le retour à l'état infantile de colonie dépendante, exploitée et aliénée à des morales obsolètes, est un foyer d'infection particulier pour ce genre d'exhibitions de foires. Même la justification par la mémoire est irrecevable tant la conscience historique se meuble de savoirs, d'analyses et de réflexions et non de spectacles, de dramatisations et d'étalements narcissiques petit-bourgeois. Rappelons donc les conclusions essentielles des quatre consciences nationales confrontées à la Guerre de 1812.
l'Histoire, ne sont que des exotismes qui apportent un divertissement en pique-niques, mais qui suscitent davantage de fausses consciences historiques que d'authentiques. Les fantômes de l'Histoire n'ont pas besoin de figurants en costumes pour revenir hanter les époques ultérieures. L'ombre du XIXe, sinon du XVIIIe siècles pèse sur le début du XXIe comme il n'était pas possible d'imaginer voilà à peine vingt ou dix ans. Du néo-libéralisme sorti tout droit de l'École des économistes de Chicago au néo-conservatisme patriarcal, fondamentaliste et impitoyablement intolérant, nous retrouvons aussi bien la pensée magique de Adam Smith dans nos Think Tanks que le procès du singe, qui mobilisât en juillet 1925 les Américains autour du professeur Scopes, qui avait osé enseigner la théorie de Darwin en classe, est réactualisé maintenant par les partisans du dessein intelligent. Le Canada, dans son penchant pathologique vers le retour à l'état infantile de colonie dépendante, exploitée et aliénée à des morales obsolètes, est un foyer d'infection particulier pour ce genre d'exhibitions de foires. Même la justification par la mémoire est irrecevable tant la conscience historique se meuble de savoirs, d'analyses et de réflexions et non de spectacles, de dramatisations et d'étalements narcissiques petit-bourgeois. Rappelons donc les conclusions essentielles des quatre consciences nationales confrontées à la Guerre de 1812.a) Pour les Britanniques, 1812 est moins l’année de la guerre anglo-américaine que celle de la retraite française de Russie, commémorée en grandes pompes en Russie et ailleurs en Europe. Après deux siècles, cette guerre inutile a quitté la connaissance historique des Britanniques, et à plus forte raison leur conscience.
b) Pour les Américains, l’importance qu’avait le conflit aux XIXe et XXe siècles s’est amenuisée, surtout après la participation aux deux guerres mondiales et aux autres conflits qui, tels le Vietnam et l’Iraq, occupent essentiellement la mémoire militaire des Américains. Comme la Grande-Bretagne est devenue le plus fidèle allié des Américains dans le monde, Thatcher ou Blair au pouvoir peu importe, les vieux conflits sont désormais «effacés». Par contre, les débuts du sentiment national demeurent rattachés aux affrontements autour des Grands Lacs. Il faut mentionner, toutefois, que la Guerre du Mexique, dans le principe de l’expansion américaine, apporta immensément plus aux Américains que la paix blanche du traité de Gand. L’oubli, que les grands symboles de la nation - la Maison-Blanche, l’Uncle Sam, l’hymne national même - proviennent du contexte de cette guerre, laisse présumer que les Américains ont déjà quasi évacué, à leur tour, la needless war de leur mémoire nationale.
c) Pour les Canadiens, le seul fait que la conscience historique britannique ait évacué la mémoire de 1812 renvoie, au Canada seul, le fardeau de porter cet événement qui a touché les colons britanniques et français entre 1812 et 1814. C’est en tant qu’objet de convoitise par les Américains et résistance défensive des colons des deux ethnies, que les effets du conflit sur la conscience historique canadienne sont évoqués par le gouvernement fédéral conservateur pour justifier les dépenses de 28 millions de dollars. Dans les faits, toutefois, la connaissance historique canadienne n’a jamais retenu d’autres que les retombées négatives de cette guerre, de la perte de territoires à l’affirmation d’une nationalité «canadienne», négative elle aussi, qui a placé jusqu’à nos jours le conservatisme canadien entre l’héritage européen et l’appartenance au territoire nord-américain.
d) Enfin, l’historiographie québécoise a réduit sa mémoire collective de la Guerre de 1812 à rien. Non pas comme les Britanniques, la faisant descendre progressivement derrière d’autres grands conflits beaucoup plus marquants de la représentation sociale, mais en la dévidant de sa substance au point de la rendre relative à des intérêts qui excluent ceux des Québécois du début du XIXe siècle. Même la victoire jadis célébrée de la bataille de la Châteauguay avec son Léonidas, Salaberry, est refoulée dans l’histoire haut-canadienne qui ne tiendrait pas compte de la particularité du loyalisme des habitants francophones de l’époque.
 |
| Re-enactment de soldats de la guerre de 1812 pour le ministre Moore |
Toutefois, nous ne pouvons accepter entièrement les critiques qui ont été adressées à l’entreprise. Il y a des fondements poétiques, symboliques et idéologiques à l’entreprise du gouvernement conservateur, et nous devons en chercher les racines avec le survol que nous venons d’effectuer. Pour les Québécois, la grosse sottise a été proférée par le ministre Moore, comme nous le rappelions au
 début de notre texte : «La Guerre de 1812, un bienfait pour les francophones d'Amérique du Nord». Affirmation tranchée, qui a fait surtout plus que grincer des dents les historiens nationalistes québécois. En fait Moore ne faisait que reprendre l’opinion d’un collègue conservateur, le député de Nepean-Carleton, Pierre Poilievre, qui certifie que si les Américains avaient gagné la guerre de 1812 et annexé le Canada, «l’identité francophone du Québec et du Canada n’existerait plus», ce que l’historien Pierre Anctil, spécialiste de l’époque, a qualifié de position révisionniste. Évidemment, depuis les mouvements révisionnistes français critiquant la factualité des camps d'extermination nazis, l’accusation de révisionnisme apparaît excessive et insignifiante en soi. Et Anctil n’y va pas avec le dos de la cuiller pour qualifier l’affirmation de Poilievre de «fiction». L’ancien directeur
début de notre texte : «La Guerre de 1812, un bienfait pour les francophones d'Amérique du Nord». Affirmation tranchée, qui a fait surtout plus que grincer des dents les historiens nationalistes québécois. En fait Moore ne faisait que reprendre l’opinion d’un collègue conservateur, le député de Nepean-Carleton, Pierre Poilievre, qui certifie que si les Américains avaient gagné la guerre de 1812 et annexé le Canada, «l’identité francophone du Québec et du Canada n’existerait plus», ce que l’historien Pierre Anctil, spécialiste de l’époque, a qualifié de position révisionniste. Évidemment, depuis les mouvements révisionnistes français critiquant la factualité des camps d'extermination nazis, l’accusation de révisionnisme apparaît excessive et insignifiante en soi. Et Anctil n’y va pas avec le dos de la cuiller pour qualifier l’affirmation de Poilievre de «fiction». L’ancien directeur  de l'Institut d'études canadiennes de l'Université d'Ottawa a déclaré tout de go : «C'est un peu de la fiction, tout ça, Chose certaine, le fait français ne doit pas sa survie à la bienveillance de l'Empire britannique. Et quand on parle de (la défense du Canada) il faut savoir que l'identité canadienne n'existait pas. Les troupes britanniques défendaient les territoires nord-américains de l'Empire (britannique)». Mais les troupes britanniques, au début, étaient fort peu nombreuses sur le terrain pour s'opposer, sans l'aide des volontaires coloniaux, aux trois armées d'invasion. Ce sont les miliciens, relevés à même la population civile, qui ont fait au début une grande partie du travail de résistance. Ce n’est seulement après que l’Espagne se soit libérée de l'oppression française avec l'aide des troupes britanniques que Wellington put détacher des corps expéditionnaires vers le continent américain. C’est la raison pour laquelle c’est Pakenham, le beau-frère du «duc de fer», qui dirigea l’assaut sur la Nouvelle-Orléans, en cette journée fatidique du 8 janvier 1815, deux semaines après la signature de la paix à Gand.
de l'Institut d'études canadiennes de l'Université d'Ottawa a déclaré tout de go : «C'est un peu de la fiction, tout ça, Chose certaine, le fait français ne doit pas sa survie à la bienveillance de l'Empire britannique. Et quand on parle de (la défense du Canada) il faut savoir que l'identité canadienne n'existait pas. Les troupes britanniques défendaient les territoires nord-américains de l'Empire (britannique)». Mais les troupes britanniques, au début, étaient fort peu nombreuses sur le terrain pour s'opposer, sans l'aide des volontaires coloniaux, aux trois armées d'invasion. Ce sont les miliciens, relevés à même la population civile, qui ont fait au début une grande partie du travail de résistance. Ce n’est seulement après que l’Espagne se soit libérée de l'oppression française avec l'aide des troupes britanniques que Wellington put détacher des corps expéditionnaires vers le continent américain. C’est la raison pour laquelle c’est Pakenham, le beau-frère du «duc de fer», qui dirigea l’assaut sur la Nouvelle-Orléans, en cette journée fatidique du 8 janvier 1815, deux semaines après la signature de la paix à Gand.Jacques Lacoursière, historien nationaliste dont la réputation n’est plus à faire, n’a pas été moins élégant que M. Anctil : «On veut vraiment faire de la récupération avec cet événement qui n’a pas eu la portée sur l’histoire du Canada qu’on lui prête aujourd’hui». La chose est certaine, mais à quoi peut bien servir cette récupération de la needless war? Toute la question est là. Un article du web.journal du Devoir (http://www.ledevoir.com/politique/canada/352837/souvenir-des-liens-monarchiques), prête la récupération au service de la monarchie. Après la critique de Lacoursière, le journal donne la parole à un autre historien:
«C’est un événement important dans l’histoire du pays, ajoute Donald Fyson, professeur d’histoire à l’Université Laval et spécialiste de la période. Mais il serait très difficile de soutenir que ce soit un élément fondateur du pays. Du point de vue de quelqu’un qui étudie de près cette période, je ne vois pas comment ça a changé de façon fondamentale le Canada.»
Dans ces témoignages, il y a moins de révisionnisme et de récupération qu'il y a ce que Renouvier appelait, de l'uchronie. Le Canada serait sensiblement le même, même s'il n'y avait pas eu la guerre de 1812 (Fyson) ou encore, c'est évident si les Américains avaient réussi à s'emparer du Haut-Canada, le pays aujourd'hui serait tout à fait différent (Fyson, encore). Mais on ne peut pas dire en quoi il aurait été sensiblement le même ou évidemment différent.
M. Fyson affirme ainsi que «si on enlève 1812 dans l’histoire canadienne, le Canada serait probablement sensiblement le même qu’aujourd’hui. Le conflit n’a à peu près rien changé à la dynamique canadienne qui prévaut avant 1812 et après 1815 [date de la fin des hostilités]. Or, si vraiment la guerre avait été ce moment fondateur qui a soudé les Canadiens, il n’y aurait pas eu tout de suite après la reprise des conflits intérieurs qui mèneront aux Rébellions de 1837-1838. La guerre de 1812 n’a marqué qu’une petite pause.»
Quand le gouvernement dit que le Canada n’existerait pas sans la victoire obtenue en 1815, il fait «de l’histoire contre-factuelle», estime ainsi M. Fyson. «C’est évident que si l’invasion américaine du Haut-Canada avait été une réussite, l’histoire serait différente. Mais on ne refait pas l’histoire avec des si, ou en inversant des événements.»
En remontant le cours des événements, M. Fyson soutient que le conflit n’a pas fait de grand vainqueur. «Personne n’est sorti gagnant, il n’y a pas eu d’échange significatif de territoire et on n’a pas vraiment réglé les tensions qui existaient à l’époque, dit-il. En fait, un seul groupe a vraiment perdu, et ce sont les Amérindiens, qui ont perdu des territoires importants.»
De l’autre côté de la frontière, l’historien Don Hickey estime que «ç’a été un conflit important aux États-Unis parce qu’il a jeté les contours du paysage politique, militaire et culturel qui sera celui de la jeune république pour les décennies suivantes, note ce spécialiste de la guerre de 1812 au Wayne State College du Nebraska. Et ç’a été encore plus important pour les Canadiens parce qu’ils ont pu préserver leur identité et demeurer au sein de l’Empire britannique… tout en continuant sur le chemin qui mènera à 1867.»
Cette question des liens avec la monarchie explique d’ailleurs en grande partie l’intérêt des conservateurs pour ce conflit, juge Roch Legault, professeur d’histoire militaire canadienne au Collège militaire royal de Kingston. «On en parlait peu avant les conservateurs, dit-il. En fait, il y a toujours eu un trou entre la Conquête [1759] et les Rébellions. Mais pour le gouvernement actuel, c’est une façon de dire que nous sommes canadiens, tout en étant en même temps britanniques. C’est une occasion de célébrer cet héritage britannique, de rappeler ces racines.»
Dans un ouvrage à paraître cet automne, M. Legault écrit que «la guerre de 1812 célèbre la concorde politique au sein de la colonie, Canadiens français, colons britanniques et Amérindiens luttant ensemble pour repousser l’envahisseur. Mais elle renouvelle aussi les vœux de l’union entre le Canada (anglais) et la Grande-Bretagne».
Si Donald Fyson note que la concorde fut de courte durée, il acquiesce aux propos de M. Legault. «La guerre de 1812 a permis la construction d’un mythe où le Canada a rejeté la tentation républicaine pour rester fermement rattaché à la Couronne, explique-t-il. D’un point de vue conservateur, ces liens avec la monarchie sont un des fondements de l’identité du Canada. La célébration de 1812 est donc parfaitement logique si on la situe dans le courant actuel où le gouvernement fait beaucoup d’efforts pour rappeler ce passé.»
Et ces efforts par rapport à 1812 seront visibles longtemps : le calendrier de célébration s’étend jusqu’en 2015».
 |
| Bataille de la Nouvelle-Orléans et mort du général Pakenham, 1815 |
On aura reconnu certains des thèmes abordés depuis longtemps par les différentes historiographies. Parmi les quelques questions qui nous viennent à l’esprit, il y a celle-ci : dans l’optique où Harper entend bien rappeler les liens britanniques et monarchiques avec la Grande-Bretagne, comment peut-il se montrer plus britannique que la Reine ou le Prince de Galles qui eux, ont oublié - jubilé oblige et justifie - la Guerre de 1812? Le Canada est un pays souverain, bien que son autonomie soit discutable. Comme le rappelle le professeur américain Hickey, ce sont les États-Unis qui sont sortis grands gagnants de cette guerre, alors que pour le professeur Fyson, ce sont les Amérindiens qui ont perdu le plus dans le conflit.
Le même site web, à une autre adresse, revient sur le sujet (http://www.ledevoir.com/politique/canada/352786/guerre-de-1812-refaire-l-histoire). Le Devoir rappelle que la Guerre de 1812 trouverait «ses racines dans la guerre qui faisait rage entre la France de Napoléon et la Grande-Bretagne»:
«Pour tenter d’asphyxier l’économie de la France, la Grande-Bretagne promulgua en 1807 un décret qui interdisait aux navires de pays neutres (comme les États-Unis) de faire du commerce entre les ports contrôlés par la France. Or, cette mesure touchait de plein fouet la jeune économie américaine.
Mort du Général Brock
Les tensions entre les États-Unis et la Grande-Bretagne sont ensuite montées d’un cran quand Londres s’est mise à fouiller les vaisseaux américains pour confisquer des marchandises… et remettre la main sur des déserteurs qui détenaient pourtant désormais la citoyenneté américaine.
Les hostilités lancées en sol nord-américain, la guerre de 1812 durera plus de deux ans et se déroulera principalement dans le sud de l’Ontario (Haut-Canada). Des combats auront aussi lieu au Québec, notamment à Châteauguay en 1813, en haute mer… et jusqu’à la Maison-Blanche, à laquelle les Britanniques mirent le feu en 1814.
L’objectif avoué des Américains était d’envahir le Haut-Canada (dont la majorité de la population était américaine, et dont on supposait qu’elle accueillerait positivement cette invasion) et ainsi mettre la main sur une grande partie de l’Amérique du Nord britannique. L’effort de guerre combiné des Britanniques, des Canadiens et des Amérindiens a empêché la percée».
L’interprétation apportée ici reprend la doxa canadienne, mais insiste sur la portion convoitée par les Américains n’était pas tout le Canada mais seulement le Haut-Canada, c’est-à-dire l’Ontario, et que c’est un moment décisif pour l’histoire de cette province (et dans un sens aussi peut-être pour
 Montréal, puisque l’on n’était pas encore tout à fait fixé de situer dans le Haut plutôt que dans le Bas-Canada, la grande ville commerciale des fourrures, d’où l’affrontement de la Châteauguay). Même s’il est vrai que la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick furent également affectés par les conflits frontaliers, aucune de ces deux provinces n’a été autant menacées que l’actuelle Ontario. Si le gouvernement fédéral du Canada lance la célébration du bicentenaire d’un océan à l’autre, il va de soi qu’il veut ressouder les liens entre les régionalismes qui tendent, depuis le début de son gouvernement, à s’isoler les uns des autres et développer chacun des récriminations directes envers son gouvernement. Il y a plus que des histoires de symboles monarchiques dans cette entreprise.
Montréal, puisque l’on n’était pas encore tout à fait fixé de situer dans le Haut plutôt que dans le Bas-Canada, la grande ville commerciale des fourrures, d’où l’affrontement de la Châteauguay). Même s’il est vrai que la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick furent également affectés par les conflits frontaliers, aucune de ces deux provinces n’a été autant menacées que l’actuelle Ontario. Si le gouvernement fédéral du Canada lance la célébration du bicentenaire d’un océan à l’autre, il va de soi qu’il veut ressouder les liens entre les régionalismes qui tendent, depuis le début de son gouvernement, à s’isoler les uns des autres et développer chacun des récriminations directes envers son gouvernement. Il y a plus que des histoires de symboles monarchiques dans cette entreprise.Dans un éditorial polémique nationaliste publié encore dans Le Devoir, Josée Boileau écrit:
«On peut craindre que la révision à la sauce conservatrice de la naissance du Canada, à force d’être répétée, finisse par avoir des résonances, en dépit de ses extravagances. Ainsi du ministre du Patrimoine, James Moore, qui répète depuis des mois que la guerre de 1812 a permis de protéger le français.On peut être sympathique à l’idéologie livrée par Refaire l’histoire? titre de la critique de Mme Boileau, mais notre inventaire historiographique montre que pour «avoir des résonances, en dépit de ses extravagances», la conscience historique canadienne n’a jamais considérée comme une extravagance le Poétique d’une unité nationale canadienne issue de la Guerre de 1812. Où réside la démesure interprétative, c’est croire que ce Poétique était positif, alors qu’il était né du désenchantement, voire du ressentiment
Cela n’a rien à voir. Comme l’a rappelé l’historien Jacques Lacoursière au Devoir la semaine dernière, l’immigration britannique menaçait à l’époque le Canada français. Les batailles contre les Américains ne s’arrimaient d’aucune manière à la dualité linguistique représentée par le Haut et le Bas-Canada. Le vrai lien de la guerre de 1812 était monarchique, point. En tirer d’autres leçons, c’est sombrer dans la démesure interprétative.
Il y a quelques années, les professeurs Stéphane Kelly et Guy Laforest ont publié, aux Presses de l’Université Laval, l’ouvrage Débats sur la fondation du Canada, édition française des débats menés entre 1864 et 1873 dans les Parlements de l’Amérique du Nord britannique pour décider de la création d’un nouveau pays. Une brique où résonnent les discours de MacDonald, Cartier, D’Arcy McGee, Dorion, Robson, Taché, Riel…
Comme l’écrivent les directeurs anglophones de cette impressionnante recension, dans leurs discours, «les députés font montre de vastes connaissances en droit, en histoire, en politologie et en pensée politique moderne». Il s’agit, comme ils le notent, d’une «délibération politique d’un très haut niveau». Le passé est appelé à la rescousse des débats, tout comme la comparaison avec les États-Unis. Différents conflits sont évoqués : la rébellion des Patriotes, la guerre civile américaine, les soulèvements populaires de 1848 à Paris, en Hongrie, en Irlande… Il y est bien question d’une invasion américaine : celle de… 1775, qui verra les villes de Québec et Saint-Jean assiégées. Et 1812 ? Pas-un-mot!»
 à l'égard du gouvernement métropolitain (comme chez les Américains en 1773), et l’apprentissage inattendu de se débrouiller seul contre un puissant voisin. Autant d’avoir crû que c’était avec enthousiasme que les Canadiens-français loyalistes s’enrôlaient dans la milice, autant c'est une extravagance d'un autre type de croire que l'Imaginaire des habitants des deux Canadas n'en ait pas été affecté. Autant ne pas tenir compte du contexte de 1812 - qui n’est pas celui de 1867 - qui, pourtant, lui ressemble par certains aspects. Ainsi, les débats qui entourent la Confédération se situent en un temps où la situation internationale était aussi tendue qu’en 1812. L’Angleterre, dont le Canada était toujours l’une des colonies, avait pris fait et cause pour les Sudistes, dont la production de coton faisait rouler les manufactures britanniques. Les Américains du Nord regardaient à nouveau le Canada comme une proie qui pourrait compenser la
à l'égard du gouvernement métropolitain (comme chez les Américains en 1773), et l’apprentissage inattendu de se débrouiller seul contre un puissant voisin. Autant d’avoir crû que c’était avec enthousiasme que les Canadiens-français loyalistes s’enrôlaient dans la milice, autant c'est une extravagance d'un autre type de croire que l'Imaginaire des habitants des deux Canadas n'en ait pas été affecté. Autant ne pas tenir compte du contexte de 1812 - qui n’est pas celui de 1867 - qui, pourtant, lui ressemble par certains aspects. Ainsi, les débats qui entourent la Confédération se situent en un temps où la situation internationale était aussi tendue qu’en 1812. L’Angleterre, dont le Canada était toujours l’une des colonies, avait pris fait et cause pour les Sudistes, dont la production de coton faisait rouler les manufactures britanniques. Les Américains du Nord regardaient à nouveau le Canada comme une proie qui pourrait compenser la  perte des riches états sudistes survenant la défaite dans la Guerre de Sécession. Trop insister en discussions constitutionnelles sur les menaces que faisaient peser la colère américaine sur les provinces isolées au nord du 49º parallèle pouvait froisser les susceptibilités mises à vif par la guerre civile. On pouvait parler de la guerre d’Indépendance, qui remontait à presque cent ans, du siège du Fort Saint-Jean et de Québec, oui, mais pour les survivants de la Guerre de 1812, cela éveillait des souvenirs encore douloureux. Dans le contexte où l’Union et la Grande-Bretagne furent à un doigt de se déclarer la guerre après l’arrimage du Trent, navire anglais, par les Américains en novembre 1861, la nécessité de conclure le nouveau pacte confédératif prenait une gravité d'urgence. Aussi, est-il fort probable qu’à chacune des conférences préléminaires à la Confédération, les Pères du Canada se disaient un peu ce que Gambetta dira à ses partisans, après la perte de l’Alsace-Lorraine en 1870 : «Pensez-y toujours, n’en parlez jamais!».
perte des riches états sudistes survenant la défaite dans la Guerre de Sécession. Trop insister en discussions constitutionnelles sur les menaces que faisaient peser la colère américaine sur les provinces isolées au nord du 49º parallèle pouvait froisser les susceptibilités mises à vif par la guerre civile. On pouvait parler de la guerre d’Indépendance, qui remontait à presque cent ans, du siège du Fort Saint-Jean et de Québec, oui, mais pour les survivants de la Guerre de 1812, cela éveillait des souvenirs encore douloureux. Dans le contexte où l’Union et la Grande-Bretagne furent à un doigt de se déclarer la guerre après l’arrimage du Trent, navire anglais, par les Américains en novembre 1861, la nécessité de conclure le nouveau pacte confédératif prenait une gravité d'urgence. Aussi, est-il fort probable qu’à chacune des conférences préléminaires à la Confédération, les Pères du Canada se disaient un peu ce que Gambetta dira à ses partisans, après la perte de l’Alsace-Lorraine en 1870 : «Pensez-y toujours, n’en parlez jamais!».En fait, l’usage du bicentenaire de 1812 sert de souvenir-écran afin de préparer une autre série de commémorations de centenaires qui vont s’échelonner
 de 2014 à 2018, je parle, bien évidemment, de ceux entourant les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Beaucoup plus qu’en 1812, la participation canadienne, encore là controversée aussi bien parmi les Canadiens Français que les Canadiens Anglais, fut bien plus importante. Comment pourrait-on ignorer les deux batailles d’Ypres? Courcelette? Pascendaele? et toutes les autres batailles sur le sol français ou belge où des troupes canadiennes, dont le Royal 22e Régiment, ont laissé des dizaines de milliers d'hommes sur le terrain? À côté des 28 millions qui seront dépensés pour les célébrations du bicentenaire de 1812, les sommes investies par le gouvernement conservateur dans les commémorations de 2014-2018 seront, comme certains de ses budgets, des dépenses-mammouth!
de 2014 à 2018, je parle, bien évidemment, de ceux entourant les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Beaucoup plus qu’en 1812, la participation canadienne, encore là controversée aussi bien parmi les Canadiens Français que les Canadiens Anglais, fut bien plus importante. Comment pourrait-on ignorer les deux batailles d’Ypres? Courcelette? Pascendaele? et toutes les autres batailles sur le sol français ou belge où des troupes canadiennes, dont le Royal 22e Régiment, ont laissé des dizaines de milliers d'hommes sur le terrain? À côté des 28 millions qui seront dépensés pour les célébrations du bicentenaire de 1812, les sommes investies par le gouvernement conservateur dans les commémorations de 2014-2018 seront, comme certains de ses budgets, des dépenses-mammouth! |
| Elizabeth II reine du Canada, par Phil Richards |
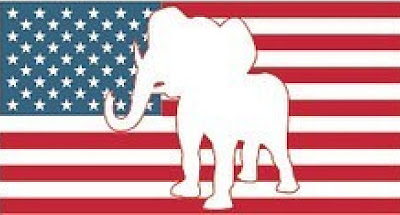 d’opérettes costumées défiler pour célébrer une sympathique petite guerre, les fonctionnaires conservateurs et les députés recevront les commandes et les discours à réciter pour les quatre années qui suivront, dès à partir de l’année prochaine, en vue de célébrer l'une des plus sales guerres de l'Histoire à laquelle la résistance des Québécois à la conscription fut autrement plus tragique, à Québec en 1917, qu'à Lachine en 1812. Pourquoi célébrer 1812? Parce que c'est une mystification nationale, dont les dupes sont essentiellement les Canadiens-anglais d'Ontario et les Autochtones. Comment célébrer une needless war? En pensant aux célébrations prochaines de la Grande Guerre. En célébrant le vaincu (de 1814) dans le vainqueur (de 1918). Un autre oxymoron baroque dont les Canadiens - et les Québécois - ont l’impénétrable recette. À la manière américaine, il s'agit de célébrer le sang, les souffrances et les morts au nom de la Patrie reconnaissante. Mais comme cet agent américain des C.S.I. qui dresse une lettre transpercée d'un poignard qui a tué la nanny, nous pouvons lire, avec lui, écrits en lettres de sang : WE HAVE HARPER⌛
d’opérettes costumées défiler pour célébrer une sympathique petite guerre, les fonctionnaires conservateurs et les députés recevront les commandes et les discours à réciter pour les quatre années qui suivront, dès à partir de l’année prochaine, en vue de célébrer l'une des plus sales guerres de l'Histoire à laquelle la résistance des Québécois à la conscription fut autrement plus tragique, à Québec en 1917, qu'à Lachine en 1812. Pourquoi célébrer 1812? Parce que c'est une mystification nationale, dont les dupes sont essentiellement les Canadiens-anglais d'Ontario et les Autochtones. Comment célébrer une needless war? En pensant aux célébrations prochaines de la Grande Guerre. En célébrant le vaincu (de 1814) dans le vainqueur (de 1918). Un autre oxymoron baroque dont les Canadiens - et les Québécois - ont l’impénétrable recette. À la manière américaine, il s'agit de célébrer le sang, les souffrances et les morts au nom de la Patrie reconnaissante. Mais comme cet agent américain des C.S.I. qui dresse une lettre transpercée d'un poignard qui a tué la nanny, nous pouvons lire, avec lui, écrits en lettres de sang : WE HAVE HARPER⌛21-23 juin 2012



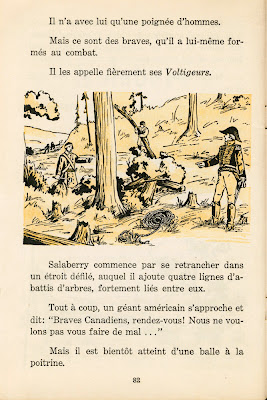












.jpg)































































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire