MES LECTURES HISTORIOGRAPHIQUES
Pour ceux qui auraient manqué ou désireraient lire mes critiques d'ouvrages, la plupart parues de février à juillet 2025 et publiées sur Facebook, je vous les offre à nouveau, mais revues et corrigées, dans ce blogue en espérant que vous les apprécierez, si ce n'est déjà fait. Merci à vous tous lecteurs pour votre fidélité, et bonne lecture.
TABLE
LA LIGNE DE PARTI AU QUÉBEC
Le récent livre de l'historien québécois Alexandre Dumas, La ligne de parti, aborde un sujet rarement étudié, celui du rôle de la ligne de parti au sein de notre régime politique : «Ce qu'on appelle ligne de parti, ou discipline de parti, fait traditionnellement référence à l'obligation pour les élus d'une formation politique de se lever en bloc au moment du vote. Dans une perspective plus large, on pourrait ajouter l'obligation de ne pas contredire la position officielle du parti, à l'intérieur ou à l'extérieur du parlement. La ligne de parti n'a aucune valeur sur le plan institutionnel ou légal. Chaque député est officiellement libre de voter ou non comme ses collègues et de contredire son chef en pleine séance. Si les dissidents étaient monnaie courante à une autre époque, elles sont aujourd'hui découragées».
Dumas suit l'évolution de la pratique de la ligne de parti à l'Assemblée nationale du Québec depuis la Confédération. Il la suit aussi bien au sein du parti ministériel que dans les partis d'opposition. Cette tradition s'est établie d'elle-même, avec la pratique de la démocratie, mais ses effets négatifs semblent n'avoir été perçus qu'en 1982, lorsque le ministre péquiste Denis Vaugeois, «afin de combattre "l'anémie" de la démocratie québécoise», souhaita «rendre le Parlement plus indépendant du gouvernement en donnant un plus grand rôle aux députés». Aussi, «l'objectif à long terme serait de faire de l'Assemblée nationale un "véritable forum démocratique", c'est-à-dire un lieu où peuvent se faire les débats politiques à l'abri des allégeances partisanes». Cet idéal, c'était déjà celui des révolutionnaires français de 1789.
Dumas pose la ligne de parti en fonction de «quatre principales motivations au vote d'un parlementaire : sa réélection, l'avancement de sa carrière (qui se traduit généralement par l'accession au cabinet ministériel), l'implantation de politiques publiques ainsi que le respect de ses valeurs et ses convictions personnelles. Un député ne soutiendra pas son chef si son vote ne favorise pas au moins une de ces préoccupations». - «Notre étude se concentre principalement sur la première moitié de notre histoire politique, soit de la Confédération à la Seconde Guerre mondiale. C'est au cours de cette période que s'installe la ligne de parti telle qu'on la connaît aujourd'hui. Comme on le constatera, en 1944, la ligne de parti au Parlement québécois est un fait établi. À compter de cette date, malgré des dissidences occasionnelles et d'autres plus spectaculaires, la discipline est rarement remise en question».
Il faut se rappeler que dans l'Acte constitutionnel de 1867, non seulement le Premier ministre était un grand absent, mais le concept de parti politique n'existait pas. C'est donc par une démarche empirique que les partis canadiens et québécois se sont définis au cours de la pratique de la démocratie parlementaire. Dumas nous rappelle que ce n'est qu'à partir de 1972 «que la reconnaissance légale des partis politiques fédéraux a permis l'ajout des affiliations partisanes sur les bulletins de vote. Avec cette reconnaissance légale des partis politiques vient le pouvoir de désigner un candidat officiel, le seul ayant le droit de se réclamer du parti en question. Les députés sortants courent le risque de se voir exclure, donc qu'on leur refuse le droit de se présenter au nom du parti. Au Québec, c'est en 1964 que se produisit ce changement législatif». Ici, l'évolution de la pratique parlementaire québécoise aura précédé la pratique fédérale.
De même, l'idée d'imposer et de suivre une ligne de parti procède de la tradition : «son champ d'application et la force avec laquelle la discipline est appliquée sont laissés à la discrétion des partis». Il appartient donc aux partis de décider de la conduite des députés, d'assurer leur solidarité tout en autorisant, sous certaines limites, la liberté de conscience et de parole des élus. Comme le souligne encore Dumas, «la politique est à l'époque une entreprise individuelle dans laquelle le parti ne joue qu'un rôle secondaire. Les partis politiques ne disposent d'aucun moyen de contrôler les candidatures». Cela a été la norme surtout lors des premières législatures.
En effet. Au début de la Confédération, les partis sont peu structurés et, en fait, ils n'existent même pas. Sauf le parti Conservateur établi depuis l'Union de 1840. Les députés se rassemblent selon leurs affinités, d'où va se dégager peu à peu le parti de l'opposition, le parti Libéral. Selon les votes, on peut voir les députés franchir aisément les deux côtés de la Chambre, affirmant ainsi une indépendance d'opinion. Les chefs de gouvernement eurent donc beaucoup à faire pour imposer un semblant de discipline dans ce qui formait un parti; les députés ne cessant «de penser en matière d'intérêts locaux». En cela, ils étaient fidèles à la définition du député comme représentant du peuple. Comme le rappelle Josiane Boulad-Ayoub : «Les représentants s'identifient au peuple, aux forces vives de la Nation. L'exécutif n'a à aucun moment le droit de substituer sa volonté à celle du peuple souverain».
Le principe est clair, comme l'exprime le dissident conservateur Louis Beaubien : «il faut se ranger d'abord avec son pays puis avec son parti», opinion reprise par son collègue L.-T. Dorais, lui aussi conservateur : «Quand on vote toujours d'un côté, on vote en aveugle»; les députés, en effet, répugnent à ce qu'on les prenne pour des «machines à voter», ou encore des «députés de pailles». C'était l'époque où les partis commençaient à recourir aux parachutages de candidats dans des comtés vacants. La chose prend de l'ampleur lorsque «le gouvernement bénéficie d'une forte majorité, les députés ne sentent plus obligés de suivre leur chef inconditionnellement», comme sous le gouvernement Chapleau (1879). C'est dire que «la plupart des députés représentent avant tout les intérêts de leur propre circonscription». Ils sont les délégués des électeurs de leur comté au parlement.
 Donc, ce que
l'enquête de Dumas nous révèle d'implicite de l'évolution de la
démocratie, c'est qu'au travers de la ligne de parti et des
manifestations de dissidence des élus, c'est la notion de
représentant du député qui change. Comme il l'expose au cours des
premières chapitres, «le début du XXe
siècle représente un âge d'or de l'initiative parlementaire.
Chaque député était alors libre de faire des propositions
importantes en son propre nom». Mais c'est alors qu'on commença
à dénoncer l'«insubordination» des députés, ceux qui
disputaient les décisions de la direction du parti. Une trop grande
désobéissance risquait de coûter le pouvoir à la majorité
gouvernementale. Il fallait discipliner les troupes. C'est ainsi que
«la ligne de parti s'est construite d'elle-même», même si
«les appartenances régionales et religieuses prennent toujours
le dessus sur la solidarité partisane».
Donc, ce que
l'enquête de Dumas nous révèle d'implicite de l'évolution de la
démocratie, c'est qu'au travers de la ligne de parti et des
manifestations de dissidence des élus, c'est la notion de
représentant du député qui change. Comme il l'expose au cours des
premières chapitres, «le début du XXe
siècle représente un âge d'or de l'initiative parlementaire.
Chaque député était alors libre de faire des propositions
importantes en son propre nom». Mais c'est alors qu'on commença
à dénoncer l'«insubordination» des députés, ceux qui
disputaient les décisions de la direction du parti. Une trop grande
désobéissance risquait de coûter le pouvoir à la majorité
gouvernementale. Il fallait discipliner les troupes. C'est ainsi que
«la ligne de parti s'est construite d'elle-même», même si
«les appartenances régionales et religieuses prennent toujours
le dessus sur la solidarité partisane».
Le candidat Arthur Turcotte, lorsqu'il «se présente... comme conservateur, ...promet de toujours faire passer les intérêts de Trois-Rivières avant ceux de son parti.. C'est d'ailleurs la devise du journal "La Concorde" qu'il a fondé et qu'il dirige : "Les intérêts du pays avant ceux des partis"». Et le serment sera repris par son successeur, le jeune Maurice Duplessis : «Lors de sa première campagne électorale en 1923, il se déclare prêt à voter contre Arthur Sauvé si c'est dans l'intérêt de son comté : "Je serai avant tout citoyen des Trois-Rivières et je m'engage à voter contre MM. Sauvé et Patenaude s'ils veulent passer une loi contraire aux intérêts des Trois-Rivières. L'esprit de parti a fait trop de dommage à cette province. Il est temps que nous puissions exprimer notre opinion en toute sincérité et en toute franchise". La promesse est suffisamment remarquable pour que "Le Nouvelliste" en fasse le titre de son compte-rendu. Comme la plupart de ses collègues, il arrive à Duplessis de voter contre son chef à l'Assemblée législative. Il enregistre six dissidences entre 1928 et 1932».
Cette transformation du représentant des élus au délégué du parti commence avec le long règne des Libéraux qui va de 1897 à 1936. Jusqu'alors, le député est avant tout représentant de son comté. Le ministre libéral Joly de Lotbinière convenait que «sous le système des gouvernements par partis, il n'y a pas de gouvernement possible à moins de concessions mutuelles entre les membres de ce parti». Des concessions, ce qui voulait dire que si le parti autorisait une certaine liberté de conscience sur les projets de loi privé déposés par de simples députés, il fallait se ranger d'une seule voix lors des projets de loi publique déposés par le gouvernement. En proposant un bill privé, on n'en faisait pas une question ministérielle et les députés étaient donc libres de voter selon leur convenance.
Avec le gouvernement de Lomer Gouin (1906) la règle va se resserrer. Gouin lui-même avait «freelandiser»* son prédécesseur, Simon-Napoléon Parent, en opérant un véritable coup d'État par sa démission fracassante de son ministère. Prenant le pouvoir en main, il devint bientôt la cible du député libéral Prévost qui l'accusait de «despotisme» et «de siéger "du haut de sa tour d'ivoire"». Un autre député libéral, offusqué de la ligne de parti, Cyprien Dorris, se plaignait pour sa part que devant un vote, «les députés du côté ministériel n'ont pas été consultés, et les députés, c'est des peureux!». Mais, comme le remarque Dumas, «ces francs-tireurs sont de moins en moins nombreux. À l'époque de Louis-Alexandre Taschereau, les députés libéraux sont pour la plupart des politiciens de carrière et n'osent pas défendre des principes, au risque de perdre le soutien de leur parti».
Malgré la discipline imposée par Gouin et Taschereau, la ligne de parti se montrait encore assez souple : «Joseph-Adolphe Chapleau et Lomer Gouin ont fait certains efforts, mais n'ont jamais exigé une unanimité aussi absolue que celle qui caractérisa le règne du "cheuf". Sous Duplessis, la dissidence n'est plus permise. C'est un état de fait qu'on constate dès son arrivée en chambre comme chef de l'opposition». Si le député demeure le représentant de ses électeurs, cette fonction se voit vite ombragée par le fait qu'il devient de plus en plus le délégué du parti auprès des électeurs.
Certes, Duplessis ne put empêcher les manifestations de certains de ses députés. Son ministre du travail, William Tremblay, en 1938, ainsi bousculé par son collègue Bélanger, ancien de l'Action libérale nationale : «"Quelle est donc, en vérité, l'utilité des représentants du peuple? Ne sont-ils là que pour remplir le rôle de messagers, si ce n'est de garçons d'ascenseur, de lèche-bottes, de thuriféraires des ministres pour obtenir de malheureux octrois ou de bouts de chemin pour leur comté?"». L'exaspération d'une voix montre que la conscience des élus subissait un choc sévère. Toutefois, Duplessis était suffisamment certain de la cohérence de ses députés qu'il pouvait laisser cette voix s'exprimer sans conséquences nuisibles.
«Le premier gouvernement Duplessis marque également le début de la fin de l'initiative parlementaire. L'initiative fait référence au droit de présenter des projets de loi. Jusqu'en 1936, les députés ont le loisir de déposer des projets de loi de leur propre inspiration. Parmi les plus célèbres, on retient évidemment l'octroi du droit de vote aux femmes. Les projets de loi d'initiative parlementaire étaient une occasion pour les députés de s'exprimer librement, puisque le gouvernement n'imposait souvent pas de ligne de conduite lors de ces débats. Maurice Duplessis est le premier premier ministre à imposer des règlements sessionnels ou spéciaux afin de donner priorité aux projets de loi du gouvernement. Adélard Godbout suivra son exemple et les libéraux de Jean Lesage poursuivront ce qu'il conviendra ensuite d'appeler une tradition. En plus de donner l'avantage au gouvernement, cette diminution de l'initiative parlementaire fait disparaître les principales occasions de dissidence».
C'est le parti qui devient l'unique représentant du peuple. De là qu'il délègue ensuite ses candidats dans les différents comtés pour se faire élire. Ainsi, «la tendance à la monopolisation des activités politiques par les représentants s'accompagne donc de diverses formes de dépossession des représentés». Si la dissidence ouverte d'un député n'est plus acceptable par son parti, on peut toujours accepté qu'il la manifeste d'une autre façon. C'est l'absentéisme au moment du vote, signe implicite de désaveu : «Les premières occasions où les députés se sont absentés volontairement pour ne pas voter contre leur propre parti se voient sous le deuxième gouvernement Gouin (1909-1912). C'est à partir du gouvernement Godbout (1939-1944) que ces absences deviennent une façon de faire répandue et acceptée. C'est une tradition qui a perduré jusqu'à aujourd'hui». L'absentéisme (auquel recours certains députés de façon répétée) demeure le seul moyen pour un député de marquer sa désapprobation sans avoir à en subir de conséquences graves.
Mais il est arrivé des périodes où l'absentéisme ne suffisait plus et des députés sont retournés au désaveu. La chose s'est vue à l'époque des grands conflits linguistiques sous J.-J. Bertrand et R. Bourassa. Par contre, les pires affrontements ont eu lieu sous le gouvernement du Parti Québécois. La chose est normale si on considère que le Parti Québécois se veut un parti d'idées, constitué à l'origine de nationalistes déçus de l'Union nationale. Il est animé par une «culture de débats», comme le dit Véronique Hivon : «Le débat devrait être célébré. C'est l'expression de sensibilités différentes, mais on appelle ça de la chicane. C'est une étiquette qui nous est accolée et qui montre à quel point la culture de la ligne de parti et du leadership relativement autoritaire est ancrée dans nos mœurs politique». Mais les débats jusqu'à la rupture? Même dans l'opposition, les tensions entre des députés et leur cheffe (à l'époque Pauline Marois) ont conduit à des déchirements douloureux. Trop étroite, la ligne de parti étouffe des députés et fait ressaisir la conscience des représentants contre leur rôle de délégué. Comme l'avoue Jean-Martin Aussant dans une entrevue avec l'auteur : «on se souvient qu'on a été élu non pas pour représenter la vision du chef auprès des citoyens, mais bien pour représenter ce que les citoyens veulent».
Le député délégué du parti discrédite la fonction de représentant de comté. La journaliste Myriam Segal «critique la ligne de parti dans son ensemble : "Pour que la politique inspire le respect, il faut restaurer la fonction de député; leur rendre la liberté de parole et de pensée. Tant qu'ils suivent aveuglément la ligne de parti, mentant aux électeurs sous couvert d'unanimité factice, les politiciens alimentent un cynisme mérité". Son collègue Jonathan Trudeau va plus loin en affirmant qu'il s'agit d'un "déni de démocratie"». Car, demande Dumas, «Quelle est la valeur d'un vote individuel si seuls les chefs et les leaders connaissent réellement les enjeux des propositions?». C'est reconnaître que la ligne de parti s'est imposée, en partie, à cause de la complexité des projets de loi mais aussi de la croissance des députations.
Elle s'impose aussi avec la révolution de l'information depuis le début du XXIe siècle : «Toute déclaration maladroite est susceptible de provoquer une tempête médiatique. Nous avons vu... les conséquences que peut avoir une dissidence : monopoliser l'attention des médias et, ce faisant, ruiner l'agenda médiatique du parti, remettre en question le leadership et envoyer un message contradictoire à la population. On comprend donc bien les préoccupations des partis au sujet de la discipline...». Toute une équipe d'agents de presse et de conseillers entoure désormais les ministres et les députés. Les caucus ne concernent plus seulement la famille ministérielle, mais tout un entourage de techniciens de l'information et de fonctionnaires. Comme se le demande la députée de Québec Solidaire Ruba Ghazal : «Dans la réalité, à quand remonte la dernière fois qu'un député indépendant s'est fait élire?». En 1966, mais la chose était courante au début de la Confédération.
Aucun parti aujourd'hui ne peut s'éviter la ligne de parti, même en prêchant qu'il est le plus démocratique de tous. Gabriel Nadeau-Dubois pouvait se vanter qu'à Q.S., «tout le monde doit se sentir écouté et respecté. La nécessité de construire un consensus est fortement ancrée chez Québec solidaire». Évidemment, depuis l'entrevue accordée à Dumas, les faits lui ont donné tort à travers les critiques virulentes de Catherine Dorion et surtout d'Emilyse Lessard-Therrien qui retrouvaient dans Q.S. ce qu'une ex-députée de la C.A.Q. décrit ainsi :«Ce n'est pas le chef qui intimide que son entourage. Ces gens-là assistent au caucus. Ces apparatchiks sont très puissants au sein du parti, décident de beaucoup de choses, influencent beaucoup le chef». Les candidats de Q.S. naissent déjà comme des délégués (pratique peut-être importée du monde syndical?) avant même d'avoir bien compris la définition de ce qu'est un représentant du peuple.
* Freelandiser, de Chrystia Freeland, la vice-première ministre libérale de Justin Trudeau qui dénonça ouvertement les mesures onéreuses du premier ministre et força à sa démission.
MAIS C'EST UN COMPLOT!
Jamais un complot n'abolira la théorie du complot. Parce que la théorie du complot est le fruit d'une pensée paresseuse devant une situation ou un événement complexe. Recourir à un monisme devient alors une façon d'englober en un tout un ensemble disparate et donner une explication qui n'en est pas une. Mais ce n'est pas parce que la théorie du complot est simpliste qu'elle signifie qu'il n'existe pas de complots. Et la réalité est là. Il existe des complots, mais aucun dans lequel on ferait intervenir à la fois les Sages de Sion, les Jésuites, les Francs-Maçons, les Neuf supérieurs inconnus, le Nouvel Ordre mondial et Hilary Clinton.
Benjamin Brillaud – l'auteur de podcasts historiques Nota Bene sur la chaîne You Tube – et Stéphane Genêt nous donnent un inventaire des grands complots avérés de l'histoire dans ce recueil, Mais c'est un complot! Conspirations, intrigues et coups fourrés dans l'histoire. Dans cette réédition de poche «Texto», les auteurs parcourent les temps, du premier complot enregistré sous le règne du pharaon Ramsès III jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001. Bien avisés, ils nous posent la question :
«Comment identifier un réel complot? Définissons déjà de quoi on parle. Il s'agit d'un projet collectif mené dans le plus grand secret afin de nuire à un individu ou à une institution. La définition est large mais elle peut alors coller à de nombreux cas, que ce soit à échelle humaine ou à celle de pays entiers. Ce qui peut caractériser le complot, c'est qu'il a été identifié comme tel, avec des preuves irréfutables de sa mise en application. Quand un soupçon de preuve, qui ne repose sur rien de tangible, pointe ce qui pourrait être alors un complot, on parle de la fameuse "théorie du complot"».
Évidemment, depuis 2001 – date marquante de la naissance du complotisme comme mode de pensée -, les vrais et les faux complots ne cessent de s'entre-mêler. L'extravagance ne semble même plus en position de distinguer le vrai du faux. «Pour faire la différence entre une vraie et une fausse conspiration, il est essentiel de réaliser un travail intellectuel sur soi-même. Au-delà de l'émotion suscitée par un événement, se poser quelques questions peut-être salutaire pour éviter de succomber aux sirènes du complotisme : qui, pourquoi, comment?».
Qui d'abord? Sûrement pas de vastes collectivités. Les vrais conspirationnistes ne peuvent être que quelques personnes, car de trop vastes organisations risquent de voir l'un des leurs trahir le secret. Le secret est l'une des conditions essentielles qui permettent de saisir un vrai complot. Or le fait de dénoncer constamment des complots infirme leur existence puisque, normalement, nous devrions en être tenus dans l'ignorance. Un complot éventé n'en est plus un.
Le second critère – se demander pourquoi – vise à s'interroger à qui bénéficie l'accomplissement d'une telle action subversive. Un complot qui ne bénéficie pas à quelques individus particuliers – une secte, une faction politique, une cellule terroriste -, ne bénéficie à personne. Il est donc absurde de le considérer sérieusement. Surtout si on suppose une assemblée d'individus riches et puissants qui disposent de tous les instruments pour parvenir à leur fin sans utiliser la clandestinité.
Enfin, troisième critère, le comment. Comment passer d'une préparation soignée, secrète, à l'abri des regards indiscrets et de la surveillance policière, en arriver à un accomplissement? Ne cherchons pas de modes d'emploi du parfait complot. À travers les 25 complots historiques retenus par les auteurs, la moitié sont des réussites et l'autre des échecs : «De l'ascension de l'impératrice Irène (Constantinople 797) à la conspiration de Cinq-Mars (France, 1642) en passant par le coup d'État de Pinochet en 1973 et ses possibles liens avec la CIA, Nixon et le Watergate, jusqu'à des théories funestes autour du 11 Septembre, nous vous proposons ici de voyager à travers les époques et les espaces géographiques pour découvrir des histoires incroyables et leurs protagonistes, les raisons de leur implication, leurs modes opératoires et, bien souvent, leurs échecs».
 Le but de l'ouvrage consiste à «mettre
en avant des exemples concrets de ces machinations politiques, avec
la rigueur de l'historien et l'accessibilité du vulgarisateur, peut
contribuer à briser le fameux cercle du "on nous cache des
choses!" tout en évitant la facilité du "on ne nous cache
rien". Dans cette époque de fake
news, d'incertitude climatique, politique, sociale et
économique, il paraît important de pouvoir prendre du recul sur la
consommation que nous faisons de l'information. Et le métier de
l'historien, c'est justement de prendre du temps pour se poser des
questions, analyser des contextes et interpréter des événements.
Ce qui implique parfois... de ne pas trouver de réponse aux
questions posées! Car l'Histoire, c'est aussi la science de
l'humilité».
Le but de l'ouvrage consiste à «mettre
en avant des exemples concrets de ces machinations politiques, avec
la rigueur de l'historien et l'accessibilité du vulgarisateur, peut
contribuer à briser le fameux cercle du "on nous cache des
choses!" tout en évitant la facilité du "on ne nous cache
rien". Dans cette époque de fake
news, d'incertitude climatique, politique, sociale et
économique, il paraît important de pouvoir prendre du recul sur la
consommation que nous faisons de l'information. Et le métier de
l'historien, c'est justement de prendre du temps pour se poser des
questions, analyser des contextes et interpréter des événements.
Ce qui implique parfois... de ne pas trouver de réponse aux
questions posées! Car l'Histoire, c'est aussi la science de
l'humilité».
Brillaud et Genêt n'iront pas plus loin sur une thèse du complot. Ni thèse psychologique, ni thèse sociologique. Mais c'est un complot!, avec un ton parfois humoristique, est une chronique divertissante comme en produisaient Decaux et Castelot il y a plus d'un demi-siècle. Cependant, s'il part d'une affirmation péremptoire : «Une chose est sûre : depuis qu'il existe des sociétés humaines, les hommes complotent», les conclusions butent sur certaines expressions dubitatives : paradoxalement, plausible... C'est l'humilité de l'historien qui s'exprime, car l'objet de l'enquête n'est pas soumis aux apports des différentes sciences humaines, contrairement aux ouvrages déjà mentionnés plus tôt de Luc Boltanski (Énigmes et complots) et de Naomi Klein (Le Double, Voyage dans le Monde miroir).
Il eut été pertinent de se demander, par exemple, dans quelles conditions sociologiques et politiques naissent les conjurations. Évidemment, on devine assez vite que les crises sociales tendent à générer de ces complots. La conjuration de Catilina, l'assassinat de César, la conjuration des Pazzi à Florence ou la conspiration des poudres à Londres sous Jacques Ier, témoignent des crises internes. Par contre, d'autres crises surgissent surtout des situations obsidionales, paranoïaques, comme lors de la Peste noire de 1348, «très virulente» qui «se répand en Europe grâce aux flux de marchandises et d'abord au transport maritime et cela malgré les différentes tentatives des autorités de l'époque d'empêcher sa propagation» aurait dû rappeler aux auteurs que la diffusion de la Covid 19 s'est faite en partant de ces paquebots monstrueux de touristes revenant d'Extrême-Orient. Ils ont été les premières «cités» à subir la quarantaine. Ce qui n'a pas empêché, avant même la fin de tous les confinements, ces parasites avoués impatientés de reprendre ces croisières. Il est donc possible de carburer à la paranoïa et de la suspendre le temps des loisirs toxiques.
Il arrive à Brillaud et à Genêt de crier au paradoxe. Et les complots, en effet, ont des issus souvent paradoxaux : «Les poignards qui, en tuant César, voulaient abattre le tyran et rétablir la république, vont donc amener Octave au pouvoir. Sous le nom d'Auguste, il installe progressivement le principat, un régime impérial. Un beau paradoxe pour un complot finalement aussi réussi que raté!». César assassiné, ses meurtriers sont poursuivis puis exécutés mais de la République, on passe encore plus rapidement au régime impérial. Les Pazzi ont-ils voulu exterminer les Médicis afin de soustraire Florence à leur domination? «Les Médicis s'en sortent... grâce à l'habileté diplomatique de Laurent et toute cette conjuration, c'est un beau paradoxe, leur permet de renforcer leur pouvoir sur Florence».
Paradoxe veut dire ici retournement de situation. Les conjurés finissent bannis. Voulant libérer la patrie, ils en resserrent les liens : «C'est tout le paradoxe de ce complot [de juillet 1944] mené par des officiers courageux [de la Wehrmacht], prêts à prendre tous les risques pour tuer Hitler : leur échec renforce l'obstination du Führer et rend finalement l'armée allemande plus endoctrinée encore». De même, la conjuration de l'O.A.S. en vue de supprimer le général de Gaulle – complot d'officiers militaires luttant contre l'indépendance de l'Algérie en 1962 -, ouvre sur des effets contraires : «Non seulement Bastien-Thiry [le chef des conjurés] n'a pas abattu le Général, mais il a, paradoxalement, renforcé son pouvoir. Le 28 septembre 1962, le référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct est approuvé par les Français avec 82% de oui. Trois ans plus tard, lors de la première élection présidentielle, le général de Gaulle est réélu». Les auteurs n'hésitent donc pas à tirer des leçons de l'histoire dans la veine de Cicéron : «historia magistra vitæ».
Ces paradoxes dont parlent Brillaud et Genêt sont de plusieurs ordres. Leurs illustrations jusqu'à présent concernent le paradoxe de l'arroseur arrosé. Parfois, il faut attendre longtemps pour qu'une conjuration engendre des effets contraires. Ainsi, le coup d'État anglo-américain en vue de se débarrasser du Premier ministre Mossadegh en Iran (1953), réussi au premier regard, contient des effets ultérieurs imprévisibles : «en supprimant progressivement toute vie démocratique iranienne, en créant un fort sentiment anti-américain et en laissant dans le pays les mains libres aux sociétés étrangères, ce coup d'État est l'une des causes préparant vingt-cinq ans plus tard une autre révolution, mais cette fois-ci islamiste».
D'autres fois, la conjuration est présentée comme un effort vain puisque le temps rattrape les conjurés. Ainsi du jeune favori, le marquis de Cinq-Mars, exécuté à l'âge de 22 ans pour avoir comploté contre son protecteur, le roi Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Se serait-il lancé dans cette stupide entreprise s'il avait tenu compte des états de santé déplorables du roi et de son ministre (les deux se rencontrent pour un pourparler, chacun étendu dans son lit) et qui devaient mourir, l'un après l'autre, six mois après l'exécution de Cinq-Mars? «Finalement, Cinq-Mars aurait gagné à patienter un peu». Observation laconique, mais qui dit tout.
Il est remarquable qu'à travers tous ces complots, Brillaud et Genêt n'aient pas retenu le plus paradoxal de tous; celui qui fut à la fois réussite et échec, la conjuration des sudistes d'avril 1865. Avec l'assassinat de Lincoln, le complot est réussi, mais au quart seulement, car l'assassin qui devait tuer le vice-président Johnson s'est dégonflé; celui qui réussit à poignarder le Secrétaire d'État Seward dans son lit fut maîtrisé par son fils alors que le général Grant échappa dans l'après-midi à son sbire en prenant le train. Cette conjuration fantastique devait saboter ce qui aurait été la grande œuvre de Lincoln durant son second mandat : la Reconstruction du Sud, qui fut laissée à des carpetbaggers sans scrupules (des aventuriers nordistes descendus dans le Sud) et la constitution du racisme avec les lois Jim Crow et la société secrète du Ku Klux Klan. Il est certain que la déréliction traumatique que subit le Sud après sa défaite militaire suite à la dissolution de son État confédéral s'est développée avec la tentative au quart réussie du complot d'avril 1865.
L'usage des conjurations ou des complots, réussis ou vains, véhicule le nec plus ultra de la conception whig de l'histoire dont parlait Herbert Butterfield. Ce regard téléologique qui conduit notre connaissance de l'histoire jusqu'à exclure toute histoire alternative. Alors que celle-ci obtient la faveur actuelle dans les débats philosophiques, la conception whig exclue tout autre variation à l'état de fait avéré. Ce relativisme cause des ulcères à bon nombre d'historiens. Si l'assassinat de Lincoln a réussi et les autres non, c'est qu'il devait en être ainsi pour le monde actuel. Un uchroniste, par contre, s'amuserait inlassablement à poser les assassinats de Johnson, de Seward et de Grant comme ayant tous réussis; ou si, encore, Booth avait échoué à tuer Lincoln. Pour apparemment gratuites que sont ces fantaisies interprétatives, elles nous forcent à extrapoler sur le cours de l'histoire.
«Agiter la peur et faire croire à un complot peut être une arme puissante dans les mains d'hommes politiques médiocres et en mal de reconnaissance». Sans doute est-ce là, en effet, la seule conclusion possible de l'histoire des vrais complots. Elle confirme notre jugement du début, que le complotisme est une paresse de l'esprit. Le complot, s'appuyant essentiellement sur des hasards (sa réussite ou son échec), n'abolira jamais cette paresse à les retrouver au moindre détour des événements courants.
L'ESPACE SIGNIFIANT DU TEXTE
En 1964 paraissait l'un des premiers essais littéraires québécois, La Mère dans le roman canadien français, œuvre d'une religieuse de la Congrégation Notre-Dame, Sœur Sainte-Marie-Éleuthère. Ce volume inaugurait la collection «Vie des lettres canadiennes» des Presses de l'Université Laval. Avec son approche jungienne (c'est ce qui en faisait un essai moderne), elle analysait la présence de la figure maternelle dans les romans québécois publiés jusqu'alors et les archétypes qui lui étaient associés.
Cinquante ans plus tard, François Ouellet a fait de la figure du Père le centre de ses recherches littéraires. L'espace signifiant du texte, ensemble d'articles réunis, explore la «métaphore paternelle et [les] significations collatérales». En plus d'un demi-siècle, la sémiologie a évolué – Barthes et Eco sont passés par là -, et on ne se satisfait plus des seuls paradigmes jungiens pour analyser ces figures archaïques littéraires qui confinent à la métaphysique :
«Au cœur de ma compréhension de la littérature se trouve la programmatique du Père. Une problématique, c'est-à-dire la prise en compte d'un sujet déterminé qui est marqué par l'histoire et qui s'impose par les questions qu'il suscite, par les enjeux qui le constituent. J'écris le "Père" avec une capitale : c'est que je ne traite pas de celui de tous les jours, le père de famille comme on disait il n'y a encore pas si longtemps, mais d'une figure textuelle qui le dépasse et dont, comme référent, il ne représente d'ailleurs qu'un aspect; car le Père tel que je l'entends, à titre de signifiant, concerne toute forme d'autorité».
Ouellet ne se satisfait pas des seuls romanciers québécois, essentiellement contemporains. Il puise autant chez Zola, Rachilde, Paul Morand, René Barjavel, Olivier Frébourg et Hélène Lenoir que chez Laure Conan, Robert Charbonneau, Gabrielle Poulin, Gilles Marcotte, Hervé Bouchard, Louis Hamelin, Si l'étude de sœur Sainte-Marie-Éleuthère n'abordait pas l'aspect anthropologique du matriarcat, Ouellet, lui, ne peut échapper aux jugements sévères, portés souvent avec raison, sur le patriarcat.
«...le patriarcat, pour le meilleur et pour le pire, a été "le" système duquel découle tout le reste, dans lequel tout le reste s'emboîte. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais un fait, qu'on le veuille ou non. Les postures du romancier sont infinies; mais qu'il écrive contre la famille, qu'il relate une histoire amoureuse, qu'il s'inspire de faits dont il a eu la connaissance, qu'il cherche à être moderne à tout prix, qu'il s'adonne aux littératures de l'imaginaire, qu'il se fasse militant, philosophe ou pédagogue, aucune posture ne pourra soustraire son discours au patriarcat qui la surplombe et qui, jusqu'à tout récemment, a régenté le monde. Qui a fait que le monde était monde».
Il n'est certes pas question de reprocher à Ouellet de ne pas faire ici ce qu'il a fait ailleurs. Il faut seulement constater que ces grandes figures archaïques, qui ne cessent de hanter nos représentations sociales, nos productions littéraires et artistiques, apparaissent impossibles à contourner, même en s'efforçant de les ignorer, et ne succombent nullement aux prétentions idéologiques du féminisme ou de la doctrine du genre. Le paradoxe féministe qui rejette le «nom du père» pour se retrouver pris avec le «nom du père de la mère» fait jaillir l'intolérable prégnance du patriarcat, le rendant insupportable à la conscience féministe. Où qu'une femme se retourne, elle n'a pas de nom propre qui lui assigne une filiation strictement matronymique. Ce fantasme du lesbianisme radical doit alors en appeler aux néologismes fantaisistes issus de la science-fiction ou de l'utopie, car dans le monde de l'Histoire, il ne semble pas qu'il puisse trouver de précédents.
Il y a donc quelque chose de foncièrement totalitaire dans le patriarcat comme dans l'archétype du Père auquel nous sommes tous soumis; duquel il n'y a aucun échappatoire possible. Cela mutile chacun d'entre nous car il nous impose une filiation, autant dire une sujétion comme l'ont démontré, au cours des siècles, les rapports entre l'autorité et l'individu (et les collectivités). Nulle organisation sociale ou communautaire sans figures archaïques dominantes – le Père ou la Mère –, le plus souvent les deux. Le prix à payer pour l'individu d'atteindre à sa liberté et son autonomie, c'est de tuer le père pour accéder lui-même à la paternité; quitter le champ du fils pour s'approprier celui de la direction de la meute et, en particulier dirait Freud, des femmes. C'est ainsi qu'il imaginait l'origine des groupes humains dans Totem et tabou (1913). Ce que Ouellet, à propos du roman de Laure Conan, (Angéline de Montbrun, 1882), rappelle par sa phrase : «au commencement était la mort du père».
 Qu'elle soit placée
au début ou à la fin du roman, cette mort (ce meurtre) du père
fonde tout projet littéraire. Comme il le répète encore à propos
de «Parents et amis sont invités à y assister» (2006),
roman d'Hervé Bouchard qui «s'ouvre sur la mort du père,
événement fondateur aussi bien de la fiction (l'histoire racontée
s'écrit comme conséquence de la disparition du père) que de la
littérature comme quête de sens et enquête sur le sens».
Cette pierre d'achoppement ne concerne pas seulement l'auteur de
fictions. Elle est la condition même de l'apparition de l'énigme
historiographique. Totem et tabou suppose que
l'Histoire se sépare de la Préhistoire précisément à partir du
meurtre fondateur du Père. Le parricide est la violence criminelle
d'où origine la faute première à partir de laquelle tout «bonheur
terrestre» sera désormais astreint à porter le fardeau de la
culpabilité. Une culpabilité qui engendrera d'autres crimes,
d'autres guerres, d'autres inconduites qui feront de la vie
l'antichambre de l'Enfer.
Qu'elle soit placée
au début ou à la fin du roman, cette mort (ce meurtre) du père
fonde tout projet littéraire. Comme il le répète encore à propos
de «Parents et amis sont invités à y assister» (2006),
roman d'Hervé Bouchard qui «s'ouvre sur la mort du père,
événement fondateur aussi bien de la fiction (l'histoire racontée
s'écrit comme conséquence de la disparition du père) que de la
littérature comme quête de sens et enquête sur le sens».
Cette pierre d'achoppement ne concerne pas seulement l'auteur de
fictions. Elle est la condition même de l'apparition de l'énigme
historiographique. Totem et tabou suppose que
l'Histoire se sépare de la Préhistoire précisément à partir du
meurtre fondateur du Père. Le parricide est la violence criminelle
d'où origine la faute première à partir de laquelle tout «bonheur
terrestre» sera désormais astreint à porter le fardeau de la
culpabilité. Une culpabilité qui engendrera d'autres crimes,
d'autres guerres, d'autres inconduites qui feront de la vie
l'antichambre de l'Enfer.
Ce crime est en même temps castrateur. Et c'est ce que chaque analyse de Ouellet s'efforce de démontrer. Revenons à ce qu'il dit du roman déjà cité de Bouchard, où «ces orphelins de père sont dorénavant condamnés à ne jamais être autre chose que des fils, donc à ne jamais devenir des hommes, des pères, car leur modèle d'identification n'est plus : ..."Mon père est mort. On ne saura jamais parler aux hommes. On ne passera jamais l'âge des boutons"». Dire qu'un roman commence par la mort du père, c'est faire s'abattre cette pierre d'achoppement, à la fois sur les personnages et sur l'auteur lui-même. L'intrigue demeure celle d'une castration confiée intimement aux lecteurs. En cela, le texte lui-même est castration, car il rappelle que si l'auteur est Dieu, lui aussi est lié à une logique dont il ne peut, même avec tous les effets dont il dispose, de son imagination comme des mécanismes littéraires, se libérer.
C'est alors que l'œuvre littéraire se fait démarche consistant, soit à trouver le salut qui permettra de se libérer de la culpabilité névrotique du parricide; soit à échouer dans cette entreprise, condamnée à la répéter autant de fois qu'elle n'y parviendra pas, à éviter le suicide qui en est sa conséquence logique ultime (ce qui équivaut à ne jamais passer «l'âge des boutons»).
Ici, on perd assez vite de vue le patriarcat. Avouons que cet axiome anthropologique se retrouverait difficilement au centre d'une intrigue romanesque, (bien que le roman analysé de Barjavel en fasse l'un de ses thèmes centraux, comme nous le verrons plus tard.) Il faut penser passer à l'historiographie. Là où la fiction trouve son équivalent, c'est lorsqu'en 1859, dans sa Contribution à la critique de l'économie politique, Karl Marx associait la fin de la «préhistoire de l'humanité» avec l'avènement du prolétariat :
«Le système de production bourgeois est la dernière forme antagonique du processus de production social, non point dans le sens d'un antagonisme individuel, mais d'un antagonisme qui naît des conditions d'existence sociales des individus. Les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cet antagonisme. Avec ce type de société s'achève donc la préhistoire de la société humaine». Il apparaît dans la pensée de Marx que ces «conditions d'existence sociales des individus» constituent bien l'optimum de l'autorité paternelle dans les rapports de production. L'antagonisme Père/fils serait donc finalement condamné par les forces productives nouvelles, créant «les conditions matérielles pour résoudre cet antagonisme». Dans Le Capital, huit ans plus tard, Marx reprenant métaphoriquement cet antagonisme, le posera entre «le royaume de la nécessité» et celui «de la liberté» :
«Le règne de la liberté ne commence, en réalité, que là où cesse le travail imposé par le besoin et la nécessité extérieure; il se trouve donc, par la nature des choses, en dehors de la sphère de la production matérielle proprement dite. Tout comme le sauvage, l'homme civilisé doit lutter avec la nature pour satisfaire ses besoins, conserver et reproduire sa vie; cette obligation existe dans toutes les formes sociales et tous les modes de production, quels qu'ils soient. Plus l'homme civilisé évolue, plus s'élargit cet empire de la nécessité naturelle, parallèlement à l'accroissement des besoins; mais en même temps augmentent les forces productives qui satisfont ces besoins. Sur ce plan, la liberté ne peut consister qu'en ceci : l'homme socialisé, les producteurs associés règlent de façon rationnelle ce processus d'assimilation qui les relie à la nature et le soumettent à leur contrôle commun, au lieu de se laisser dominer par lui comme par une puissance aveugle, l'accomplissant avec le moins d'efforts possible et dans les conditions les plus conformes à leur dignité et à leur nature humaines. Mais ce domaine est toujours celui de la nécessité. C'est au-delà de ce domaine que commence l'épanouissement de la puissance humaine qui est son propre but, le véritable règne de la liberté. Mais ce règne ne peut s'épanouir que sur la base du règne de la nécessité».
Le «royaume de la nécessité» est bien celui placé sous l'autorité de la figure du Père. Les personnages de romans nous décrivent le poids de l'existence qui les écrase, mais par lequel ils doivent assurer leur survie. Ce que représentent «l'homme socialisé», «les producteurs associés» rappellent cette meute fraternelle coupable du parricide. La fin du «royaume de la nécessité» nécessite le meurtre du Père. Marx résout donc préalablement l'aporie posée par Freud un demi-siècle plus tard, en plaçant le parricide dans le royaume de la nécessité. C'est par un saut - la révolution - que ses héritiers dépasseront la nécessité, et dont Marx ne semble pas élaborer «au-delà de ce domaine»; qu'enfin, de la préhistoire «aveugle» on passera à l'histoire, c'est-à-dire, à «l'épanouissement de la puissance humaine qui est son propre but, le véritable règne de la liberté»! Or, le sentiment tragique qui anime la pensée freudienne ne voit pas tant ce «règne de la liberté» comme celui d'un épanouissement. La liberté qu'entrevoit Freud rappelle plutôt celle de saint Augustin, lorsqu'il la voit comme la fatalité qui conduit de chute en rechutes. Ce pessimisme semble s'ouvrir d'avantage à la dramatisation pour les auteurs de fiction.
Évidemment, l'historien cherche dans tous les événements du passé les traces de ce saut qui permettrait d'aller d'un temps de l'aveuglement à celui de l'épanouissement. Finalement, en vient-il à se demander, pourquoi l'optimisme de Marx, qui voyait dans ce saut qualitatif le passage de l'aveuglement (de l'aliénation) à l'épanouissement, s'affaisse-t-il dans l'entre-tuerie des frères jusqu'à ce que l'un d'eux se rétablisse dans la position de la nécessité, héritière du patriarcat et de l'aliénation? Pour le romancier, parce qu'il est le Dieu-Père de son écriture, il peut toujours donner sa réponse personnelle. Comme le référant des auteurs qu'analyse Ouellet provient souvent de la culture chrétienne – dans le roman de Bouchard, par exemple -, le saut qualitatif n'est pas économique ou sociologique mais sotériologique. Il en appelle au salut chrétien : «être "sauvé", c'est apprendre sa mort, que nous sommes mortels, que nous sommes tous sans père». Sans père ne veut pas dire délivré de la figure du Père. Même assassiné, comme dans Hamlet, la figure du Père revient d'entre les morts; de même qu'il est déraisonnable de croire que, libéré d'une structure de production, on va s'éviter d'en passer à une autre, peut-être encore plus aliénante.
Car si les fils des romans analysés par Ouellet échouent à accéder à la position de père, c'est peut-être, précisément, parce que le patriarcat lui-même prédispose des conditions du parricide avant même qu'il ne soit commis? L'impératif de la nécessité (du patriarcat) leurs ôte tous les moyen d'assumer leur paternité. Comme chez ces pères absents des romans nord-américains (québécois y compris; québécois surtout), le continent de toutes les libertés n'est pas parvenu à s'émanciper du patriarcat oppressif qu'on reconnaissait jadis dans les monarchies européennes. La meute des frères rassemblés à Philadelphie en 1787 ou celle qui alla d'une conférence l'autre pour établir le Canada en 1865-1867, n'ont pas fait aboutir le royaume de la liberté, mais un nouveau royaume de la nécessité pour remplacer les vieux royaumes, déficients dans leur paternité même. Voilà pourquoi il semble si facile de renoncer au final et s'abandonner dans la sotériologie. Le salut ne peut venir que d'une entité extérieure où la figure du Père réconciliera la paternité avec la liberté, ce rêve que les «hommes roses», les «pères amis de leurs enfants» s'obstinent à vouloir jouer au risque même de l'évolution de leurs enfants.
Voilà où nous en sommes. Le patriarcat comme la paternité appartiennent au temps de la mort. C'est à eux qu'on demande de faire face et contenir la mort. Contrairement à la figure de la Mère - pour qui le temps et la mort n'existent pas parce qu'elle est porteuse de vie -, le Père ne peut faire comme Caterina Sforza qui, sur les parapets du château où elle avait trouvé refuge, pouvait affronter ses adversaires qui tenaient ses enfants en otages en se frappant le ventre, disant qu'elle avait toujours le moule pour en faire d'autres. Dans les sociétés, depuis l'aube de l'histoire vers le Ve millénaire avant notre ère, c'est la figure du Père qui est associée au temps. Au temps qui passe. Au temps qui s'achève par des récoltes de morts aux combats, ou d'épidémies et de tragédies diverses. La figure de la Mère peut toujours se frapper le ventre en disant que c'est pas grave, qu'elle a toujours le moule pour en faire d'autres. Mais, au final, c'est du Père qu'on attend les moyens pour donner au temps quelque chose d'autre qu'un transit entre la naissance et l'inhumation. Que si «l'homme est fait par la mort», qu'il ne soit pas «fait pour la mort» (Heidegger).
Jamais la chose n'apparaît aussi claire que dans l'analyse que Ouellet tire du roman de Barjavel, Le voyageur imprudent, où se trouve l'un des paradoxes les plus séduisants de la littérature de science-fiction, celui du «To be and not to be» : «Je rappelle ce paradoxe. En 1943, Pierre Saint-Menoux recule dans le temps de cent cinquante ans en se transposant à Toulon en 1793, où il espère assassiner Napoléon. Mais ayant raté l'empereur, il tue par mégarde son ancêtre maternel avant que celui-ci n'ait le temps de fonder une famille; dès lors, Saint-Menoux meurt à son tour, car il ne saurait exister si son ancêtre maternel n'a pas procréé. Or, comment Saint-Menoux peut-il avoir tué son ancêtre s'il n'a pas vu le jour?». Barjavel se contente de poser le paradoxe sans le résoudre alors que le patriarcat, dans une perspective lointaine, est annulé par un monde où «une masse gigantesque au sommet de laquelle trône une tête de femme; son corps se compose de centaines de vulves, à l'intérieur desquelles s'engouffrent des hommes par milliers. Du corps de cette "reine" ressortent de nouveaux hommes adultes. C'est ce mécanisme qui tient lieu de moyen de reproduction. Ici on ne fait pas l'amour; l'homme est entièrement absorbé par la vulve et, en échange de sa mort, "l'être reproducteur" donne naissance à un autre homme, tout frais et déjà adulte. Dans ce système, outre que l'enfant a été éliminé de la chaîne humaine, l'homme doit sacrifier sa vie pour permettre la naissance d'un autre être, du reste pareil à lui. Dans cet univers du même, de la reproduction mécanique, où l'altérité a été abolie, la paternité est une impossibilité radicale». Dans l'état actuel, il n'est pas sûr que la dysopie de Barjavel rejoigne davantage les prophètes du génome humain qu'étrangement, par la bande, les fantasmes du lesbianisme radical.
Figure ogresse comme le Saturne de Goya où les figures monstrueuses que répandent notre cinéma de terreur, le patriarcat en a beaucoup sur les épaules et l'impuissance de la figure de la Mère à le remplacer n'empêche pas qu'elle en a revêtu souvent l'armure au cours des siècles. La perspective de Barjavel a le mérite de rappeler qu'il est difficile d'en finir avec le patriarcat sans être sûr que ce qui le remplacerait serait plus bénéfique pour l'humanité. Comment gérer la hideur de la mort dans un monde où les généalogies passent, s'accroissent ou rétrécissent sans que le saut définitif du royaume de la nécessité au royaume de la liberté ne s'accomplisse? Le seul salut raisonnable ne serait-il pas, malgré que la mort soit toujours déjà-là à nos côtés, à chaque instant, sa hideur jamais ne nous enlève l'amour que nous avons pour la vie.
Riche de ses longues années de recherches et de réflexions sur l'Histoire du Québec, Yvan Lamonde, dans, ce petit essai, ventile les approches faites autour de l'idée d'indépendance du Québec, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la formation du mouvement souveraineté-association en 1968. Par de brefs chapitres, l'auteur nous conduit allègrement de Jules-Paul Tardivel à René Lévesque. Plus élaboré que le livre de Maurice Séguin, L'idée d'indépendance au Québec (1968), mais moins que les deux tomes de l'Histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois de Comeau, Courtois et Monière, il souligne combien l'idée d'indépendance est différente de l'indépendantisme en soi et pour soi. Si l'histoire de l'indépendantisme suit le développement des écrits, des actions et des mouvements indépendantistes, l'histoire de l'idée d'indépendance prend pour objet les opinions, aussi bien pro que contra, nées autour de l'indépendance du Québec.
Ce qui saute aux yeux à la lecture de Lamonde, c'est combien l'idée d'indépendance est toujours restée circonscrite à l'intérieur de paramètres étroits, rigides, propres à satisfaire la velléité plutôt qu'à encourager l'audace. Outre le fait que des forces extérieures ont réduit ces audaces (face à la motion Francœur en 1918, ou contre le FLQ dans les années 1960), c'est de l'intérieur même que l'idée d'indépendance dut lutter contre cette absence de volonté collective (voire personnelle) réelle.
En fait, le saut qualitatif le plus remarquable s'est effectué sous la Révolution tranquille : «on n'imaginait pas comment [l'idée d'indépendance] avait pu être la même, tant elle avait crû à droite pour enfin passer à gauche en 1960 avec le Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN). Le saut qualitatif de l'Alliance laurentienne (1957-1962) de Raymond Barbeau au RIN paraissait être une énigme. La trop fameuse "Révolution tranquille" explique-t-elle ce saut? C'est plutôt cette Révolution tranquille qu'il faut expliquer; elle n'explique rien et met plutôt deux mots ambigus sur un moment. L'énigme ne fait que porter, encore et toujours, la grande question : comment le changement s'est-il opéré?» Si Lamonde avait poursuivi son inventaire jusqu'au début du XXIe siècle, il aurait sans doute constater un nouveau saut, mais un saut réactionnaire, qui ramènerait cette idée d'indépendance du côté de la droite nationaliste, la plus conservatrice et rétrograde.
Reste toutefois le constat : «L'indépendance politique est toujours inachevée; je retrace ici les péripéties de l'idée de l'indépendance du Canada français et du Québec depuis un siècle, tout en ne sachant pas quel éclairage l'initiative pourra apporter à cet inachèvement. L'histoire n'est ni un procès ni une prophétie».
L'ouvrage débute donc en plein cléricalo-nationalisme ultramontain de la fin du XIXe siècle, avec le journal de Jules-Paul Tardivel qui, avec des articles étoffés et un roman propagandiste, Pour la patrie (1895), «prolonge et radicalise l'idée de François-Edme Rameau de Saint-Père et d'Étienne Parent selon laquelle le Canada français aurait en Amérique une destinée manifeste, une vocation spirituelle et catholique. Grâce à l'indépendance, le Canada français pourrait poursuivre sa défense de la religion et christianiser l'Amérique et, du coup, créer une Nouvelle-France plus ou moins d'Ancien Régime». Cette vision a été reprise essentiellement par le clergé durant les cinq premières décennies du siècle. Indépendance nostalgique d'une «tradition inventée», imaginaire, d'une Nouvelle-France plus catholique que Rome, plus française que Versailles. Indépendance missionnaire devenue culturelle, diffusion en Amérique du Nord des traits typiques canadiens-français : la religion catholique et la langue française.
La vision de Tardivel pose une constante qui sera rémanente de l'idée d'indépendance au cours du siècle : sa nécessité historique, qui fait abstraction de la volonté populaire. Dans Pour la patrie, «le personnage principal du roman est la main de Dieu. Le parti indépendantiste serait mené par la Providence et cette indépendance se ferait moins par l'action des hommes que dans l'attente de la volonté divine». Il ne sert à rien d'agiter ou de précipiter l'indépendance. Comme le dira Lionel Groulx en 1922, «c'est de la constance du péril suspendu sur notre existence française qu'a vécu la constance de notre "rêve" d'indépendance non pas le principe libéral des nationalités. De toute façon, les signes viendront de la Providence pour remplir la mission spéciale du "seul peuple catholique de l'Amérique au nord de la frontière mexicaine».
Pour justifier la volonté divine, il faut recourir à un réquisitoire anti-confédéral contre le Canada. C'est l'action la plus effective des indépendantistes, tel le jeune oblat Rodrigue Villeneuve pour qui «la Confédération n'a été en ce qui concerne nos intérêts nationaux qu'une banqueroute lamentable, qu'une déception humiliante et amère..., nous ne courons au-devant d'aucune séparation; nous n'accepterons que celles-là seules que nous imposeront la nécessité et les hasards de l'histoire, et contre lesquelles par conséquent ni les uns ni les autres ne pourraient quelque chose» (1922). Quiconque se souvient des échecs référendaires de 1980 et de 1995 y reconnaîtra-là les prophéties compensatrices post-traumatiques.
Face à l'idée d'indépendance s'est dressé le nationalisme pan-canadien d'Henri Bourassa. Ici, ce n'est pas la faillite autant que la Confédération est jugée un pacte injuste pour la minorité francophone et catholique : «Les Anglais ont voulu employer la Confédération à nous asservir, mais ils n'ont pas voulu de l'association égale avec nous». Le paradoxe est qu'au moment où l'abbé Groulx et «L'Action nationale» vont travailler à mousser l'affirmation nationale des canadien-français, Bourassa assomme littéralement l'idée d'indépendance du Québec d'«un trait de mentalité pour donner de la faisabilité de l'Indépendance; la "trop faible volonté" des Canadiens français, hier et demain».
On a peine à s'imaginer comment cette «trop faible volonté» a encouragé la haine de soi des Québécois au milieu des années 1930! Même Groulx n'y a pas échappé : «Les pires ennemis de l'État français, les plus hostiles à cette idée, vous pouvez déjà le constater, ce ne seront pas ceux que vous auriez pensés; ce seront vos propres compatriotes canadiens-français. Un long asservissement politique, puis national, nous a pliés, habitués à la servitude, a fait de nous une nationalité hésitante, pusillanime». Depuis près d'un siècle, les nationalistes québécois ne cessent de refouler cette haine derrière un optimisme qui ne repose finalement que sur cette «nécessité historique»; soit de la divine Providence, soit de l'effondrement d'un Canada matérialiste et incertain.
Que viennent les échecs référendaires de 1980 et de 1995, et vous voyez cette mesquinerie ressurgir chez les gouvernements qui ont «osé» défier la Providence : l'échec lamentable du second mandat du Parti Québécois sous Lévesque, qui s'achève avec «le beau risque» et la paranoïa du chef; celui du gouvernement Bouchard, qui conduit à l'hystérie politique du «déficit zéro», ont été payés par la population jugée trop «habituée à la servitude». Jadis et naguère, la vengeance des Indépendantistes floués s'est toujours défoulée sur ce peuple qui n'osait pas dire oui. Surtout à des questions si peu compromettantes qu'on hésite à les prendre au sérieux.
Mais la quebecer Selbsthaß domine surtout dans la vision fasciste de l'indépendance du Québec. On la retrouve formulée dans «La Nation», dirigée par Paul Bouchard entre 1936 et 1939 :
«Le fascisme, c'est l'application politique du corporatisme. C'est un idéal disciplinaire d'ordre, d'énergie, de dynamisme et de progrès dont nous avons éminemment besoin, nous que 175 ans de joug étranger et 100 ans d'avachissement démocratico-parlementaire n'ont cessé d'avilir et de dégrader, nous qui vivons sous le signe de la peur : peur de vivre, peur de s'affirmer individuellement, de trancher agressivement sur le voisin, de faire valoir âprement et victorieusement ses qualités natives, peur de vivre individuelle qui se traduit en une immense et pitoyable peur collective de vivre. Les [C]anadiens français sont devenus si lâches, si mous, si dévirilisés, si dégoûtantamment petit-bourgeois, qu'ils refusent l'idée de vivre en État libre, parce qu'ils ont peur de courir les risques et les aléas des sociétés libres; peur d'être obligés de défendre le territoire, peur de savoir ce qu'il adviendra d'eux si cette hypothèse chimérique inventée par leur esprit d'écœurante froussardise venait à se réaliser».
Comme le rappelle Lamonde un peu plus loin, «le groupe de La Nation est le seul avant 1960 à travailler à une "rupture" en faveur d'un "État libre français en Amérique"». Mais même au-delà de la période heureuse de l'idée d'indépendance, déplore-t-il, «la peur est une épistèmé de l'histoire des Canadien-français et des Québécois». Malgré son excentricité, P. Bouchard mettait-là le doigt sur une des sources indéniables du refus et des échecs de l'indépendance nationale.
Dans les années 1930, en effet, le corporatisme se retrouvait pratiquement dans tous les groupes de jeunesse et des revues nationalistes. C'était le cas des frères O'Leary de Jeune Canada, confrontés à la Crise de 1929. Si les «"Jeunesses patriotes" visent la création d'un état corporatiste canadien-français; il entend organiser les professions et les ouvriers contre les "trustards". Le mouvement est farouchement opposé au capitalisme et au libéralisme, tout autant qu'au communisme»; pour Dostaler O'Leary : «Sans vouloir en faire une loi pour notre pays, il est à remarquer que les véritables évolutions radicales sur le terrain économique ont été précédées d'évolutions non moins radicales sur le terrain politique. Montrons que la nation canadienne-français veut non seulement exister, mais vivre». L'indépendantisme se vendrait-il mieux avec le corporatisme?
 La
droite réactionnaire, qui avait enlevé le flambeau du nationalisme
des mains des traditionalistes, trouvait toutefois sa némésis dans un
nationalisme qui tendait davantage vers le gauche et qui annonce le
mouvement du RIN et du Parti Québécois première mouture. C'est
André Laurendeau qui, par un mélange judicieux d'humanisme, de
libéralisme et de nationalisme, brise avec l'indépendantisme
providentiel : «Ne vaudrait-il pas mieux, maintenant,
aider les événements?»
demandait-il à Groulx dès 1932? Pour Lamonde, «Laurendeau
esquisse un nationalisme moderne, actuel, mais toujours dans un
rapport au passé : "Nous brisons délibérément avec tout
"conservatisme", avec ce qui sent la vieille poussière des
musées historiques". Il évoque "le désir des innovations
fécondes qui ne détruisent pas la stabilité", la "tâche
qui incombe à notre génération" d'accorder "les vérités
éternelles avec notre temps et notre espace du monde"».
L'influence d'un Jacques Maritain n'était pas étrangère à cette
mouvance d'un nationalisme détaché de la vision maurrassienne.
La
droite réactionnaire, qui avait enlevé le flambeau du nationalisme
des mains des traditionalistes, trouvait toutefois sa némésis dans un
nationalisme qui tendait davantage vers le gauche et qui annonce le
mouvement du RIN et du Parti Québécois première mouture. C'est
André Laurendeau qui, par un mélange judicieux d'humanisme, de
libéralisme et de nationalisme, brise avec l'indépendantisme
providentiel : «Ne vaudrait-il pas mieux, maintenant,
aider les événements?»
demandait-il à Groulx dès 1932? Pour Lamonde, «Laurendeau
esquisse un nationalisme moderne, actuel, mais toujours dans un
rapport au passé : "Nous brisons délibérément avec tout
"conservatisme", avec ce qui sent la vieille poussière des
musées historiques". Il évoque "le désir des innovations
fécondes qui ne détruisent pas la stabilité", la "tâche
qui incombe à notre génération" d'accorder "les vérités
éternelles avec notre temps et notre espace du monde"».
L'influence d'un Jacques Maritain n'était pas étrangère à cette
mouvance d'un nationalisme détaché de la vision maurrassienne.
Pourtant, «aider les événements» ne voulait pas dire dans son esprit opérer un saut qualitatif définitif. Laurendeau hésite. La peur dont parlait Bouchard le saisirait-il? «Redécouvrons la vraie notion de l'homme. L'homme ne s'élève à l'universel que par étapes. Faite sauter un échelon s'élancer droit dans l'abstrait, c'est risquer de s'y perdre et fabriquer des idéologies en série. L'enfant n'apprend que par degrés l'existence du monde; il en prend conscience à mesure qu'il prend conscience de soi». Pour peu, on se croirait devant «l'étapisme» de Claude Morin! C'est ici que l'historien affiche sa problématique :
«Une question s'impose : comment et pourquoi le nationalisme traditionnel se dépouille-t-il de ses oripeaux pour renaître sous de nouveaux habits. Pour y répondre de façon détaillée et satisfaisante, il faut suivre parallèlement deux trames entre 1939 et 1959 : le déclin de ce nationalisme traditionnel, d'une part, et l'émergence d'un nationalisme dissocié de la religion et militant pour la laïcité d'une part. Telles sont les conditions de possibilité d'un indépendantisme et d'un souverainisme modernes, d'un projet de souveraineté à la hauteur du temps».
Pourtant, dans l'immédiat après-guerre, c'est encore l'esprit le plus radicalement réactionnaire – celui d'un Robert Rumilly – qui monopolise la question de l'indépendance. Devant les activités du Centre d'information nationale (1956-1962), le vieux nationalisme groulxien se révolte, comme il le dit dans une lettre de 1952 à François-Albert Angers :
«...on peut discerner chez nous des éléments d'un nouveau séparatisme, qui s'établirait sur de nouvelles raisons, toutes sérieuses – mais toutes déficientes sur un point essentiel : à savoir que le séparatisme, la coupure du Québec d'avec le reste du Canada, est une chimère, une irréalité, un rêve qu'on ne doit plus rêver quand on a passé la jeunesse. Les motifs économiques, techniques, politiques et militaires qui rendaient cet idéal difficile en 1920, le rangent aujourd'hui parmi les anachronismes».
Les deux dernières décennies de la vie du chanoine s'avèrent décevantes. Il ne croit plus aux possibilités d'un indépendantisme même à l'intérieur du Canada. L'autonomie provinciale, pratiquée par Duplessis, l'a discréditée comme vulgaire business politique. De plus, la jeunesse intellectuelle se porte désormais vers une restauration libérale. Comme le remarque Lamonde, chez lui, «l'intuition est remarquable : dans l'après-guerre, la critique du nationalisme est alors tout autant le fait d'une nouvelle revue, "Cité libre" (1950), que de la voix même du nationalisme traditionnel, "L'Action nationale" (1933), qui connaît une crise profonde au milieu de la décennie 1950-1959».
Car c'est surtout face aux «jeunes internationalistes» de «Cité libre» que Groulx «ironise en se demandant s'il faut, "sous le prétexte de tendre à l'universel", courir "le risque de n'atteindre qu'à l'impersonnel"»? C'était déjà, en 1958, la critique d'un multiculturalisme qui ne s'était pas encore défini et qui va devenir la politique des Trudeau, père et fils. «Ce barrésien impénitent», poursuit Lamonde, «trouve chez les Canadiens français "tous les symptômes d'un peuple qui manque de boussole intérieure, qui a perdu foi en son destin"; dans ce milieu où l'on a "galvaudé [...] la notion de nationalisme", "la plus dangereuse espèce d'hommes qui soit, [ce sont] les déracinés"». De là à penser à cette fameuse boussole dont François Legault espérait tant pour la Noël 2023...
C'est donc bien avant la Révolution tranquille que l'idée d'indépendance prend un nouveau jour avec «l'analyse concrète des objectifs et conditions de possibilité d'une Laurentie», effectuée par Raymond Barbeau dans sa revue «La Laurentie» (1957-1962). Située au-delà de la province et englobant les Franco-ontariens, la Laurentie s'affirme comme république autonome :
«Barbeau publie la Constitution de la république laurentienne en janvier [1960], précisant qu'elle est de même nature que le programme de la Judenstaat de 1896, publié par Theodor Herzl et qui va légitimer la création de l'État d'Israël en 1948. La Laurentie sera une république unitaire et chrétienne, "organique et corporative". Le français sera la langue officielle, son drapeau sera celui de Carillon et de ses fleurs de lys, son hymne national Ô Laurentie et saint Laurent sera son patron, fêté le 10 août. En seront citoyens tous les Laurentiens de naissance ou naturalisés dont les droits seront respectés. L'État y reconnaîtra l'Église catholique puis les autres confessions. La famille y sera conçue comme "groupe primaire, naturel et fondamental de la société" et les conjoints seront égaux eu égard à l'éducation des enfants...»
Avec Barbeau, on ne se contente plus de suggérer l'idée, mais on la concrétise organiquement, avec des institutions. Avec le manifeste de deux jeunes disciples de Barbeau, André d'Allemagne et Marcel Chaput, «observant l'affranchissement colonial partout, le manifeste affirme : "si la liberté nationale n'est pas une fin en soi, elle est la condition essentielle à tout épanouissement réel des hommes et des peuples..."» Ils font un pas de plus en fondant le premier parti politique nettement voué à l'indépendance, le Rassemblement pour l'Indépendance Nationale, le RIN (1962), ce qui est un saut révolutionnaire : «Historiquement, l'indépendance s'est construit contre l'esprit de parti, contre les partis traditionnels, contre l'électoralisme. Il a trouvé sa force en se situant au-dessus des partis. Lorsque la question de devenir un parti se pose au RIN, il s'agit d'une première aux effets inattendus».
Inattendus, car bientôt il y aura trois partis indépendantistes! De plus, inscrit dans la mouvance électorale, on passe de l'indépendantisme au séparatisme, «selon que l'on fait place à la chose ou qu'on la récuse». De leur côté, les fédéralistes de «Cité libre», avec Trudeau et Pelletier, voient «poindre à nouveau sous la pensée de la décolonisation et de l'anticolonialisme [le nationalisme honni]; c'est "aux intellectuels de gauche que le nationalisme doit sa résurrection" et ses nouvelles lettres de créance».
Cette nouvelle mouvance laisse perplexe les vieux nationalistes. André Laurendeau, «qui avait observé l'aube de ce renouveau indépendantiste, ne voit pas l'intérêt d'un "chambardement politique", [il] propose de "profiter pleinement du statu quo" et de "trouver la formule d'une collaboration où nous ne serons pas écrasés"». Pierre Bourgault, le second président du RIN, qualifie cette vision d'«irréaliste», répondant par «des commentaires pertinents : "Pas une génération, depuis trois siècles, n'a vécu collectivement, avec assez de dignité pour se mériter l'admiration et l'estime de la génération suivante". Il demande à l'autre "génération de réengager le dialogue avec nous, de nous faire part de vos expériences passées", de façon que nous n'ayons pas "à refaire tout le travail que vous aviez accompli et qui nous prend un temps précieux". Tout peut-il être cumulatif?». C'était mettre le doigt sur une tare profonde et morbide des Canadiens-français.
Comment expliquer ce saut qualitatif au tournant des années 1960? Comme on l'a souligné, Lamonde ne se satisfait pas d'une simple référence à la Révolution tranquille. Celle-ci n'a pas susciter la montée de l'idée, mais en est plutôt tributaire (par le slogan libéral «Maître chez nous» par exemple) : «On ne peut comprendre comment on passe de Robert Rumilly et Raymond Barbeau à André d'Allemagne et Marcel Chaput, de l'Alliance laurentienne (1957-1962) au RIN (1960-1968) si l'on ne saisit pas bien comment le nationalisme traditionnel se défait, se décompose devant l'urbanisation et l'industrialisation du temps de guerre et d'après-guerre». C'est le développement de l'idée elle-même, issue comme disait Maurice Blain, «d'une sublimation de la nation, assiégée, pessimiste, mais toujours triomphante. En effet, cette histoire est essentiellement providentielle et magique, qui consiste à mettre Dieu en demeure de sauver ce "petit peuple" perdu à chaque quart de siècle». Blain, pourfendeur du cléricalisme et militant pour la laïcité, ne pouvait se satisfaire du vieux déterminisme chrétien des indépendantistes d'avant-guerre.
L'échec à long terme de l'Indépendance nationale s'explique par son succès même durant les décennies 1960-1970. Si le passage de l'idée d'indépendance à des organisations institutionnelles politiques l'a tirée de sa sphère idéaliste, il en a fait toutefois une polémique partisane. Et il l'a fait également pour le fédéralisme. Nationalisme et fédéralisme se sont vidés de toute substance idéaliste ou transcendante. La Confédération devenait (ce qu'elle était) un contrat impérialiste et la nation un rétrécissement économique et social. Si le mouvement vers la gauche a voulu ressusciter un nationalisme selon le modèle de 1830, avec son ouverture généreuse, le retour du balancier vers la droite après la défaite référendaire de 1995 l'a conduit à s'encastrer dans l'étroite frilosité du bockcôtisme et d'un Parti québécois fossile-vivant de l'enthousiasme de 1976. On ne peut que souscrire à la conclusion de Lamonde : «À moins d'un élan révolutionnaire, violent ou pas, qui réussit – les cas de figure ne sont pas nombreux – ou d'une conjoncture vraiment facilitante, l'indépendance démocratique se fait toujours dans un état de société donné. Le projet même d'indépendance peut-il convaincre par lui seul ou ne faut-il pas lui agréger d'autres axes dont on voit que l'indépendance leur permettra une meilleure chance d'accomplissement?». Autant dire : s'il doit y avoir un jour indépendance du Québec, ce ne sera pas pour sa vertu, mais pour les intérêts corporatifs de quelques intéressés. Si l'idée naît du rêve, le rêve ne sera jamais rien de plus qu'une idée.
* Manifeste des jeunes, «L'Action Nationale» 1, 2 (février 1933).
LES TÊTES RÉDUITES
«Les têtes réduites» ou «Essai sur la distinction sociale dans un demi-pays» de Jean-François Nadeau est un essai que j'exposerais volontiers dans un cabinet de curiosités. Nadeau est connu comme journaliste, historien, mais surtout biographe d'Adrien Arcand et de Pierre Bourgault (excellentes), de Robert Rumilly (plus faible. Nadeau ne donne pas une analyse historiographique du sujet).
«Dans un cabinet de curiosités», parce que son essai aurait pu être écrit durant la décennie des années 1960, figurant en bonne position entre Les insolences du Frère Untel de Jean-Paul Desbiens, Le Canadien français et son double de Jean Bouthillette, et le couple Chalvin, auteurs d'un pamphlet vitriolique contre les manuels scolaires : «Comment on abrutit nos enfants». Le premier texte, «Un cadavre dans la bouche», donne le ton à l'ensemble de l'ouvrage. Nous y reviendrons, en attendant j'esquisserai une présentation générale.
Usant de l'écriture journalistique qui est la sienne, les essais contenus dans l'ouvrage sont construits comme des exercices de surf agréablement menés. Dans le second essai, «S'échapper de la fumée», il part de la mort du docteur Chénier à Saint-Eustache durant la Rébellion de 1837, puis passe à l'ex-politicien et journaliste Pierre de Bellefeuille, son collaborateur au journal «Le Couac» (ses funérailles se déroulent dans la même église d'où Chénier s'extirpa pour échapper aux flammes avant d'être abattu), à une ancienne actrice française déchue, enfin à «Charlie Hebdo» et à son ami personnel Charb. On voit la courbe. Par delà espaces et temps, les circonstances et les raisons, le caricaturiste mitraillé par les islamistes tend la main au Patriote fusillé par la soldatesque anglaise. Nos humbles vies ainsi s'entremêlent-elles entre ces grands événements qui ont le triste privilège de leur violence inouïe, comme si seule la violence pouvait accoucher de l'histoire.
Dans «Le lait au chocolat de Serge Bouchard», Nadeau part de la problématique du «transfuge de classe» posée par Rue Duplessis de Jean-Philippe Plau, pour s'arrêter à une comparaison physique entre le philosophe Charles Taylor et son ami chroniqueur, Serge Bouchard. Nadeau cherche à saisir combien la différence des origines sociales marque le destin des intellectuels québécois. Le texte qui suit, «Qui parle?», surfe plutôt sur la qualité du français au Canada en s'appuyant sur les écrits d'André Laurendeau et «Les insolences du frère Untel» : «Le monde de la belle parole paysanne se dégradait lorsqu'il tentait de s'envisager depuis une autre position que la sienne propre, affirme Laurendeau». Distinction politique et sociale dont les pourfendeurs du français paysan ne lui semble pas avoir conscience. Même inconscience de la part d'Anne Hébert, réfugiée à Paris et que le jeune Nadeau va interviewer dans son lointain exile; elle déprécie avec la même vigueur la parlure du Canada français, ce qu'avait déjà fait de façon méprisante Françoise Sagan («Anne Hébert ne parle pas de Hockey»)...
Comme on l'aura constaté, Nadeau ramène à l'avant-plan des thématiques socio-culturelles critiques des années 1960. Dès le premier essai déjà mentionné - «Un cadavre dans la bouche» -, il s'en prend à l'anti-intellectualisme duplessiste. La pierre angulaire du texte est une déclaration aussi stupide que célèbre du juge Antoine Rivard, un temps ministre du «Cheuf» et fils du célèbre auteur de romans du terroir, Adjutor Rivard : «les Canadiens français étaient les détenteurs d'un héritage de pauvreté et d'ignorance dont il leur fallait se féliciter, un héritage qu'il leur fallait voir à sauvegarder» avec, comme point de chute (en fait, la déclaration est tronquée et varie d'une citation l'autre, Nadeau ne parvenant à en identifier la source originale) : «L'instruction! Pas trop! Nos ancêtres nous ont légué un héritage de pauvreté et d'ignorance, et ce serait une trahison que d'instruire les nôtres». Si les mots varient, l'esprit reste le même.
Au départ, Nadeau s'acharne à infirmer l'anti-intellectualisme de Rivard. Il en tire une critique s'appuyant sur le colonialisme britannique, l'asservissement clérical catholique et le détournement des Canadiens français de la chose économique : «Au chapitre de l'histoire, Rivard refuse d'envisager les suites dramatiques de la mise en infériorité qu'a entraînée la Conquête anglaise de 1763. À ses yeux, ce peuple accroché aux rives du Saint-Laurent flotte tout bonnement en apesanteur sur l'Amérique. Il se constitue et se définit en vertu d'un devoir national indifférent au monde matériel, au nom d'une grande communion divine avec une religion et un clergé qui tiennent lieu d'État, peu importe que la Couronne britannique se soit imposée à lui. La persistance de cette nationalité de langue française s'explique par la volonté initiale des aïeux, qui, selon Rivard, n'ont jamais eu d'autre ambition que de "rester fidèles à leur foi, à leur langue, à leurs lois". "Notre infériorité économique, se félicite-t-il enfin, vient d'abord du fait que nous descendons de pauvres gueux qui ont voulu rester pauvres pour demeurer Français"».
«Jamais il ne lui viendrait à l'esprit de remonter à la source de cette mainmise de la langue anglaise sur l'univers social». D'un Rivard l'autre, Nadeau passe à l'essayiste Yvon Rivard (pas de liens de parenté, semble-t-il) qui, aujourd'hui, relaie l'apologie de la pauvreté telle qu'encensée par Antoine, un demi-siècle plus tôt : «Comment se réconcilier avec un tel passé? Yvon Rivard idéalise-t-il la notion éthérée d'une pauvreté atavique qu'il faudrait savoir accepter et embrasser? Sa vision du passé de sa société semble faire l'impasse sur le rôle d'une bourgeoisie qui a imposé ses vues, profitant d'une main-d'œuvre aussi corvéable que docile. Soumis à un tel régime le colon avait pourtant vite compris qu'il lui fallait "restreindre sa conscience à celle de son maître, et [...] abdiquer devant son pouvoir qui le rend fort à condition seulement qu'il le serve", comme l'explique Alain Deneault dans un essai vif et tonique. Dans cette société, le sens de l'État se confondait surtout avec le sens des affaires».
Voilà qui secoue bien des puces du Québec post-colonial, post-Révolution tranquille, post-référendaire. Au cœur de cet enjeu de la pauvreté : la langue. Antoine Rivard la voulait protéger de l'intrusion de l'anglais : «De toute façon, à quoi sert d'apprendre l'anglais? demande encore Rivard. À quoi cela peut-il rimer puisque la grande majorité de ses compatriotes sont destinés à occuper des emplois de manœuvre où la langue du maître leur est inutile? Oui, c'est bien ce qu'il dit...». Ce que vilipende Nadeau, c'est le fameux «né pour un petit pain» et le manque d'ambitions dans lequel on tenait les Canadiens français de l'époque. Sans oublier l'autre - «Je connais ma classe, je connais mon rang» -, qui, dans d'autres essais, spécifie la distinction sociale entre l'aristocratie des Hébert et des Saint-Denys Garneau et les Serge Bouchard prolétaire de l'autre. Nadeau s'identifie à ce dernier plutôt qu'à Taylor et aux Hébert/Garneau. Or, se demande l'essayiste : «L'aliénation était-elle inscrite au cœur même d'un projet éducatif qui avait pour fonction de construire des têtes instruites mais pourtant réduites?»
Pour anticiper une réponse à cette question, Nadeau rappelle l'histoire de l'enseignement au Québec : «Après la défaite aux mains des Britanniques, la langue française s'est pourtant trouvée à la merci d'un système politique qui lui était largement défavorable, en partie à cause d'un affrontement religieux entre catholiques et protestants. Aucune école française ne fut établie dans les années qui ont suivi la Conquête anglaise. De livres pour l'enseignement du français, répéterait-on souvent pour faire image, il ne restait plus à Québec qu'une vieille grammaire, utilisée en cachette par les Ursulines. En 1801, l'école a repris, du moins en anglais, mais placée cette fois sous l'égide de la puissance royale britannique. Les élèves y apprenaient, comme si la vie de tous les jours ne la leur enseignait pas déjà suffisamment, la culture des nouveaux maîtres. À l'heure des soulèvements de 1837, la fréquentation de ces écoles royales a pratiquement cessé. Leur nombre est passé de 85 à 5. Entre ces écoles royales et l'union forcée des deux Canadas en 1840, il y eut pendant un bref intervalle, les écoles d'Assemblée, plus démocratiques. Elles montraient au moins que la prise en main de l'éducation, mise au service de tous, était une chose possible».
Dans ce résumé paraît l'une des faiblesses d'historien de Nadeau. Comme lorsque dans un autre essai, il affirme, trop certain de sa mémoire, que «Miguel de Unamuno, cet essayiste espagnol favorable, à la fin de sa vie, à la mise en place d'un régime autoritaire dirigé par le généralissime Franco». Or, c'est tout le contraire. Unamuno, recteur de l'Université de Salamanque, fut à un doigt d'être trucidé par l'âme damnée de Franco, le général Astray, qui répondit à sa critique du coup d'État par son «Viva la muerte!» et que l'épouse de Franco dut l'envelopper de son manteau pour le soustraire à la vindicte soldatesque.M. Nadeau a décidément le défaut des approximations kantiennes.
 Ainsi,
il n'est pas besoin d'avoir lu les deux tomes de l'Histoire
de l'enseignement au Québec de Louis-Philippe Audet pour s'apercevoir des ellipses contenues dans
le paragraphe cité. Nadeau ne retient essentiellement que la
loi de 1801 de l'Institution royale et des écoles anglophones dont
les buts, rappelait Audet, pouvaient être contournés par les
francophones. De même, il omet l'âpre lutte entre l'école des
syndics et l'école des paroisses dans les années 1820. Lutte pour
la prépondérance politique sans doute, mais lutte aussi dans la
perspective d'une instruction publique qui ne se limite pas à la
seule religion et au français. Après 1840, on ne peut que
considérer les efforts du clergé de hausser le niveau des
apprentissages. À Saint-Jean, en 1855, le curé LaRocque, revenant
d'un voyage en Europe, ramena de France des livres, des globes
terrestres, des sphères ptoléméennes et des cartes géographiques
d'une valeur de 79 louis. En ayant emporté en trop, on redistribua
un globe terrestre dans chaque école de rang! De même, Antoine
Rivard peut bien dire des sottises, il n'en reste pas moins que des
écoles furent construites sous le gouvernement Duplessis; il finança
des laboratoires et le célèbre Jardin botanique de Montréal. À
côté du Frère André, Duplessis adulait le Frère Marie-Victorin.
Ainsi,
il n'est pas besoin d'avoir lu les deux tomes de l'Histoire
de l'enseignement au Québec de Louis-Philippe Audet pour s'apercevoir des ellipses contenues dans
le paragraphe cité. Nadeau ne retient essentiellement que la
loi de 1801 de l'Institution royale et des écoles anglophones dont
les buts, rappelait Audet, pouvaient être contournés par les
francophones. De même, il omet l'âpre lutte entre l'école des
syndics et l'école des paroisses dans les années 1820. Lutte pour
la prépondérance politique sans doute, mais lutte aussi dans la
perspective d'une instruction publique qui ne se limite pas à la
seule religion et au français. Après 1840, on ne peut que
considérer les efforts du clergé de hausser le niveau des
apprentissages. À Saint-Jean, en 1855, le curé LaRocque, revenant
d'un voyage en Europe, ramena de France des livres, des globes
terrestres, des sphères ptoléméennes et des cartes géographiques
d'une valeur de 79 louis. En ayant emporté en trop, on redistribua
un globe terrestre dans chaque école de rang! De même, Antoine
Rivard peut bien dire des sottises, il n'en reste pas moins que des
écoles furent construites sous le gouvernement Duplessis; il finança
des laboratoires et le célèbre Jardin botanique de Montréal. À
côté du Frère André, Duplessis adulait le Frère Marie-Victorin.
Plus juste la formulation du problème de l'élite canadienne-française face à l'Europe : «Dans "l'œil du maître", Dalie Giroux explique qu'à défaut d'être européen, ou du fait de n'être pas tout à fait européen sans être tout à fait autre chose, qu'"à défaut d'avoir une grande culture, ou du fait de tenir une succursale de la France en Amérique", on souhaiterait, quand on descend du colon, mais sans se l'avouer, "être un Autochtone, être comme les Autochtones", c'est-à-dire "pouvoir réclamer une appartenance, un enracinement millénaire". On voudrait, en quelque sorte, héritier d'une lutte claire et forte, d'une liberté, d'une identité politique propre, avance Giroux. Pourtant, le système d'éducation de ce demi-pays semble avoir eu pour mission de repousser les éléments susceptibles de nourrir sa plénitude, à commencer par sa créolité et sa nature américaine et sauvage. Le rêve d'un enracinement profond, d'une appartenance incontestée, ne s'y trouve pas incarné. Dans ces conditions, comment aller au bout de soi pour découvrir l'ailleurs et le partout en échappant à l'étouffante norme identitaire aujourd'hui promue de toutes parts par les réactionnaires?».
C'est alors que revient la figure de style de «l'apesanteur de l'esprit canadien-français», faisant «de meilleurs paysans que de meilleurs intellectuels», selon le mot de Laurendeau : «En se coupant de ses racines, le monde de la campagne, à en croire Laurendeau, se met à flotter dans les airs et à ressembler sans le vouloir à des ballons qui montent au ciel à tout vent, en désordre, avant de retomber, amollis, se dégonflant pour devenir flasques et informes, incapables de s'élever à nouveau autrement que dans des rebondissements au sol qui ne produisent aucune élévation réelle». Mais n'arrive-t-il pas à Nadeau de succomber, lui aussi, à la «Folk Society» qui projetterait les fantasmes des agents idéologiques dans la réalité factuelle, omettant tous les efforts de modernisation qui enthousiasmaient les cultivateurs des régions du Québec?
La réponse se trouve dans l'essai : «La parole de René Lecavalier, le silence de Maurice Richard». Formulé comme une vieille publicité de Provigo des années 1980, cet oxymoron baroque oppose une description détaillée de la carrière du commentateur des parties de hockey à Radio-Canada dans les belles années 1950-1970, et le mutisme du joueur de hockey, intimidé devant les micros au point de bredouiller ses phrases ...sauf celles où il affirmait soutenir Maurice Duplessis. Les deux Maurices, le cheuf et le rocket – un français joualisé et un anglicisme – qui font s'interroger Nadeau, après que l'entrevue accordée par le fils de Lecavalier, faite à partir de Los Angeles où il réside, fût tenue en anglais exclusivement : «Le langage épuré et l'élocution parfaitement maîtrisée qui ont valu à René Lecavalier une place au ciel de sa société ont-ils, comme la lune, une face cachée que révèle cette répudiation du français par son fils?».
«Les têtes réduites», au cœur du dernier essai, ce sont les modèles réduits, les timbres, les cartes de hockey de collection qui ont fasciné le jeune Nadeau avant que le temps ne passe et ne montre toute leur futilité, symboles de l'aliénation canadienne-française qui se passionnait pour ces compulsions à répétition névrotiques (reprises aujourd'hui par la loto). Le thème de l'aliénation est au cœur des essais de Nadeau, véritable symptomatologie des années 1950-1970 dont les échos se prolongent jusqu'à nos jours. C'est l'impression d'immobilité qui fait surface, au-delà des soi-disant bouleversements qui se seraient abattus sur la société québécoise depuis la Révolution tranquille.
Lorsque relatant sa rencontre à Paris avec l'autrice Anne Hébert, Nadeau observe : «Le garçon de café, parti quérir nos deux Schweppes, tient lui aussi un rôle auquel il se doit de correspondre, soit celui du serveur parisien qui force le trait de son personnage. N'en venons-nous pas tous, comme lui, comme Anne Hébert, comme moi, chacun à notre façon, à surjouer nos rôles sociaux, à un moment ou un autre, afin de nous assurer d'être conformes à notre personnage?». Cette remarque, profondément sartrienne – Nadeau évoque d'ailleurs le philosophe la page suivante -, ne ramène-t-elle pas à la méditation autour du garçon de café dans L'Être et le Néant?
«Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide, il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement, sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client, enfin le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres, sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes; il se donne la prestance et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s'amuse. Mais à quoi donc joue-t-il? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte : il joue à être garçon de café. Il n'y a rien là qui puisse nous surprendre : le jeu est une sorte de repérage et d'investigation. [...] Il est une "représentation" pour les autres et pour moi-même, cela signifie que je ne puis l'être qu'en représentation. Mais précisément si je me le représente, je ne le suis point, j'en suis séparé, comme l'objet du sujet, séparé par rien, mais ce rien m'isole de lui, je ne puis l'être, je ne puis que jouer à l'être, c'est-à-dire m'imaginer que je le suis. Et, par là-même, je l'affecte de néant». (Gallimard, pp. 99-100.)
Et tout le drame québécois se tient dans cette citation déterminante que Nadeau ne reprend pas mais à laquelle il fait implicitement allusion : nous jouons à être Québécois, à être des Québécois, à la manière du Elvis Gratton de Falardeau. Des Elvis ou les Patriotes, le cinéaste en faisait peu la distinction puisque le trouble reste le même derrière ces symptômes manifestes. Le garçon de café se ment par peur de se réaliser pleinement, et cette mauvaise foi ne fait que trahir sa peur d'exister librement. C'est le sens que Nadeau prête à tous ces déserteurs de l'américanité qui se sont réfugiés dans l'idéalisation de l'héritage européen (tant britannique que français); dans ce «racinien-toupin» radio-canadien «représenté» par une diction impeccable (mais morte) de René Lecavalier. Une génération plus tard, le rejeton de ce «grammairien» rompait avec la langue de son père et se précipitait au cœur du «global english» américain. Le prix de la désertion canadienne-française a été énorme à payer et nous nous apercevons aujourd'hui qu'il nous a été remboursé d'une monnaie de singe, symbolisée par ces timbres, cet argent de Monopoly et ces cartes de joueur de hockey sans valeur. «L'appareil d'État semble toujours être entre les mains d'individus dont la perspective culturelle se limite à l'idéalisation grotesque de figures à la mesure de leur vision étroite de l'avenir. Aussi en sommes-nous réduits, collectivement, à collectionner les symboles d'un succès qui nous échappe».
LE GRAND RÉCIT
Johann Chapoutot, historien de la culture nazie, sonneur d'alerte contre les partis européens d'extrême-droite et leur tendance à la fascisation, s'est fait voir et entendre au cours des derniers mois en Europe. Dans ce livre publié en 2021 pour le centenaire des Presses universitaires de France, il nous donne sa philosophie de l'histoire. Aussi, si le sous-titre du livre est «Introduction à l'histoire de notre temps», ne vous attendez pas à un étalage chronologique des grands événements du XXe siècle, mais plutôt à des considérations «métahistoriques» sur ce siècle.
Philosophie de l'histoire, Le Grand Récit nous rappelle que «notre espèce fabule sa vie individuelle et son existence de groupe, "le récit" étant selon le psychologue américain Jerome Bruner, "le fondement de l'identité". Il ne faut pas chercher plus loin, ou plus profond, ce besoin que nous avons de "nous raconter des histoires"». (p. 20) En effet, pourquoi écrit-on et lisons-nous des livres sur des périodes de temps si lointaines? Quel intérêt pour une époque qui carbure à la technocratie et au numérique?
Parce que nous restons des êtres vivants et donc mortels, inscrits dans les dimensions de l'espace et du temps. «L'historicité est cette inscription dans l'histoire, ce temps orienté vers la mort, ce lieu vectoriel de la finitude. Être historique, être doté d'historicité, d'une conscience de sa propre finitude, revient donc à avoir un problème avec le temps.» (p. 31) Mais plutôt qu'interroger cette historicité qui donne sens à son existence, «pour éviter de penser, penser sa misère, sa mort et, donc, sa grandeur, l'homme pense à quantité de choses superficielles et inutiles, aux affaires et aux jeux du monde, qui le divertissent, c'est-à-dire qui le détournent de son être mortel.» (p. 33) C'est donc dans l'ordre des choses que la société de consommation proclame la fin du Grand Récit, préférant s'arrêter à des fragments de textes, de connaissances et d'expériences, Chapoutot nous dit que sans de grands récits, nous ne pouvons saisir la portée de l'Histoire qui nous entraîne, incapables d'accéder au sens que l'écriture et la réécriture de l'histoire permettent : «L'histoire n'est donc pas une réalité brute, mais aussi, voire surtout, le récit que l'on en fait, à l'échelle individuelle comme à l'échelle des groupes et des sociétés, pour donner sens au temps, au temps vécu, au temps qui passe.» (p. 36)
Le but de l'ouvrage est ainsi résumé par l'historien : «Au rebours de l'opposition un rien abrupte entre discours et pratiques – les premiers relevant de l'analyse de discours ou de l'histoire culturelle, les secondes étant sous la juridiction de l'histoire sociale – ou de celle qui distingue histoire et "métahistoire", il s'agit d'entrer de plain-pied dans l'histoire de notre temps en voyant comment nos contemporains (et nous-mêmes) habitent le temps en tentant de lui donner sens.» (pp. 36-37)
Ce n'est pas sans raison que le premier chapitre porte sur la religion et l'Église catholique. Nietzsche avait annoncé la mort de Dieu. Le XXe siècle apprend à en faire le deuil. Et puisque l'homme a tué Dieu, il doit donc expier : «Difficile..., de ramener Dieu au cœur d'un monde qui, par le fer le feu, dans les orages d'acier1 de la Grande Guerre, puis dans les fours crématoires, les bombardements systématiques des civils et le feu nucléaire, est devenu le gouffre dantesque du mal. Que le monde soit devenu infernal, qui peut en douter au moment où les Alliés découvrent l'intensité et l'extension des crimes nazis, quelques mois seulement avant que le monde n'apprenne un autre impensable – la croissance à l'infini du pouvoir de dévastation de l'homme via l'atome?» (p. 55). Cette «infernalisation» du monde depuis les tranchées de Verdun ou de Vimy restreint le discours religieux. On a trop dit ce qu'était Dieu ou ce que Dieu voulait; on ne peut plus que parler la langue des mystiques, celle de la théologie négative qui ne peut pas dire Dieu mais seulement ce que Dieu n'est pas. Par les guerres et les révolutions, l'homme a dépouillé Dieu de sa Toute-Puissance : «La kénose, ce dépouillement du Dieu vivant qui se laisse porter en croix, flageller, mutiler et tuer comme un homme, est donc ce moment d'entrée du divin dans le temps, le moment de son historicisation, ainsi que l'écrit Hans Urs von Balthasar.2.» (pp. 61-62)
Le théologien protestant Rudolf Bultmann avait définitivement rompu l'image du Jésus historique de celui de la foi des apôtres et des martyrs.3 Les épreuves du régime nazi et de la Seconde Guerre mondiale ont ouvert à cette théologie négative de la kénose. Dans un entretien de 1981, Elie Wiesel4 affirmait qu'«après Auschwitz, sauvegarder une foi intacte sans la mesurer contre cette catastrophe est presque inhumain. On ne peut pas, aujourd'hui, simplement célébrer le judaïsme, ce qu'il représente, ce qu'il invoque, sans se tourner à la fois vers Dieu, pour Dieu et contre Dieu. Je pense que l'on peut être juif avec Dieu et même contre Dieu, mais non pas sans Dieu. Mais comment peut-on continuer à croire comme avant?» (cit. p. 63)
Déjà André Gide avait posé «la question de la littérature après Verdun, du récit après la Somme, en mettant en abîme la question de la création littéraire.» (p. 82) Le philosophe Theodor Adorno, pour sa part, affirmait qu'«écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes.»5 Le journal d'Etty Hillesum6, puis l'essai du philosophe Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz7 ont placé l'impuissance de Dieu au centre des faits historiques et l'aide que seuls les croyants pouvaient Lui apporter. Plutôt qu'une inhumation définitive de Dieu, c'est plutôt à une «re(con)naissance» qu'appelait la kénose moderne. Comme l'écrit le philosophe chrétien Jean-Luc Marion :
«L'économie des passions, leur maîtrise et leur étiologie, est une exploration classique de la philosophie moderne, centrée sur le sujet connaissant, agissant et pâtissant. Or "l'amour s'avère libre de la raison d'aimer ou de ne pas aimer [...]. Il obéit à un principe de raison insuffisante" et il "produit une logique propre, sans égal, sans précédent, sans condition". Il lui faut néanmoins "le temps de l'histoire pour médiatiser le rapport à l'absolu qui ne peut pas encore se médiatiser dans le présent"; il suit donc "la flèche temporelle de l'eschatologie" et vise un "accomplissement final" dont tous les caractères (gratuité, pauvreté, irrationalité) et le fait qu'il "transforme l'absence en présence, la pénurie en surabondance, la solitude en communion", montrent qu'il est gagé dans et par Dieu.» (p. 67)8
En fait, ce sont plutôt les promesses du Siècle des Lumières que le XXe siècle a tuées : «L'expérience atroce de la guerre est un désenchantement radical.» (p. 78) C'est du moins ce dont témoignent les littératures : «De toutes ces œuvres, on ne peut que conclure que la pensée catholique abandonne le terrain de la philosophie de l'histoire pour méditer sur les modes de présence du divin, se coupant sans doute par là d'une proposition de sens s'adressant à la très grande masse des contemporains en scellant la fin du providentialisme, au moins sur les vieilles terres du christianisme occidental.» (p. 68) La Providence, en effet, était une conception inspirée du déisme des philosophes à laquelle peuvent être associées des idées telles que le progrès ou du déclin. C'est ainsi qu'après la guerre, «la littérature, avec ses doutes, ses mises en question et ses difficultés, apparaît comme le lieu par excellence de ce savoir – celui de la finitude et de la mortalité des civilisations.» (p. 80)
Paul Valéry, en effet, avait ouvert la porte en 1919 avec son fameux avertissement : «Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortelles.» (cit. p. 70)9 Ce n'était plus, évidemment, de la mort de Dieu qu'il s'agissait, mais de celle de la civilisation des hommes. «Dans ce contexte, "c'est l'histoire qui est chargée de donner un sens à l'aventure humaine – comme les dieux. De relier l'homme à l'infini". Et l'histoire, c'est l'action de l'homme conscient et volontaire, désireux de marquer son temps et de repousser ainsi le terme de l'oubli : en répondant à "l'appel de l'histoire", il s'agit "de laisser sur la terre une cicatrice". [...] L'appel et le souffle de l'histoire sont là, couchés sur papier comme s'ils étaient appelés à être filmés "avec un ralenti de cinéma".» (p. 88)
Échappant des mains de la religion, où, sinon que dans la littérature et l'histoire, pouvait-on trouver le sens? «Être jeté dans l'existence, sans provenance ni destination, être radicalement indéterminé, être parfaitement libre, c'est-à-dire indéfini, tout en étant fini et perdu dans l'infini... Cela fait beaucoup pour une psyché humaine, qui doit pourtant se débrouiller avec tout cela.» (p. 91) La chose n'était pas simple. Il fallait psychologiquement réaliser qu'«il n'y a pas de dieu pour nous attribuer une essence; il n'y a pas de Dieu, donc pas de providence qui nous assignerait une place affectée d'une fonction à laquelle nous serions prédestinés de toute éternité.» (p. 96) Réaliser même que «notre naissance est une pure contingence, un pur surgissement, et n'a rien de nécessité ni de déterminé» (p. 96), n'était-ce pas l'humiliation absolue?
La vulnérabilité de l'homme l'a poussé vers une conception paranoïaque du monde. À l'ère du soupçon annoncée par Nathalie Sarraute10, on assiste, dès l'entre-deux-guerres, à l'explication par des causes obscures; à cette «causalité diabolique» dont parlait Léon Poliakov11 dans les années 1980. Cette action secrète opérée par des forces qui, dès l'époque hellénistique, avait déjà entraîné la Grèce puis Rome sur leur déclin. C'est cette philosophie de l'histoire nazie qu'a tant étudiée Johann Chapoutot :
«...ce qui a emporté Rome n'est pas la force armée d'un ennemi supérieur (les Grecs et les Romains gagnent toujours sur ce terrain, contre Darius, Xerxès ou Hannibal), mais la ruse chafouine d'un ennemi malin, qui prospère dans le demi-jour interlope des conspirations. Le "Juif Saul est devenu Paul", résume Hitler dans ses propos privés, comme le "Juifs Mordechai est devenu Marx" : Saul, le converti du chemin de Damas, est devenu le "commissaire politique" du judéo-christianisme, comme Karl Marx, petit-fils de rabbin, a donné son armature conceptuelle et son organisation au judéo-communisme. Vue ainsi, l'histoire prend sens et cohérence : Rome a été minée par les catacombes, et le Reich doit combattre avec radicalité un ennemi immémorial qui surgit toujours sous des apparences renouvelées, mais avec un objectif immuable : nier la supériorité germanique au nom de l'universalisme et de l'égalitarisme (chrétien ou marxiste), fédérer la lie des ratés, des tarés, des malades et des métisses contre l'élite germanique.
 Ce
récit est un opérateur d'intelligibilité redoutable, qui permet de
tout expliquer et de tout comprendre : la fin de l'Empire romain, la
guerre de Trente Ans, la Grande Guerre, la Révolution française, la
Commune de Paris, la Révolution bolchevique... Le récit de
l'Antiquité est en effet à la fois descriptif (une description
curieuse à nos yeux, mais qui n'était pas forcément délirante) au
regard de ce que l'on enseignait à l'époque un peu partout en
Occident et prescriptif : la fable est riche de normes que ce soit en
matière de procréation, de combat ou de règne impérial.» (p.
144)
Ce
récit est un opérateur d'intelligibilité redoutable, qui permet de
tout expliquer et de tout comprendre : la fin de l'Empire romain, la
guerre de Trente Ans, la Grande Guerre, la Révolution française, la
Commune de Paris, la Révolution bolchevique... Le récit de
l'Antiquité est en effet à la fois descriptif (une description
curieuse à nos yeux, mais qui n'était pas forcément délirante) au
regard de ce que l'on enseignait à l'époque un peu partout en
Occident et prescriptif : la fable est riche de normes que ce soit en
matière de procréation, de combat ou de règne impérial.» (p.
144)
L'hitlérisme avait une conception particulière de l'histoire, opposée même à celle de son voisin fasciste italien : «Le rapport au passé des fascistes, de Mussolini en premier chef, s'inscrit dans un temps ouvert, vectoriel, au rebours du temps circulaire fantasmé par les nazis, qui tordent ce vecteur et rendent impossible le passage du temps, cet axe de la déperdition du mélange, de l'épuisement. Les nazis illustrent pleinement cette "terreur de l'histoire" que Mircea Eliade12 identifie chez ceux qui veulent fuir le temps qui passe pour regagner le temps anhistorique du mythe.» (p. 150) Hitler refusait le deuil de Dieu avec, pour conséquence, une intériorisation paranoïaque du missionnariat :
«Tributaire de la culture catholique, Hitler développe une rhétorique fortement imprégnée de religiosité, dans une perspective instrumentale, purement formulaire, qui confine au pastiche et vise à séduire les croyants à la manière du joueur de flûte d'Hamelin : "Que notre Dieu tout-puissant veuille accepter notre œuvre en sa grâce, guider notre volonté, bénir nos projets et nous accorder la confiance de notre peuple", implore-t-il dans un discours radiodiffusé du 1er février 1933, qui inaugure la campagne électorale pour les élections du Reichstag prévues le 5 mars suivant, ou bien dans ce discours de campagne prononcé au Sportpalast de Berlin le 11 février 1933, qu'il conclut par un vibrant et cinglant "Amen!"...» (p. 157)
Nombre de dirigeants nazis étaient conscients de ce retour du religieux dans leurs cérémonies empreintes d'idéologies guerrières : «Le nazisme n'est pas la cause, mais la conséquence d'une crise spirituelle. Cette crise, qui s'est déployée au cours des siècles passés et, particulièrement, ces dernières décennies, est double - religieuse et spirituelle...» (cit. pp. 166-167), témoignait à son procès (1944) le Gruppenführer (en charge des Einsatzgruppen, «la Shoah par balles»), Ohlendorf. Il est difficile de ne pas voir dans le communisme stalinien ou l'isolationnisme américain des réponses similaires à cette crise spirituelle :
«Cette crise contemporaine du sens est à la fois une crise de la culture et une crise de l'expression littéraire, dont le premier lieu est l'Allemagne, "patrie des poètes et des penseurs" qui s'éprouve une fois encore battue, mais cette fois-ci largement détruite, aussi bien matériellement que moralement. L'histoire littéraire a pu qualifier le style et la production de l'immédiat après-guerre de Trümmerliteratur, de littérature des ruines...» (p. 171) Mais la littérature française n'a pas été exempte de cette Trümmerliteratur, par exemple, Marguerite Duras : «Dans Hiroshima mon amour (1959), titre oxymorique et scandaleux, il est dit et répété qu'il est "impossible de parler de Hiroshima. Tout ce que l'on peut faire, c'est de parler de l'impossibilité de parler de Hiroshima", car la "connaissance de Hiroshima" est "un leurre exemplaire de l'esprit".» (p. 180) Si on ne peut faire de la poésie après Auschwitz comment pourrait-on faire du roman après Hiroshima? «La parataxe durassienne, cette juxtaposition de mots mis en tas comme l'on entasse les pierres d'un édifice détruit par un bombardement, est signe que le langage est lui-même disloqué et détruit par la catastrophe, qu'il n'en sort pas indemne : il montre la crise de la littérature, la crise du langage qui ne peut plus nommer l'innommable dont l'humain s'est rendu coupable et montré capable.» (p. 181) Avant Duras, Joyce, avec la fin d'Ulysse, avait entrevu cette expérience du langage disloqué. L'Histoire lui a ajouté pour causalité les catastrophes.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'esprit paranoïaque s'est imposé dans l'ensemble de l'Occident puis - par la décolonisation -, dans le reste du monde : «Recherche des raisons secrètes, identification et dénonciation de causalité diaboliques : l'imaginaire du complot est à la fois intarissable et rassurant pour ses praticiens et partisans. Expression d'une mélancolie heuristique qui ne parvient pas réellement à faire le deuil d'une transcendance, fût-elle néfaste et maléfique, il est l'expression d'une nostalgie du sens, d'un sens cohérent, unifié et total – de préférence global. En somme, il constitue une herméneutique du pauvre...» (p. 208). Pour Chapoutot, il ne fait aucun doute que «la consubstantialité entre l'imaginaire complotiste et la sensibilité religieuse est patente : rien n'est accident, tout est nécessité; tout événement peut être rapporté à des causalités cachées; tout est lié.» (p. 227)
«Tout est lié», donc il faut frapper au cœur du sens de l'unité; après Dieu, il faut mettre la hache dans le Grand Récit dernier porteur de sens : «Nous sommes entrés dans un âge où "le savoir est et sera produit pour être vendu" (J.-F. Lyotard), et nous aurons avec lui le rapport "que les producteurs et les consommateurs de marchandises auront avec ces dernières". La connaissance, devenue information, aura une simple valeur d'échange, et non une valeur intrinsèque; le savoir "cesse d'être à lui-même sa propre fin, il perd sa valeur d'usage"...» (p. 244) Dans son essai de 1980, La condition postmoderne,13 le philosophe Jean-François Lyotard annonçait ainsi la mort du Grand Récit comme Nietzsche, un siècle plus tôt, celle de Dieu : «De cette décomposition des grands Récits..., il s'ensuit ce que d'aucuns analysent comme la dissolution du lien social et le passage des collectivités sociales à l'état d'une masse composée d'atomes individuels lancés dans un absurde mouvement brownien.» (cit. p. 246) Avec la fin du Grand Récit mourait l'universalisme humaniste de la bourgeoisie.
Finis les grands ensembles d'histoire universelle, mais aussi finie l'histoire nationale, finie l'histoire des cités et, pourquoi pas, la biographie? Lyotard encore : «Il me semble que les conceptions générales de la société ont abandonné l'idée d'une unité, d'une histoire universelle, de tout ce qui implique un modèle de prévision possible. Tout ceci – évident dans les sciences depuis la grande crise de la fin du dix-neuvième siècle – circule maintenant massivement dans le social.» (cit. p. 248) Mais Chapoutot voit bien que le besoin de sens est plus fort que la volonté de disloquer l'unité : «Si les grands récits hégéliens ont peut-être provisoirement disparu, le besoin de sens est demeuré et, avec lui, celui des récits, fussent-ils de petits récits ou, pour employer un terme anglo-américain qui s'est généralisé jusqu'à devenir commun sur les réseaux sociaux, de stories.» (p. 254) Mais les stories de Facebook ne sont que des fragments, non des unités.
Plus le monde apparaît incohérent et absurde, plus «la conversion et parfois la radicalisation de certains est aussi une crise du récit et une crise de l'avenir; comment "s'accommoder d'un monde capitaliste qui ne fait plus rêver" quand le "désir de reconnaissance est nié" et le "désir d'école éconduit", et qu'"il n'existe plus de projet alternatif au projet néolibéral" [F. Truong14], tout de violence social-darwinienne, de "projets" parcellaires et individuels, de simple déploiement de la force dans un espace désespérément immanent?» (p. 293) La nouvelle tâche de l'écriture de l'histoire serait, selon Chapoutot, de décoder ce récit unitaire, porteur de sens. Il en appelle à Ernst Cassirer15 pour qui, «l'histoire est "une branche de la sémantique" : "Ce sont les règles de la sémantique [...] qui constituent les principes généraux de la pensée historique. L'histoire s'inscrit dans le champ de l'herméneutique".» - «L'histoire apparaît dès lors bien autrement que comme une simple matière que l'on étudie ou comme un métier que l'on embrasse. Elle est une manière de lire et de vivre, d'habiter humainement ce temps qui nous est échu. Au sens le plus élémentaire, elle nous permet de nous tenir dans le temps.» (cits p. 304)
Se «tenir dans le temps» est sans doute l'enseignement fondamental en ce début du XXIe siècle : «Faire de l'histoire est donc un mode de vie, une forma vitæ singulière, motivée par un rapport au temps à la fois particulier et problématique, et par la volonté d'explorer ce rapport pour croître en humanité.» (p. 330) Devant les échecs du religieux à livrer un sens acceptable à un monde devenu infernal, il est important d'«étudier les possibles non advenus, ces réalités historiques demeurées à l'état de simple potentialité, [qui] permet de défataliser l'histoire, de couvrir le champ des possibles pour les acteurs du temps : au lieu de considérer, a posteriori, un déroulement clos et scellé, rapidement envisagé comme nécessaire, on rend aux acteurs leur marge d'indétermination et de liberté, de rêve et d'initiative. En un mot, on se fait meilleur historien car on ressaisit les contemporains dans l'univers d'appréciation et d'action qui était le leur : un univers de possibles ouvert, indéfini, où la liberté, la responsabilité et le choix ont bien davantage leur place que dans un récit clos. Conjointement, on évite de sombrer dans le piège de la téléologie, en considérant que tel événement ou développement était inévitable.» (p. 339)
Il y
a toutefois un danger à vouloir faire triompher définitivement la
contingence sur la nécessité. Le relativisme de l'histoire vise à
dénouer les déterminismes de l'historicisme du XIXe
siècle, comme lorsque «Herder,16
au XVIIIe siècle, prévenait les Lumières
françaises contre leur hubris : se concevoir à la pointe
avancée du temps, au sommet – provisoire – du vecteur du
progrès, entraînait une condescendance de mauvais aloi pour les
temps passés. Peut-être en sommes-nous encore là, à nous
gargariser de nos satellites et de nos moteurs, alors que la
Modernité est aussi, et peut-être surtout, la dévastation du
monde. Des ingénieurs, des managers, des gestionnaires et des
techniciens hydroponiques, de plus en plus hors sol, et voués au
bégaiement d'un éternel présent, serait-ce là l'idéal de notre
temps?» (p. 353) Voilà pourquoi le relativisme a conduit à une
fragmentation des temps qui, à l'image du Dieu de saint Augustin,
fait défiler toutes les époques devant notre regard, attendant
notre jugement, sinon notre condamnation. On sait le parti malsain
que les wokes en ont tiré.
L'essai, riche d'informations et de pensées s'achève sur de longues considérations sur la langue. Contre les wokes, Chapoutot est bien conscient du présentisme qui se substitue à la durée, une abolition du temps pour le seul moment actuel. La traduction langagière de cette posture malsaine apparaît lorsqu'il constate que...
«la langue de service n'est pas l'anglais en soi, bien au contraire, mais un usage spécifique de la langue, un usage servile qui vise la dénotation, l'immédiateté et le résultat alors que l'usage culturel fait toute sa place à la connotation, au temps et à la méditation. L'une est figée dans "le présentisme", celui d"'une certaine linguistique structurale qui a envahi nos manuels scolaires", alors que l'autre déploie toutes les dimensions du temps. Il faut y insister : l'usage culturel des langues n'est pas simple anamnèse de leurs états passés mais, grâce à la présence du passé, ouverture créative, et donc avenir : "L'usage culturel de la langue" est "un usage inventif, qui fait constamment renaître la langue à elle-même". L'histoire de la langue, avec sa littérature, est donc moins retour vers le passé comme on pratiquerait un art pour l'art, une piété antiquaire, que dilatation du temps au-delà de ce présent du codage informatique, de la "boîte à outils" politique, de la "boîte à idées" (think tank) des lobbies, du tuto(riel) ou du process managérial. Il y a l'icône unidimensionnelle purement dénotative, sur laquelle on clique, et il y a le mot, riche de ses états imaginatifs, de ses rêves et de ses promesses – en bref, de ses connotations.» (pp. 354-355)
Ce n'est plus le latin dégradé du Moyen Âge qui avait la prétention de conserver l'héritage de l'Empire. C'est une langue qui abolit le temps et par le fait même l'intelligibilité du langage. Ce qu'illustre la romancière Sandra Lucbert par «une langue jubilatoire, comment l'on passe de l'argent cristal à l'argent liquide, de l'entreprise localisée au capitalisme actionnarial, du capital immobilisé et captif à la bonne monnaie sonnante et trébuchante : la langue, rajeunie par le XVIe siècle, nous sort de notre hébétude managériale, des frimas des mots robotisés, d'une langue mécanique, où la pensée et la conscience n'existent plus, "parce-que-la-dette", où règnent les acronymes (les plans TOP, NeXT, ACT de France Télécom). Avec Rabelais, avec la littérature ou, plutôt, par l'acte littéraire, qui consiste, à tout le moins, à reprendre possession de la langue, à parler la langue, la ressource humaine redevient être humain, le "facteur travail" recouvre sa dignité, la "charge sociale" ou le "coût salarial" n'est plus un poids...» (pp. 362-363)
Pour Chapoutot, la littérature n'est pas seulement le salut de la langue au moment où celle-ci semble se déréaliser dans notre monde virtuel (les fake-news, la mythomanie, etc.), mais aussi, à travers le Grand Récit, le sens du monde, de la vie, pourquoi pas de l'univers? Questions trop longtemps jugées obséquieuses parce que posées pour la forme, mais dont le sens ne réside pas dans la réponse, mais plutôt dans le questionnement même.
Notes.
1Allusion au roman d'Ernst Jünger publié en 1920.
2Prêtre et théologien suisse (1905-1988).
3Bultmann (1884-1976) est l'auteur de Jésus : mythologie et démythologisation, préface de Paul Ricœur, Paris, Seuil, 1968.
4Elie Wiesel (1928-2016) philosophe d'origine roumaine ayant vécu l'expérience des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, il en a laissé des témoignages vibrants dont le plus connu est La Nuit. Émigré aux États-Unis, il y a mené une vie d'activiste afin de perpétuer le souvenir de l'Holocauste.
5Theodor W. Adorno (1903-1969), philosophe d'origine allemande, de tendance marxiste, il est connu comme l'un des fondateurs de l'École de Francfort qu'il amena avec lui lorsqu'il se réfugia aux États-Unis durant la période nazie. La citation vient de son recueil Prismes, Paris, Payot, Col. P.B.P. # 781, 2010, pp. 30-31.
6Esther "Etty" Hillesum (1914-1945). Une vie bouleversée, Paris, Seuil, Col. Points, # P29, 1995, pp. 175-176. De confession juive, Etty se convertit au christianisme. (Dimanche 12 juillet 1942) «Prière du dimanche matin. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu, oh, une broutille : je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir; mais cela demande un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus clair : ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider – et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque et c'est aussi la seule chose qui compte : un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte, c'est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes, un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous».
7Hans Jonas (1903-1993). Philosophe allemand. Le concept de Dieu après Auschwitz, Paris, Rivages, Col. Petite Bibliothèque, 2022, 92 p.
8Citation tirée de J.-L. Marion, propos recueillis par Michaël Fœssel et Olivier Mongin. Esprit, juillet 2009, pp. 11, 12, 13.
9Le mot de Paul Valéry (1871-1945) est tiré de La crise de l'esprit (1919).
10Nathalie Sarraute (1900-1999). Femme de lettres française. L'ère du soupçon (Gallimard) date de 1956.
11L. Poliakov. La causalité diabolique, 2 tomes, Paris, Calmann-Lévy, Col. Liberté de l'esprit, t. 1, 1980, t. 2, 1985. Les deux volumes sont aujourd'hui publiés en un seul.
12Chapoutot fait référence ici au livre de Mircea Eliade. Le mythe de l'éternel retour, Paris, Gallimard, Col. Idées, # 191, 1969. La «terreur de l'histoire» est le titre du chapitre IV, le dernier, pp. 163 sq.
13Jean-François Lyotard (1924-1998). La condition post-moderne. Rapport sur le savoir, Paris, Éditions de Minuit, Col. Critique, 1970, 113 p.
14Fabien Truong. Sociologue français, chercheur sur la jeunesse des banlieues.
15Ernst Cassirer (1874-1945). Philosophe allemand naturalisé suédois. Essai sur l'homme, Paris, Éditions de Minuit, 1975, pp. 246-251.«C'est cette "palingénésie", cette résurrection du passé, qui caractérise et distingue un grand historien. Friedrich Schlegel appelait l'historien einen rückwärtz gekehrten Propheten, un prophète du passé. Il existe aussi une prophétie du passé, une révélation de sa vie cachée. L'histoire ne peut prédire les événements à venir; elle ne peut qu'interpréter le passé. Mais la vie de l'homme est un organisme dans lequel chaque élément implique et explique chaque autre. Une nouvelle compréhension du passé nous donne donc en même temps une nouvelle perspective du futur, laquelle à son tour stimule la vie intellectuelle et sociale. L'historien, pour ce double regard sur le monde, de prospection et de rétrospection, doit choisir son point de vue. Il ne peut aller au-delà des conditions de son expérience actuelle. La connaissance historique est la réponse à des questions bien déterminées, une réponse qui doit être donnée par le passé; mais c'est le présent, nos intérêts intellectuels actuels et nos besoins moraux et sociaux actuels, qui posent et qui dictent les questions.» (pp. 250-251)
16Johann Gottfried (von) Herder (1744-1803). Philosophe allemand de l'histoire, d'abord rival de Kant, il représente le mouvement Sturm und Drang qui annonce le romantisme du XIXe siècle. Ce qui l'opposait à l'Aufklärung apparaît dans un premier traité, Une autre philosophie de l'histoire, 1774, (Paris, Aubier-Montaigne, col. Bilingue, s.d.). Herder s'y montre novateur dans la mesure où il pose les catégories ethno-culturelles comme fondements du développement historique. Sans rompre avec son approche, il rejoint Kant dans un second traité, Idées pour la philosophie de l'histoire de l'humanité, 1784-1791, (Paris, Aubier-Montaigne, - édition incomplète -, 1962), où la prise en compte des mœurs joue un plus grand rôle et en font un des fondateurs de l'anthropologie. Les ouvrages de Herder véhiculent des visions organicistes de l'Histoire qui influenceront les auteurs romantiques : de Mme de Staël jusqu'à Spengler, en passant par Nietzsche et Wagner, évidemment.
LE DESTIN DU QUÉBEC
Je viens de terminer probablement le livre le plus déprimant qui m'ait été donné de lire. Le livre testamentaire de Claude Corbo, Le destin du Québec Trois axes d'une histoire. Philosophe passionné d'histoire, professeur de sciences politiques à l'UQAM dans ses belles et jeunes années, il en a été par la suite recteur. Selon les vœux de l'auteur, son livre s'adresse à la jeunesse et il le dédie plus spécifiquement à ses deux petit-fils.
Ce livre est aussi lourd qu'une tragédie grecque – pas même ces plages d'humour dont Shakespeare savait essaimer tout au long de ses pièces -, et le terme de destin évoque effectivement ce grand thème des tragédies antiques. Corbo développe la trame de l'histoire de la nation québécoise en l'articulant autour de trois axes : l'axe démographique, l'axe politique et l'axe comportemental. Ces trois axes sont en fait trois divinités qui se jouent de la nation québécoise comme les trois déesses du sort de Troie. La nation québécoise se trouve prise ainsi au centre d'une aporie insoluble à la croisée de ces trois axes.
Corbo présente Le destin du Québec comme un livre lucide, bien qu'il peut susciter un sentiment de démoralisation chez ses lecteurs. En épilogue, il se plaît à se revendiquer d'une phrase d'Antonio Gramsci : «...je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté». Sa démarche scientifique fait honneur à sa formation, évitant de se laisser entraîner dans un lyrisme délirant ou geignard comme tant d'autres ouvrages du genre. Méthodique, l'auteur n'hésite pas à multiplier les tableaux chronologiques ou thématiques, voire même à répéter des conclusions encadrées en gris pour que le lecteur ne s'égare pas et puisse suivre le chemin de sa réflexion. Et, en effet, on ne s'égare pas, car si nous piétinons dans une même zone délimitée de la conscience nationale, l'auteur finit par nous amener là où il voulait.
Tout le destin du Québec tient en fait dans cette contradiction entre la décroissance démographique de la minorité francophone du Québec et le resserrement de la condition québécoise dans les mailles, toujours tissées plus serrées du fédéralisme canadian. Corbo utilise même le thème foucaldien «d'enfermement», qui donne l'idée d'une nation québécoise prisonnière du fédéralisme depuis le rapatriement de la Constitution en 1982, jusqu'à l'asphyxie de toute velléité indépendantiste par la loi sur la clarté référendaire de 2009, par laquelle le gouvernement fédéral édicterait seul les conditions autorisant la sécession d'une province (en fait, du Québec). À partir de ce moment, même si la régression démographique des francophones allait s'accélérant, il deviendrait impossible de répondre aux exigences édictées par le fédéralisme pour accéder à l'indépendance. Même avec un Oui fortement majoritaire, toutes les règles politiques et juridiques sont déjà disposées afin d'empêcher l'accomplissement de cette «sécession». La nation québécoise, comme le héros tragique grec, se verrait maintenant condamnée à accomplir son destin fatal jusqu'au bout.
Corbo fait des efforts répétés pour rappeler que ce qu'il nous raconte ne relève pas (tant) de son humeur que des faits, des documents et de ses observations liées à son engagement depuis les années 1950, et son honnêteté ne saurait être mise en doute. Nulle digression littéraire. Seulement l'exposé dru des faits, des documents et de ses observations, et c'est sans doute ce qui rend la réception de ce livre si éprouvante. On ne peut le prendre en défaut. À moins de s'abandonner à ce que Corbo appelle l'axe comportemental, c'est-à-dire à toutes ces illusions – illusions perdues – que la nation québécoise se donne à rêver d'une troisième voie : celle de la volonté réformiste de l'appareil gouvernemental fédéral des libéraux québécois nationalistes. Ou le destin du Québec s'achèvera comme «pittoresque communauté linguistique régionale» perdue dans une mer multiculturelle avec l'anglais comme lingua franca, ou par une quelconque action d'Athéna par laquelle la nation québécoise obtiendrait son émancipation. Mais Corbo, contrairement à Eschyle, ne croit pas aux interventions divines.
Surenchérissant la dimension tragique de sa vision, Corbo nous rappelle que dès le milieu du XIXe siècle, le sort de la nation québécoise avait été entrevu par deux esprits exceptionnels, le Français Alexis de Tocqueville et l'Anglais John George Lambton 1er comte de Durham. Corbo n'a jamais dissimulé son admiration pour Tocqueville, sur lequel il a écrit un livre : «Tocqueville chez les perdants» (2016) – les perdants, ai-je besoin de le souligner, c'étaient nous-autres, alors que les Voisins du Sud sont les gagnants -, de même qu'il s'efforce d'émanciper la figure de lord Durham de cette démonisation dans laquelle les nationalistes québécois le tiennent. Comme des veilleurs annonçant le drame qui va se jouer sous les yeux des spectateurs, ces deux esprits aguerris de leur époque percevaient déjà le long cours du développement qui adviendrait de la nation québécoise, prise entre sa fragilité démographique et la mainmise d'une tyrannie coloniale sur son développement. Entre ces deux forces, il lui serait difficile de trouver un espace suffisant de liberté pour asseoir sa volonté.
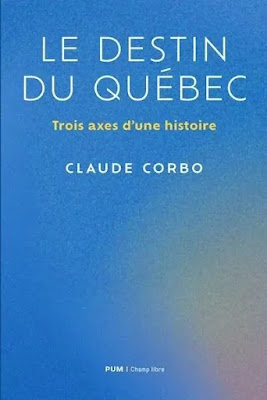 Depuis l'échec des Rébellions jusqu'à
nos jours, la nation québécoise n'a cessé de louvoyer entre un
raidissement de l'emprise coloniale (de Londres ou d'Ottawa) et une
démarche autonomiste toujours déjà condamnée à l'échec (Honoré
Mercier, Maurice Duplessis, Daniel Johnson, Robert Bourassa ou
François Legault). Comme l'assimilation se révèle aussi impossible
(George-Étienne Cartier dissuadant John A. Macdonald de l'union
législative fédérale) que l'indépendance (le double échec
référendaire), le destin de la nation serait ainsi scellé d'une
disparition annoncée, «prostrée», comme l'auteur le dit,
«dans un provincialisme ratatiné racorni et sans avenir»
(p. 223). Ce style rompu revient à quelques reprises dans l'ouvrage,
seules échappées d'humeur du professeur Corbo.
Depuis l'échec des Rébellions jusqu'à
nos jours, la nation québécoise n'a cessé de louvoyer entre un
raidissement de l'emprise coloniale (de Londres ou d'Ottawa) et une
démarche autonomiste toujours déjà condamnée à l'échec (Honoré
Mercier, Maurice Duplessis, Daniel Johnson, Robert Bourassa ou
François Legault). Comme l'assimilation se révèle aussi impossible
(George-Étienne Cartier dissuadant John A. Macdonald de l'union
législative fédérale) que l'indépendance (le double échec
référendaire), le destin de la nation serait ainsi scellé d'une
disparition annoncée, «prostrée», comme l'auteur le dit,
«dans un provincialisme ratatiné racorni et sans avenir»
(p. 223). Ce style rompu revient à quelques reprises dans l'ouvrage,
seules échappées d'humeur du professeur Corbo.
Il va sans dire que ce ton ne prête pas à l'enthousiasme de la jeunesse qui, en ces heures sombres, a besoin plus d'espoir que de leçons de découragement. Je crains que ses petit-fils, à la lecture du livre, ne se résignent à s'abandonner à l'anglais et devenir de «proud Canadians». Je veux bien du stoïcisme qui nous dit de maintenir une tenue de dignité à l'orée de la mort, mais ce stoïcisme ne se confond pas avec l'amertume d'un destin raté. Nous pouvons bien nous écrier : «Nous sommes tous des ratés»; que «nous avons raté notre vie», cela ne relève plus de la lucidité, mais d'une complaisance masochiste qui ne fait que donner toute sa légitimité au sentiment d'échec.
Le défaut provient à mon avis que l'auteur limite la notion de destin à la complexité constitutionnelle de l'État québécois. Corbo associe la fatalité du destin québécois par son assimilation à la structure du fédéralisme canadian. La dissolution du fait minoritaire français dans le multiculturalisme à la Trudeau père et fils, où bientôt tous les dialectes asiatiques, hindi ou mandarin, repousseront le français loin derrière, fera en sorte que le bilinguisme des «peuples fondateurs» ne signifiera plus rien. Il y a toujours, en sourdine, une tentation complotiste dans la narration historique de Corbo. Sans doute moins simpliste que celle que l'on retrouve chez Normand Lester, car beaucoup plus subtile. Mais elle est là pour qui sait l'entendre.
Je l'affirme avec autant de lucidité que Corbo en met à démontrer l'impossible solution sinon que par l'Ou bien ou bien de Kiergegaard. Dans ce vaste assemblage de textes, le philosophe danois opposait la vie esthétique à la vie éthique : la séduction fédéraliste (le Canada comme milieu protecteur de l'épanouissement de la nation québécoise) au choix éthique par la volonté de s'auto-réaliser, de s'auto-déterminer. C'est ce dilemme cornélien que Corbo pose aux Québécois. La troisième voie – celle des illusions – étant irrémédiablement discréditée, tant il fait la démonstration historique qu'elle n'existe pas. Évidemment, dans l'alternative proposée par Kierkegaard, il est possible de choisir le maintien de l'éthique plutôt que de succomber à la séduction. La chose apparaît impensable dans le cas québécois. La séduction du fédéralisme et l'illusion du réformisme se ligueront toujours contre l'option éthique de la souveraineté.
Au trois quart de son ouvrage Corbo évoque les droits collectifs lorsqu'il écrit : «Cette province appartient de plus à un pays qui confère aux droits individuels la primauté par rapport aux droits collectifs, ce qui amène à combattre toute volonté de la nation québécoise de prendre les moyens juridiques pour affirmer son propre droit à imposer le français sur son territoire» (p. 317). Il n'est pas sans ignorer que la notion de droits collectifs a été mis sous le boisseau après les monstruosités qu'ils permirent sous les fascismes et surtout sous le nazisme (les lois de Nuremberg de 1935). Les droits collectifs sont antithétiques pour le libéralisme, mais ne pas les reconnaître ouvertement ne signifie pas qu'ils n'existent pas.
Au Canada de Justin Trudeau, les droits collectifs – dit aussi droit historique dans le cas des nations - ne sont reconnus que pour les Premières Nations, et pour cause, elles sont plusieurs et jamais une. Elles ne forment pas un tout unifié qui menacerait l'intégrité territoriale de la domination canadienne. On compte autour de 630 communautés de Premières Nations réparties d'un océan à l'autre qui peuvent s'avérer autant de cauchemars pour chacune des provinces et l'État fédéral lorsqu'elles s'opposent à des projets de développement. Par contre, il n'y a qu'une nation québécoise, avec son territoire provincial unifié, sa langue dominante, sa culture ouverte, ses institutions de droit, mais aussi avec des revendications capables de couper le Canada en deux. On comprend qu'à elle seule elle soit un réel problème significatif, d'où l'importance de ne pas lui reconnaître ce qu'on reconnaît facilement aux Premières Nations. Reconnaître la nation québécoise, comme le fit la Chambre des Communes sous Stephen Harper, ne signifie pas reconnaître qu'elle a des droits collectifs. Elle ne reconnaît pas plus à la majorité anglophone ces mêmes droits. Elle n'a pas besoin de le faire dans ce cas, les Canadians, par le nombre, s'assoyant sur ces droits.
Car ces droits, ils existent aussi pour la majorité anglophone, fondés par le fait de l'immigration britannique provenant de la Révolution américaine. Ce sont les Loyalistes de 1776 qui ont fondé le droit historique de la majorité anglophone d'aujourd'hui et non la cession de 1763. Avant leur arrivée, le nombre de Britanniques dans l'ex-Nouvelle France était dérisoire. De même, c'est le refus de s'engager dans cette Révolution qui fonde le droit historique de la minorité francophone, car en ne s'engageant pas dans cette rébellion, la nation québécoise a rendu possible la Confédération des colonies britanniques en Amérique du Nord en 1867. C'est bien par le refoulement de ses droits dans l'inconscient historique que la majorité anglophone peut refuser ces mêmes droits à la minorité francophone. Pour la première fois d'ailleurs, ils ressurgissent à la conscience canadian face à la menace que profère le gouvernement Trump d'annexer «the true north»! Mais, dans la logique de l'atomisation libérale par le multiculturalisme, l'utilisation des droits individuels ne sert politiquement qu'à nier les droits collectifs, d'une part parce que la majorité anglophone la dissimule sous son siège; d'autre part, parce que n'étant pas codifiés, les droits historiques de la minorité francophone sont «sans histoire et sans littérature».
Après un tel réquisitoire contre le fédéralisme canadien et un plaidoyer pour la survie de la nation francophone québécoise, il est difficile d'ajouter une conclusion heureuse ou optimiste. L'optimisme de Corbo est joyeux comme une pluie de novembre. Pour encourager notre volonté de résistance à l'inexorable, il en appelle à la résurrection linguistique des Premières Nations encouragée par le gouvernement fédéral. Il ne voit pas – ou fait semblant ne pas voir – que ces encouragements ne sont qu'une stratégie symbolique de «réconciliation» avec les peuples autochtones qui, tout en réapprenant leurs langues, manquent cruellement, dans certaines régions, de services d'aqueduc. C'est précisément parce qu'elles ne formeront jamais plus que 630 «pittoresques communautés linguistiques régionales» que ces langues ne représentent pas une menace pour le Canada. Ottawa peut donc se permettre de leur accorder (presque) tous les droits historiques qu'elles pourraient revendiquer! Ces efforts invitent même à se réinterroger, dans la mesure où s'ils n'en venaient pas à reproduire l'esprit des zoos humains du siècle dernier, mais en renvoyant les espèces dans leur milieu naturel.
Une telle comparaison est négative pour les Québécois et la langue française, cette dernière demeurant malgré sa régression une langue universelle et non une langue culturelle dans laquelle seul un groupe ethnique restreint peut échanger. On ne doit pas considérer l'usage de la langue française au Québec comme une langue paroissiale. D'autre part, se féliciter que même en utilisant la langue française, les Québécois ont pu opérer des merveilles au niveau économique et financier – le coopératisme du Mouvement Desjardins; la Banque Nationale; la caisse de dépôt et placement du Québec, l'Hydro-Québec. -, ou de grandes entreprises à vocation industrielle (Bombardier) ou commerciale (Agropur, Air Transat, Renaud-Bray ou Aliment Couche-Tard), ne font que démontrer que les Québécois ne sont pas plus tarés que les Canadians en matière d'entrepreneurship. Terminer par contre sur l'espoir mis dans l'industrie touristique au regard de la disparition annoncée, nous ramène à un zoo humain québécois où il devient possible de se promener dans la Grande Tribu en la prenant en selfies dans son milieu naturel.
J'ai mentionné plus haut que l'erreur de Corbo consistait à limiter le destin de la nation québécoise à son aporie constitutionnelle. J'avais dit, il y a de cela bien longtemps à un ami qui venait d'apprendre qu'il était porteur du VIH (aujourd'hui décédé) que la différence entre lui et les autres, c'était que la mort se profilait à ses yeux alors que pour les autres, dans leurs certitudes existentielles, nous nous refusons de la voir devant nous. Car sa mort n'était pas plus près de lui que la mienne ne l'était de moi. C'est que par sa condition, il ne pouvait plus la dérober à sa vue, contrairement à moi, à nous. Corbo, toujours à cause de l'aporie constitutionnelle, voit la fin de la nation québécoise se profiler à l'horizon :
«Les nations, comme les individus, meurent. Mais si la nation québécoise se laisse aller passivement, parce que sans vraiment le vouloir explicitement, au choix de demeurer dans le cadre du Canada, il est approprié et légitime de lui faire comprendre qu'elle devra entrer dans la mort les yeux ouverts, forcée de reconnaître lucidement son choix mortifère ou, plus précisément, d'assumer en pleine conscience son refus de choisir sa survie».
Cette affirmation par la négative est caractéristique de la mentalité propre aux années 1950-1970 qui dissimulait derrière l'apparent optimisme de la Révolution tranquille, une démoralisation sourde qui ressort aujourd'hui face à la gravité de la situation de l'éventuelle survie de la nation québécoise francophone. Le revers de cette affirmation, positive cette fois, se retrouve à la fin d'une pièce de Shakespeare, «Le Roi Jean» :
Cela, beaucoup d'autres nationalistes le perçoivent désespérément mais s'obstinent, à grands coups de gueules, à en écarter le spectre. Comme des obsessifs-compulsifs, ils répéteront la pantomime référendaire pour en arriver aux États-associés proposés par la Souveraineté association. Or ici, je me demande si Corbo ne succombe pas à son tour aux «illusions» qu'il dénonce chez les fédéralistes-nationalistes, libéraux ou caquistes? Comme si ces États-associés, qu'ils jugent en principe égaux entre eux, ne reprenaient pas sous une autre forme un réformisme constitutionnel, une sorte d'AANB 2.0. Après tout en 1995, quand l'État québécois souverain se montrait prêt à accepter de partager avec l'État canadien la même monnaie, les mêmes douanes, la même armée, les mêmes services de télécommunication, que restait-il d'une indépendance pleine et entière?
Si Corbo a raison de rappeler qu'aucune nation n'est éternelle car, comme les individus, les communautés humaines passent, le drame survient lorsqu'elles passent sans ne rien laisser derrière elles. Il y a là deux choses différentes. Le fait de passer, mais surtout l'absence de legs, ce qui est l'obsession de la plupart des créateurs québécois : la hantise de voir leurs œuvres disparaître avec la nation où elles sont nées. Car en effet, Athènes, Rome, les royaumes médiévaux ont passé mais ils vivent toujours dans notre monde, plus d'un demi-millénaire après leur disparition. C'est au niveau de la pensée, de la créativité, que les Grecs, les Romains et les Médiévaux survivent encore même au cœur de nos apories. Cette survivance est la démonstration même que leur destin ne s'est pas limitée à la Constitution d'Athènes, à la République romaine ou à la Res Publica Christiana.
Corbo est comme ce vieux bibliothécaire du Shah dont parlait l'historien Lucien Febvre dans ses Combats pour l'histoire : «Le monarque, à la dernière minute de sa vie, aurait tant et tant voulu apprendre toute l'Histoire... "Mon prince, lui dit le sage vieillard, mon prince, les hommes naissent, aiment et meurent"». La vraie fatalité, c'est lorsque l'historien se contente de cette réponse laconique comme si elle était le point final à toute destinée. C'est refuser alors de «s'abandonner au mystère», comme le suggérait l'aumônière dans le film de Denys Arcand, Les invasions barbares. C'est dans ce mystère, probablement, que Gramsci s'abandonnait pour palier à sa raison pessimiste. Car c'est au-delà de ce cycle insignifiant que commence tout le reste.
Jean-Paul Coupal
LE BOULEVERSEMENT DU MONDE
La réédition en format poche du Bouleversement du monde de Gilles Kepel est beaucoup plus qu'une simple réédition. C'est un tout nouveau livre. Synthèse de deux livres précédents (Holocaustes : Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident et Le bouleversement du monde : L'après 7 Octobre*), il contient des réflexions inédites et poursuit le récit jusqu'à l'entrée en fonction de Donald Trump à la présidence des États-Unis, en janvier 2025. Kepel ne fait pas que mettre à jour les suites du massacre de plus de 1 210 Israéliens lors de la «trance-music» de la «Tribu de Nova», par quelque 3 000 jihadistes des brigades Ezzedine al-Qassam du Hamas, ordonné par leur chef Yahya Sinouar (tué depuis par les forces israéliennes), c'est un véritable ouvrage de philosophie de l'histoire que nous soumet l'auteur; comment cet événement tragique aurait fait basculer définitivement l'image des rapports du monde – un bouleversement – qui nous forcerait à reconsidérer les rapports du monde au XXIe siècle.
Chercheur émérite, auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen Orient musulman depuis près d'un demi-siècle, Kepel, bête universitaire, s'efforce d'être envers ses lecteurs comme il est, en tant que professeur, envers ses étudiants : «Tout au long de mes enseignements à l'université, j'ai essayé de transmettre des éléments de connaissance pour forger l'esprit critique des étudiants afin qu'ils puissent s'en servir ultérieurement comme ils l'entendraient. Mais aujourd'hui, cela n'est plus de mise : le wokisme est hostile à l'élaboration des grands récits,** c'est-à-dire aux mises en perspective déductives. Cette démarche intellectuelle est désormais vilipendée comme un acte de violence symbolique exercé par le "mâle blanc dominant", et donc illégitime. On exige de se situer dans la parcellisation, la division à l'infini de la société et de ses individus, pour aboutir à ce que Freud nommait "le narcissisme des petites différences". Ce cafouillage multi-identitaire aboutit à une perte de confiance dans le savoir, les repères cognitifs, à la destruction du magistère rationnel auquel se substitue l'enthousiasme mystico-politique, qui fait le lit des démagogues et des demi-savants.» (p. 37)
Kepel convie donc ses lecteur à penser plus loin que l'opération Déluge d'al-Aqsa, nom donné par le Hamas au massacre impitoyable des Juifs du 7 octobre 2023. La réplique israélienne, ordonnée par le gouvernement Netanyahou et qui a pour résultat l'invasion et la destruction manu militari de la bande de Gaza et de ses habitants palestiniens par une force sans précédent, a entraîné une reconsidération du monde comme il ne s'en était pas produite depuis la chute du Bloc soviétique. Même les événements du 11 septembre 2001 – la Double razzia bénie selon le nom donné à l'opération par Oussama ben Laden -, n'a pas eu l'effet de bascule que la razzia du 7 octobre a entraîné. Comment cela?
Il faut d'abord retenir le rôle déterminant joué par les réseaux sociaux dans la transmission des événements : «...la connaissance de ce drame est éparpillée par sa diffraction instantanée à travers les myriades d'images qui déferlent sur les écrans connectés, oblitérant toute mémoire, inhibant toute mise en perspective. Ce phénomène est inédit à pareille ampleur et a eu pour conséquence la première mobilisation politique mondiale inspirée par des réseaux sociaux, eux-mêmes générateurs d'infox – ou de fake news. Contrairement à la "double razzia bénie" du 11 septembre 2001, qui appartenait à l'époque cathodique finissante des télévisions satellitaires et trouva son écho, au premier chef, sur la chaîne quatarie Al Jazeera, la razzia progromiste du 7 octobre 2023 s'inscrit dans l'ère numérique qu'inaugura la licence d'exploitation de You Tube obtenue en Californie le 14 février 2005. Daech en exacerba l'usage monstrueux durant la décennie suivante, en diffusant les vidéos du supplice infligé à ses prisonniers et otages. La prolifération d'images de massacre filmées en temps réel par les quelque 3 000 jihadistes des brigades Ezzedine al-Qassam ayant franchi la frontière israélienne le 7 Octobre et relayées à l'infini sur les téléphones de la planète, en a constitué la "légende dorée" chez ses sympathisants potentiels, tout en suscitant la panique de leurs adversaires et l'effroi du commun des mortels.» (pp. 20-21)
Alors que l'effondrement des tours jumelles évoquait un massacre plutôt «abstrait», les massacres du 7 octobre 2023 donnaient à voir la manière dont les terroristes massacraient leurs victimes. Les opérations médiatiques de Daech y étaient multipliées à l'infini. En Occident, le moment de sympathie a duré le temps que vienne la réplique :
«Par la suite, l'offensive de Tsahal sur la bande de Gaza a ipso facto transformé les victimes en bourreaux. Par le même truchement des réseaux sociaux, les images de bombardements, de cadavres ensanglantés, écrasés sous le béton, de populations fuyant dans des conditions apocalyptiques, ont saturé la Toile. Certes, ni les pilotes ni les artilleurs israéliens n'éventraient personne de leurs mains, mais l'ampleur des massacres dépassa rapidement le nombre des victimes de la razzia, le multipliant par vingt en quelques semaines. Bien sûr, de fausses nouvelles ont proliféré, et le décompte des morts, venant d'un "ministère de la Santé du Hamas" qui les présentait tous comme des civils, a été discuté. Pourtant, faute d'alternative, il a constitué in fine la source de référence mondiale pour les journalistes interdits d'accès à la bande de Gaza.» (pp. 21-22) Du coup, on oubliait le massacre du 7 octobre et chaque jour nous ramenait de nouvelles images de bombardements étendus à des écoles et des hôpitaux.
Et c'est dans ce contraste entre l'hypermnésie et l'oubli que se serait effectué, selon Kepel, le bouleversement du monde : «En tout état de cause, un principe médiatique de réalité, quelles que fussent les exagérations ou manipulations de l'information par les parties en conflit, s'est rapidement imposé : la culpabilité d'Israël était prouvée par le nombre disproportionné de victimes palestiniennes et la puissance de son armée. D'autant plus que celle-ci incarnait le fort contre le faible, les chasseurs-bombardiers F-16 et les chars Merkava contre des carrioles à traction animale chargées de matelas où se juchaient des enfants effarés. Ces images structurèrent un grand récit normatif qui conquit les cœurs et les esprits les plus expressifs de la jeunesse euro-américaine, et ouvrit une faille éthique au sein de l'Occident d'hier, recodé en "Nord" d'aujourd'hui.» (p. 22)
Qu'est-ce qui a exactement basculé après ces premiers mois du conflit israélo-hamas? À la vision du monde qui avait suivi aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale opposant l'Est et l'Ouest (le bloc soviétique et l'Occident) succédait un rebalancement nord-sud où l'Occident se voyait étendu à toute la zone septentrionale du globe, alors que la Russie et la Chine se voyaient intégrés au bloc dit du «Sud Global», représenté par le BRICS+ (Organisation internationale constituée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et du South Africa rejointe par d'autres pays africains et arabes), acronyme inventé en 2001 par Jim O'Neill, économiste britannique de la Goldman Sachs. À la suite du 7 octobre 2023 :
«...en termes géopolitiques, cela se traduisit par la rotation, d'un quart de tour vers la droite, des points cardinaux à qui on avait conféré depuis 1945 une signification allégorique. L'Ouest devint ainsi le Nord, face auquel se substitua à l'Est le Sud – ce dernier flanqué de l'épithète "global" pour marquer sa prétention à détrôner le ci-devant Occident – désormais déplacé dans l'obscurité du Septentrion – comme pourvoyeur des normes éthiques universelles. Cette rotation à prétention "copernicienne" n'en constituait pas pour autant une révolution éthique : le "Sud" nouvelle manière masquait, derrière la défense des populations défavorisées des damnés de la terre méridionale, les régimes autoritaires et corrompus portant une lourde responsabilité dans la misère de leurs sujets... Quant au Nord, défini désormais négativement dans une polarisation moralement antithétique, on observera... comment il serait à son tour subjugué symboliquement par Donald Trump le 20 janvier 2025.» (pp. 10-11)
Cette abstraction économiste du «Sud Global» trouvait désormais un effet miroir qui, opposant aux peuples de l'ancien Tiers-Monde, un ennemi concret dans Israël. Une économie mondiale de haine prit racine, autant parmi les peuples qui pouvaient s'identifier aux Gazaouis que parmi les campus des collèges universitaires euro-américains : «À la fin de l'automne 2023, à la suite des bombardements de Gaza en représailles à la razzia du 7 Octobre, Israël, désormais qualifié de génocidaire par ses adversaires, se voit disqualifié dans les arènes internationales par ce terme même qui avait présidé, trois quarts de siècle auparavant, à sa création par l'ONU. L'opprobre se propage aux gouvernements vilipendés du "Nord" qui soutiennent le droit de cet État à exister, même s'ils ne ménagent pas leurs critiques à l'encontre de Benyamin Netanyahou. Ces derniers sont renvoyés par nos doctrinaires à leur propre péché originel : l'expansion coloniale européenne interprétée comme un holocauste, lequel se substitue désormais à l'extermination des Juifs par les nazis comme principe radical du mal universel. (pp. 18-19). Israël devenait le dernier État colonisateur de l'Ouest sur l'ensemble des peuples qui avaient subi par le passé le joug des grands empires occidentaux.
Certes, il existait une représentation sociale Nord-Sud depuis la fin du XXe siècle, mais elle ne s'incarnait pas dans une opposition immédiate aussi forte que celle suggérée à partir de la fin de 2023. C'est alors que «le soutien à l'existence d'Israël et à son droit à se défendre est constitutif de l'identité de l'Occident contemporain, comme en ont éloquemment témoigné les multiples condamnations du pogrom du 7 Octobre par les États concernés. Or, une incrimination par la Cour internationale de justice ouvrirait la voie à ce que soient substitués à la Shoah, comme paradigme du génocide, les massacres commis par la colonisation européenne sous toutes ses formes – dont l'hécatombe de Gaza serait l'aboutissement.» (pp. 112-113) En octroyant à la population gazaouie la victimisation d'un génocide, les idéologues du Sud global profanaient une exclusivité propre à la population juive. Les victimes d'hier devenant les bourreaux d'aujourd'hui se dépouillaient de ce qui avait été la reconnaissance séculaire à l'origine de la création de l'État d'Israël.
Kepel discute de cette notion juridique née dans la foulée de la Shoah. À la notion de génocide créée en 1943 par un juif de Galicie, Raphaël Lemkin (1900-1959), pour désigner le massacre des Arméniens par les Turcs en 1915 (1,2 million de morts pour raison religieuse), le terme fut immédiatement appliqué à la Shoah en 1946 : «Sa destruction ne passe pas seulement par le meurtre des membres, mais aussi par la volonté des exterminateurs de liquider l'identité socio-culturelle du "groupe" concerné, sa langue, sa religion, et de l'éradiquer de son territoire ancestral»... «Toutefois, lors du procès de Nuremberg en 1947, où comparurent puis furent condamnés et exécutés des dignitaires nazis, la notion de "crime contre l'humanité" – également pensée par un juriste juif de Galicie, Hersch Lauterpacht (1897-1960), par la suite naturalisé britannique, et qui serait l'un des premiers juges à la Cour internationale de justice – fut préférée à celle de "génocide". La controverse, qui est tombée dans l'oubli, entre les deux légistes issus dans les années 1920 de la faculté de Lemberg, et dont les familles respectives demeurées sur place seraient exterminées par la Shoah, retrouve une extraordinaire actualité avec l'action intentée par l'Afrique du Sud contre Israël à la CIJ en janvier 2024.» (pp. 115-116) C'est ainsi qu'un pays du BRICS entendait porter le coup fatal à l'orgueil sioniste.
Cette opération judiciaire ne signifiait rien de particulièrement concret sur le terrain et Netanyahou pouvait continuer à se promener librement dans les grandes capitales occidentales, ni Israël ni les États-Unis n'ayant signé le traité de Rome qui définit les crimes internationaux. Par contre, un germe était semé dans la conscience occidentale, tant «l'"axe de la résistance" iranien-chiite, a non seulement infligé à l'État hébreu le choc militaire et existentiel le plus grave depuis la proclamation de son existence en 1948, mais aussi profondément fracturé de l'intérieur l'hégémonie de "l'Occident" avec une ampleur inédite. Celui-ci s'est vu diabolisé par ricochet et qualifié dans la foulée, par une partie de sa propre jeunesse, de "Nord" haïssable auquel s'opposait la coalition vertueuse du "Sud Global".» (p. 17) Du coup, «Israël, réduit à la somme de ses péchés, symbolise ce "Nord" dont il illustrerait l'abjection. Gaza figure, dans cette refondation morale, la souffrance par excellence, et devient l'expression contemporaine d'un "génocide" infligé au Sud par le Nord.» Dès lors, les bombardements qui ravagent la bande de Gaza «se voient symboliquement interprétés comme l'aboutissement de la colonisation européenne, de la traite négrière et de l'esclavage. Dans ce métarécit, la razzia perpétrée par le Hamas est opportunément éludée.» (p. 18)
 On
voit que «les
événements du 7 Octobre et leurs suites ont ainsi précipité un
bouleversement du monde qui pousse ses racines dans la longue durée
d'une histoire dont la mémoire est convoquée pour justifier les
conflits qui déterminent le présent et le proche avenir du monde
contemporain tout en fracturant nos sociétés selon des lignes de
faille inédites.» (p.
216). Pour les jeunesses occidentales, trop souvent menées par les
wokes qui veulent en découdre avec le patriarcat blanc; ceux qui,
selon Kepel, «sacralisent
rétrospectivement l'histoire pour la subordonner à leur hypermnésie
mystique, les jeunes manifestants qui entonnent leur slogan sur les
campus euro-américains n'ont de la géographie et de la chronologie
– fût-elle la plus récente – qu'une connaissance désormais
aplatie par la déferlante idéologique.»
(pp. 19-20). C'est ainsi qu'en dénonçant l'esclavagisme d'antan, le
colonialisme des grands empires, la racialisation dans les pays
occidentaux, ces wokes, s'appropriant la gauche traditionnelle et en
évinçant ses paradigmes sociaux traditionnels, trouvèrent dans le
pilonnage de la bande de Gaza l'actualisation de l'opposition
ontologique du «Sud Global» au Nord.
On
voit que «les
événements du 7 Octobre et leurs suites ont ainsi précipité un
bouleversement du monde qui pousse ses racines dans la longue durée
d'une histoire dont la mémoire est convoquée pour justifier les
conflits qui déterminent le présent et le proche avenir du monde
contemporain tout en fracturant nos sociétés selon des lignes de
faille inédites.» (p.
216). Pour les jeunesses occidentales, trop souvent menées par les
wokes qui veulent en découdre avec le patriarcat blanc; ceux qui,
selon Kepel, «sacralisent
rétrospectivement l'histoire pour la subordonner à leur hypermnésie
mystique, les jeunes manifestants qui entonnent leur slogan sur les
campus euro-américains n'ont de la géographie et de la chronologie
– fût-elle la plus récente – qu'une connaissance désormais
aplatie par la déferlante idéologique.»
(pp. 19-20). C'est ainsi qu'en dénonçant l'esclavagisme d'antan, le
colonialisme des grands empires, la racialisation dans les pays
occidentaux, ces wokes, s'appropriant la gauche traditionnelle et en
évinçant ses paradigmes sociaux traditionnels, trouvèrent dans le
pilonnage de la bande de Gaza l'actualisation de l'opposition
ontologique du «Sud Global» au Nord.
Aussi, les nations occidentales en sont-elles venues à souffrir de ce bouleversement épistémologique et ontologique. Autant en Amérique qu'en Europe, «l'expression anxiogène du "déferlement migratoire" s'est répandue notamment parmi les populations modestes qui y sont directement confrontées dans leurs quartiers d'habitation, dont les conditions se dégradent, et sur le marché du travail non qualifié où les salaires sont poussés à la baisse par les nouveaux arrivants. Elle s'est traduite électoralement par un transfert massif du vote populaire, autrefois communiste ou socialiste en Europe et démocrate aux États-Unis, vers les partis de droite radicale nationalistes. Sur le Vieux Continent, cela s'est prolongé par l'érosion des formations de centre gauche ou centre droit institutionnels au profit du Rassemblement national en France, de l'AfD en Allemagne, de Reform UK au Royaume-Uni, une tendance que l'on retrouve de la Scandinavie et du Benelux à l'Italie en passant par l'Autriche et la Hongrie notamment, trois États où l'extrême droite dirige les coalitions gouvernementales. Aux États-Unis, l'idéologie nationaliste MAGA (Make America Great Again) conçue et formulée par Donald Trump a submergé le parti républicain conservateur traditionnel, puis a remporté les suffrages des Américains blancs et désormais latinos, en martelant sans cesse ses slogans, en 2016 et plus encore en 2024. Le candidat accusa des immigrés haïtiens de manger les animaux domestiques, annonçant que la plus grande déportation (expulsion) de migrants illégaux de tous les temps se déroulerait dès les débuts de son mandat.» (pp. 296-297).
«En Europe, l'exacerbation des revendications "décoloniales" relayées par l'improbable coalition du "Sud Global", est focalisée sur l'imputation de génocide perpétré contre les Palestiniens de Gaza par Israël pour relativiser la Shoah comme principe structurant du Mal et du Crime contre l'Humanité, tel qu'établit dans la seconde moitié du XXe siècle. Lui est substituée désormais la colonisation. L'hécatombe de Gaza s'inscrit dans cette perspective, en tant qu'aboutissement contemporain le plus monstrueux des massacres liés à celle-ci, l'État hébreu étant considéré comme ultime entité coloniale de la planète. Ce recodage moral anachronique de l'Histoire fait de la colonisation et des tueries l'accompagnant la définition ontologique et rétrospective de l'Europe et de l'Occident. Elle en exonère en revanche l'expansion de l'islam par le jihad comme sa pratique de l'esclavage, car cette civilisation est à l'inverse définie en termes laudateurs et émancipateurs. Pareille logique aboutit à la culpabilisation globale des États européens ex-coloniaux assimilés à l'Israël "génocidaire" de M. Netanyahou, d'autant que ceux-ci ont d'emblée reconnu le droit de l'État hébreu à se défendre après le choc du 7 Octobre. Plus encore, elle fait des populations musulmanes immigrées récemment en Europe un nouveau prolétariat exploité et rédempteur de l'humanité, tandis qu'une partie croissante de la classe ouvrière "de souche" a basculé du vote communiste vers l'extrême droite nationaliste par hantise du "déferlement migratoire". Il s'est substitué à ce marxisme historique, laïque et athée, qui faisait du "matérialisme dialectique" le moteur de l'Histoire, une mouvance "islamo-gauchiste" pour laquelle le wokisme avec son cortège d'anathèmes sert de substitut culturel et "racisé" à la lutte des classes d'antan.» (pp. 298-299)
Ce dualisme manichéen ne renvoie évidemment à aucune réalité. Le «Sud Global» est aussi improbable qu'un Occident cimenté derrière Israël. Car à quel autre État s'adresse-t-on «en reconnaissant son droit à se défendre»? Même l'Ukraine n'a pas droit à une telle formule. Que signifie-t-elle sinon qu'en plus d'un demi-siècle, la puissance légale d'Israël n'a pas réussi, aux yeux des autres États occidentaux, à fonder sa légitimité. Si Israël est né de l'activisme sioniste, c'est par la reconnaissance des membres de l'ONU, en 1948, qu'il doit son existence étatique. Depuis la réplique israélienne meurtrière dans la bande de Gaza, jamais le soutien à Israël s'est fait aussi peu fraternel en Occident. Il faut croire que si les États-Unis bombardent les sites nucléaires iraniens ou font la guerre aux Houtis du Yémen, c'est bien pour libérer les voies de navigation en Mer Rouge comme il faut assurer le libre passage des pétroliers au détroit d'Ormuz. Si, du temps de la guerre froide, Israël a servi de tête de pont de l'Occident au Moyen Orient, les négociateurs américains ou européens ont toujours préféré s'entendre immédiatement avec les puissances arabes, la corruption étant une meilleur arme de combat que n'importe quelle kalashnikov.
La conclusion de Kepel rejoint la vieille interprétation d'Arnold Toynbee qui voyait la fin de la civilisation subvertie par deux forces convergentes : le prolétariat externe, qui envie les bienfaits de la civilisation et le prolétariat interne, fait de ceux qui ont infiltré et pratiquent la subversion (tel le christianisme dans l'empire romain) joint à la population misérable en déroute de l'État universel. C'est ainsi que les Européens voient ce que Zemmour, de l'extrême droite, appelle le «Grand Remplacement». Nous pouvons ironiser de cette anxiété, mais la menace demeure bien réelle pour une partie de ce prolétariat interne qui se sent menacé par les intrus et qui n'obtient pas le support de ses propres États. Le fascisme, essentiellement anti-bolchevique et anti-démocratique du XXe siècle, luttait contre la pénétration des idées bolcheviques et du communisme. Cette menace nous apparaît plutôt fantasmatique, considérant le peu de succès qu'obtenaient les idées de Marx et de Lénine parmi les populations occidentales. Par contre, ces individus, émigrés ou réfugiés du «Sud Global», sont bien présents et les ancrages du terrorisme des années Daech ont démontré qu'ils ne sont pas seulement fantasmatique. Il est enfin incontestable que les excentricités toxiques du wokisme ont cultivé la montée d'une autre toxicité, celle des extrêmes droites en Europe et des MAGA de Donald Trump, comme si une toxicité alternative pouvait nous immuniser de l'autre. Assaillie de toute part, la civilisation occidentale est à son crépuscule. Bientôt, la chouette s'envolera pour un monde espérons-le meilleur.
* Le bouleversement du monde L'après le 7 octobre a fait l'objet d'une critique reproduite dans l'article : Mes lectures historiographiques (juillet-décembre 2024).
** Cette hostilité à l'élaboration des grands récits a été désignée depuis Jean-François Lyotard comme une caractéristique essentielle de la postmodernité. Par l'influence que la French Theory exerce sur les wokes américains, paraphrasant Lénine, nous pouvons affirmer que le wokisme est le stade suprême du postmodernisme.























































































